Compte Rendu Bureau 17 07 13
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 48 LOZERE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 48 - LOZERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 48-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 48-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 48-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 48-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -
Plaquette 2019 / 2020 De L'edml
Ecole Départementale de Musique de Lozère 2019 2020 Conservatoire à rayonnement intercommunal Artistiquement vôtre ! Plus de 800 élèves, enfants à partir de 5 ans, adolescents, adultes, 37 enseignants et interve - nants, 11 antennes sur le département, plus de 20 disciplines proposées, de l’éveil, des orches - tres, des ateliers, de la musique classique, contemporaine, des musiques actuelles, rock, jazz, de la musique traditionnelle, de la chanson, de la création par ordinateur, l’éducation artis - tique et culturelle en milieu scolaire et en sec - teur social en musique, danse et théâtre, un orchestre à l’école au collège de Sainte-Enimie, des concerts, des spectacles, des rencontres avec des artistes… Voici en quelques mots la carte d’identité de l’Ecole Départementale de Musique de Lozère en 2019, chargée d’une mission culturelle et ter - ritoriale. Débutants ou confirmés, vous trouverez nécessairement au Conservatoire la formation et les pratiques que vous recherchez et qui cor - respondent à vos attentes, vous participerez aux activités de diffusion, ou bénéficierez de l’ac - compagnement des pratiques amateur, ou peut-être pourrez-vous utiliser les studios de répétition avec votre groupe. Bonne lecture. Les disciplines enseignées : Bois : Musiques Flûte traversière, traditionnelles : Clarinette, Accordéon diatonique, Saxophone. Cabrette. Cuivres : Eveil musical Trompette/Cornet, (5 – 6 ans) Cor, Trombone, Formation musicale Tuba. (à partir de 7 ans) Cordes : Ensembles, Orchestres, Violon, Musique de chambre Violoncelle. Ateliers : Instruments Musique polyphoniques : traditionnelle, Piano, Jazz, Rock, Pop, Orgue, Chansons, Guitare. Création sonore (MAO). Voix : Chant, Chorales enfants Technique vocale. et adultes Musiques Interventions en actuelles : milieu scolaire : Guitare électrique, Musique, Danse Basse, et Théâtre. -

Portrait De Territoire Detaille
PORTRAIT DE TERRITOIRE DETAILLE Communauté de communes n°3 réunissant les communes de : Arzenc-de-Randon, Chastel-Nouvel, Châteauneuf-de-Randon, Chaudeyrac, Estables, Grandrieu, Lachamp, Les Laubies, La Panouse, Pierrefiche, Ribennes, Rieutort-de-Randon, Saint-Amans, Saint-Denis-en-Margeride, Saint-Gal, Saint-Jean-la-Fouillouse, Saint-Paul-le-Froid, Saint-Sauveur- de-Ginestoux, Servières, La Villedieu Réunion de présentation du mardi 6 décembre 2016 à Pierrefiche Table des matières ::: I- Situation géographique ................................................................................................................................ 3 II – Démographie ............................................................................................................................................. 4 III- Focus sur les ménages du territoire et les revenus fiscaux ........................................................................ 7 IV- Construction et aménagement du territoire ............................................................................................ 11 V- Emploi et entreprises du territoire ........................................................................................................... 13 VI - Synthèse – Chiffres clés et comparaison avec le Département .............................................................. 17 VII- Atouts du territoire : les enjeux de demain ............................................................................................ 18 CCI48/MR Page 2 sur 18 Portrait n°3 du 6/12/16 -

Lieux Emplacements Affichage
L O Z E R E EMPLACEMENTS d'affichage - 2015/2016 ALBARET LE COMTAL 1 Place de l'église ALBARET SAINTE MARIE 1 Mairie - La Garde ALLENC 2 Parking de la mairie Le Puech ALTIER 1 Parking mairie ANTRENAS 1 Village ARZENC D'APCHER 1 A côté mairie ARZENC DE RANDON 1 en bordure de la mairie AUMONT-AUBRAC 1 Place du Foirail AUROUX 1 Place du village BADAROUX 1 Place de la Mairie - Rue de l'Egalité BAGNOLS LES BAINS 1 Place de la poste BALSIEGES 1 Route de FLORAC ( A gauche maison forestière d'Ausset) BANASSAC 2 Place de l'église ST MEDARD Le Ségala BARJAC 1 Grand-Place BARRE DES CEVENNES 2 Place de la Loue La Croisette BASSURELS 1 Place du village BASTIDE PUYLAURENT (LA) 1 Place de l'église BEDOUES 2 Mairie - Place de l'école parking Salle des fêtes BELVEZET 1 Mairie BESSONS (LES) 1 Place de la mairie BLAVIGNAC 1 Mairie BLEYMARD (LE) 1 Place de l'église BONDONS (LES) 1 Village BORN (LE) 1 La Chape - Village BRENOUX 1 Mairie BRION 1 Place du village BUISSON (LE) 1 A côté de la salle des fêtes CANILHAC 1 place du Village CANOURGUE (LA) 4 Près mairie Canourgue - Place du pré commun Près mairie d'Auxillac - Place de l'Eglise Près mairie La Capelle Près mairie Montjézieu CASSAGNAS 1 Mairie - Village CHADENET 1 Place de l'Eglise CHAMBON LE CHÂTEAU 1 Place du village CHANAC 2 Quartier La Vignogue Place de la Bascule CHASSERADES 1 D6 CHASTANIER 1 Mairie CHASTEL NOUVEL 1 place de la mairie CHATEAUNEUF DE RANDON 1 Place Du Guesclin CHAUCHAILLES 1 devant la mairie CHAUDEYRAC 1 Mairie CHAULHAC 1 Cour Mairie CHAZE DE PEYRE (LA) 1 Mairie CHEYLARD L'EVEQUE -
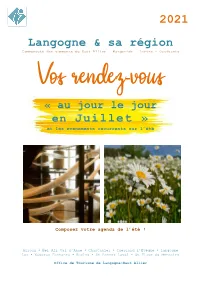
Vos Rendez-Vous Du Mois De Juillet 2021
2021 Langogne & sa région Communauté des communes du Haut Allier – Margeride – Lozère - Occitanie Vos rendez-vous « au jour le jour en Juillet » et les événements récurrents sur l’été Composez votre agenda de l’été ! Auroux Bel Air Val d’Ance Chastanier Cheylard l’Evêque Langogne Luc Naussac Fontanes Rocles St Bonnet Laval St Flour du Mercoire Office de Tourisme de Langogne–Haut Allier Vendredi 2 Concert Lisons ensemble Avec Clément Gauthier… Atelier animé par Isabelle de l'association Contelicots. Dans ce concert solo Pour les enfants de 3 jours à 3 ans accompagnés de nous passerons de la canso, grand chant leurs parents, grands-parents, nounous, assistants d’amour mystique des troubadours à la familiaux, etc. complainte, pour donner à entendre Gratuit / Sur réservation 04 66 69 27 65. quelques-unes des formes de la poésie orale 10h / Bibliothèque du Haut-Allier / LANGOGNE classique et traditionnelle occitane. Musiques traditionnelles d’aujourd’hui… Concerts 10 € / Sur réservation 06 82 97 77 35 / Tête de Block. Mégaphone Tour Festival 16h / Roc de Fenestre / GRANDRIEU Découvrez trois artistes de la nouvelle scène française : Dimoné + Rovski + L'Animal Exquis. Dimanche 4 Dans le cadre de Festiv’Allier la saison ! 12€ adultes / 10€ adultes réduits / 6€ enfants. Balade En chemin j’ai rencontré… Sur réservation Office de Tourisme « Le pays de la bête du Gévaudan » 20h30 / Salle des Fêtes / ROCLES Proposée par les Foyers Ruraux de Chaudeyrac et de Rocles et la Fédération des Foyers Ruraux de Lozère Vendredi 2 au dimanche 4 8h30 à 17h / Repas tiré du sac. Sur réservation : 04 66 46 27 57 ou 06 70 11 87 79. -

Le Grand Lac De Naussac
LE GRAND LAC DE NAUSSAC LANGOGNE ET SA RÉGION Communauté de communes du Haut Allier - Margeride - Lozère JUILLET / AOUT É T VOS É 2 RENDEZ 0 1 VOUS 9 SEPTEMBRE Auroux / Bel Air Val d’Ance / Chastanier / Cheylard l’Evêque / Langogne / Luc / Naussac -Fontanes / Rocles / St Bonnet-Laval / St Flour de Mercoire 2 Vos rendez-vous de JUILLET Jeudi 4 Mardi 9 CONFERENCE « Le camisard MARDI NATURE LANGOGNE CHASTANIER de la désespérance » 20h 16h à 18h30 La genèse d’un roman historique de « En Quête de Rapaces » Balade terroir sur la guerre des camisards. commentée par un guide naturaliste. De la documentation et de la vérité Plusieurs rendez-vous sur la Margeride historique à la fiction ou comment demandez le programme ! écrire une histoire sans défigurer le 10 € / 5 €. patrimoine historique. Réservation obligatoire auprès de l’ Animée par Alain GURLY. Office de Tourisme 04 66 69 01 38. Proposée par Les Amis du Patrimoine. INITIATION ASTRONOMIE 2 €. CHASTANIER - Salle au 1er étage de la Mairie - 21h à 23h30 A la découverte des diamants de notre Vendredi 5 ciel. Observation commentée. 15 € / 7 € LISONS ENSEMBLE Réservation obligatoire LANGOGNE 9h30 et 10h Office de Tourisme 04 66 69 01 38. Dans le cadre de 1ère page, ateliers Du Mercredi 10 au Vendredi 12 gratuits avec l’association Contelicot STAGE DE TISSAGE pour les enfants de – de 3 ans et leurs LANGOGNE parents. Sur inscription : 04 66 69 27 65 De 14h30 à 16h - Bibliothèque - C’est tout nouveau : venez-vous initier à l’art du tissage sur métier à tisser, Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avec une tisserande professionnelle. -

Juillet 2021 En Coeur Margeride
Vos rendez-vous de JUILLET 2021 Châteauneuf de Randon – Grandrieu – Rieutort de Ran Arzenc de Randon - Le Chastel Nouvel - Châteauneuf don & les alentours de Randon - Chaudeyrac - Estables – Grandrieu - Lac bies - La Panouse – Pierrefiche - Ribennes - Rieuto hamp – Les Lau- rt de Randon – St Amans - St Denis en Margeride - S St Jean La Fouillouse - St Paul Le Froid - St Sauve t Gal ur de Ginestoux - Servières - La Villedieu … SENTIER DES CRÉATEURS Quand vous voulez, Envie d’une balade insolite, d’une escapade culturelle à Grandrieu ? Du1 er juillet A votre rythme. Envie de vous faire surprendre, au détour d'une ruelle, d'une fontaine, GRANDRIEU Plan de visite à l’OT au15sept. sur des balcons, dans des vitrines délaissées par des œuvres d’art de Grandrieu/église étonnantes ? CONCERT MUSIQUE TRADITIONNELLE ROC DE FENESTRE 16h/10 € Clément Gauthier (chant/cabrette) évolue dans les musiques traditionnelles Samedi3 LA PANOUSE Tête de Block d'aujourd'hui ... MARCHE GOURMANDE 17h STADE DE 10 k + Circuit adapté aux enfants - Inscription jusqu'au 27 juin : 06 75 00 73 15€/ adulte - Samedi3 L'HABITARELLE 17 06 81 23 98 91 - Départ de la salle du 1000Club 7€/enfant (-12ans) 16h30/19h SORTIE NATURE CRIS & CHANTS DES OISEAUX CHASTANIER 12€/- 7 ans gratuit/ Mardi6 Pourquoi les oiseaux chantent ? enfant 7 € INITIATION A L'ASTRONOMIE 21h/23h30 Mardi6 Partons découvrir les étoiles, nos planètes du système solaire, notre galaxie CHASTANIER 15€/- 7 ans gratuit/ spirale, nos principales constellations … enfant 8 € TRAIN CÉVENOL 150 ANS :JOURNEE D'INAUGURATION DES FESTIVITES A partir de 10h45 Cérémonie et inauguration de la stèle commémorative en présence de la Lyre Place de la Gare. -

Profil Santé Haut Allier
Profil Santé Contrat Local de Santé Haut Allier POPULATION ET TERRITOIRE - DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ - DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX DE SANTÉ - ÉTAT DE SANTÉ ET PROBLÈMES DE SANTÉ - ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS - OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS - PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DE DÉPENDANCE 2018 AVANT-PROPOS Le profil santé du CLS du Haut-Allier rassemble les principales données quanti- tatives disponibles qui permettent de dégager certaines caractéristiques so- ciales et sanitaires, ainsi que celles de l’offre de soins et de services de ce terri- toire. Les données et indicateurs mobilisés sont présentés pour l’ensemble du terri- toire. Les indicateurs sont référés à la situation observée sur l’ensemble du dé- partement ou de la région ou au niveau national. Ce dossier s’organise autour de plusieurs chapitres : – les caractéristiques de la population et du territoire – les déterminants sociaux de santé – les déterminants environnementaux de santé – l’état de santé et les problèmes de santé – la santé des enfants et des jeunes – les comportements de santé en Occitanie – l’accès à la prévention et aux soins – l’offre de soins de premier recours – les personnes en situation de handicap et de dépendance Ces éléments doivent servir de support à un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs et des professionnels intervenant sur ce territoire afin de détermi- ner un projet de santé adapté aux spécificités locales. Nota bene : sauf indication contraire, les données et indicateurs présentés dans ce profil de santé correspondent au territoire de la communauté de communes du Haut Allier auquel s’ajoute la commune de Grandrieu, commune qui devrait intégrer le CLS du Haut-Allier au 01/01/2019. -

Le Sentier Des Fées 3,5KM 13
Communauté de Communes du Haut Allier Rando Lozère Fiche® Terre de randonnées ® 1H30 PR Le Sentier des Fées 3,5KM 13 Entrez dans la forêt de Mercoire, terre de légendes… Laissez-vous guider sur Le Sentier des Fées, « Ron de las Fades »… Cheminez parmi les chaos granitiques, sentinelles de Margeride, peuplées de fées forestières… 11 1 8 SITUATION Code de balisage PR® 12 Saint-Flour-de-Mercoire, à 5,5 km au sud-ouest de 1 110 m Langogne par la N 88 FFRandonnée Bonne direction PARKING 50 m 5 Le Puy-en-Velay aire de pique-nique en bordure de la N 88, 1 080 m Changement Aubenas sur la gauche de la route, 900 m après l’embranchement Dénivelée positive de direction qui mène à Saint-Flour-de-Mercoire © marques déposées Mauvaise direction 7 N 44.693474° E 3.815096° À DÉCOUVRIR EN CHEMIN i Office de tourisme • aire de pique-nique • chaos granitiques • sapin de 4 • OT de Langogne : +33 (0)4 66 69 01 38, Stevenson • points de vues www.ot-langogne.com 15 randonnées 9 RandoFiches téléchargeables À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION • barrage et lac de Naussac • Langogne : parcours e FFRANDONNÉE 1 Les balcons du lac (Fontanes) : 5 km 2 historique de la ville, halle, église du XII siècle, filature des Calquières • Pradelles : un des plus beaux villages de • Comité Lozère : www.randonnee-lozere.fr 2 La croix Blanche (Rocles) : 8 km France 3 Circuit de l’Évêque (Cheylard-l’Évêque) : 6 km 14 BALISAGE 4 Circuit du Langouyrou (Langogne) : 8 km 15 jaune 48 5 Mende La croix de Parpaillon (Auroux) : 9 km Toulouse 6 Circuit du château (Luc) : 5,5 km 6 ANDONNÉE 3 FFR 7 -

Margeride (Siren : 200069102)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Randon - Margeride (Siren : 200069102) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Monts-de-Randon Arrondissement Mende Département Lozère Interdépartemental non Date de création Date de création 30/11/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Francis SAINT-LEGER Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Mairie Numéro et libellé dans la voie Village Distribution spéciale Code postal - Ville 48700 Rieutort-de-Randon Téléphone 04 66 47 33 31 Fax 04 66 47 39 98 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 5 457 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 10,71 Périmètre Nombre total de communes membres : 15 Dept Commune (N° SIREN) Population 48 Arzenc-de-Randon (214800088) 203 48 Chastel-Nouvel (214800427) 923 48 Châteauneuf-de-Randon (214800435) 546 48 Chaudeyrac (214800450) 310 48 Grandrieu (214800708) 767 48 Lachamp-Ribennes (200083335) 364 48 La Panouse (214801086) 77 48 Les Laubies (214800831) 157 48 Monts-de-Randon (200085223) 1 314 48 Pierrefiche (214801128) 169 48 Saint-Denis-en-Margeride (214801458) -

Langogne Nos Villages
1 2 3 4 10 11 12 13 Cartes et topo-guides LÉGENDE Langogne DES CARTES En vente dans les librairies locales : • aux éditions Chamina : Margeride et Gévaudan - Vallée et Gorges Camping de l’Allier - GR 70 Le Chemin de Stevenson Monts de la Margeride : guide nature Restauration Hébergement • aux éditions de la FFRP GR de Pays Tours en Margeride (Réf. 480) Activités Le Puy-enVelay GR 70 Le Chemin de Stevenson (Réf. 700) nautiques GR 700 Le Chemin de Régordane (Réf. 7000) a Communauté de Communes du Haut GR 4 des gorges de l’Ardèche à la Margeride (Réf. 407) L Allier, en Lozère, est constituée de neuf Kayak Possibilité de randonnées à thème avec des guides communes : Auroux, Chastanier, Cheylard accompa gnateurs du secteur. Locations de VTT sur place. l’Évêque, Fontanes, Langogne, Luc, Prestataires de Espace sport d’orientation : cartes Naussac, Rocles et Saint-Flour-de-Mercoire. randonnées en eaux vives (initiation, perfectionnement Langogne, gros bourg commerçant de et randonnée) en vente à 3200 âmes, est situé à 913 m d’altitude, Randonnées l’Office de Tourisme. au confluent de l’Allier et du Langouyrou, pédestres sur les hauts plateaux sud-est du Massif Central, aux portes du Gévaudan, du Vivarais et du Velay. Centre équestre Cité millénaire (998), Langogne offre une diversité de Prestataires commerces, de restaurations et d’hébergements. escalade C’est aussi une station verte de vacances avec une histoire riche que vous Terrain de golf pourrez découvrir avec le parcours historique. Musée Territoire étonnant alliant calme et détente, savoir-faire et savoir vivre, c’est VTT aussi un terrain exceptionnel pour les activités de pleine nature. -

Recueil Special N°26 Du 26 Juillet 2017
SOMMAIRE RECUEIL SPECIAL N° 26 /2017 du 26 juillet 2017 Préfecture de la Lozère AARRETE n° PREFBEPAR2017206-0003 du 25 juillet 2017 ÉLECTIONS SÉNATORIALES 2017 :TABLEAU MODIFICATIF DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX. 1 PRÉFET DE LA LOZÈRE PRÉFECTURE DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES Bureau des élections, des polices administratives et de la réglementation ARRETE n° PREFBEPAR2017206-0003 du 25 juillet 2017 ÉLECTIONS SÉNATORIALES 2017 ____ TABLEAU MODIFICATIF DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX ____ Le préfet, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite VU le Code Électoral, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU le décret n° 2017-1091 du 02 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, VU la circulaire n° NOR/INTA/INTA1717222C du 12 juin 2017 du Ministre de l’intérieur, relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement du tableau des électeurs sénatoriaux, VU l’arrêté n° PREFBEPAR2017187-0002 du 06 juillet 2017 établissant le tableau des électeurs sénatoriaux, VU les déférés préfectoraux en date du 10 juillet 2017, VU les jugements n° 1702070, 1702056, 1702092, 1702055, 1702064, 1702093, 1702094, 1702088, 1702082, 1702091, 1702095, 1702080, 1702086, 1702057, 1702085, 1702077, 1702076, 1702084, 1702083, 1702075, 1702130, 1702074, 1702060, 1702062, 1702124, 1702058, 1702078, 1702128, 1702073, 1702132, 1702072, 1702131, 1702071, 1702090, 1702089, 1702100, 1702129, 1702059, 1702127, 1702066, 1702114,