S'engage Pour Le Patrimoine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mise En Page
Annexe 1 Quincampoix-Quincampoix-Quincampoix- FleuzyFleuzyFleuzy Escles-Saint-Escles-Saint-Escles-Saint- Distribution d'eau potable PierrePierrePierre FouilloyFouilloyFouilloy Saint-ValerySaint-ValerySaint-Valery Saint-ValerySaint-ValerySaint-Valery GourchellesGourchellesGourchelles RomescampsRomescampsRomescamps Lannoy-Lannoy-Lannoy- RomescampsRomescampsRomescamps en gestion communale CuillèreCuillèreCuillère DaméraucourtDaméraucourtDaméraucourt DargiesDargiesDargies(( GolancourtGolancourtGolancourt AbancourtAbancourtAbancourt Saint-ThibaultSaint-ThibaultSaint-Thibault Gouy-les-Gouy-les-Gouy-les- Saint-ThibaultSaint-ThibaultSaint-Thibault OffoyOffoyOffoy Gouy-les-Gouy-les-Gouy-les- SolenteSolenteSolente ElencourtElencourtElencourt SolenteSolenteSolente ElencourtElencourtElencourt GroseillersGroseillersGroseillers Croissy-sur-CelleCroissy-sur-CelleCroissy-sur-Celle GroseillersGroseillersGroseillers Flavy-le-Flavy-le-Flavy-le- (( OgnollesOgnollesOgnolles Flavy-le-Flavy-le-Flavy-le- LaverrièreLaverrièreLaverrière OgnollesOgnollesOgnolles VilleselveVilleselveVilleselve (( MeldeuxMeldeuxMeldeux (( SarnoisSarnoisSarnois (( LibermontLibermontLibermont MeldeuxMeldeuxMeldeux LeLeLe Plessis- Plessis-Plessis- (( SarcusSarcusSarcus SarnoisSarnoisSarnois BeaudéduitBeaudéduitBeaudéduit Bonneuil-les-EauxBonneuil-les-EauxBonneuil-les-Eaux LeLeLe Plessis- Plessis-Plessis- (( LavacquerieLavacquerieLavacquerie (( Bonneuil-les-EauxBonneuil-les-EauxBonneuil-les-Eaux BlargiesBlargiesBlargies SommereuxSommereuxSommereux Patte-d'OiePatte-d'OiePatte-d'Oie (( -

Rapport D'activité Des Services
Rapport 2008 d’activité des services AVANT PROPOS C’est un exercice difficile que de retracer en quelques pages l’activité annuelle des services d’une collectivité. Le présent rapport n’a pas la prétention de recenser La Communauté de Communes du Pays de exhaustivement l’intégralité Valois est née le 1er janvier 1997 du regrou- de la charge des services pement de soixante-deux communes des de la CCPV mais seulement cantons de Betz, Crépy-en-Valois et l’essentiel, c’est à dire ce qui Nanteuil-le-Haudouin. est directement au service des communes et des habitants du Valois. Il ne fait pas état, par exemple, des Les instances de la CCPV * quelque 1 500 à 2 000 visites accueillies au siège de Le Conseil communautaire la CCPV dans l’année : des Organe délibérant de la CCPV, le Conseil communautaire décide de la réalisation des actions élus bien entendu, mais et opérations d’intérêt communautaire sur le territoire de la CCPV. Il est composé de cent- aussi, et de plus en plus, des un délégués, désignés par les conseils municipaux des communes membres. habitants en quête d’infor- Le Bureau communautaire mations. Il ne mentionne pas Composé du Président, des cinq Vice-présidents et de quinze Conseillers délégués, le Bureau fait des propositions au Conseil communautaire. Il est compétent pour délibérer par non plus les dizaines de délégation du Conseil communautaire. milliers d’appels téléphoni- ques réceptionnés, autant Le Président Elu par le Conseil communautaire pour la durée du mandat des Conseillers, il préside le de courriers décachetés et Conseil et le Bureau. -

Inventaire Des Mouvements De Terrain Et Cavités De L'arrondissement De
Inventaire des mouvements de terrain et cavités de l’arrondissement de Senlis (Oise) Rapport final BRGM/RP-56608-FR Octobre 2008 Inventaire des mouvements de terrain et cavités de l’arrondissement de Senlis Rapport final BRGM/RP-56608-FR Octobre 2008 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2008 PSP07PIC056 D. Moiriat, C. Nail, Y. Thuon Avec la collaboration d’A. Bertrand Vérificateur : Approbateur : Nom : Ch. MATHON Nom : M. AGUILLAUME Date : Date : Signature : Signature : (Ou Original signé par) (Ou Original signé par) Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. I Mots clés : inventaire, BDCavité, BDmvt mouvement de terrain, carrière souterraine, cavité souterraine, effondrement, affaissement, Senlis, Oise. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : D.Moiriat, C.Nail, Y.Thuon (2008) – Inventaire des mouvements de terrain et cavités de l’arrondissement de Senlis (Oise). Rapport final. BRGM/RP-56608-FR. 62 pages, 9 illustrations, 5 annexes. © BRGM, 2008, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Inventaire cavités et mouvements de terrain liés - Arrondissement Senlis Synthèse Suite à différentes études de recensement et d’analyse des mouvements de terrains, réalisées en 2002 et 2004 par le BRGM sur les arrondissements de Montdidier et Clermont-de-l’Oise puis Compiègne et Péronne, la DE de l’Oise a souhaité poursuivre la démarche à l’arrondissement de Senlis en l‘élargissant aux cavités souterraines. Cette étude a été financée par une subvention de la DDE de l’Oise et la dotation de Service Public du BRGM. -

Mairie De Crépy-En-Valois - Répertoire Des Archives Antérieures À 1790
Mairie de Crépy-en-Valois - Répertoire des archives antérieures à 1790 Sous Jour/mois Date Série Article Analyse Jour/mois fin Date fin série début début 1A1 Lois octobre 1790 décembre 1791 1A2 Lois janvier 1792 septembre 1792 1A3 Lois (en déficit) octobre 1792 messidor An III 1A4 thermido Lois An III fructidor An VI r 1A5 vendémi Lois An VII ventôse An VIII aire 2A1 Lettres patentes du roi sur des décrets de l'Assemblée nationale janvier 1790 octobre 1790 3A1 Proclamations du roi sur des décrets de l'Assemblée nationale 1790 1792 4A1 Discours prononcé par le roi à l'Assemblée naionale 4/02/ 1790 4/02/ 1790 4A2 Réponse du roi au discours que lui a adressé monsieur de Lafayette au nom et à la tête des députations de toutes les gardes 13/07/ 1790 13/07/ 1790 nationales du royaume 4A3 Lettres du roi aux Princes, ses frères, emmigrés, les priant de 16/10/ 1791 11/11/ 1791 rentrer en France 5A1 Arrêt du Conseil d'état du roi qui nomme le sieur Toussaint Auguste Pitet pour signer au lieu et place du sieur Laurent Blando, 7/08/ 1790 7/08/ 1790 en qualité de tireur, les assignats de deux cents livres 6A1 Extraits du procès verbal de l'Assemblée nationale 11/02/ 1790 30/04/ 1790 6A2 Pièces relatives à la fête de la fédération nationale juin 1790 juin 1790 7A1 Actes du corps législatif non sujets à la sanction du roi janvier 1792 août 1792 8A1 Exposition des motifs d'après lesquels l'Assemblée nationale a proclamé la convocation d'une convention nationale et prononcé 1792 1792 la suspension du pouvoir exécutif dans les mains du roi 9A1 Projet de décret sur le jugement de Louis XVI présenté à la Convention nationale par N. -

Inventaire Des Anciens Sites Industriels Et Activités De Service De Picardie, Volet Oise État D’Avancement Au 1Er Septembre 2003
Inventaire des anciens sites industriels et activités de service de Picardie, volet Oise État d’avancement au 1er septembre 2003 BRGM/RP-52523-FR octobre 2003 PICARDIE Inventaire des anciens sites industriels et activités de service de Picardie, volet Oise État d’avancement au 1er septembre 2003 BRGM/RP-52523-FR octobre 2003 Étude réalisée dans le cadre des opérations de Service public du BRGM 2002-POL-130 A. Wuilleumier Avec la collaboration de C. Nail, S. Cocu, J. Delcroix, M. M’Basse PICARDIE Inventaire des anciens sites industriels de l’Oise Mots clés : Inventaire, Sites industriels, Activités de service, Département de l’Oise. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Wuilleumier A., Nail C., Cocu S., Delcroix J., M’Basse M. (2003) – Inventaire des anciens sites industriels et activités de service de Picardie, volet Oise. État d’avancement au 1er septembre 2003. BRGM/RP-52523-FR, 56 p., 5 ann. © BRGM, 2003, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 2 BRGM/RP-52523-FR Inventaire des anciens sites industriels de l’Oise Synthèse ans le cadre du contrat de plan État-Région Picardie 2000-2006, il a été décidé de D réaliser l’opération d’inventaire des anciens sites industriels et activités de service dans le département de l’Oise. Lancée officiellement lors de la réunion de Comité de pilotage du 28 juin 2000, cette opération est financée par : - l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ; - l’ADEME ; - le BRGM ; - le Conseil régional de Picardie. L’opération se poursuit toujours au 1er septembre 2003. -
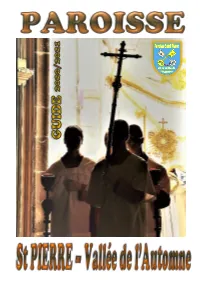
Guide-Paroissiale-2020-2021.Pdf
A partir du CE2, pour les enfants de 8 à 12 ans Catéchisme dans les villages, contacter Mme Geneviève FRENOIS (03 44 40 99 29) ou l’abbé FLAMANT Aumônerie pour les jeunes de la 5ème à la Terminale, contacter l’abbé FLAMANT (06 08 96 85 34) 20 septembre 2020 11h30 : Messe à VERBERIE, 11 octobre 2020 12h45 : Pique-nique tiré du sac, 13h40 : Enseignement et échanges, 15 novembre 2020 15h00 : Temps de prière, 13 décembre 2020 15h30 : fin de la rencontre. 17 janvier 2021 14 février 2021 14 mars 2021 9 mai 2021 Page internet : sur tout moteur de recherche : « Paroisse de la Vallée de l’Automne » L a p a r o i s s e VERBERIE MORIENVAL BÉTHISY St PIERRE ORROUY St SAUVEUR FRESNOY la R BÉTHISY St MARTIN GLAIGNES SAINTINES SÉRY-MAGNEVAL St VAAST de L GILOCOURT NÉRY BÉTHANCOURT en V IPNS « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » Jn.3,16. Presbytère : Place de l’église 60410 VERBERIE Curé : Abbé FLAMANT 06 08 96 85 34 [email protected] Diacre : Maison paroissiale : Roland GRUART 317, rue Jean Jaurès 137, rue de l’église 60320 BÉTHISY St PIERRE 60410 SAINTINES 03 44 39 70 35 03 44 85 55 67 03 44 85 55 67 Demandes de baptêmes et mariages Confessions – Tous renseignements A la maison paroissiale de BÉTHISY St PIERRE : - les mercredis de 17h30 à 19h, - les samedis de 9h à 11h. -

Syndicat D'aménagement Et De Gestion Des Eaux Du Bassin De L
Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne Rapport d'Activités 2015 © Daniel Prévot sageba Syndicat d’Aménagement et de Gestion Des Eaux du Bassin Automne - 1 sente de l'école 60127 Morienval Tél. : 03 44 88 49 48 www.bassin-automne.fr SOMMAIRE LE SAGEBA ________________________________________________________ 5 LE SAGE DE L’AUTOMNE ______________________________________________ 6 LE CONTRAT GLOBAL ________________________________________________ 7 LES ACTIONS DU SAGEBA EN 2015 ______________________________________ 8 I. Sur les ressources en eaux souterraines __________________________________ 8 I. 1) Etude « Connaissance des aquifères Lutétien et Yprésien supérieur (Cuisien) - Campagnes de mesures et cartes piézométriques basses-eaux et hautes-eaux dans le Bassin Parisien » _________ 8 I. 2) Le Bassin d’Alimentation de Captages (BAC) d’Auger-Saint-Vincent ____________________ 11 2) a) Le territoire ______________________________________________________________ 11 2) b) Actions engagées __________________________________________________________ 12 I. 3) Autres captages d’eau potable du bassin versant ___________________________________ 14 II. Sur les ressources en eaux superficielles _______________________________ 15 II. 1) Réseau de mesures de la qualité des affluents de l’Automne _______________________ 15 II. 2) Mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) ______ 17 2) a) Travaux de restauration et de continuité écologique du PPRE ____________________ 17 2) b) Typologie des -

Horaires Valables Du 01/09/2021 Au 07/07/2022 Etablissements De Crepy En Valois Etablissements De Crepy En Valois
ETABLISSEMENTS DE CREPY EN VALOIS ETABLISSEMENTS DE CREPY EN VALOIS 6441 6441Course accessible PMR – Pour garantir votre prise en charge en fauteuil roulant, merci d’informer préala- blement le transporteur au 03 44 87 30 00 Des modifications mineures pourront être faites sur lesHORAIRES horaires, merci VALABLES de vous rendre DU régulièrement 01/09/2021 sur AU 07/07/2022 VERSION SEPTEMBRE 2021 le site www.oise-mobilité.fr, rubrique Horaires RETOUR EN DIRECTION DE VERBERIE MERCREDI Attention cette ligne ne circule pas pendant Code course 40218 40226 40225 40228 40229 40227 40230 40231 40232 40219 40220 40221 40223 40222 40224 les vacances scolaires : A • Du 23 octobre au 8 novembre 2021 Gare Sud - - - - - - - - - - - - - - - • Du 18 décembre au 3 janvier 2022 College Gérard de Nerval - - - - - - - - 12:20 - - - - - - • Du 5 février 2022 au 21 février 2022 Lycée Jean Monnet - - - 12:15 12:18 12:18 12:20 12:20 12:25 - - - - - - • Du 9 avril 2022 au 25 avril 2022 Lycée Jean de la Fontaine - - - 12:18 12:20 12:20 12:23 12:23 12:30 - - - - - - • Vacances d’été à partir du 7 juillet 2022 CREPY-EN-VALOIS Lycée Robert Desnos - - - - 12:25 12:23 12:25 12:25 12:35 - - 17:30 - 17:35 17:40 Ne circule pas pendant les jours fériés College Gérard de Nerval 11:20 11:25 11:25 12:20 12:30 12:30 12:35 12:35 - - - - - - - Lycée Jean Monnet - - - - - - - - - - 17:36 17:33 17:35 17:40 17:45 CourseCourse accessibleaccessible PMRPMR –– PourPour garantirgarantir votrevotre priseprise enen Course accessible PMR – Pour garantir votre prise en Lycée Robert Desnos -

Infos Collecte
CONSEILS PRATIQUES PAYS DE VALOIS DU 1ER JANVIER AU INFOS 31 DÉCEMBRE 2019 COLLECTE Contacts CCPV Afi n de ne pas rater le service… www.cc-paysdevalois.fr • si collecte le matin : [email protected] sortez votre bac la veille au soir gestes simples à adopter RDV encombrants à domicile • si collecte l’après-midi : 0 800 880 944 sortez votre bac le matin pour faciliter la collecte (numéro vert gratuit d’une ligne fi xe) jusqu’à 14h au plus tard 3 Regrouper les bacs par 2, 1 avec votre voisin si possible. Mettre la collerette vers la rue, bac parallèle à la chaussée. Pour tout renseignement L’éloigner de tout obstacle de 50 cm, sur les déchetteries 2 Vous n’avez pas de bac jaune véhicule, panneaux divers, murs… Mardi au samedi : ni de bac noir ? 9h-12h et 14h-18h Contactez la CCPV Dimanche : 9h-12h Couvercle fermé sans sac ni carton Fermeture les lundis et jours fériés 3 dessus et à côté. Attention, les bacs qui vous 0 800 60 20 02 ont été remis sont sous votre responsabilité. Ils sont attachés www.smdoise.fr à votre logement. En cas de Attention, déménagement, ne les emmenez pas avec vous ! veillez à laisser libre l’accès aux bacs ! INFOS COLLECTE PUBLICATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS ∙ 62 rue de Soissons, 60800 Crépy-en-Valois ∙ Responsable du pôle Environnement-Déchets : ∙ 03 44 88 30 91 • [email protected] Sylvie Lamoureux ∙ Conception, réalisation : ∙ www.cc-paysdevalois.fr ∙ Horaires : lundi-mardi : 8h30 DonCameleon.net Chantilly ∙ n°ISSN : 1296-4166 à 12h15 / 13h30 à 17h30 ; mercredi-jeudi : 8h30 à 12h00 / Rejoignez nous sur 13h30 à 17h30 ; vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30 ∙ Directeur de la publication : Benoît Haquin cc-paysdevalois.fr Orrouy Gilocourt Béthancourt-en-Valois Pays de VALOIS Collecte des déchets 2019 Glaignes Rocquemont Séry-Magneval Trumilly Duvy Fresnoy-le-Luat Rouville DÉCHETS ORDURES DÉCHETS RECYCLABLES MÉNAGÈRES DE JARDIN 9 JANVIER • • • collecte (emballages plastiques, Collecte le matin Noël : métalliques, cartons 240 litres max. -

Les Nouvelles De Morienval
HP DateN° 11de Février parution 2013 P2 Les nouvelles de Morienval Titre de l'article principal Les Nouvelles de Morienval Chères Morienvaloises, chers Morienvalois, Le bulletin C’est avec un peu de retard que le Conseil Municipal et moi-même nous vous d’informations souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. municipales La crise économique et son impact, le chômage sont malheureusement au cœur de cette nouvelle année. La solidarité sera nécessaire pour se sortir de cette situation. Difficile, elle le sera également pour le Conseil Municipal qui va devoir établir un budget en équilibre, en tenant compte des nouvelles réformes gouvernementales et des objectifs des structures territoriales auxquelles nous adhérons. Le change- Le mot ment des rythmes scolaires voulu par L’Education Nationale implique un impact financier pour les collectivités locales. Le Conseil Général, de son côté, veut ren- du Maire dre accessible à tous le très haut débit pour l’informatique en mettant à contribu- tion les communes. Le projet de territoire de la Communauté de Communes pré- voit des investissements pour relancer l’économie locale et donner au Valois des services indispensables pour la croissance et l’équilibre de notre secteur. Oui, l’avenir ne semble pas facile, le contexte international n’est pas favorable et pourtant nous devons continuer à gérer au mieux notre Commune. Cette conjoncture nécessite une évolution de nos pratiques afin de rester une collectivité attractive et agréable à vivre pour chacun de nous. Nous travaillons dans ce sens et mettons en œuvre les outils nécessaires pour gé- nérer des recettes qui permettront de soulager les impôts à la charge des contri- buables. -

Crépy En Valois Du Lundi Au Vendredi
Horaires valables à partir du 05 septembre 2011 Etablissements de Crépy en Valois du lundi au vendredi Arrivée Jours de circulation L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V L à V Jours scolaires aux Ets Jours non scolaires Renvois à consulter RUSSY BÉMONT Prégnonval 7:16 VAUCIENNES Le Plessis au bois 7:34 VAUCIENNES Bas 7:36 VAUCIENNES Mur du Nain 7:38 GONDREVILLE RN 2 7:47 VERBERIE Eglise 7:10 | SAINTINES Jaures 7:14 | BÉTHISY ST PIERRE Place 7:10 | | BÉTHISY ST MARTIN Ecole 7:14 | | BÉTHISY ST MARTIN Le Larris | 7:27 | ORROUY Centre | | | NÉRY Centre | 7:32 | NÉRY Verrines | 7:35 | ROCQUEMONT Ecole | 7:38 | BOURSONNE Ecole 7:02 | | | AUTHEUIL EN VALOIS Billemont 7:07 | | | AUTHEUIL EN VALOIS Le Plessis sur Autheuil 7:09 | | | AUTHEUIL EN VALOIS Centre 7:11 | | | AUTHEUIL EN VALOIS La sanglilère 7:14 | | | IVORS Centre 7:20 | | | VAUCIENNES Chavres 7:25 | | | VERSIGNY Droizelles Eglise 7:30 7:09 | | | VERSIGNY Centre | 7:13 | | | ROSIÈRES Centre | 7:20 | | | BARON Centre | 7:26 | | | BARON Ecole | 7:30 | | | FRESNOY LE LUAT Ducy | 7:33 | | | FRESNOY LE LUAT Centre | 7:38 | | | FRESNOY LE LUAT Le Luat | 7:41 | | | GILOCOURT Place | | | | | 7:37 GLAIGNES Centre | | 7:20 | | 7:45 SÉRY MAGNEVAL Magneval | | 7:23 | | 7:47 SÉRY MAGNEVAL Demi-Lune | | 7:25 | | 7:50 BONNEUIL EN VALOIS Le Berval | | | | | 7:22 | BONNEUIL EN VALOIS Lieu restauré | | | | | 7:24 | VEZ Petit VEZ | | | | | 7:26 | VEZ Ecole | | | | | 7:28 | BONNEUIL EN VALOIS La Croix sainte Barbe | | | | | 7:20 | | BONNEUIL EN VALOIS Centre | | | | | 7:30 | | BONNEUIL -

L E S M O B I L I T
Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Valois - Fiches synthétiques Politique publique prioritaire de l’État, la sécurité caractéristiques afin que les usagers adaptent routière fait l'objet d'un programme pluriannuel leur comportement. F d'actions dont l'un des objectifs, au-delà du contrôle Concrètement, l'écriture du document doit être et de la sanction des comportements fautifs, est de l'occasion d'analyser les accidents intervenus ces faire émerger une culture tournée vers la prévention. dernières années, tout en évaluant l'impact en terme I Le Grenelle de l'Environnement a aussi mis en de sécurité des projets d'aménagement ou de voirie, avant le développement des nouvelles technologies une attention particulière devant être portée aux C d'information et de communication. L'aménagement endroits où se concentrent des usages numérique des territoires doit être intégré au projet particulièrement vulnérables, tels que les sorties territorial. d'écoles ou parcs de stationnement. H A ce titre, les auteurs des documents Sur le fond, le document d'urbanisme approuvé d'urbanisme doivent se mobiliser car ils peuvent agir doit notamment permettre d'éviter : E en posant les principes de base susceptibles – des extensions urbaines reliées à d'assurer un haut niveau de sécurité routière, à l'agglomération seulement par la route savoir : – un recul trop important des constructions – la prise en compte des usagers vulnérables élargissant le champ visuel, et donc les vitesses – l'affectation des voies avec le souci d'un – des alignements droits trop longs n° rééquilibrage des usages entre circulation et vie – la multiplication des accès nouveaux sur les locale pour les voies traversant l'agglomération voies principales de circulation 6 – la vérification de la cohérence entre l'affectation – de contraindre le développement des nouvelles L des voies existantes ou projetées et leurs technologies d'information et de communication.