Plurielles N° 22 "Le Juif Et L'autre"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lions and Roses: an Interpretive History of Israeli-Iranian Relations" (2007)
Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 11-13-2007 Lions and Roses: An Interpretive History of Israeli- Iranian Relations Marsha B. Cohen Florida International University, [email protected] DOI: 10.25148/etd.FI08081510 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Part of the International Relations Commons Recommended Citation Cohen, Marsha B., "Lions and Roses: An Interpretive History of Israeli-Iranian Relations" (2007). FIU Electronic Theses and Dissertations. 5. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/5 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida LIONS AND ROSES: AN INTERPRETIVE HISTORY OF ISRAELI-IRANIAN RELATIONS A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in INTERNATIONAL RELATIONS by Marsha B. Cohen 2007 To: Interim Dean Mark Szuchman College of Arts and Sciences This dissertation, written by Marsha B. Cohen, and entitled Lions and Roses: An Interpretive History of Israeli-Iranian Relations, having been approved in respect to style and intellectual content, is referred to you for judgment. We have read this dissertation and recommend that it be approved. _______________________________________ -

The Library of Secular Humanistic Judaism
THE LIBRARY OF SECULAR HUMANISTIC JUDAISM PUBLICATIONS CATALOG INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SECULAR HUMANISTIC JUDAISM The Library of Secular Humanistic Judaism Secular Humanistic Judaism celebrates cultural Jewish identity through a human-centered philosophy. The International Institute for Secular Humanistic Judaism offers professional training for Rabbis, Leaders, Educators and Spokespersons. It also provides adult learning opportunities through seminars, colloquia and publications. The Institute is the academic and intellectual center for a world-wide movement that appeals to cultural, Secular and Humanistic Jews. The publications in this catalog are some of the best resources for cultural Jews to explore their Jewish identities. 2 International©2018 InstituteInternational for Institute Secular for Secular Humanistic Humanistic Judaism Judaism The Library of Secular Humanistic Judaism Contents Philosophy of Secular Humanistic Judaism Judaism Beyond God: A Radical New Way to be Jewish ............. 4 Judaism in a Secular Age: An Anthology ..................................... 5 Humanist Readings in Jewish Folklore .......................................... 6 Beyond Tradition: The Struggle for a New Jewish Identity .......... 7 Jewish History A Provocative People: A Secular History of the Jews ................... 8 Jews and the Muslim World: Solving the Puzzle .......................... 9 Reclaiming Jewish History ............................................................ 10 Inspiration Staying Sane in a Crazy World: A Guide to Rational -

Judaism As a Culture Table of Content
Judaism as Culture The Beauty of Secularism Presented by the Posen Foundation Judaism as a Culture Table of Content Forward David Shaham Judaism, a Jewish State & Social Justice Dr. Ovadia Ezra What is Jewish Secularism? Dr. Yedidya Itzhaki Know How to Respond to the Orthodox (Book Review) Tova Birenbaum Judaism as a Plurality of Jewish Cultures Yaakov Malkin "The Return to History" – Jewish Secularism and its Fracturing Prof. Shalom Ratsabi On Gender and the Beginning of Secularization in Europe Prof. Shmuel Feiner The Secular Battle in the Knesset Lior Tal interviews MKs Nitzan Horowitz and Shlomo Mula A Revolt Grounded in Tradition – A Book Review Noam Regev A Lax Secularism with No Battles Dr. Guy Ben-Porat On Music, Psalms and God Doron Nesher Judaism, Culture and that which is between Them – An Interview with Daniel Posen Yossi Beilin converses with Daniel Posen The Objective is Still Ahead of Us Felix Posen Idealistic Teachers Open Student Minds Doron Nesher interviews Prof. Ron Margolin Judaism as a Culture Dr. Ariel Picard Secularism and Me Miriam Kayni Secular Israeli Identity: No Apologies Needed Dr. Ela Bauer What Appears on the Price List is Holy: On Secularization & Hebrew Dr. Zvia Valdan Women's Singing – Her Lips are Moving and Her Voice won't be Heard? Eli Bareket On Modesty, Permissiveness and Secular Silence Galia Oz The Secular Yeshiva's Fringe Theatre Ariel Levinson How Secularism Affected My Life Shlomit Naim Naor BINA – The Posen Foundation's Link to Young People in Israel Gal Brozin interviews Eran Baruch, BINA general director Loyalty, Flexibility & Mission: The Challenges of Secular Judaism Dov Elboim Dubnov & Kalish: Personal Stories of Secularization Dr. -
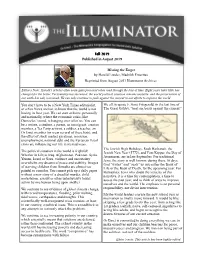
ILLUMINATOR Fall 2019 Final
Fall 2019 Published in August 2019 Missing the Target by Harold Londer, Madrikh Emeritus Reprinted from August 2011 Illuminator Archives Editor’s Note: Harold’s articles often seem quite prescient when read through the lens of time. Eight years later little has changed for the better. Partisanship has increased, the world political situation remains unstable. and the preservation of our earth has only worsened. We can only continue to push against the current in our efforts to improve the world. You don’t have to be a New York Times editorialist, We all, to quote F. Scott Fitzgerald, in the last line of or a Fox News anchor, to know that the world is not The Great Gatsby, “beat on, boats against the current.” having its best year. We can start at home, personally and nationally, where the economic crisis, like Damocles’ sword, is hanging over all of us. You can be a retiree, a student, a parent, an immigrant, a union member, a Tea Party activist, a soldier, a teacher, an Or Emet member (or wear several of these hats), and the effect of stock market gyrations, recession, unemployment, national debt and the European fiscal crisis are influencing our life in myriad ways. The Jewish High Holidays, Rosh Hashanah, the The political situation in the world is frightful! Jewish New Year (5772), and Yom Kippur, the Day of Whether in Libya, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Syria, Atonement, are in late September. For traditional Yemen, Israel or Gaza, violence and uncertainty Jews, the story is well known; during these 10 days, overwhelm any dreams of peace and stability. -

The Shofar Sept-Oct 2019
SEPTEMBER-OCTOBER 2019 The Shofar FROM THE EDITOR’S DESK Back to September now! On Sept. 17 we Website: oraynu.org will offer one of our semi-annual intro Shalom everyone — sessions: “Secular Humanistic Judaism — Hope you have all spent a good summer What, Why, How?” It’s on at the Borochov. wherever you were. Our activities slowed Please let others whom you think may be down over July and August, but we are interested in learning more about Oraynu Inside this issue: now set into full gear for a very busy fall. and how we “do Jewish.” Upcoming Events………….p. 3-5 2019 marks our 50th year and we have High Holidays are late this this year, start- Rabbi Denise’s Message……….2 events planned both for the School and ing on Sept. 30th, held at our usual School Principal’s Report……...7 Congregation to mark this huge milestone location, the Avenue. See the Board notice Note from our Board…………...6 in the life of Oraynu. on HH security on p. 6. We have refreshed our Erev Yom Kippur program and, as Tribute to Yaakov Malkin……..6 First up is our “YidLive!” event on Sept. 10 most of you will know from an email sent at the Miles Nadal JCC featuring the Teaching Staff Update………….8 earlier, there is a revamped memorial YidLife Crisis guys, Jamie Elman and Eli section. We will no longer be reading Putting (Oraynu) Teachings Batalion. It promises to be an evening of into Action…………………………....9 names aloud in the Nizkor section, but will hilarious entertainment. -

Jewish Attitudes Toward Poles: in Search of Haman5
May 2020 “...a Jew from Poland is not and never was simply Polish. … it was clear to Jews and Poles alike that they were two very different peoples who happened to share the same piece of territory. They could be neighbors and business partners, but they were seldom friends and almost never relatives or social or legal equals.” 1 Adam Kirsch, American poet and critic The ethno-nationalist spin for this state of affairs: “It’s all the Poles’ fault!” “Their animus, which carries Polish nationalism into such an aggressively xenophobic articulation, springs primarily from a deep pool of ethnic-cum- religious hatred, which is indigenous to Poland and has historically been aimed at Jews.”2 Jan T. Gross, American sociologist “…the sort of primitive anti-Polish sentiments that too often characterize those whom I shall call ‘professional Jews’.”3 French-Jewish historian Pierre Vidal-Naquet “…it is possible for Jewish people to be racist, just as it is possible for people of other faiths to be.” 4 John Bercow, former Speaker of U.K. House of Commons Traditional Jewish Attitudes Toward Poles: In Search of Haman5 by Mark Paul Mutual prejudices and stereotypes have been harboured by both Poles and Jews in regard to one another for long centuries. Few scholars in the West, however, have recognized that Jews, no less than Poles, 1 Adam Kirsch, “A Cruel and Elusive Family History,” Tablet, January 2, 2018. 2 Jan T. Gross, “Poles Cry for “Pure Blood’ Again,” The New York Times, November 16, 2017. 3 Pierre Vidal-Naquet, The Jews: History, Memory, and the Present (New York: Columbia University Press, 1996), 182. -

Jewish Culture 1 Jewish Culture
Jewish culture 1 Jewish culture Jewish culture is the international culture of the Jews. Since the formation of the Jewish nation in biblical times the international community of Jewish people has been considered a tribe or an ethnoreligious group rather than solely a religion. Judaism guides its adherents in both practice and belief, so that it has been called not only a religion, but an orthopraxy.[1] Not all individuals or all cultural phenomena can be classified as either "secular" or "religious", a distinction native to Enlightenment thinking.[2] Jewish culture in its etymological meaning retains the linkage to the land of origin, the people named for the Kingdom of Judah, study of Jewish texts, practice of community charity, and Jewish history. The term "secular Jewish culture" therefore refers to many aspects, including: Religion and World View, Literature, Media, and Cinema, Art and Architecture, Cuisine and Traditional Dress, attitudes to Gender, Marriage, and Family, Social Customs and Lifestyles, Music and Dance.[3] "Secular Judaism," is a distinct phenomenon related to Jewish secularization - a historical process of divesting all of these elements of [4] culture from their religious beliefs and practices. Sephardi Jewish couple from Sarajevo in traditional clothing. Photo taken in 1900. Secular Judaism, derived from the philosophy of Moses Mendelssohn,[5] arose out of the Haskalah, or Jewish Enlightenment, which was itself driven by the values of the Enlightenment. In recent years, the academic field of study, has encompassed Jewish Studies, History, Literature, Sociology, and Linguistics. Historian David Biale[6] has traced the roots of Jewish secularism back to the pre-modern era. -

Hayom 46 Sommaire DOMAINE DE CHANTILLY FRANCE - 20 P.M
210x297_G0A35130_FR_bout_G0A35130_1_1 30.01.12 10:34 Page1 ULTIME DISCRÉTION LE MAGAZINE DU JUDAÏSME D’AUJOURD’HUI TODAY HAYOM N°46 - HIVER 2012 > INTERVIEW EXCLUSIVE Francis Huster joue Anne Frank > ENTRETIEN Tal Ben-Shahar, «professeur du bonheur» > PORTRAIT Yemen Blues > CULTURE Les Juifs d’Algérie et e PIAGET ALTIPLANO le 50 anniversaire La montre automatique la plus plate du monde Boîtier en or blanc, 5,25 mm d’épaisseur des accords d’Évian Le mouvement automatique le plus plat du monde Calibre Manufacture Piaget, 2,35 mm d’épaisseur www.piaget-altiplano.com Boutiques PIAGET : Genève - rue du Rhône 40 0 Zurich - Bahnhofstrasse 38 édito > Jérusalem joue la carte design et musicale Visiter Jérusalem – capitale éternelle et carrefour des religions monothéistes – demeure toujours une découverte. Un échange continu entre tradition et modernité, entre cultures et styles de vie hétéroclites. Après les festivités religieuses qui ont notamment ponctué les mois de septembre et d’octobre, la ville s’est ensuite ouverte à la saison laïque avec un calendrier intense et adapté à tous les amoureux de la cause culturelle… Dominique-Alain Pellizari in octobre, pendant deux jours, les portes de Jérusalem se sont ouvertes avec les Houses rédacteur en chef From Within: un voyage consacré à l’architecture publique et privée qui a permis de dé- couvrir, de manière tout à fait singulière, les divers styles qui caractérisent la ville. Et F ce, en entrant dans les maisons de fameux artistes ou en visitant la face cachée de monu- ments, les coulisses de théâtres, les bas-fonds du métro, des chantiers de construction originaux, des places ou des jardins. -

Anita Shapira Hirbet Hizah Between Remembering and Forgetting
Anita Shapira Hirbet Hizah Between Remembering and Forgetting Woe to the generation that has to commit the acts of “Hizah” and flees the pain of their recounting. —Ephraim Kleiman Memory—what, how, and when we remember—continues to fascinate scholars. It is elusive, complex, and difficult to define. Collective memory sits at the divide between the conscious and the subliminal, acknowledg- ment and denial, history and psychology. Currently in vogue is the con- struct of a “usable past”: collective memory as a product of national- cultural manipulation, which embeds those portions of the past that reinforce society’s self-image and foster its interests and agendas. This con- ception rejects the notion of spontaneous processes at work in the for- mation of collective memory. But if conscious intent does shape memory, who are its agents? What are their tools? In democracies, moreover, there is never one single guiding hand. How does the open arena of conflicting interests impact on memory’s configuration? When is a particular event stamped in memory? What processes catalyze its fixing; what forces act to submerge it? If the “usable past” ministers to present interests, what hap- pens to past segments that do not serve current goals? Are they relegated to oblivion? Or do past and present interact dynamically, transforming memory as changing circumstances impact on public consciousness? Memory confounds historical consciousness. The gray area between consciousness and memory is especially evident when dealing with top- ics hard to face, such as the departure/flight/removal/expulsion of Arabs in Israel’s War of Independence. This essay deals with changing represen- tations of the past and the interrelation of memory and reality. -

Neither a Sabra, Nor a Geranium
Studies in Visual Arts and Communication: an international journal Vol 4, No 1 (2017) on-line ISSN 2393 - 1221 Opening Raffi’s Box: Neither a Sabra, Nor a Geranium Nava Sevilla-Sadeh* Abstract As an artist distinctively identified with the currents of conceptual art, Raffi Lavie (1937-2007) was one of the most influential artists on the Israeli art scene during the 1970s and 80s, and also represented Israel at the 53rd Venice Biennale. Although much has been written on his artistic work, it has remained enigmatic, given that his signifiers are deliberately vague. Lavie’s case was defined by the historian of Israeli art, Gideon Ofrat, as “Raffi’s Box”, in equivalence to the mythological Pandora’s Box, as an issue ostensibly not to be decoded. This study examines four collages created by Lavie from the beginning of the 1980s, composed of photos of Classical images. The accepted interpretations have conceived these images as declaratively meaningless and as worthless pieces of history; from the premise that all that remains from the Classical past is but a lexicon of banal and depleted images. The argument underlying the present study is that, rather, these very images are the signifiers of the abstract meaning claimed of Lavie’s work, as contended by most of his commentators, and even expressed by him in a certain way. This research, which belongs to the field of Classical Reception Studies, offers a critical analysis achieved via a deconstructive methodology, according to which the Classical images are conceived as a supplementary or parasitic text within the main text, present in order to reaffirm the accuracy of the latter. -

Literature and Nation in the Middle East
LITERATURE LITERATURE AND NATION IN THE MIDDLE EAST YASIR SULEIMAN is Director of the AND NATION IN Edinburgh Institute for the Advanced THE MIDDLE EAST Study of the Arab World & Islam and Professor of Arabic & Middle Edited by Yasir Suleiman Eastern Studies at the University of and Ibrahim Muhawi Edinburgh. He has written extensively ‘An excellent addition to the field of Arabic literary on the Middle East and his books studies, nationalism studies, and colonial/post-colonial This compelling study presents an original look at how ‘the nation’ is include The Arabic Language and studies. I strongly recommend it.’ National Identity (Edinburgh University represented in the literature of the LITERATURE Middle East. It includes chapters on Press, 2003), The Arabic Grammatical Professor Joseph Massad, Columbia University Egypt, Sudan, Lebanon, Iraq, Palestine Tradition (Edinburgh University Press, and Israel, drawing on the expertise 1999) and A War of Words: Language of literary scholars, historians, political and Conflict in the Middle East (2004). AND NATION IN scientists and cultural theorists. ‘A study on the literary construction of the nation in IBRAHIM MUHAWI is a fellow the Middle East is most welcome today, particularly with Literature and Nation in the Middle East of the Edinburgh Institute for offers a synthesising contribution to its emphasis on Palestinian and Hebrew literature… knowledge, placing Arab literature within the Advanced Study of the Arab THE MIDDLE EAST this is an opportune moment to see how [Middle Eastern] the context of emergent or conflicting World & Islam. His published nationalist projects in the area. Topics work is interdisciplinary and writers perceive themselves and their identity.’ addressed include: ranges over the areas of Arabic • the roles played by literature and literature, folklore, and translation. -

Secular Identification: the Case of Bina and Its Secular Yeshiva
SECULAR IDENTIFICATION: THE CASE OF BINA AND ITS SECULAR YESHIVA By Efrat Sadras-Ron A DISSERTATION Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Anthropology – Doctor of Philosophy 2016 ABSTRACT SECULAR IDENTIFICATION: THE CASE OF BINA AND ITS SECULAR YESHIVA By Efrat Sadras-Ron The clashing perspectives over Jewishness in Israel, on the one side an orthodox minority that is a major political player, on the other a secular majority that is politically fragmented, is a cause of constant tension in Israeli Jewish society. In Israel, Jewishness with its religious overtones overlaps with national sentiments. This overlap is one aspect of the Israeli secular story, orthodox monopoly over the state’s Jewish character is another. The Jewish renewal movement in Israel looks to bridge, and reestablish a reciprocal relationship, between the national and religious aspects of Israeliness with Hebrew culture based on the Hebrew Bible as the common core. The movement calls upon secular Jewish individuals to challenge the Jewish orthodoxy monopoly in Israel. Furthermore, it calls for secular individuals to reclaim ownership and with it authority over Jewish culture, recreating Jewishness in their own secular image. What exactly is that secular image that is to mold Jewishness into a contemporary frame of reference, is in fact the subject of this dissertation. In this work, I carry out an analysis of group identification based on secular principles. I argue that group identification based in secularity facilitates inclusive environment; however, it does not guarantee inclusion. Looking at BINA and its secular yeshiva in the south of Tel-Aviv, I introduce ethnographic data showing how secular sensibilities challenge current understanding of group belonging and boundaries.