Chrysomelidae
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exp10ration Du Parc Nationa1 A1bert
INSTIfUT DES PARCS NATlON'AUX l'NSTlTUUT DER NATIONALE PARKEN DU CONGO BELGE VAN BElGISCH CONGO Exp10rat ion du Parc Nat ion a1 A1bert MISSION G. F. DE WITTE (1933-1935) FASCICULE 37 Exploratie van het Nationaal Albert Park ZENDING G. F. DE WITTE (1933-1935) AFLEVERI NG 37 CHRYSOMELIDAE S. Fam. EUMOLPINAE L. BUnGEON (Tcrvucl'en). BRUXELLES BRUSSEL 1942 1942 PARC NATIONAL ALBERT NATIONAAL ALBERT PARK J. MISSION G. F. DE WITTE 1933-1935 J. ZENDING G. IF. DE WHTE 1933-1935 Fascicule 37 Aflevering 37 C,H RYSOM ELI DAE S. Fam. EUMOLPINAE l'AU L. SURGEON (Tervueren). Les Eumolpides ['écoJlés par !\.I. DE \VITTE au Parc Nalional Albed, ainsi que lors d'une expédilion dans l' ele, eomptent 244 spécimens, parmi lesquels 37 espèces de la région des Parcs, dont 7 nouvelles: dans l'Uele il il récolté 11 autres espèces, dont li Ilouvelles. Dans les collections du Musée du Congo j'ai noté 22 autres espèces provenant des Parcs du Kivu, de l'Ituri, du Ruanda et de leurs aborcls immédiats. Sans tenir compte des formes de l'Dele, on arrive ainsi il un total de 39 espèces, ce qui est peu comparativement il (l'autres régions congolaises de faune plus riche ou plus longuelTlent explorée. Il y a plus de 260 espèces lI' I~umolpides congo lais dans les collections du Musée du Congo. L'endémisme des Eumolpides au Kivu est restreint; on n'en voit pas à haute altitude: il n'en a pas été récolté au-dessus de2.li00 m. Les espèces suivantes sont propres il la forêl de montagne: Pseudoco ((fs]Jis Sj)Ii'lUlI'lIs m., Ps('wl. -

The Beetle Fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta: Coleoptera): Diversity and Distribution
INSECTA MUNDI, Vol. 20, No. 3-4, September-December, 2006 165 The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta: Coleoptera): Diversity and distribution Stewart B. Peck Department of Biology, Carleton University, 1125 Colonel By Drive, Ottawa, Ontario K1S 5B6, Canada stewart_peck@carleton. ca Abstract. The beetle fauna of the island of Dominica is summarized. It is presently known to contain 269 genera, and 361 species (in 42 families), of which 347 are named at a species level. Of these, 62 species are endemic to the island. The other naturally occurring species number 262, and another 23 species are of such wide distribution that they have probably been accidentally introduced and distributed, at least in part, by human activities. Undoubtedly, the actual numbers of species on Dominica are many times higher than now reported. This highlights the poor level of knowledge of the beetles of Dominica and the Lesser Antilles in general. Of the species known to occur elsewhere, the largest numbers are shared with neighboring Guadeloupe (201), and then with South America (126), Puerto Rico (113), Cuba (107), and Mexico-Central America (108). The Antillean island chain probably represents the main avenue of natural overwater dispersal via intermediate stepping-stone islands. The distributional patterns of the species shared with Dominica and elsewhere in the Caribbean suggest stages in a dynamic taxon cycle of species origin, range expansion, distribution contraction, and re-speciation. Introduction windward (eastern) side (with an average of 250 mm of rain annually). Rainfall is heavy and varies season- The islands of the West Indies are increasingly ally, with the dry season from mid-January to mid- recognized as a hotspot for species biodiversity June and the rainy season from mid-June to mid- (Myers et al. -

Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae
ZOOSYSTEMATICA ROSSICA, 25(2): 299–313 27 DECEMBER 2016 To the knowledge of the leaf-beetle genera Rhyparida and Tricliona (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) from Indochina and Malay Peninsula К познанию жуков-листоедов родов Rhyparida и Tricliona (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) Индокитая и Малайского полуострова P. V. R OMANTSOV & A.G. MOSEYKO* П.В. РОМАНЦОВ, А.Г. МОСЕЙКО P.V. Romantsov, 105-9 Krasnoputilovskaya Str, St Petersburg 196240, Russia. E-mail: [email protected] A.G. Moseyko, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 1 Universitetskaya Emb., St Petersburg 199034, Russia; All-Russian Institute of Plant Protection, 3 Podbelskogo St, St Petersburg – Pushkin 196608, Russia. E-mail: [email protected] Four species (Rhyparida spiridonovi sp. nov. from Penang Island and Singapore, Tricliona tri- maculata sp. nov. from Penang Island and Malay Peninsula, T. suratthanica sp. nov. and T. tran- gica sp. nov. from Thailand) are described. A key to the species of the genus Tricliona from In- dochina and Malay Peninsula is given. Rhyparida faitsilongi nom. nov. is the new replacement name for Rhyparida megalops (Chen, 1935), comb. n., transferred from the genus Tricliona; Tricliona tonkinensis (Lefèvre, 1893), comb. nov. and Tricliona episternalis (Weise, 1922), comb. nov. transferred from the genera Phytorus and Rhyparida, accordingly. Lectotypes of Rhyparida episternalis Weise, 1922 and Phytorus tonkinensis Lefèvre, 1893 are designated. Описаны четыре новых для науки вида (Rhyparida spiridonovi sp. nov. с о. Пенанг и Син- гапура, Tricliona trimaculata sp. nov. с о. Пенанг и Малайского полуострова, T. suratthanica sp. nov. и T. trangica sp. nov. из Таиланда). Составлена определительная таблица для рода Tricliona Индокитая и Малайского полуострова. -

Barcoding Chrysomelidae: a Resource for Taxonomy and Biodiversity Conservation in the Mediterranean Region
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 597:Barcoding 27–38 (2016) Chrysomelidae: a resource for taxonomy and biodiversity conservation... 27 doi: 10.3897/zookeys.597.7241 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Barcoding Chrysomelidae: a resource for taxonomy and biodiversity conservation in the Mediterranean Region Giulia Magoga1,*, Davide Sassi2, Mauro Daccordi3, Carlo Leonardi4, Mostafa Mirzaei5, Renato Regalin6, Giuseppe Lozzia7, Matteo Montagna7,* 1 Via Ronche di Sopra 21, 31046 Oderzo, Italy 2 Centro di Entomologia Alpina–Università degli Studi di Milano, Via Celoria 2, 20133 Milano, Italy 3 Museo Civico di Storia Naturale di Verona, lungadige Porta Vittoria 9, 37129 Verona, Italy 4 Museo di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia 55, 20121 Milano, Italy 5 Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources–University of Tehran, Karaj, Iran 6 Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente–Università degli Studi di Milano, Via Celoria 2, 20133 Milano, Italy 7 Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali–Università degli Studi di Milano, Via Celoria 2, 20133 Milano, Italy Corresponding authors: Matteo Montagna ([email protected]) Academic editor: J. Santiago-Blay | Received 20 November 2015 | Accepted 30 January 2016 | Published 9 June 2016 http://zoobank.org/4D7CCA18-26C4-47B0-9239-42C5F75E5F42 Citation: Magoga G, Sassi D, Daccordi M, Leonardi C, Mirzaei M, Regalin R, Lozzia G, Montagna M (2016) Barcoding Chrysomelidae: a resource for taxonomy and biodiversity conservation in the Mediterranean Region. In: Jolivet P, Santiago-Blay J, Schmitt M (Eds) Research on Chrysomelidae 6. ZooKeys 597: 27–38. doi: 10.3897/ zookeys.597.7241 Abstract The Mediterranean Region is one of the world’s biodiversity hot-spots, which is also characterized by high level of endemism. -
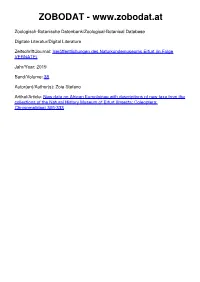
New Data on African Eumolpinae with Descriptions of New
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt (in Folge VERNATE) Jahr/Year: 2019 Band/Volume: 38 Autor(en)/Author(s): Zoia Stefano Artikel/Article: New data on African Eumolpinae with descriptions of new taxa from the collections of the Natural History Museum of Erfurt (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae) 305-333 VERNATE 38/2019 S. 305-333 New data on African Eumolpinae with descriptions of new taxa from the collections of the Natural History Museum of Erfurt (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae) STEFANO ZOIA Abstract the opportunity to re-examine some problematic taxa, providing illustrations of the genitalia, and to correct a Mainly based on the collection of the Natural History homonymy issue in a genus name. Museum of Erfurt and on the private collection of the author, the following taxa are described: Afroeurydemus Material and methods adustus sp. n. (Kenya), A. adustus tanzaniae ssp. n. (Tanzania), A. adustus zambesianus ssp. n. (Namibia), All specimens are preserved dried and glued on pinned A. augusti sp. n. (Zambia), Phascus pallidus australis cards. ssp. n. (Namibia). Selmania nom. nov. is proposed as The reported length of the specimens is evaluated from replacement name for Massartia Selman, 1965 (nec the anterior edge of pronotum to the elytral apex. The Conrad, 1926, nec Schouteden, 1952) and the following ratio of frons width to eye width, to describe the di- new combinations are formalized: Selmania albertiana mensions of eyes in relation to the head, is evaluated (Burgeon, 1941) n. comb., S. colasposomoides (Bur- in frontal view along a horizontal line at a level of the geon, 1941) n. -

Biologie Et Écologie De Syagrus Calcaratus (F.) (Coleoptera, Chrysomelidae), Ravageur De La Culture Cotonnière Au Burkina Faso Jean-Claude Streito, Samuel Nibouche
Bulletin de la Société entomologique de France Biologie et écologie de Syagrus calcaratus (F.) (Coleoptera, Chrysomelidae), ravageur de la culture cotonnière au Burkina Faso Jean-Claude Streito, Samuel Nibouche Citer ce document / Cite this document : Streito Jean-Claude, Nibouche Samuel. Biologie et écologie de Syagrus calcaratus (F.) (Coleoptera, Chrysomelidae), ravageur de la culture cotonnière au Burkina Faso. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 103 (1), mars 1998. pp. 51-56; https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1998_num_103_1_17393 Ressources associées : Coleoptera Chrysomelidae Fichier pdf généré le 24/09/2019 Résumé Depuis 1991, Syagrus calcaratus (F.) occasionne d'importants dégâts en culture cotonnière au Burkina Faso. Nous avons étudié la biologie de cet insecte au champ et en insectarium en 1994. S. calcaratus n'a qu'une génération annuelle, de juillet à octobre. L'adulte passe la saison sèche en quiescence, enfoui dans le sol dans des zones ombragées. Dès les premières pluies, les adultes reprennent leur activité et sont observés sur des repousses de cotonniers de l'année précédente ou sur d'autres plantes-hôtes, Malvacées spontanées ou cultivées. Les champs de coton sont envahis à partir de début juillet. Le développement larvaire dure environ deux mois. Les premières attaques racinaires se produisent en juillet et se poursuivent jusqu'en septembre. Abstract Biology and ecology ofSyagrus calcaratus (F.), a cotton pest in Burkina FasoColeoptera ( , Chrysomelidae). Since 1991, Syagrus calcaratus (F.) causes heavy damages to the cotton crop in Burkina Faso. In 1994, we have studied the biology of this pest in the field and during insectarium rearing. S. -

(Chrysomelidae: Eumolpinae) Ревизия Рода Phytorus Jacoby, 1884
Russian Entomol. J. 11 (4): 401407 © RUSSIAN ENTOMOLOGICAL JOURNAL, 2002 A revision of the genus Phytorus Jacoby, 1884 (Chrysomelidae: Eumolpinae) Ðåâèçèÿ ðîäà Phytorus Jacoby, 1884 (Chrysomelidae: Eumolpinae) L. N. Medvedev*, A. G. Moseyko** Ë. Í. Ìåäâåäåâ*, À. Ã. Ìîñåéêî** *Institute for Problems of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky prospekt 33, Moscow 119071 Russia. *Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè ÐÀÍ, Ëåíèíñêèé ïð-ò 33, Ìîñêâà 119071 Ðîññèÿ. **Department of Entomology, Faculty of Biology, M. V. Lomonosov Moscow State University, Vorobyovy Gory, Moscow 119899 Russia. **Êàôåäðà ýíòîìîëîãèè Áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, Âîðîáüåâû ãîðû, Ìîñêâà 119899 Ðîññèÿ. KEY WORDS: Chrysomelidae, Eumolpinae, Phytorus, Phytorellus, revision, new genus, new species. ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ: Chrysomelidae, Eumolpinae, Phytorus, Phytorellus, ðåâèçèÿ, íîâûé ðîä, íîâûå âèäû. ABSTRACT. A revision of the genus Phytorus is Naturelles de Belgique in Brussels and senior authors proposed. Genus Phytorus is removed from tribe Typo- collections. A few types of Jacoby, Lefevre and Weise phorini to tribe Metachromini. 2 new species are de- were studied. scribed: Ph. antennalis (Palawan), Ph. laysi (Mindan- The following abbreviations were used for depositary ao); Ph. puncticollis Lefevre 1885 is a new synonym of places: IRSNB Institute Royal des Sciences Naturelles de Ph. dilatatus Jacoby 1884. 8 species are transferred Belgique, NHMB Naturhistorisches Museum (Basel), from genus Phytorus to genus Rhyparida: Rh. simplex, SMNS Museum für Naturkunde (Stuttgart), LM L. Rh. fervidus, Rh. plebejus, Rh. leyteana, Rh. nigripes, Medvedevs collection, Moscow. Rh. tibiellus, Rh. pallidus, Rh. assimilis. Phytorus line- olatus Weise 1913 is a new synonym of Rhyparida Main characters of genus are: convex anterior mar- simplex (Lefevre 1885). -

An Inventory of Nepal's Insects
An Inventory of Nepal's Insects Volume III (Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera & Diptera) V. K. Thapa An Inventory of Nepal's Insects Volume III (Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera& Diptera) V.K. Thapa IUCN-The World Conservation Union 2000 Published by: IUCN Nepal Copyright: 2000. IUCN Nepal The role of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in supporting the IUCN Nepal is gratefully acknowledged. The material in this publication may be reproduced in whole or in part and in any form for education or non-profit uses, without special permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made. IUCN Nepal would appreciate receiving a copy of any publication, which uses this publication as a source. No use of this publication may be made for resale or other commercial purposes without prior written permission of IUCN Nepal. Citation: Thapa, V.K., 2000. An Inventory of Nepal's Insects, Vol. III. IUCN Nepal, Kathmandu, xi + 475 pp. Data Processing and Design: Rabin Shrestha and Kanhaiya L. Shrestha Cover Art: From left to right: Shield bug ( Poecilocoris nepalensis), June beetle (Popilla nasuta) and Ichneumon wasp (Ichneumonidae) respectively. Source: Ms. Astrid Bjornsen, Insects of Nepal's Mid Hills poster, IUCN Nepal. ISBN: 92-9144-049 -3 Available from: IUCN Nepal P.O. Box 3923 Kathmandu, Nepal IUCN Nepal Biodiversity Publication Series aims to publish scientific information on biodiversity wealth of Nepal. Publication will appear as and when information are available and ready to publish. List of publications thus far: Series 1: An Inventory of Nepal's Insects, Vol. I. Series 2: The Rattans of Nepal. -

Tituboea Purcharti Sp. Nov., the First Representative of Clytrini from Socotra Island (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalin
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Published 17.xii.2012 Volume 52 (supplementum 2), pp. 395–401 ISSN 0374-1036 Tituboea purcharti sp. nov., the fi rst representative of Clytrini from Socotra Island (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae) Jan BEZDĚK Mendel University, Department of Zoology, Zemědělská 1, CZ-613 00 Brno, Czech Republic; e-mail: [email protected] Abstract. Tituboea purcharti sp. nov., the fi rst known species of Clytrini from Socotra Island (Yemen), is decribed and illustrated. The new species belongs to the group of larger species (above 7.0 mm) with not prolonged protarsi, glabrous elytra and not elevated posterior pronotal angles. It is closely related to T. arabica (Olivier, 1808) but differs in slender, fl at aedeagus with prolonged apex and in black pattern on elytra reduced to transverse fascia behind elytral midlength. Key words. Coleoptera, Chrysomelidae, Cryptocephalinae, Clytrini, Tituboea, new species, Yemen, Socotra Introduction The genus Tituboea Lacordaire, 1848, is distributed in the Palaearctic, Oriental and Afro- tropical Regions. REGALIN & MEDVEDEV (2010) listed 62 species from the Palaearctic Region. Recently, additional new species, T. pindai Bezděk, 2011, was described from the United Arab Emirates (BEZDĚK & BATELKA 2011). The species from the Arabian Peninsula were reported and keyed by MEDVEDEV (1979, 1993, 1996, 1997). The chrysomelid fauna of Socotra Island is extremely insuffi ciently known. Until now, only fi ve species were reported: Eryxia socotrana Gahan, 1903, Colasposoma densatum -

(Coleoptera: Chrysomelidae) of Korea, with Comments and New Records
Number 404: 1-36 ISSN 1026-051X April 2020 https://doi.org/10.25221/fee.404.1 http://zoobank.org/References/C2AC80FF-60B1-48C0-A6D1-9AA4BAE9A927 AN ANNOTATED CHECKLIST OF LEAF BEETLES (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) OF KOREA, WITH COMMENTS AND NEW RECORDS H.-W. Cho1, *), S. L. An 2) 1) Animal & Plant Research Team, Nakdonggang National Institute of Biological Resources, 137 Donam 2-gil, Sangju 37242, Republic of Korea. *Corresponding author, E-mail: [email protected] 2) Division of Research, National Science Museum, 481 Daedeok-daero, Yuseong-gu, Daejeon 34143, Republic of Korea. Summary. An updated list of Chrysomelidae of Korea is provided with comments on all taxonomic, nomenclatural, and distributional changes. This paper is the first attempt to divide the distributional records of all Korean Chrysomelidae into records for North and South Korea. In total, 128 genera and 424 species are reported: 293 species in North Korea, 340 in South Korea, and 10 without precise localities in Korea; 22 species are excluded from the Korean fauna; 15 new national records from South Korea are reported, 10 of which are new to Korea. Key words: Chrysomelidae, fauna, new record, taxonomy, North Korea, South Korea. Х. В. Чо, С. Л. Ан. Аннотированный список жуков-листоедов (Coleop- tera: Chrysomelidae) Кореи с замечаниями и новыми указаниями // Дальне- восточный энтомолог. 2020. N 404. С. 1-36. Резюме. Приводится обновленный список жуков-листоедов (Chrysomelidae) Кореи с таксономическим и номенклатурным изменениями и замечаниями по 1 распространению. Предпринята первая попытка разделения фаунистических данных по всем корейским листоедам на указания для северной и южной частей полуострова. Всего приводятся 424 вида из 128 родов, из которых 293 вида отмечены для Северной, 340 видов – для Южной Кореи, а 10 видов – из Кореи без более точного указания; 22 вид искючен из фауны Корейского полу- острова; 15 видов впервые указаны для Республики Корея, из них 10 видов являются новыми для полуострова. -

Molecular Evidence of Cycad Seed Predation by Immature Aulacoscelidinae (Coleoptera: Orsodacnidae)
Systematic Entomology (2012), DOI: 10.1111/j.1365-3113.2012.00639.x Molecular evidence of cycad seed predation by immature Aulacoscelidinae (Coleoptera: Orsodacnidae) ALBERTO PRADO1, DUANE D. MCKENNA2 and DONALD WINDSOR3 1Department of Plant Science, McGill University, Ste Anne de Bellevue, Quebec, Canada, 2Department of Biological Sciences, University of Memphis, Memphis, TN, U.S.A. and 3Smithsonian Tropical Research Institute, Balboa-Ancon, Panama Abstract. Adult beetles in the small subfamily Aulacoscelidinae (superfamily Chrysomeloidea) are known to feed on the foliage and juices of New World cycads (Order Cycadales; family Zamiaceae), but the habits of larvae have long remained a mystery. We provide the first direct evidence that Aulacoscelidinae larvae feed on and develop within the megagametophyte of the Mesoamerican cycad, Dioon merolae (Zamiaceae). Phylogenetic analyses based on partial DNA sequences from 3 genes recover a cycad seed-feeding larva proposed to belong to Aulacoscelidinae. These observations reveal a more intimate feeding relationship between Aulacoscelidinae and their New World cycad host plants than was previously recognized. Further, adult Aulacoscelidinae have long been noted to resemble Jurassic fossil chrysomeloids in the extinct subfamily Protoscelidinae. The molecular, morphological, ecological and fossil data reported herein are broadly compatible with an early association between Aulacoscelidinae and their gymnosperm hosts. Introduction Phytophaga, and that the complex plant–phytophage associ- ations observed today may have originated well before the The Phytophaga (1 30 000 species), comprising the angiosperm radiation on one or more of these formerly impor- Chrysomeloidea and Curculionoidea, together contain close tant lineages of plants (Labandeira, 2000; Labandeira et al., to 50% of phytophagous insect species and nearly 80% of 2007). -

Coleoptera, Chrysomelidae, Eumolpinae)
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 720: 65–75Insights (2017) on the genus Acronymolpus Samuelson with new synonymies... 65 doi: 10.3897/zookeys.720.13582 SHORT COMMUNICATION http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Insights on the genus Acronymolpus Samuelson with new synonymies and exclusion of Stethotes Baly from the fauna of New Caledonia (Coleoptera, Chrysomelidae, Eumolpinae) Jesús Gómez-Zurita1 1 Animal Biodiversity and Evolution, Institute of Evolutionary Biology (CSIC-Universitat Pompeu Fabra), 08003 Barcelona, Spain Corresponding author: Jesús Gómez-Zurita ([email protected]) Academic editor: M. Schmitt | Received 8 May 2017 | Accepted 24 August 2017 | Published 11 December 2017 http://zoobank.org/3B26061F-853D-41E7-A0A5-8328FF2CC709 Citation: Gómez-Zurita J (2017) Insights on the genus Acronymolpus Samuelson with new synonymies and exclusion of Stethotes Baly from the fauna of New Caledonia (Coleoptera, Chrysomelidae, Eumolpinae). In: Chaboo CS, Schmitt M (Eds) Research on Chrysomelidae 7. ZooKeys 720: 65–75. https://doi.org/10.3897/zookeys.720.13582 Abstract In this work, several taxonomic problems affecting the recently erected genus Acronymolpus Samuelson, 2015, endemic to New Caledonia, are addressed. Two of the three New Caledonian species described in Stethotes Baly are transferred to Acronymolpus and their priority is recognized over the names proposed in the revision of this genus. Moreover, different forms of Acronymolpus always found in sympatry, one red- dish and larger, and the other black and smaller, were each given species status in that revision, but they are recognized here as the females and males, respectively, of the same species. The taxonomic summary of these discoveries is: (i) A.