Emmanuel Todd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
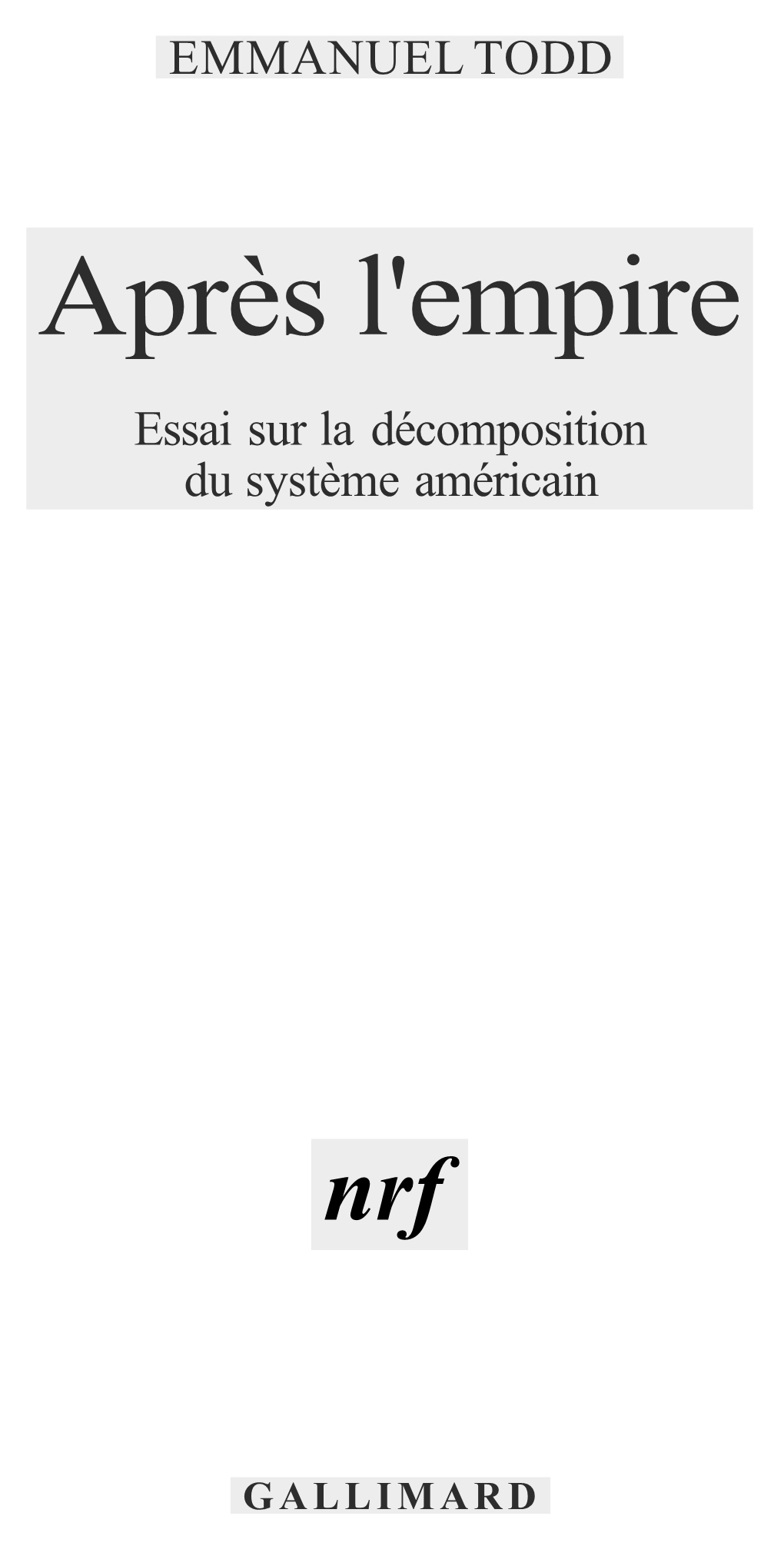
Load more
Recommended publications
-

Je Suis Charlie?
Je Suis Charlie? Why Positive Integration of Muslims in France Reinforces the Republican Ideal By Emmanuel Todd e can now say, with the benefit of hindsight, that in January 2015 France succumbed to an attack of hysteria. The massacre of the editorial board Wof the satirical magazine Charlie Hebdo, as well as of several police officers and the customers of a Jewish shop, triggered a collective reaction unprec - edented in our country’s history. It would have been impossible to discuss it in the heat of the moment. The media joined hands to denounce terrorism, to celebrate the admirable character of the French people, and to sacralize liberty and the French Republic. Charlie Hebdo and its caricatures of Mohammed were enshrined. The government announced that it was giving a grant to the weekly so that it could get back on its feet. Crowds of people followed the government’s appeal to march in protest throughout the land: they held pencils to symbolize press freedom and applauded the state security police and the marksmen posted on the rooftops. The logo “Je suis Charlie” (“I am Charlie”), written in white letters against a black background, could be seen everywhere: on our screens, in the streets, on restaurant menus. Children came home from school with a letter C written on their hands. Kids aged 7 and 8 were interviewed at the school gates and asked for their thoughts on the horror of the events and the importance of one’s freedom to draw caricatures. The government decreed that anyone who failed to toe the line would be punished. -

Family Types and the Persistence of Regional Disparities in Europe
Bruges European Economic Research Papers http://www.coleurop.be/eco/publications.htm Family Types and the Persistence of Regional Disparities in Europe Gilles Durantona, Andrés Rodríguez-Poseb,c and Richard Sandallb BEER paper n ° 10 March 2007 a Department of Economics, University of Toronto. b Department of Geography and Environment, London School of Economics. c Corresponding author: Andrés Rodríguez-Pose, Department of Geography and Environment, London School of Economics. Houghton St, London WC2A 2AE, UK Abstract This paper examines the association between one of the most basic institutional forms, the family, and a series of demographic, educational, social, and economic indicators across regions in Europe. Using Emmanuel Todd’s classification of medieval European family systems, we identify potential links between family types and regional disparities in household size, educational attainment, social capital, labour participation, sectoral structure, wealth, and inequality. The results indicate that medieval family structures seem to have influenced European regional disparities in virtually every indicator considered. That these links remain, despite the influence of the modern state and population migration, suggests that either such structures are extremely resilient or else they have in the past been internalised within other social and economic institutions as they developed. Keywords: Institutions, family types, education, social capital, labour force participation, economic wealth and dynamism, regions, Europe. JEL Classification: J12, O18, O43, R11. Family Types and the Persistence of Regional Disparities in Europe1 Gilles Duranton, Andrés Rodríguez-Pose and Richard Sandall BEER paper n° 10 1. Introduction The role of institutions as factors shaping human activity has attracted enormous attention in recent years. -

Who Is Emmanuel Todd?
Am Soc (2017) 48:476–477 DOI 10.1007/s12108-017-9349-x Who is Emmanuel Todd? Julien Larregue1 Published online: 6 June 2017 # Springer Science+Business Media New York 2017 In this special issue devoted to contemporary French sociology, political scientist Anne Verjus sheds light on the intense controversy that followed the publication of Emmanuel Todd’s Who is Charlie? in the aftermath of the Charlie Hebdo terrorist attacks in Paris (Verjus 2017; Verjus’ defense of Todd is only applicable to Who is Charlie? and should not be extended to his recent communications during the French presidential election). From his own words, Todd’s ambition was no less than to B[take] apart the infernal machinery that leads from a decaying or ‘zombie’ Catholicism to Islamophobia^ (Todd 2015, Preface to the English Edition). But before answering the question Who is Charlie? maybe we should first ask, who is Emmanuel Todd? Todd was born in Saint-Germain-en-Laye (a mid-sized town located in the Paris suburbs) in 1951. His social origins are important to notice, for Todd has inherited an important volume of cultural capital. His father, Olivier Todd, is a renowned leftist journalist who wrote several novels and biographies of prominent French authors (including Albert Camus and André Malraux). Todd’s mother, Anne-Marie Nizan, was born from communist journalist and philosopher Paul-Yves Nizan. This cultural capital would play a determinant role in Emmanuel Todd’s trajectory. Historian Emmanuel Le Roy Ladurie, a friend of Todd’s parents who today holds the Chaire d’histoire de la civilisation moderne at the prestigious Collège de France, would become Todd’s mentor and train him in the discipline of historical anthropology. -

French Anti-Americanism (1930-1948) Review ESSAY
H-Diplo Review Essay: Irwin Wall on Seth D. Armus, French Anti-Americanism (1930-1948) Review ESSAY Seth D. Armus. French Anti-Americanism (1930-1948): Critical Moments in a Complex History. Lanham, MD: Lexington Books, 2007. pp. x, 179. ISBN-10: 0739112686, ISBN-13: 978-0739112687. $60.00. by Irwin Wall, Professor Emeritus, University of California, Riverside and Visiting Scholar, NYU Published by H-Diplo on 11 June 2007 nti-Americanism, Seth Armus reminds us, has long been a permanent feature of French cultural life; it is a cultural trope, an idée fixe, that exists independently as a mode of intellectual discourse quite independently of American government policies and behavior. Of course such behavior influences it strongly, and the recent crisis over Iraq has brought it once again to the fore. This revival has also stimulated an outpouring of studies, some of them extraordinary, and it should be said at the outset that Philippe Roger’s work, now available in English, has become an instant classic, required reading on the subject.1 Roger traces anti-Americanism back to the eighteenth century, when French naturalists believed that life in the Americas was of necessity savage, brutish, short, and destructive of civilization. He takes us through several critical periods in its development, from the early national period through the Civil and Spanish-American wars, when the specter of American imperialism first began to frighten Europeans, through the 1920s and 1930s, and the postwar period. The merit of Armus’s study is to focus in on one such critical moment, the period from 1930 to 1948, which in his telling became a defining moment, in which anti-Americanism developed into an obsession with some thinkers, a world-view and an ideology almost in itself. -

From Model to Menace: French Intellectuals and American Civilization
Matsumoto Reiji(p163)6/2 04.9.6 3:17 PM ページ 163 The Japanese Journal of American Studies, No. 15 (2004) From Model to Menace: French Intellectuals and American Civilization Reiji MATSUMOTO* I The international debate about the Iraqi War once again brought to light a difference between Europe and America. Particularly striking was the French initiative to criticize American unilateralism, which aroused the resentment of the American people and provoked the Secretary of Defense to speak of “punishing” France. Jacques Chirac’s determined resistance to the Bush Administration’s war policy was countered with Donald Rumsfeld’s angry complaint against “old Europe.” Not only did the diplomats and politicians of the two countries reproach each other, but also in public opinion and popular sentiments, mutual antipathy has been growing on both sides of the Atlantic. The French government questioned the legitimacy of the Iraqi War and criticized American occupational policies. As far as these current issues are concerned, a diplomatic compromise will be possible and is to be reached in the process of international negotiation. The French gov- ernment’s bitter criticism of U.S. diplomacy, however, raised a more general question about the American approach to foreign affairs. In spite of the unanimous sympathy of the international community with American people after the disaster of September 11th, the Bush Administration’s Copyright © 2004 Reiji Matsumoto. All rights reserved. This work may be used, with this notice included, for noncommercial purposes. No copies of this work may be distributed, electronically or otherwise, in whole or in part, without permission from the author. -

IFE Course Syllabus
IFE course syllabus Course title The Foundations of French Politics, Policies, and Institutions, Yesterday and Today Course taught by Pascal Cauchy is Professor of History and former Dean of the Doctoral School at the Institut d’Etudes Politiqiques de Paris (“Sciences Po”). Pascal also served Sciences Po as Dean of International Studies and is currently attached to that institution’s Center for History both as researcher and administrator. Pascal joined Sciences Po after nine years of research and teaching in Moscow and is a specialist in the historiography of communism. He has published “A History of the IVth Republic” (Presses Universitaires de France) and is currently researching the work of Blandine Kriegel, a historian of communism. Purpose of the course The purpose of this course is to help students grasp fundamental notions of French society today by studying the roots and the development of the main institutions and concepts of French political life. This course in turn contributes to the overall purpose of the IFE preparatory session which is to equip students to participate as fully as possible in French professional life and social and political discussion. It should be seen as a companion course to “Structure, Transformation and Issues in French Society”. The course aims at a thorough familiarity with the politically and institutionally constitutive elements of contemporary France by examining how history shaped institutions and outlooks which in turn shape France today. Description of the course The course is taught in two parts, or “modules”, the frst one focusing on the foundations and structures of the French State and the second on the French State in a European and international context from a historical perspective. -

Anti-Americanism and Americanophobia : a French Perspective
ANTI-AMERICANISM AND AMERICANOPHOBIA : A FRENCH PERSPECTIVE Denis Lacorne CERI/FNSP French anti-Americanism has never been as much the focus of debate as it is today. This is true both in France, where a crop of books has appeared on the subject, and in the United States, for reasons linked to the French refusal to support the American invasion of Iraq. Some authors have underlined the unchanging nature of the phenomenon, defining anti- Americanism as a historical “constant” since the 18th century, or again an endlessly repetitive “semantic block” to use Philippe Roger’s expression. Others, like Jean-François Revel, have tried to show what lay hidden behind such a fashionable ideology: a deep-rooted critique of economic liberalism and American democracy. Yet others, while rejecting the anti-American label, like Emmanuel Todd, have attempted to lift the veil and lay bare the weaknesses of American democracy and the extreme economic fragility of an American empire “in decline,” despite appearances.1 Contradictions and swings in public opinion What I propose to do here, rather than pick out historical constants, defend the virtues of the liberal model, or pontificate upon the inevitable decline of great empires, is to take a closer look at the contradictions of what I view as a changing and ambiguous phenomenon, a subject of frequent swings in public opinion. In The Rise and Fall of Anti-Americanism (1990) Jacques Rupnik and I pointed out that France is a heterogeneous country made up of countless different groups, every one of which has its “own” image of America, which frequently changes in the light of circumstances or political events. -

Who Is Charlie?: Xenophobia and the New Middle Class Emmanuel Todd
To purchase this product, please visit https://www.wiley.com/en-us/9781509505777 Who is Charlie?: Xenophobia and the New Middle Class Emmanuel Todd E-Book 978-1-509-50581-4 October 2015 $12.00 Paperback 978-1-509-50578-4 October 2016 $14.95 Hardcover 978-1-509-50577-7 September 2015 $19.95 DESCRIPTION In the wake of the attack on the offices of Charlie Hebdo in Paris on 7 January 2015, millions took to the streets to demonstrate their revulsion, expressing a desire to reaffirm the ideals of the French Republic: liberté, égalité, fraternité. But who were the millions of demonstrators who were suddenly united under the single cry of ‘Je suis Charlie’? In this probing new book, Emmanuel Todd investigates the cartography and sociology of the three to four million who marched in Paris and across France and draws some unsettling conclusions. For while they claimed to support liberal, republican values, the real middle classes who marched on that day of indignant protest also had a quite different programme in mind, one that was far removed from their proclaimed ideal. Their deep values were in fact more reminiscent of the most depressing aspects of France’s national history: conservatism, selfishness, domination and inequality. By identifying the anthropological, religious, economic and political forces that brought France to the edge of the abyss, Todd reveals the real dangers posed to all western societies when the interests of privileged middle classes work against marginalised and immigrant groups. Should we really continue to mistreat young people, force the children of immigrants to live on the outskirts of our cities, consign the poorer classes to the remoter parts of the country, demonise Islam, and allow the growth of an ever more menacing anti-Semitism? While asking uncomfortable questions and offering no easy solutions, Todd points to the difficult and uncertain path that might lead to an accommodation with Islam rather than a deepening and divisive confrontation. -

Interview of Emmanuel Todd by Olivier Berruyer, for the French Website: Les Crises.Fr
Interview of Emmanuel Todd by Olivier Berruyer, for the French website: les crises.fr http://www.les-crises.fr/todd-1-la-servitude-volontaire-de-la-france/ (5 installments) Translated by Anne-Marie de Grazia Olivier Berruyer: Mr.Todd, how do you see the present crisis with Russia ? Emmanuel Todd: There’s something strange, unreal in the present international system. Something isn’t right: the whole world is lashing out on Russia, a country of only 145 million inhabitants, which has sprung back, it’s true, but which nobody can imagine will become again a dominant power on the planetary, or even the European scale. The strength of Russia is basically defensive. Maintaining the integrity of its immense territory with such a small population, comparable to the size of Japan’s, is already problematic. Russia is a balancing power: its nuclear arsenal and its energetic autonomy allow it to play as a counterweight to the United States. It can afford to welcome Snowden and, paradoxically, contribute in this way to the defence of civil liberties in the West. But the hypothesis of Russia devouring Europe and the world is absurd. At the beginning of your career, you were much interested in Russia – even predicting its impending break-up. Nowadays, Russia has no longer the hegemonic level which the USSR once had, and despite the fact that Russia is much more democratic than was the USSR, it is treated much worse. For instance, when the USSR intervened in Czechoslovakia in 1968, sending in tanks, there were protests but in the end, the hysteria didn’t go on for weeks. -

40.Tracing the French Statute (Detail)
Tracing the French Statute on Religious Dress at School (Detail) • A cultural idea of “citizenship” whereby “citizenship” is created by the state and is premised on the ideas of “universalism” and “equality”, thus excluding the notion of “groups” or “collective rights” and entailing cultural assimilation to “Frenchness” for all. Taking the view that it is its duty to promote citizenship, namely on account of the attendant social cohesion that it generates, it is the state which, in France, creates citizenship. In exchange, it demands “unstinting political allegiance”.1 Consider Rousseau, whose thought continues to have an impact on France which cannot be overestimated: “There is […] a profession of purely civil faith, the articles of which the sovereign has the task of establishing, not exactly as religious dogmas, but as feelings of sociability without which it is impossible to be either a good citizen or a loyal subject”.2 Reference thus continues to be made to “the famous French need for a civil religion”.3 Thus, in France it is hardly an exaggeration to assert that the citizen does not have an identity independently from the state. A. In the words of article 1 of the Constitution of 4 October 1958, the French Republic is “indivisible” (“indivisible”).4 The governing idea is that of a unified state designed to give voice to an undifferentiated nation. The French conception of citizenship is abstract. It does not recognize any “horizontal” ties. In the words of Jacques Chirac, then President of the Republic, in a letter to Bernard Stasi, -

Towards a Sociology of Revolutionary Situations. Reflections on the Arab Uprisings Mounia Bennani-Chraïbi and Olivier Fillieule
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Serveur académique lausannois Revue française de science politique, 2012/5-6 (vol. 62) Towards a sociology of revolutionary situations. Reflections on the Arab uprisings Mounia Bennani-Chraïbi and Olivier Fillieule ‘Uprisings have a body with which one can engage in combat. Revolutions, on the other hand, have a lot in common with ghosts’. Metternich to Guizot, October 31st, 1847 When we contemplate the apparent domino-effect of upheavals precipitated by the rapid and unexpected fall of Ben Ali on January 14th, 2011, the first image that comes to mind is that of 1848’s ‘Springtime of the Peoples’, when a demonstration in the streets of Paris prompted three days of insurrection, the restoration of the Republic and, thanks to the telegraph, the railways and the rotary press, over ten days of uprisings across cities as distant as Berlin, Munich, Vienna, Milan and Venice. However, just as when considering the revolutions of 1848, we should be wary of overly generalizing interpretations that seek to describe the events of 2010–2012 as the product of a unified wave of insurrections. Aside from the trigger provided by Ben Ali’s downfall, the trajectory, and consequently the shape, taken by the Egyptian, Moroccan, Bahraini, Libyan, Yemeni, and Syrian uprisings were all very different.It is only if we do not understand their respective contexts or if we are blinded by a well-meaning enthusiasm that we may collectively refer to them as the ‘Arab revolutions’. It is too soon to tell if any of these movements can be labelled as revolutionary. -

A Thesis Fall, 1995
University of Alberta An Anthropological Examination of Family Structures in Canadian Historical Context by Joan Evelyn Popp :@ A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Mâster of Arts Department of Anthropology Edmonton, Al berta Fall, 1995 National Library Bibliothèque nationale I+Idm, du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliographiques 395 Weiringûm Street 395. rue Wellington OtiawaON K1AON4 Ottawa ON K1A ON4 Canada Canada The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Libmy of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prêter, distribuer ou copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette thèse sous papcr or electronic formats. la fome de microfiche/nlm, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor subs+mtialextracts from it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. For Brant and Grier Abstract Using a set of ideal-type models developed by Emmanuel Todd who posits a relationship between family structure and the values that inform the working out in practice of political ideology, this thesis examines and analyzes selected practices of Highland Scots, French-Canadian and English colonists and their descendants in rural Canadian contexts.