Du LATIFUNDIUM Au LATIFONDO
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Cave of the Nymphs at Pharsalus Brill Studies in Greek and Roman Epigraphy
The Cave of the Nymphs at Pharsalus Brill Studies in Greek and Roman Epigraphy Editorial Board John Bodel (Brown University) Adele Scafuro (Brown University) VOLUME 6 The titles published in this series are listed at brill.com/bsgre The Cave of the Nymphs at Pharsalus Studies on a Thessalian Country Shrine By Robert S. Wagman LEIDEN | BOSTON Cover illustration: Pharsala. View of the Karapla hill and the cave of the Nymphs from N, 1922 (SAIA, Archivio Fotografico B 326) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Wagman, Robert S. Title: The Cave of the Nymphs at Pharsalus : studies on a Thessalian country shrine / by Robert S. Wagman. Description: Boston : Brill, 2015. | Series: Brill studies in Greek and Roman epigraphy, ISSN 1876-2557 ; volume 6 | Includes bibliographical references and indexes. Identifiers: LCCN 2015032381| ISBN 9789004297616 (hardback : alk. paper) | ISBN 9789004297623 (e-book) Subjects: LCSH: Thessaly (Greece)—Antiquities. | Excavations (Archaeology)—Greece—Thessaly. | Inscriptions—Greece—Thessaly. | Farsala (Greece)—Antiquities. | Excavations (Archaeology)—Greece—Farsala. | Inscriptions—Greece—Farsala. | Nymphs (Greek deities) Classification: LCC DF221.T4 W34 2015 | DDC 938/.2—dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2015032381 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, ipa, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. issn 1876-2557 isbn 978-90-04-29761-6 (hardback) isbn 978-90-04-29762-3 (e-book) Copyright 2016 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. -

Exploring Agro-Towns and Inequality in Southern Italy Through a Collective
A new Mezzogiorno? Exploring agro-towns and inequality in Southern Italy through a collective agricultural system in Apulia, 1600-1900 “What do people do here? I once asked at a little town between Rome and Naples; and the man with whom I talked, shrugging his shoulders, answered curtly, „c‟è miseria‟, there‟s nothing but poverty… I have seen poverty enough, and squalid conditions of life, but the most ugly and repulsive collection of houses I ever came upon was the town of Squillace”.1 George Gissing’s ‘rambles’ through Southern Italy at the turn of the twentieth century led him to remark extensively on the topography. In particular, he frequently mentioned the miserable living conditions of the people he encountered who tended to live huddled together in large impoverished towns. His account is made all the more interesting by the fact that (a) Southern Italy is today more economically disadvantaged than Northern Italy with some of the poorest social and economic infrastructures in Western Europe,2 and (b) this habitation pattern within large towns has been retained in large parts of modern Southern Italy. While alternative settlement patterns do exist in Southern Italy including small villages and isolated farms, it is undeniable that the distribution of large concentrated towns is prolific.a It is also a settlement structure often seen in other areas of the Mediterranean such as in central and southern parts of the Iberian Peninsula, regions of mainland Greece, and in parts of Northern Africa. These large agglomerated settlements are often referred to as ‘agro-towns’, pointing to their essentially agricultural function. -

The Transformation to the Early Middle Ages
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES From the Light and into the Dark: The Transformation to the Early Middle Ages Arrush Choudhary College of Arts and Science, Vanderbilt University From a historic perspective, the period of Roman rule and the following Middle Ages are po- lar opposites. For most, the city of Rome and the Western Roman Empire represent a time of advancement for the Mediterranean world while the Middle Ages are viewed as a regression of sorts for Europe. The reasons explaining the underlying cause of this transition from the West- ern Roman Empire to the Middle Ages are numerous but this paper will specifically focus on the practices started by the Romans themselves and how they contributed to the rise of the Early Middle Ages on the Italian Peninsula. More specifically, economic turmoil and urbanization fol- lowing the 3rd century crisis in the city of Rome laid the groundwork for social, legislative, and political changes that thread the path to the fundamental characteristics of the Middle Ages. Changing views of the city and the countryside, the construction of latifundia and villas, and the passing of legislation that restricted the rights of laborers, in addition to other transformations in late Rome, all contributed to the decentralized governance, rural life, and serfdom that are characteristic of the Middle Ages. Ultimately, the goal of this paper is to illustrate that despite the major differences that exist between the Roman period and the Middle Ages, the practices of the late Western Roman Empire were often directly carried over into the Middle Ages and, as a result, for one to truly understand the origins of the Middle Ages, it is essential to comprehend the traditions started by the late Romans. -

The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476)
Impact of Empire 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd i 5-4-2007 8:35:52 Impact of Empire Editorial Board of the series Impact of Empire (= Management Team of the Network Impact of Empire) Lukas de Blois, Angelos Chaniotis Ségolène Demougin, Olivier Hekster, Gerda de Kleijn Luuk de Ligt, Elio Lo Cascio, Michael Peachin John Rich, and Christian Witschel Executive Secretariat of the Series and the Network Lukas de Blois, Olivier Hekster Gerda de Kleijn and John Rich Radboud University of Nijmegen, Erasmusplein 1, P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, The Netherlands E-mail addresses: [email protected] and [email protected] Academic Board of the International Network Impact of Empire geza alföldy – stéphane benoist – anthony birley christer bruun – john drinkwater – werner eck – peter funke andrea giardina – johannes hahn – fik meijer – onno van nijf marie-thérèse raepsaet-charlier – john richardson bert van der spek – richard talbert – willem zwalve VOLUME 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd ii 5-4-2007 8:35:52 The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476) Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C. – A.D. 476) Capri, March 29 – April 2, 2005 Edited by Lukas de Blois & Elio Lo Cascio With the Aid of Olivier Hekster & Gerda de Kleijn LEIDEN • BOSTON 2007 This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC 4.0 License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. -

The Monumental Villa at Palazzi Di Casignana and the Roman Elite in Calabria (Italy) During the Fourth Century AD
The Monumental Villa at Palazzi di Casignana and the Roman Elite in Calabria (Italy) during the Fourth Century AD. by Maria Gabriella Bruni A dissertation submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classical Archaeology in the GRADUATE DIVISION of the UNIVERSITY OF CALIFORNIA Committee in Charge Professor Christopher H. Hallett, Chair Professor Ronald S. Stroud Professor Anthony W. Bulloch Professor Carlos F. Noreña Fall 2009 The Monumental Villa at Palazzi di Casignana and the Roman Elite in Calabria (Italy) during the Fourth Century AD. Copyright 2009 Maria Gabriella Bruni Dedication To my parents, Ken and my children. i AKNOWLEDGMENTS I am extremely grateful to my advisor Professor Christopher H. Hallett and to the other members of my dissertation committee. Their excellent guidance and encouragement during the major developments of this dissertation, and the whole course of my graduate studies, were crucial and precious. I am also thankful to the Superintendence of the Archaeological Treasures of Reggio Calabria for granting me access to the site of the Villa at Palazzi di Casignana and its archaeological archives. A heartfelt thank you to the Superintendent of Locri Claudio Sabbione and to Eleonora Grillo who have introduced me to the villa and guided me through its marvelous structures. Lastly, I would like to express my deepest gratitude to my husband Ken, my sister Sonia, Michael Maldonado, my children, my family and friends. Their love and support were essential during my graduate -

Quod Omnium Nationum Exterarum Princeps Sicilia
Quod omnium nationum exterarum princeps Sicilia A reappraisal of the socio-economic history of Sicily under the Roman Republic, 241-44 B.C. Master’s thesis Tom Grijspaardt 4012658 RMA Ancient, Medieval and Renaissance Studies Track: Ancient Studies Utrecht University Thesis presented: June 20th 2017 Supervisor: prof. dr. L.V. Rutgers Second reader: dr. R. Strootman Contents Introduction 4 Aims and Motivation 4 Structure 6 Chapter I: Establishing a methodological and interpretative framework 7 I.1. Historiography, problems and critical analysis 7 I.1a.The study of ancient economies 7 I.1b. The study of Republican Sicily 17 I.1c. Recent developments 19 I.2. Methodological framework 22 I.2a. Balance of the sources 22 I.2b. Re-embedding the economy 24 I.3. Interpretative framework 26 I.3a. Food and ideology 27 I.3b. Mechanisms of non-market exchange 29 I.3c. The plurality of ancient economies 32 I.4. Conclusion 38 Chapter II. Archaeology of the Economy 40 II.1. Preliminaries 40 II.1a. On survey archaeology 40 II.1b. Selection of case-studies 41 II.2. The Carthaginian West 43 II.2a. Segesta 43 II.2b. Iatas 45 II.2c. Heraclea Minoa 47 II.2d. Lilybaeum 50 II.3. The Greek East 53 II.3a. Centuripe 53 II.3b. Tyndaris 56 II.3c. Morgantina 60 II.3d. Halasea 61 II.4. Agriculture 64 II.4a. Climate and agricultural stability 64 II.4b. On crops and yields 67 II.4c. On productivity and animals 70 II.5. Non-agricultural production and commerce 72 II.6. Conclusion 74 Chapter III. -

ATINER's Conference Paper Series LNG2015-1524
ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: LNG2014-1176 Athens Institute for Education and Research ATINER ATINER's Conference Paper Series LNG2015-1524 Applying Current Methods in Documentary Linguistics in the Documentation of Endangered Languages: A Case Study on Fieldwork in Arvanitic Efrosini Kritikos Independent Researcher Harvard University USA 1 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: LNG2015-1524 An Introduction to ATINER's Conference Paper Series ATINER started to publish this conference papers series in 2012. It includes only the papers submitted for publication after they were presented at one of the conferences organized by our Institute every year. This paper has been peer reviewed by at least two academic members of ATINER. Dr. Gregory T. Papanikos President Athens Institute for Education and Research This paper should be cited as follows: Kritikos, E. (2015). "Applying Current Methods in Documentary Linguistics in the Documentation of Endangered Languages: A Case Study on Fieldwork in Arvanitic", Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: LNG2015-1524. Athens Institute for Education and Research 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece Tel: + 30 210 3634210 Fax: + 30 210 3634209 Email: [email protected] URL: www.atiner.gr URL Conference Papers Series: www.atiner.gr/papers.htm Printed in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and Research. All rights reserved. Reproduction is allowed for non-commercial purposes if the source is fully acknowledged. ISSN: 2241-2891 19/07/2015 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: LNG2015-1524 Applying Current Methods in Documentary Linguistics in the Documentation of Endangered Languages: A Case Study on Fieldwork in Arvanitic Efrosini Kritikos Independent Researcher Harvard University USA Abstract Arvanitic is a language of Greece also called Arberichte or Arvanitika. -

Imray Charts and Books 2014 CATALOGUE ABOUT the IMRAY CATALOGUE
Imray charts and books 2014 CATALOGUE ABOUT THE IMRAY CATALOGUE For charts, see pages 1–16 Foreign language editions For books, see pages 17–34 Foreign language editions of various Imray pilots are available as follows: Our combined book and chart catalogue In German is designed to be used in conjunction Delius Klasing with the Imray Stock List and Order D ABC-Straße 21 Form which is published about three D-20354 times a year and gives details of prices Hamburg Imrays are an Admiralty Chart Agent and hold a good stock of corrected and current information on publication Telephone +49 40 339 667 0 www.delius-klasing.de Admiralty charts and publications for dates. The Stock List announces new areas frequented by yachtsmen. We also titles as they become available during In Italian stock of Admiralty Leisure charts and the season. It also lists publications that Edizioni Il Frangente I 37129 Verona, Via Gaetano publications. we distribute from other publishers Trezza, 12 Agent for Netherlands Hydrographic including Seaworthy in the United ) +39 045 801 2631 Department, Norwegian Hydrographic States, the RYA and Adlard Coles Fax +39 045 59 3881 Service, ANWB and Croatian www.frangente.com Nautical. In particular more general Hydrographic Office. titles and narratives from other In French We are also able to obtain charts from publishers which are not listed in this Vagnon the French, Spanish, German, Danish, catalogue appear in the Stock List. Full F 26 rue Jacob Swedish and Finnish hydrographic details of these are given on our 75006 Paris ) +33 1 42 34 96 69 departments. -

VENETIANS and OTTOMANS in the SOUTHEAST PELOPONNESE (15Th-18Th Century)
VENETIANS AND OTTOMANS IN THE SOUTHEAST PELOPONNESE (15th-18th century) Evangelia Balta* The study gives an insight into the historical and economic geography of the Southeast Peloponnese frorm the mid- fifteenth century until the morrow of the second Ottoma ill conquest in 1715. It necessarily covers also the period of Venetialll rule, whiciL was the intermezzo between the first and second perio.ds of Ottoman rule. By utilizing the data of an Ottoman archivrul material, I try to compose, as far as possible, the picture ())f that part of the Peloponnese occupied by Mount Pamon, which begins to t he south of the District of Mantineia, extends througlhout the D:istrict of Kynouria (in the Prefecture of Arcadia), includes the east poart of the District of Lacedaimon and the entire District of Epidavros Limira . Or. Evangelia Balta, Director of Studies (Institute for N1eohellenic Resea rch/ National Hellenic Research Foundation). Venetians and Oltomans in the Southeast Peloponnese 169 (in the Prefecture of Laconia), and ends at Cape Malea. 1 The Ottoman archival material available to me for this particular area comprises certain unpublished fiscal registers of the Morea, deposited in the Ba§bakal1lIk Osmal1lI Al"§ivi in Istanbul, which I have gathered together over the last decade, in the course of collecting testimonies on the Ottoman Peloponnese. The material r have gleaned is very fragmentary in relation to what exists and I therefore wish to stress that th e information presented here for the first time does not derive from an exhaustive archival study for the area. Nonetheless, despite the fact that the material at my disposal covers the region neither spatially nor temporarily, in regard to the protracted period of Ottoman rule, J have decided to discuss it here for two reasons: I. -

Ostia Antica from the Republic Through Late Antiquity
excerpt ACTA INSTITUTI ROMANI FINLANDIAE ACTA ACTA INSTITUTI ROMANI FINLANDIAE VOL. 47 IRF 1. Sylloge inscriptionum Christianarum veterum Musei Vaticani 23. The Roman Middle Republic 47 Ediderunt commentariisque instruxerunt sodales Instituti Romani Politics, religion, and historiography c. 400 - 133 B.C. Finlandiae curante HENRICO ZILLIACUS, 1-2, 1963. edited by CHRISTER BRUUN, 2000. [Out of print] 2. 1. Onomastic Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome 24. Magistrates and Assemblies. A Study of Legislative Practice in and Carthage by IIRO KAJANTO, 1963. [Out of print] Republican Rome by KAJ SANDBERG, 2001. 2. Biometrical Notes by HENRIK NORDBERG, 1963. [Out of print] 3. A Study of the Greek Epitaphs of Rome 25. Women, Wealth and Power in the Roman Empire by IIRO KAJANTO, 1963. [Out of print] by PÄIVI SETÄLÄ, RIA BERG et al., 2002. HARBOUR CITY: MULTICULTURAL A IN AND DEATH LIFE 3-4. Graffiti del Palatino 26. Vettius Agorius Praetextatus. A senatorial Life in Between raccolti ed editi sotto la direzione di VEIKKO VÄÄNÄNEN. by MAIJASTINA KAHLOS, 2002. 3. Paedagogium a cura di HEIKKI SOLIN e MARJA ITKONEN-KAILA, 1966. 27. Ostia e Portus nelle loro relazioni con Roma 4. Domus Tiberiana a cura di CHRISTER BRUUN e ANNA GALLINA ZEVI, 2002. LIFE AND DEATH IN A MULTICULTURAL a cura di PAAVO CASTRÉN e HENRIK LILIUS, 1970. 28. The Roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the Partes in 5. Studies in the Romanization of Etruria the Later Middle Ages ATRICK RUUN HARBOUR CITY: by P B et al., 1975. [Out of print] KIRSI SALONEN and CHRISTIAN KRÖTZL, 2003. -
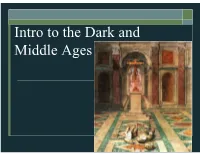
Intro to the Dark and Middle Ages Effects of the Fall of Rome
Intro to the Dark and Middle Ages Effects of the Fall of Rome Germanic tribes took over Roman lands. Hundreds of little kingdoms took the place of the Western Roman Empire in Europe. Initially, there was no system for collecting taxes. Kingdoms were always at war with one another. People lost interest in learning. Warfare increased. Trade decreased. The “Dark Ages” began. The “Dark Ages” Historians call the period following the fall of Rome the “Dark Ages.” Formally, this period is known as the beginning of the Middle Ages. It was a time of increased warfare, decreased trade, and a decline in learning. Disruption of Trade Merchants’ businesses were destroyed by barbarians Unsafe to trade No Trade = No Cultural Diffusion Downfall of Cities People retreat to countryside to evade invaders Lack of central government administration More people live in rural areas than urban centers Decline of Learning Germanic tribes were illiterate and had no written language Illiteracy + Lack of Written Language = NO VALUE ON EDUCATION Loss of Common Language Germanic invaders did not speak Latin Various dialects form from mixing Latin and Germanic languages By the 800s, French and Spanish had evolved No Common Language = NO UNITY Germanic-style Government Allegiance to family tribes as opposed to a state No central authority; lack of an emperor No loyalty to a king; no “Hail Caesar” The Rise of Europe The Early Middle Ages During the early Middle Ages, Europe was a relatively backward region cut off from the advanced civilizations of Byzantium, the Middle East, China and India. Between 700 and 1000, Europe was battered by invaders. -

The Megarians’: a City and Its Philosophical School Matthias Haake, Westfälische Wilhelms-Universität
McGill University Library and Archives Montreal, QC・2018 Copyright © Individual Contributors, 2018 The contents of this work are protected under a Creative Commons 4.0 Attribution-NonCommercial-4.0 International License (https://creativecommons.org/ licenses/by-nc/4.0). Edited by Hans Beck and Philip J. Smith Published by McGill University Library and Archives 3459 rue McTavish, Montreal, Quebec H3A 0C9 www.mcgill.ca/library Created in Canada. Online version accessible at http://teiresias-supplements.mcgill.ca Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Megarian Moments. The Local World of an Ancient Greek City-State / edited by Hans Beck and Philip J. Smith. ISBN 978-1-77096-223-1 (Teiresias Supplements Online, Volume 1) Teiresias Supplements Online / edited by Hans Beck and Fabienne Marchand PDF layout and design by Hans Beck and Fabienne Marchand. Front cover design by Émilie Lucas. Photograph: the Fountain House of Theagenes at Megara, copyright © Hans Beck. 1. Megara (Greece)--Mediterranean Region--Antiquities--Localism !2. Mediterranean Region--Antiquities. I. Beck, Hans, 1969-, author, editor II. Smith, Philip J., 1965-, author, editor III. Megarian Moments. The Local World of an Ancient Greek City-State Editorial Board Series Editors HANS BECK, McGill University, Montreal – [email protected] FABIENNE MARCHAND, Université de Fribourg – [email protected] Editorial Board BRENDAN BURKE, University of Victoria, British Columbia DENIS KNOEPFLER, Collège de France, Paris LYNN KOZAK, McGill University, Montreal CATHERINE MORGAN, Oxford University NIKOLAOS PAPAZARKADAS, University of California, Berkeley GREG WOOLF, Institute of Classical Studies, London Honorary Board Member ALBERT SCHACHTER, McGill University, Montreal Editorial Assistant CHANDRA GIROUX, McGill University, Montreal Series Preface This volume is the first publication in the new series ‘Teiresias Supplements Online’ (TSO), an open access venue for the publication of high-end research in Classical Studies.