1 Table Des Matières
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
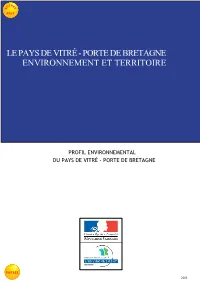
Le Pays De Vitré - Porte De Bretagne Environnement Et Territoire
TRE U S A PAYS LE PAYS DE VITRÉ - PORTE DE BRETAGNE ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU PAYS DE VITRÉ - PORTE DE BRETAGNE ENTRÉE 2003 TRE U S A PAYS Le Pays de Vitré - Préambule - Préambule - Après une présentation générale du Pays, le profil environnemental présenté dans les pages qui suivent est abordé sous l’angle de huit thématiques : 1. biodiversité et milieux naturels 2. qualité du cadre de vie (paysage, patrimoine) 3. prélèvement des ressources naturelles 4. production et consommation énergétique 5. risques naturels et technologiques 6. production de pollution et qualité des milieux 7. déchets 8. implication des acteurs et de la population Pour chacune de ces thématiques, sont déclinés successivement : un diagnostic synthétique, un bilan environnemental (forces - faiblesses, opportunités). Ce diagnostic synthétique est fondé sur les éléments de connaissance disponibles résultant d’inventaires naturalistes (ZNIEFF), de l’état des protections mises en place, de statistiques (INSEE, RGA, observatoires régionaux), de suivis administratifs et techniques (Agence de l’Eau, DRIRE) … Les cartes présentées résultent d’un traitement géographique des données, soit que certaines aient fait l’objet d’un géoréférencement (notamment celles relatives à la biodiversité), soit qu’elles puissent être rapportées à une unité territoriale géoréférencée (commune, canton). Le champ de l’environnement ainsi abordé privilégie une approche territoriale - état des milieux et du territoire, et pressions s’y exerçant -, dans l’optique de mettre en évidence les interactions entre les activités humaines d’une part, et l’état des territoires et des milieux d’autre part. Ne sont pas abordés certains thèmes, habituellement considérés comme relevant au sens large du champ de l’environnement, telle la santé publique. -

Centre Scolaire De LA GUERCHE DE BRETAGNE: Circuits Spécifiques
20/08/2021 Centre scolaire de LA GUERCHE DE BRETAGNE: circuits spécifiques. U01 MATIN U01 MERCREDI MIDI Fréquence: LMMJV-- Transporteur: RGO Mobilités Fréquence: --M---- Transporteur: RGO Mobilités MA01.00L EANCÉ EGLISE 07:26 0863.000 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE COLLEGE ST- 12:35 CI01.010 MARTIGNÉ-FERCHAUD AV DU GENERAL DE 07:40 JOSEPH GAULLE 1799.000 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE COLLEGE DES 12:38 CI01.001 FORGES-LA-FORÊT PARKING 07:51 FONTAINES MA01.037 CHELUN EGLISE 08:04 MA01.037_2 CHELUN EGLISE 13:03 2131.000 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ECOLE-PUBLIQUE 08:16 CI01.001_2 FORGES-LA-FORÊT PARKING 13:16 1799.000 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE COLLEGE DES 08:16 CI01.010 MARTIGNÉ-FERCHAUD AV DU GENERAL DE 13:34 FONTAINES GAULLE 0863.000 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE COLLEGE ST- 08:20 MA01.00L_2 EANCÉ EGLISE 13:50 JOSEPH Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. -

La Sectorisation Des Transports Scolaires 2020-2021 En Ille-Et-Vilaine
La sectorisation des transports scolaires 2020-2021 en Ille-et-Vilaine COLLÈGES LYCÉES COMMUNES SECTEURS PUBLICS SECTEURS PRIVÉS SECTEURS PUBLICS SECTEURS PRIVÉS Acigné Noyal-sur-Vilaine Liffré Liffré/Cesson-Sévigné Rennes / Cesson-Sévigné Amanlis Janzé Janzé Rennes Rennes / Retiers / Cesson-Sévigné Andouillé-Neuville St-Aubin-d’Aubigné St-Aubin-d’Aubigné Liffré St-Grégoire Arbrissel La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Vitré Retiers Argentré-du-Plessis Vitré Argentré-du-Plessis Vitré Vitré Aubigné St-Aubin-d’Aubigné St-Aubin-d’Aubigné Liffré St-Grégoire Availles-sur-Seiche La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Vitré Vitré Baguer-Morvan Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne St-Malo Dol-de-Bretagne Baguer-Pican Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne St-Malo Dol-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Redon Bains-sur-Oust Redon Redon Redon Redon Bais La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Vitré Vitré Balazé Vitré Vitré Vitré Vitré Baulon Guichen Guignen Bruz Bruz / Rennes Baussaine (la) Tinténiac Tinténiac Combourg Montauban-de-Bretagne Bazouge-du-Désert (la) St-Georges-de-R. St-Georges-de-R. Fougères Fougères Bazouges-la-Pérouse Val Couesnon (Tremblay) Val Couesnon (Antrain) Combourg Fougères Beaucé Fougères Fougères Fougères Fougères Bécherel Romillé Tinténiac Montfort-sur-Meu Montauban-de-Bretagne Bédée Montauban-de-Bretagne Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Montauban-de-Bretagne Betton Betton St-Grégoire Rennes St-Grégoire Billé Fougères Fougères Fougères Fougères Bléruais St-Méen-le-Grand -

Activité Jeunesse
Différentes propositions te sont faites chaque semaine des vacances : INFO JEUNES EN TOURNÉE Bléruais • Boisgervilly • Gaël • Irodouër • La Chapelle-du-Lou-du- Différentes propositions te sont faites chaque semaine des vacances : Lac • Landujan • Le Crouais • Médréac • Montauban-de-Bretagne • LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Le service info jeunes vient à ta rencontre pendant les Muël • Quédillac • St-Malon-sur-Mel • St-Maugan • LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI vacances. St-Méen-le-Grand • St-Onen-la-Chapelle • St-Pern • St-Uniac 9h 9h 10h LES Tu as un projet de voyage ? des 10h VENDREDIS interrogations existentielles ? 11h 11h MERCREDIS CUISINE besoin de t’émanciper ou alors de MERCREDIS 12h SPORTIFS LES MDJ MDJ ACTIVITÉ JEUNESSE 12h SPORTIFS (9h/13h30) trouver le stage de tes rêves… 13h P’TITS VACANCES D’HIVER 2021 13h ATELIERS Les informateurs jeunesse t’accompagnent dans tes 14h projets et répondent à toutes tes questions ! du lundi 22 février au vendredi 5 mars 14h 15h DU 15h Accueil gratuit et sans rendez-vous de 14h à 17h. 16h MDJ JEUDI MDJ MDJ 16h MDJ LE MARDI MDJ lundi 22/02 Salle des jeunes de Saint-Malon-sur-Mel 17h 17h C’EST SORTIE 18h vendredi 26/02 Mairie d’Irodouër 18h 19h lundi 01/03 Médiathèque de Muël 19h 20h vendredi 05/03 Espace culturel de Quédillac 20h 21h 21h 22h 22h 23h DES PAYS&MOI, semaine 23h de la mobilité internationale Comment s’inscrire ? Horaires d’ouverture des MDJ Tu as des questions sur la mobilité internationale ou un 1 – ADHÉRER au service jeunesse (dossier d’adhésion projet de voyage à l’étranger ? Le service jeunesse peut MDJ MONTAUBAN MDJ MÉDRÉAC t’aider à concrétiser tes envies d’ailleurs. -

La Sectorisation Des Transports Scolaires 2017-2018 COLLEGES LYCEES
FO-PDEV-0317-008_SectorisationDesTS.qxp 16/05/2017 15:19 Page1 La sectorisation des transports scolaires 2017-2018 COLLEGES LYCEES COMMUNES SECTEURS PUBLICS CSOEMCMTEUUNRESS PRIVES SECTEURS PUBLICS SECTEURS PRIVES Acigné Noyal-sur-Vilaine ALCifIfGréNE Cesson-Sévigné Rennes / Cesson-Sévigné Amanlis Janzé AJManAzNéLlS Rennes Rennes / Retiers / Cesson-Sévigné Andouillé-Neuville St-Aubin-d'Aubigné ASNt-DAOubUiInL-LdE'A-NubEiUgnVéILLE Rennes St-Grégoire Antrain-sur-Couesnon Tremblay AANnTtrRaAinIN Fougères Fougères Arbrissel La Guerche-de-Bretagne ALRaB GRuIeSrScEhLe-de-Bretagne Vitré Retiers Argentré-du-Plessis Vitré AARrgGeEnNtrTéR-dEu-D-PUle-sPsLisESSIS Vitré Vitré Aubigné St-Aubin-d'Aubigné ASUt-BAIuGbNinE-d'Aubigné Rennes St-Grégoire Availles-sur-Seiche La Guerche-de-Bretagne ALVaA GILuLeErSc-hSeU-dRe--SBErIeCtHagEne Vitré Vitré Baguer-Morvan Dol-de-Bretagne BDAoGl-UdeE-RB-rMetOagRnVeAN St-Malo Dol-de-Bretagne Baguer-Pican Dol-de-Bretagne BDAoGl-UdeE-RB-rPeItCagAnNe St-Malo Dol-de-Bretagne Baillé Maen Roch BMAaILeLnE Roch Fougères Fougères Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne BBAaIiNn-dDeE--BBrRetEaTgAnGeNE Bain-de-Bretagne Redon Bains-sur-Oust Redon BRAeIdNoSn-SUR-OUST Redon Redon Bais La Guerche-de-Bretagne BLAaI SGuerche-de-Bretagne Vitré Vitré Balazé Vitré BVAitLréAZE Vitré Vitré Baulon Guichen BGAuUigLnOeNn Bruz Bruz / Rennes Baussaine (la) Tinténiac BTAinUtéSnSiAacINE (LA) Combourg Montauban-de-Bretagne Bazouge-du-Désert (la) St-Georges-de-R. BSAt-ZGOeUorGgEe-sD-dUe--DRE.SERT (LA) Fougères Fougères Bazouges-la-Pérouse Tremblay BAAnZtrOaUinGES-LA-PEROUSE -

Power Inequality in Inter-Communal Structures
Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France Zineb Abidi, Matthieu Leprince, Vincent Merlin To cite this version: Zineb Abidi, Matthieu Leprince, Vincent Merlin. Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France. Economie et Prévision, Minefi - Direction de la prévision, 2020. halshs-02996998 HAL Id: halshs-02996998 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02996998 Submitted on 9 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Power Inequality in Inter-communal Structures: The Simulated Impact of a Reform in the Case of the Municipalities in Western France Zineb Abidi∗†‡ Matthieu Leprince§ Vincent Merlin¶ Abstract. This paper deals with an important issue concerning democratic government: how delegates are to be allocated among jurisdictions in a federal system. More precisely, we analyze the effect of the 2010 inter-municipal reform in France, which changed the allocation of delegates between municipalities within their inter-communal structures. Using the theory of power indices and a unique set of data gathering 377 inter-municipal structures for three French regions, we compare the fairness of the distribution of municipal delegates prior to the 2010 reform to that of the new distribution, by simulating the impact of the 2010 reform. -

Page De Garde Aide ACCESSION NEUF
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT AIDE A L’ACCESSION DANS LE NEUF Manoir de la Ville Cotterel 46, rue de St Malo BP 26042 35360 Montauban-de-Bretagne Tél. : 02 99 06 54 92 HABITAT www. stmeen-montauban .fr AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DANS LE NEUF MODALITÉS D’ATTRIBUTION (Par délibération n°2020/074/MaM du 25 juin 2020) Nature des opérations aidées Acquisition d’un bien neuf : - Avoir un prix inférieur ou égal à 1 500€ net vendeur (hors frais notarié) le m² de surface habitable. Acquisition d’un terrain : Superficie Communes Prix max max 80 € TTC le m ² Boisgervilly, Irodouër, La Chapelle du Lou du Lac, 500 m² OU Le Crouais, Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Uniac 40 000 € le lot 80€ TTC le m² Bléruais, Gaël, Landujan, Médréac, Muël, Quédillac, 550 m² OU Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, Saint-Pern 44 000€ le lot 95 € TTC le m ² Saint-Méen-Le-Grand 450 m² OU 40 000 € le lot 110 € TTC le m ² Montauban-de-Bretagne 380 m² OU 45 000 € le lot Montant de l’aide Communes Montant aide Boisgervilly, Irodouër, La Chapelle du Lou du Lac, Le 3 000€ Crouais, Saint -Onen -la -Chapelle, Saint -Uniac Bléruais, Gaël, Landujan, Médréac, Muël, Quédillac, 4 500€ Saint -Malon -sur -Mel, Saint -Maugan, Saint -Pern Saint-Méen-Le-Grand 4 500€ Montauban-de-Bretagne 3 000€ CCSMM - Aide à l’Accession à la propriété dans le neuf Juillet 2020 1 Bénéficiaires Le bénéficiaire doit : - Etre primo-accédant (ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années) ; - Respecter les plafonds de ressources suivants : Revenu fiscal de Nombre de personnes référence 1 24 740 € 2 32 990 € 3 38 160 € 4 42 284 € 5 et plus 46 398 € Engagements du ou des bénéficiaires En contrepartie de l’aide versée : - Le(s) bénéficiaire(s) s’engage(nt) à habiter dans le logement à titre de résidence principale, à ne pas le louer ou le vendre avant 5 ans à compter de la date d’attribution de l’aide. -

Le B-26 Marauder Miss Take Ne Répond Plus _____
Le B-26 Marauder Miss Take ne répond plus _____ Depuis le 6 juin 1944, date du débarquement en Normandie, le 391st Bomber Group (BG) basé au nord-est de Londres, enchaîne les missions de bombardement à l’ouest et au nord de l’hexagone. Ce groupe aérien dépend de la 9e Air Force américaine (USAAF) mise en action dès le début l’opération Overlord. Ses objectifs sont d’appuyer les troupes alliées au sol et de détruire tous les points stratégiques utilisés par l’ennemi. Il y a 75 ans, les occupants du bimoteur B-26 Marauder Miss Take du 391st BG ont vécu une aventure peu commune sur le département d’Ille-et-Vilaine. n début d’après-midi du samedi 8 juillet 1944, le lieutenant-colonel George W. E Stalnaker, commandant le 575th Bomber Squadron du 391st Bomber Group de l’USAAF, a bien l’intention de profiter d’une permission de deux nuits à Londres. Un repos bien mérité, pense-t-il, après six semaines de missions continues dans le cadre de l’opération Overlord. Mais vers 16 heures, la réalité de la guerre le rappelle dans la salle des opérations, pour reconnaître un nouvel objectif sur Nantes, précisément le pont de chemin de fer dit « de Pornic » enjambant la Loire. George Stalnaker est chargé de conduire une formation de 36 bombardiers B-26 Marauder prévus pour cette mission. En tant que « leader », il examine avec attention le plan de vol imposé et s’inquiète du tracé en rouge le Bimoteur Martin B-26 Marauder long de l’estuaire de la Loire. -

Conseil Municipal 28/02/2019
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28 février 2019 L'an deux mil dix-neuf, le vingt-huit février à vingt heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont réunis dans la salle de la mairie. Date de convocation du Conseil Municipal 12 février 2019 Date d’affichage de la convocation 12 février 2019 Nombre de conseillers en exercice 15 Nombre de conseillers présents 14 Etaient présents : LORAND Hubert MASSARD André PEILA-BINET Carine CRESPEL Vincent VERGER Joseph MASSARD Alain BOUGAULT Christine MÉAL Lydie LEPEIGNEUL Christine GOBIN Christophe RÉGEARD Blandine MARTEL Laurence ROLLAND Dominique LEBRETON David Excusée : POUESSEL Murielle A l’issue de la séance, sera présenté le Débat d’Orientations Budgétaires ************************ ORDRE DU JOUR : 1. Élection du secrétaire de séance 2. Compte-rendu du conseil municipal du 24 janvier 2019 FINANCES LOCALES 3. Budget principal et budgets annexes : comptes administratifs 2018 4. Demandes de subventions 2019 COMMANDE PUBLIQUE 5. Eglise – avenant négatif sur le lot n°2 6. Salle polyvalente – terrain de pétanque INTERCOMMUNALITÉ 7. Statuts – modification de la liste des membres et modification de la répartition des sièges DÉCISIONS – INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES Conseil municipal du 28 février 2019 Page 1 sur 8 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de rajouter l’ordre du jour suivant : FINANCES LOCALES 3bis – Comptes de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes Les membres du conseil municipal ACCEPTENT à l’unanimité. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE Madame Christine LEPEIGNEUL, conseillère municipale, est élue secrétaire de séance par le conseil municipal à l’unanimité des présents. COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 janvier 2019 Monsieur le Maire soumet le compte-rendu de la séance du 24 janvier 2019 au vote. -

Enquête Publique Avis
Secrétariat général Direction de la coordination interministérielle et de l'appui territorial Bureau de l'environnement et de l'utilité publique ENQUÊTE PUBLIQUE AVIS Par arrêté du 20 janvier 2021, le préfet informe les habitants de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, BEDEE, BOISGERVILLY, CARDROC, GEVEZE, IFFENDIC, IRODOUER, LA BAUSSAINE, LA CHAPELLE-DES- FOUGERETZ, LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC, LA NOUAYE, LE CROUAIS, LES IFFS, LANDUJAN, LONGAULNAY, MEDREAC, MINIAC-SOUS-BECHEREL, SAINT-M’HERVON (commune nouvelle de Montauban-de-Bretagne), PACE, PLOUASNE (22), SAINT-GONLAY, SAINT-MALON-SUR-MEL, SAINT- MAUGAN, SAINT-MEEN-LE-GRAND, SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE, SAINT-PERAN, SAINT-PERN, SAINT- THUAL, SAINT-UNIAC et TREFUMEL (22) , qu’une enquête publique sera ouverte, du 17 février 2021 (9h) au 19 mars 2021 (17h), sur la demande présentée par la S.A.R.L. CENTRALE BIOGAZ DE MONTAUBAN DE BRETAGNE, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale de mettre à jour le plan d'épandage de l'unité de méthanisation exploitée à MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, au lieu-dit "Le Pungeoir". Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier, comprenant notamment l’étude d’impact, l’étude de dangers, leurs résumés non techniques et l’avis de l’autorité environnementale, sera consultable gratuitement : - en mairie de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (version papier) aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 10h à 12h (uniquement sur rendez-vous entre 9h et 10h) - sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe Un poste informatique est mis à disposition du public dans le hall de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 3 avenue de la préfecture – 35000 Rennes, sur rendez-vous téléphonique (02.99.02.10.39), afin de permettre la consultation électronique du dossier. -

Document Inscription Et Classe De Seconde
Affectation et Inscription au lycée René CASSIN En classe de SECONDE Pour l’admission en classe de Seconde c’est le collège d’origine public ou privé (pour les élèves de 3 ème ) qui saisira les vœux demandés par les familles (Procédure Affelnet). Le lycée René Cassin est le lycée de secteur pour les communes de : Bécherel, Bédée, Bléruais, Boisgervilly, Breteil, Cardroc, La Chapelle Chaussée, La Chapelle du Lou du Lac, Clayes, Le Crouais, Gaël, Iffendic, Irodouer, Landujan, Médréac, Miniac sous Bécherel, Montauban, Monterfil, Montfort sur Meu, Muel, La Nouaye, Pleumeleuc, Quédillac, Romillé, Saint Gonlay, St Malon sur Mel, St Maugan, St Méen le Grand, St M’Hervon, St Onen la Chapelle, St Péran, St Pern, St Thurial, St Uniac, Talensac, Treffendel, Le Verger. Les résultats de l’affectation sont prononcés en juin par la Direction Académique et sont visibles par le biais de votre compte toutatice, téléservices, affectation. En classe de PREMIERE Pour l’admission en classe de Première Technologique STMG (au lycée René Cassin), c’est le lycée d’origine de l’élève qui saisira les vœux des familles (Procédure Affelnet). Le résultat de l’affectation sera prononcé en juin par la Direction Académique. L’établissement prendra contact avec la famille pour le dossier d’inscription. Pour l’admission en classe de Première Générale, c’est le lycée d’origine de l’élève qui remettra à la famille un dossier de candidature pour s’inscrire dans un autre établissement (Public). Ce dossier après validation du conseil de classe sera envoyé au lycée demandé en vœu 1 (2 vœux possibles). -

La Sectorisation Des Transports Scolaires 2018-2019
La sectorisation des transports scolaires 2018-2019 COLLÈGES LYCÉES COMMUNES SECTEURS PUBLICS SECTEURS PRIVÉS SECTEURS PUBLICS SECTEURS PRIVÉS Acigné Noyal-sur-Vilaine Liffré Cesson-Sévigné Rennes / Cesson-Sévigné Amanlis Janzé Janzé Rennes Rennes / Retiers / Cesson-Sévigné Andouillé-Neuville St-Aubin-d’Aubigné St-Aubin-d’Aubigné Rennes St-Grégoire Antrain-sur-Couesnon Tremblay Antrain Fougères Fougères Arbrissel La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Vitré Retiers Argentré-du-Plessis Vitré Argentré-du-Plessis Vitré Vitré Aubigné St-Aubin-d’Aubigné St-Aubin-d’Aubigné Rennes St-Grégoire Availles-sur-Seiche La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Vitré Vitré Baguer-Morvan Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne St-Malo Dol-de-Bretagne Baguer-Pican Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne St-Malo Dol-de-Bretagne Baillé Maen Roch Maen Roch Fougères Fougères Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Redon Bains-sur-Oust Redon Redon Redon Redon Bais La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Vitré Vitré Balazé Vitré Vitré Vitré Vitré Baulon Guichen Guignen Bruz Bruz / Rennes Baussaine (la) Tinténiac Tinténiac Combourg Montauban-de-Bretagne Bazouge-du-Désert (la) St-Georges-de-R. St-Georges-de-R. Fougères Fougères Bazouges-la-Pérouse Tremblay Antrain Combourg Fougères Beaucé Fougères Fougères Fougères Fougères Bécherel Romillé Tinténiac Montfort-sur-Meu Montauban-de-Bretagne Bédée Montauban-de-Bretagne Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Montauban-de-Bretagne Betton Betton St-Grégoire Rennes St-Grégoire Billé Fougères