Lanrivain (18:08:2016)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Centre Scolaire De Saint-Nicolas Du Pelem
Fiche Horaire Ligne : 030701 - ST GILLES PLIGEAUX - ST NICOLAS DU PELEM Validité du 02/09/2019 au 03/07/2020 Itinéraire : Speciaux COLLEGE - LYCEE : Oui Itinéraires 030701-1A Commune Point d'arrêt lm-jv--- KERPERT GARS AN CLOAREC (CARREF D69) 07:00 GUERNIOU (CONTAINER) 07:08 CENTRE 07:14 TOULLFOLL 07:17 SAINT-GILLES-PLIGEAUX KERGROAS 07:25 CENTRE( LOT. LES BRUYERES) 07:29 COLLEREDO (CARREFOUR D4) 07:33 CANIHUEL CENTRE 07:38 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM KERBELLEC 07:47 CANAC'H LERON 07:51 COLLEGE JEAN JAURES 07:55 Légende itinéraires 030701-1A - ST GILLES PLIGEAUX - ST NICOLAS DU PELEM est valide à partir du 21/12/2018 RETOUR COLLEGE - LYCEE : Oui Oui PRIMAIRES 4 JOURS : Non Oui Itinéraires 030701-2R 030701-1R Commune Point d'arrêt --m----- lm-jv--- SAINT-NICOLAS-DU-PELEM COLLEGE JEAN JAURES 12:40 16:40 CANAC'H LERON 12:44 16:44 KERBELLEC 12:48 16:48 CANIHUEL CENTRE 12:57 16:57 SAINT-GILLES-PLIGEAUX COLLEREDO (CARREFOUR D4) 13:02 17:02 CENTRE( LOT. LES BRUYERES) 13:06 17:06 KERGROAS 13:10 17:10 KERPERT TOULLFOLL 13:18 17:18 CENTRE 13:21 17:21 GUERNIOU (CONTAINER) 13:27 17:27 GARS AN CLOAREC (CARREF D69) 13:35 17:35 Légende itinéraires 030701-2R - ST NICOLAS DU PELEM - ST GILLES PLIGEAUX est valide à partir du 21/12/2018 030701-1R - ST-NICOLAS-DU-PELEM-ST-GILLES-PLIGEAUX est valide à partir du 21/12/2018 Fiche Horaire Ligne : 030702 - LANRIVAIN - ST-NICOLAS-DU-PELEM Validité du 02/09/2019 au 03/07/2020 Itinéraire : Speciaux COLLEGE - LYCEE : Oui Oui Itinéraires 030702-1A 030702-1A Commune Point d'arrêt lm-jv--- --m----- LANRIVAIN GUER LAGADEC -

Vivre À Saint-Nicolas-Du-Pélem Bulletin D'information Municipal
Vivre à Saint-Nicolas-du-Pélem Bulletin d’information Municipal Eté 2017 Numéro 7 Sommaire Conseil Municipal P.2 Des nouvelles de nos associations P.8 Pièces d’identité P.4 Le coin du citoyen P.10 Vie locale P.5 Pratique P.11 Dossiers P.7 Conseil Municipal Le conseil du 28 mars 2017 Principales délibérations prises en Conseil Municipal : Compte rendu du Conseil sur site de - Le conseil a adopté, le règlement la mairie : www.stnicolasdupelem.fr d’attribution et de versement des subventions communales aux associations. Ce règlement définit Le conseil du 24 janvier 2017 les conditions générales d’attribution, dans une volonté de transparence et d’équité vis-à-vis des - Le conseil autorise par convention, associations et des contribuables Pélémois. l’installation de miradors de chasse dans la forêt Communale de Beaucours, dans le but d’améliorer la Subventions 2017 : sécurité en battue. Adhésions, cotisations, - Intercommunalité : Le Conseil Municipal a participations obligatoires refusé le transfert au niveau communautaire de la Association des Maires de France 604.69 € compétence « Plan local d’urbanisme » et a accepté Stations vertes de vacances 832.00 € le principe d’initier, à l’échelle de la CCKB d’une démarche visant à la réalisation d’un document Conseil Général FSL Saint Brieuc 605.50 € urbanistique. FLAJ Mission locale 400.00 € RASED Rostrenen 171.00 € - Cartes d’identité : Depuis le 1er Décembre 2016, seulement 25 mairies du département sont Subventions budget habilitées à en délivrer. Saint Nicolas du Pélem en (subvention d'équilibre des budgets) Association foncière fait partie. Cela se traduit par une charge de travail 3 049.00 € importante pour les agents et un délai d’obtention St Nicolas du Pélem de titre sécurisé qui s’allonge. -

Centre Scolaire De ST NICOLAS DU PELEM: Circuits Spécifiques. 030701-1A
27/08/2021 Centre scolaire de ST NICOLAS DU PELEM: circuits spécifiques. 030701-1A - KERPERT - ST NICOLAS DU PELEM 030701-Rm - ST NICOLAS DU PELEM - KERPERT Fréquence: LMMJV-- Transporteur: Fréquence: --M---- Transporteur: TRANSPORTS TRANSPORTS LE PARC LE PARC KERPERT - GARS AN CLOAREC (CARREFOUR 07:15 2122_2 SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM COLLEGE JEAN 12:40 RD69) JAURES - SAINT-NICOLAS-DU-PELEM 510 KERPERT - CENTRE 07:21 145 CANIHUEL - CENTRE 12:45 2026 SAINT-GILLES-PLIGEAUX CENTRE( LOT. LES 07:28 24884 SAINT-GILLES-PLIGEAUX COLLEREDO 12:55 BRUYERES) - SAINT-GILLES-PLIGEAUX (CARREFOUR D4) - SAINT-GILLES-PLIGEAUX 24884 SAINT-GILLES-PLIGEAUX COLLEREDO 07:35 2026 SAINT-GILLES-PLIGEAUX CENTRE( LOT. LES 13:05 (CARREFOUR D4) - SAINT-GILLES-PLIGEAUX BRUYERES) - SAINT-GILLES-PLIGEAUX 145 CANIHUEL - CENTRE 07:40 510 KERPERT - CENTRE 13:12 2122 SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM COLLEGE JEAN 07:50 SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM - GARS AN CLOAREC 13:17 JAURES - SAINT-NICOLAS-DU-PELEM (CARREFOUR RD69) Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à la Région Bretagne pour validation. -

Secretariat General
PREFET DES COTES-D’ARMOR direction départementale Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration des territoires et de la mer en application de l'article L. 214-3 du code de service l'environnement relative au plan d’épandage des boues environnement de décantation issues de l’usine de production d’eau potable de Kerne-Uhel à Lanrivain Le Préfet des Côtes-d’Armor Chevalier de la Légion d’honneur Officier de l'ordre national du Mérite VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, l’article L 216-3 les articles L. 171-6 à 8 et L. 173-1, les articles R. 211-25 à R. 211-47 et les articles R. 214-1 et suivants ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. -
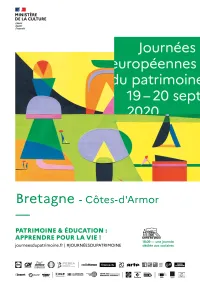
Programmation Côtes-D'armor
Bretagne - Côtes-d'Armor Plougrescant • • Trégastel • Louannec • Pleumeur-Bodou • Ploubazlanec Pleudaniel • • Paimpol • Lannion Ploëzal • • Lanleff Côtes-d'Armor • Plouzélambre • Erquy • Pléneuf-Val-André • Pordic • Plouisy Morieux • Lamballe-Armor • Créhen • • Beaussais-sur-Mer Saint-Péver • Saint-Brieuc • Planguenoual • Bourbriac • Hillion • Pléven • Langrolay-sur-Rance • Plédran • Lamballe Saint-Brandan •• Plaintel • Trégenestre Saint-Connan • Quessoy • • Taden • Quintin Dinan • • Lanvallay • Hénon Plélan-le-Petit • Léhon • Lanrivain • • Saint-Glen • Saint-Nicolas-du-Pélem Tréfumel • Évran • • Le Quiou Uzel • • Plouguenast-Langast Guitté Le Quillio • • Saint-Thélo • Gouarec • • Saint-Gelven • Guerlédan - Mûr-de-Bretagne Saint-Launeuc • • Loudéac JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 – BRETAGNE / COTES D’ARMOR* Détails sur le site programme : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ BEAUSSAIS-SUR-MER LANNION PLOUGRESCANT BOURBRIAC LANRIVAIN PLOUGUENAST-LANGAST CREHEN LANVALLAY PLOUISY DINAN LE FAOUËT PLOUZELAMBRE ERQUY LE QUILLIO PORDIC EVRAN LE QUIOU QUESSOY GOUAREC LEHON QUINTIN GUERLEDAN - MUR-DE- LOUANNEC SAINT-BRANDAN BRETAGNE LOUDEAC SAINT-BRIEUC GUITTE PAIMPOL SAINT-CONNAN GURUNHUEL PLAINTEL SAINT-GELVEN HENON PLEDRAN SAINT-GLEN HILLION PLELAN-LE-PETIT SAINT-LAUNEUC LAMBALLE PLENEUF-VAL-ANDRE SAINT-NICOLAS-DU-PELEM LAMBALLE-ARMOR - MORIEUX PLEUDANIEL SAINT-PEVER LAMBALLE-ARMOR - PLEUMEUR-BODOU TADEN PLANGUEMOUAL PLEVEN TREFUMEL LANGROLAY-SUR-RANCE PLOËZAL TREGASTEL LANLEFF PLOUBAZLANEC TREGENESTRE *Liste et informations -

Guingamp Rostrenen Guingamp
LIGNE GUINGAMP 21 ROSTRENEN LIGNE RENSEIGNEMENTS 21 Site internet : www.breizhgo.bzh du lundi au samedi de 8h à 20h. GUINGAMP | ROSTRENEN Contactez-nous via le formulaire en ligne : www.breizhgo.bzh/nous contacter PRIME TRANSPORT -50% sur votre abonnement grâce à la prime transport GUINGAMP BOURBRIAC KERIEN LANRIVAIN PLOUNEVEZ-QUINTIN ROSTRENEN Renseignez-vous auprès de votre employeur CONSEILS AUX VOYAGEURS MLP - 07/2020 • Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de passage prévue. • A l’approche du car, faites signe au conducteur. • Présentez votre carte d’abonnement ou achetez un ticket. Merci de préparer l’appoint. • Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. • Gardez avec vous les objets de valeur. • Les bagages encombrants sont autorisés dans les soutes et restent sous votre responsabilité. • Les animaux ne sont pas admis à bord des véhicules, exception faite des chiens guides d’aveugles et des animaux domestiques de petite taille transportés dans des paniers. • Retrouvez le règlement complet sur www.breizhgo.bzh. HORAIRES VALABLES • Groupe (+ 8 personnes), contactez le 02 96 68 31 39 DU 31/08/2020 AU 29/08/2021 Transdev - CAT Un service opéré par CS 90210 - 22002 ST-BRIEUC GUINGAMP > ROSTRENEN DU 31 AOÛT 2020 AU 29 AOÛT 2021 ligne 21 Période scolaire L______ __Me_V__ __Me____ VACANCES SCOLAIRES 2020/2021 (ZONE B) Période vacances scolaires et été I __Me_V__ __Me____ • Toussaint : 17 octobre au 1er novembre inclus • Noël : 19 décembre au 3 janvier inclus • Hiver : 20 février au 7 mars inclus Particularités de service A B • Printemps : 24 avril au 9 mai inclus GUINGAMP Gare Pôle d’échange 8:45 11:50 17:30 • Été : à partir du 7 juillet Place Vally / Piscine (vendredi matin) 8:50 11:53 17:33 Les jours fériés, BOURBRIAC Poste | 12:08 17:48 cette ligne ne circule pas Eglise 9:00 12:10 17:50 KERIEN Mairie | 12:21 18:01 Les horaires mentionnés peuvent faire l’objet d’une LANRIVAIN Le Guiaudet | 12:26 18:06 actualisation consultable Eglise | 12:28 18:08 sur le site breizhgo.bzh. -

GUINGAMP Rostrenen ROSTRENEN INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
LIGNE LIGNE GUINGAMP 21 21 GUINGAMP ROSTRENEN ROSTRENEN INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 0 810 22 22 22 0,06 € / min lundi au vendredi de 7h à 20h, samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h. www.tibus.fr [email protected] GUINGAMP BOURBRIAC KERIEN LANRIVAIN PLOUNEVEZ-QUINTIN ROSTRENEN Et suivez-nous sur Accueil TUB/TIBUS de St-Brieuc Accueil TIBUS de Lannion Gare routière - Rue du Combat des Trente Gare routière - SNCF Lundi au vendredi de 8h30 à 12h Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et de 13h30 à 17h30 Samedi de 8h30 à 13h Vous voyagez occasionnellement Vente à bord Ticket unique* 1 voyage .................................................................................................................................... 2 € Carnet de 10 tickets* 10 voyages ............................................................................................................................. 15 € Ticket combiné 1 voyage et 1 correspondance avec le réseau TUB ................................................ 2 € MLP - 07/2016 Ticket social* 1 aller-retour journée, réservé aux bénéficiaires de la carte social transport .... 1,60 € Vous voyagez régulièrement Vente en agence Carte mensuelle -50% er ....................................................sur votre abonnement € Voyages illimités du 1 au dernier jour du mois grâce à la prime 40 Carte annuelle transport Voyages illimités pendant 12 mois à compter de la date d’achat ............... 400 € ou 12 mensualités de 33,33 € Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant Carte scolaire ................................................................................................................. 115 € Ticket loisirs scolaires* 1 aller-retour journée, sur présentation de la carte scolaire .................................. 2,40 € Gratuit LE RÉSEAU DE TRANSPORT DES COSTARMORICAINS les enfants de moins de 5 ans, les personnes dont le taux d’incapacité HORAIRES DU 29 AOÛT 2016 permanente est au moins de 80% et voyageant seul ou son accompagnateur. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 Sur 99
20 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 99 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtes-d’Armor NOR : INTA1325462D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général des Côtes-d’Armor en date du 7 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département des Côtes-d’Armor comprend vingt-sept cantons : – canton no 1 (Bégard) ; – canton no 2 (Broons) ; – canton no 3 (Callac) ; – canton no 4 (Dinan) ; – canton no 5 (Guingamp) ; – canton no 6 (Lamballe) ; – canton no 7 (Lannion) ; – canton no 8 (Lanvallay) ; – canton no 9 (Loudéac) ; – canton no 10 (Mûr-de-Bretagne) ; – canton no 11 (Paimpol) ; – canton no 12 (Perros-Guirec) ; – canton no 13 (Plaintel) ; – canton no 14 (Plancoët) ; – canton no 15 (Plélo) ; – canton no 16 (Plénée-Jugon) ; – canton no 17 (Pléneuf-Val-André) ; – canton no 18 (Plérin) ; – canton no 19 (Pleslin-Trigavou) ; – canton no 20 (Plestin-les-Grèves) ; – canton no 21 (Ploufragan) ; – canton no 22 (Plouha) ; – canton no 23 (Rostrenen) ; – canton no 24 (Saint-Brieuc-1) ; . -

Kan Ba'r Bistro / Chant Au Comptoir
FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE Inventaire des pratiques vivantes liées aux expressions du patrimoine oral musical de Bretagne Lieux et occasions de pratique Veillées, soirées chantées, musicales et contées Kan ba'r bistro / Chant au comptoir Présentation sommaire Nom : Kan ba'r bistro / Chant au comptoir Région administrative : Bretagne Une danse chantée par les frères Morvan en fin de soirée lors du Kan Ba'r Bistro à La Chapelle Neuve le 23 septembre 2011 (photo Michel et Nicole Sohier) 1 FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE (A) Identification et localisation (1) Nom de la personne, de l’organisme, de la forme d’expression, de l’espace culturel Nom des personnes rencontrées : Goulven Le Gac est à l'initiative, avec son frère Gurvant Le Gac, de l'organisation des soirées "Kan Ba'r Bistro" (chant au comptoir) au café-restaurant "Le Kenhuel" au bourg de La Chapelle Neuve (22). Ils sont tous deux membres fondateurs de l'association "Jomezkeba'rgêr" ("Ne reste pas à la maison") créée pour gérer l'organisation de ces soirées. Localisation générale : Café-restaurant "Le Kenhuel" Commune de La Chapelle-Neuve, Côtes d'Armor Région administrative : Bretagne Ce café-restaurant est le lieu d'origine de cette pratique vivante qui a essaimé depuis plusieurs années dans d'autres cafés en Bretagne et ailleurs dans l'Hexagone (voir plus loin) Noluen Le Buhe, Kan ba'r bistro à La Chapelle Neuve (photo Michel et Nicole Sohier) 2 FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE (B) Description (1) Identification sommaire de la pratique En novembre 2008, le bar le Kenhuel à La Chapelle Neuve (22) accueillait le premier Kan Ba'r Bistro (chant au comptoir). -

Centre Scolaire De CARHAIX-PLOUGUER (29): Circuits Spécifiques
01/09/2020 Centre scolaire de CARHAIX-PLOUGUER (29): circuits spécifiques. CARHAIX - PLESIDY CARHAIX - PLESIDY Fréquence: L--J--- Transporteur: C.A.T. CIE 040306-1A Fréquence: L--J--- Transporteur: C.A.T. CIE ARMORIC. TRANSP ARMORIC. TRANSP 2454 GARE_LA - CARHAIX-PLOUGUER / CARHAIX- 07:10 2454 GARE_LA - CARHAIX-PLOUGUER / CARHAIX- 07:20 PLOUGUER PLOUGUER 877 CENTRE - LE MOUSTOIR / LE MOUSTOIR 07:20 877 CENTRE - LE MOUSTOIR / LE MOUSTOIR 07:30 9459 PIE_LA (AIRE DE REPOS) - PAULE / PAULE 07:25 9459 PIE_LA (AIRE DE REPOS) - PAULE / PAULE 07:35 13362 ROUTE ST BRIEUC (GARAGE PEUGEOT) - 07:35 13362 ROUTE ST BRIEUC (GARAGE PEUGEOT) - 07:45 ROSTRENEN / ROSTRENEN ROSTRENEN / ROSTRENEN 1593 MAIRIE (ARRET LR) - PLOUNEVEZ-QUINTIN / 07:45 1593 MAIRIE (ARRET LR) - PLOUNEVEZ-QUINTIN / 07:55 PLOUNÉVEZ-QUINTIN PLOUNÉVEZ-QUINTIN 623 EGLISE_PLACE DE L' - LANRIVAIN / LANRIVAIN 07:55 24205 AVAUGOUR_RUE D' - BOURBRIAC / BOURBRIAC 08:10 24205 AVAUGOUR_RUE D' - BOURBRIAC / BOURBRIAC 08:10 1193 COLLEGE DIWAN (D22) - PLESIDY / PLÉSIDY 08:20 1193 COLLEGE DIWAN (D22) - PLESIDY / PLÉSIDY 08:20 Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à la Région Bretagne pour validation. -

Date 1 Groupe 2 Et 3 Groupe 4 Groupe 97 85 76 113 98
Mois de Juillet - Départ 8h00 Date 1er groupe 2ème et 3ème groupe 4ème groupe Plouisy, Grâces, Moustéru, Rte de Callac, Bulat Plouisy, Grâces, Moustéru, Rte de Callac, Bulat Plouisy, Grâces, Moustéru, Rte de Callac, Bulat Dimanche 2 Pestivien, Kergrist Moelou, St Lubin, Plounévez Pestivien, Maël Pestivien, Lanrivain, St Nicolas du Pestivien, Maël Pestivien, Lanrivain, Kerpert, St Gilles Concentration de Quintin, St Nicolas du Pélem, Canihuel, St Gilles Pélem, Canihuel, St Gilles Pligeaux, La Clarté, Pligeaux, La Clarté, Ploumagoar, Guingamp, Plouisy Plouec du Trieux ou Pligeaux, La Clarté, Ploumagoar, Guingamp, Plouisy. Ploumagoar, Guingamp, Plouisy 97 85 76 Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Kerauzern, Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Kerauzern, Plouisy, St Laurent, Bégard, Pluzunet, Kerauzern, Lannion, St Michel en Grèves, Tréduder (par voie Ploumiliau, St Michel en Grèves, Tréduder (par voie Ploumiliau, Lanvellec, Plounérin, Beg Ar C'hra, romaine), Lanvellec, Beg Ar C'hra, Plounevez Moedec, romaine), Lanvellec, Beg Ar C'hra, Plounevez Moedec, Plounevez Moedec, Belle Isle en Terre, Gurunhuel, Dimanche 9 Belle Isle en Terre, Gurunhuel, Plougonver, Louargat, Belle Isle en Terre, Plougonver, Gurunhuel, Louargat, Gràces, Plouisy. Le Méné Bré, Pédernec, Kernilien, Plouisy. Plouisy. 113 98 85 Concentration des "Cyclos Plouisy" Dimanche 16 Route 43, 80 et 100 km, Vtt & Marche Plouisy, Plouagat, Rte de Quintin, Boquého, Col du Plouisy, Guingamp, Plouagat, Lanrodec, St Péver, Plouisy, Plouagat, Lanrodec, St Péver, Bourbriac, Machralat, St Péver, Bourbriac, Gurunhuel, Louargat, Bourbriac, Gurunhuel, Belle Isle en Terre, Plougonver, Gurunhuel, Plougonver, Route de Callac, Pont Melvez, Belle Isle en Terre, Plougonver, Bulat Pestivien, Pont Bulat Pestivien, Pont Melvez, Moustéru, Grâces, Dimanche 23 Moustéru, Grâces, Plouisy. -

Liste Des Communes Du Poher Leurs Canton, Arrondissement
Liste des communes du Poher leurs Canton, Arrondissement, Département Commune / Paroisse Canton Arrondissement Département Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Guingamp Côtes d'Armor Berné Faouët-(Le) Pontivy Morbihan Berrien Huelgoat Châteaulin Finistère Bolazec Huelgoat Châteaulin Finistère Bonen Rostrenen Guingamp Côtes d'Armor Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Guingamp Côtes d'Armor Botmel Callac Guingamp Côtes d'Armor Botmeur Huelgoat Châteaulin Finistère Botsorhel Plouigneau Morlaix Finistère Bourbriac Bourbriac Guingamp Côtes d'Armor Brasparts Pleyben Châteaulin Finistère Brennilis Pleyben Châteaulin Finistère Bulat-Pestivien Callac Guingamp Côtes d'Armor Burthulet Callac Guingamp Côtes d'Armor Calanhel Callac Guingamp Côtes d'Armor Callac Callac Guingamp Côtes d'Armor Canihuel Saint-Nicolas-du-Pélem Guingamp Côtes d'Armor Carhaix Carhaix-Plouguer Châteaulin Finistère Carnoët Callac Guingamp Côtes d'Armor Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou Châteaulin Finistère Cléden-Poher Carhaix-Plouguer Châteaulin Finistère Coadout Guingamp Guingamp Côtes d'Armor Coatquéau Huelgoat Châteaulin Finistère Collorec Châteauneuf-du-Faou Châteaulin Finistère Coray Châteauneuf-du-Faou Châteaulin Finistère Duault Callac Guingamp Côtes d'Armor Edern Briec Quimper Finistère Glomel Rostrenen Guingamp Côtes d'Armor Glomel-Saint-Michel Rostrenen Guingamp Côtes d'Armor Gouarec Gouarec Guingamp Côtes d'Armor Gouézec Briec Quimper Finistère Gourin Gourin Pontivy Morbihan Guellevain Briec Quimper Finistère Guéméné-sur-Scorff Guéméné-sur-Scorff Pontivy Morbihan