Schema De Structure Communal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
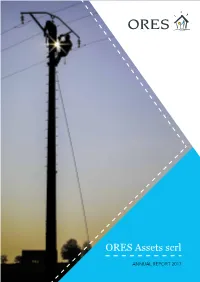
ORES Assets Scrl
ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

Votre Commune En Chiffres: Assesse
Votre commune en chiffres: Assesse Votre commune en chiffres: Assesse SPF Economie, DG Statistique et information ´economique SPF Economie, DG Statistique et information ´economique Votre commune en chiffres: Assesse Votre commune en chiffres: Assesse Introduction Assesse : Assesse est une commune de la province de Namur et fait partie de la R´egion wallonne. Ses communes voisines sont Ciney, Gesves, Hamois, Namur, Profondeville et Yvoir. Assesse a une superficie de 78,2 km2 et compte 6.610 ∗ habitants, soit une densit´ede 84,6 habitants par km2. 64% ∗ de sa population a entre 18 et 64 ans. Parmi les 589 communes belges, elle se situe `ala 213`eme y place par rapport au revenu moyen net par habitant le plus ´elev´eet `ala 366`eme z place par rapport aux prix des terrains `ab^atir les plus chers. ∗. Situation au 1/1/2011 y. Revenus de l'ann´ee2009 - Exercice d'imposition 2010 z. Ann´eede r´ef´erence : 2011 SPF Economie, DG Statistique et information ´economique Votre commune en chiffres: Assesse Votre commune en chiffres: Assesse Table des mati`eres 1 Table des mati`eres 2 Population Composition de la population Pyramide des ^ages pour Assesse 3 Territoire Densit´ede population pour Assesse et ses communes limitrophes Occupation du sol 4 Immobilier Prix des terrains `ab^atir en Belgique Prix des terrains `ab^atir pour Assesse et environs Prix des terrains `ab^atir : classement 5 Revenus Revenu annuel moyen net par habitant en Belgique Revenu annuel moyen net par habitant pour Assesse et environs Evolution du revenu annuel moyen net par habitant -

Taux De La Taxe Communale 2021 | SPF Finances
TAUX DE LA TAXE COMMUNALE (%) POUR L'EXERCICE D'IMPOSITION 2021 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z VILLE OU COMMUNE Taux (%) VILLE OU COMMUNE Taux (%) VILLE OU COMMUNE Taux (%) A Aalst 7,50 Anderlues 8,80 Assenede 7,00 Aalter 5,90 Anhée 8,50 Assesse 8,50 Aarschot 8,00 Ans 8,50 Ath 8,80 Aartselaar 4,90 Anthisnes 8,50 Attert 7,00 Affligem 7,00 Antoing 7,00 Aubange 8,00 Aiseau-Presles 8,50 Antwerpen 8,00 Aubel 7,70 Alken 7,00 Anzegem 8,00 Auderghem 6,00 Alveringem 8,00 Ardooie 6,00 Avelgem 7,00 Amay 8,50 Arendonk 7,00 Awans 8,50 Amel 6,00 Arlon 7,00 Aywaille 8,60 Andenne 8,60 As 7,50 Anderlecht 5,50 Asse 6,90 B Baarle-Hertog 7,20 Bertogne 6,00 Boutersem 7,60 Baelen 7,70 Bertrix 8,00 Braine-l'Alleud 5,90 Balen 8,00 Bever 8,00 Braine-le-Château 8,00 Bassenge 8,00 Beveren 5,00 Braine-le-Comte 8,80 Bastogne 7,50 Beyne-Heusay 8,50 Braives 8,00 Beaumont 8,80 Bierbeek 7,00 Brakel 8,00 Beauraing 8,00 Bièvre 6,00 Brasschaat 6,00 Beauvechain 7,00 Bilzen 7,90 Brecht 7,00 Beernem 7,80 Binche 8,00 Bredene 7,00 Beerse 6,90 Blankenberge 6,00 Bree 8,00 Beersel 6,90 Blegny 8,50 Brugelette 8,50 Begijnendijk 8,00 Bocholt 8,00 Brugge 6,90 Bekkevoort 7,60 Boechout 7,10 Brunehaut 8,20 Beloeil 8,50 Bonheiden 7,50 Buggenhout 7,80 Berchem-Sainte-Agathe 6,80 Boom 7,90 Büllingen 6,00 Beringen 7,60 Boortmeerbeek 5,80 Burdinne 8,00 Berlaar 7,80 Borgloon 8,50 Burg-Reuland 7,00 Berlare 7,00 Bornem 7,50 Bütgenbach 6,00 Berloz 8,50 Borsbeek 7,00 Bernissart 8,50 Bouillon 8,00 Bertem 7,50 Boussu 8,50 1/7 COMMUNES Taux (%) COMMUNES Taux (%) COMMUNES Taux (%) -

Sambreville Info FEVRIER / MARS 2017 1 2 Le Mot Du Bourgmestre
Sambreville info FEVRIER / MARS 2017 1 2 www.sambreville.be le mot du bourgmestre Chères concitoyennes, Chers concitoyens, onne et heureuse année 2017 à vous et tous ceux qui vous sont chers, espérant Bque l’an nouveau soit moins source d’in- quiétude et de questionnement de notre ma- nière de vivre ensemble que l’aura été 2016. En tout cas, le Collège communal de Sambre- ville compte bien user des 12 mois qui viennent pour poursuivre l’objectif prioritaire qu’il s’est fixé à l’occasion de la présente législature, à savoir : améliorer, à la mesure des moyens humains et financiers disponibles, le cadre et la qualité de vie de ses concitoyens. En 2017, le Collège commu- C’est ainsi qu’au cours de 2017, il sera nal de Sambreville compte procédé à la rénovation de notre salle bien poursuivre son objec- de spectacles et de notre piscine. tif prioritaire : améliorer, à la mesure des moyens humains Soucieux du développement durable et et financiers disponibles, le d’une réduction drastique de consom- cadre et la qualité de vie de mation énergétique, l’ensemble des ses concitoyens. châssis de l’Administration communale seront remplacés. Tout comme seront entièrement réhabilitées les rues Emile Vander- velde et de la Closière à Moignelée, du Try Joli d’Auvelais et la place du Louet à Arsimont, de la Gripelotte et l’impasse Botte à Auvelais. Sans compter que l’axe majeur pénétrant dans Auvelais fait des rues du Val de Sambre, des Glaces nationales et Romedenne se transfor- mera en un véritable « boulevard urbain », à la hauteur de l’attractivité que le Collège communal entend assurer à la commune et ses diffé- rents quartiers. -

Planning Nmaw 2020 - 2024
PLANNING NMAW 2020 - 2024 BEAUVECHAIN BASSENGE COMINES-WARNETON FLOBECQ GREZ-DOICEAU HELECINE VISE MOUSCRON MONT-DE-L'ENCLUS LA HULPE PLOMBIERES LA CALAMINE JODOIGNE OREYE OUPEYE DALHEM ELLEZELLES RIXENSART LINCENT JUPRELLE LESSINES WAVRE CRISNEE ESTAIMPUIS AUBEL CELLES WATERLOO BERLOZ WAREMME AWANS ORP-JAUCHE PECQ TUBIZE INCOURT REMICOURT HERSTAL LONTZEN FRASNES-LEZ-ANVAING ENGHIEN LASNE BLEGNY BRAINE-LE-CHATEAU CHAUMONT-GISTOUX ANS RAEREN REBECQ GEER THIMISTER-CLERMONT WELKENRAEDT OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE HANNUT FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER RAMILLIES HERVE BRAINE-L'ALLEUD DONCEEL ATH SILLY FAIMES SOUMAGNE ITTRE GRACE-HOLLOGNE MONT-SAINT-GUIBERT PERWEZ SAINT-NICOLAS LIEGE BEYNE-HEUSAY TOURNAI COURT-SAINT-ETIENNE WALHAIN WASSEIGES FLERON DISON LIMBOURG EUPEN BRAINE-LE-COMTE BRAIVES GENAPPE VERLAINE BRUGELETTE SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE OLNE LEUZE-EN-HAINAUT NIVELLES FLEMALLE VILLERS-LE-BOUILLET SERAING VERVIERS BAELEN EGHEZEE BURDINNE CHAUDFONTAINE CHASTRE PEPINSTER CHIEVRES LENS SOIGNIES TROOZ ANTOING ECAUSSINNES VILLERS-LA-VILLE ENGIS AMAY GEMBLOUX FERNELMONT WANZE RUMES SENEFFE NEUPRE HERON ESNEUX JALHAY BRUNEHAUT PERUWELZ BELOEIL JURBISE LES BONS VILLERS LA BRUYERE SPRIMONT HUY SOMBREFFE NANDRIN THEUX PONT-A-CELLES LE ROEULX SAINT-GHISLAIN MANAGE ANDENNE ANTHISNES FLEURUS COMBLAIN-AU-PONT TINLOT SPA BERNISSART MODAVE WAIMES LA LOUVIERE COURCELLES MARCHIN BUTGENBACH AYWAILLE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT JEMEPPE-SUR-SAMBRE NAMUR MONS MORLANWELZ SAMBREVILLE OUFFET MALMEDY QUAREGNON HAMOIR HENSIES FARCIENNES FLOREFFE OHEY BOUSSU GESVES STAVELOT CHARLEROI -

Ajustement Tactique Du Réseau Cible À Court Terme
Date : 27 avril 2021 Page 1 sur 2 Déploiement du réseau structurant intercommunal Express : ajustement tactique du réseau cible à court terme (document préparatoire au point 2.1.1 de l’Organe de Consultation du bassin de mobilité de Namur du 18 mai 2021) Plusieurs propositions émanant de Communes et de l’OTW, émises à la fois l’OCBM de Namur du 24 septembre 2020 et lors de réunions techniques, ont mené à une évolution du niveau de service des liaisons du réseau Express desservant le bassin de Namur. Lors de sa réunion du 24/09/2020, l’Organe avait émis « un avis favorable sur l’évolution de l’offre cible qui lui est soumise pour les liaisons Express suivantes : • Bastogne – Sainte-Ode Bastogne - Tenneville - Nassogne - Marche-en-Famenne (- Somme-Leuze - Namur) • Gembloux – Sombreffe – Fleurus – Charleroi • Gesves – Namur • Jodoigne – Incourt – Perwez – Ramillies – Eghezée – Namur • Nivelles – Genappe – Villers-la-Ville – Sombreffe – Namur • Philippeville – Florennes – Mettet – Fosses-la-Ville – Floreffe – Namur (informations générales) (informations • Sambreville - Jemeppe-sur-Sambre – Gembloux • Marche -Somme-Leuze-Havelange-Clavier -Tinlot-Nandrin-Neupré–Liège : 1718 : 1718 Pour la nouvelle liaison Ciney – Dinant, l’Organe recommande d’analyser son extension vert vers l’est. o N www.wallonie.be L’Organe recommande enfin la mise en place d’une concertation avec l’OTW et le SPW pour l’opérationnalisation de ces liaisons Express, notamment au niveau du choix et des aménagements des arrêts à anticiper. » La liaison qui verra l’évolution de son offre cible mise en oeuvre en 2021 est présentée ci-dessous. La fiche tactique est présentée en annexe à ce document. -

Andenne Anhée Assesse
ANDENNE Le Bibliobus : NAMÊCHE – Rue de la gare (gare) 15H15 – 15H55 VEZIN – Domaine du Bois-Gillet 16H05 – 16H40 Les samedis 16/01, 13/02, 13/03, 10/04, 15/05, 12/06, 10/07, --/08, 11/09, 09/10, 13/11, 11/12 Le BDbus : ANDENNE – Promenade des Ours en face du Phare 15H00 – 16H00 Les samedis 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06, 17/07, 21/08, 18/09, 16/10, 20/11, 18/12 ANHÉE Le Bibliobus : !!!! Portage à domicile sur demande des lecteurs inscrits !!!! Le BDbus : ANHÉE – Bibliothèque – Place communale 15H10 – 16H00 Les samedis 09/01, 06/02, 06/03, 03/04, 08/05, 05/06, 03/07, 07/08, 04/09, 02/10, 06/11, 04/12 ASSESSE Le Bibliobus : COURRIÈRE – Rue du Fays (salle) 09H00 – 09H20 Les samedis 16/01, 13/02, 13/03, 10/04, 15/05, 12/06, 10/07, --/08, 11/09, 09/10, 13/11, 11/12 Le BDbus : COURRIÈRE – Rue du Fays (salle) 14H20 – 15H00 Les mercredis 06/01, 03/02, 03/03, 07/04, 05/05, 02/06, 07/07, 04/08, 01/09, 06/10, 03/11, 01/12 BEAURAING Le Bibliobus : FELENNE - Rue Gilbert Godefroid (école) 10H00 – 10H30 SEVRY - Rue de Vencimont (monument) 10H50 – 11H50 DION - Rue de Fromelennes (école) 13H30 – 14H30 PONDROME - Rue des Monts (église) 15H00 – 16H20 - Quartier des Trois Chênes 16H30 – 17H10 HONNAY - Rue du centre (église) durant les travaux à l’école 17H20 – 18H00 Les mardis 12/01, 09/02, 09/03, 13/04, 11/05, 08/06, 13/07, --/08, 07/09, 12/10, 16/11, 14/12 FESCHAUX – Rue du Centenaire 15H50 – 16H10 Les vendredis 22/01, 19/02, 19/03, 23/04, 21/05, 18/06, --/07, 20/08, 17/09, 15/10, 19/11, 17/12 Le BDbus : BEAURAING – Place de Seurre 17H00 – 18H00 -

Fiche D'utilisation Du Sol Commune De Hamois
Fiche d'utilisation du sol Commune de Hamois Province: Namur Secteur d'aménagement: DINANT ‐ CINEY ‐ ROCHEFORT Statut de la commune selon le SDER: Commune rurale Principales catégories d’utilisation du sol 2008 Catégories d'utilisation du sol Ha % Terrains résidentiels 301 3,9 Terrains occupés par des commerces, 3,1 0 bureaux et services Terrains occupés par des services publics 19 0,2 et équipements communautaires Terrains à usage de loisirs et espaces 25 0,3 verts urbains Terrains occupés par des bâtiments 47 0,6 artificialisés agricoles Terrains à usage industriel et artisanal 16 0,2 Terrains Terrains dévolus au transport 23 0,3 Carrières, décharges et espaces 0,4 0 abandonnés Bâtiments spéciaux 0,5 0 Sous‐total 435 5,7 Terres cultivées et cultures permanentes 2.491 32,5 Prés et pâtures 2.765 36,1 Forêts, bois et production de "sapins de 1.538 20,1 Noël" artificialisés Terres vaines et vagues 99 1,3 Terrains Milieux naturels non exploités 5,4 0 non Plans d'eau et principaux cours d'eau 23 0,3 Sous‐total 6.921 90,4 Terrains non cadastrés ou de nature inconnue 303 4,0 (voiries, cours d'eau…) Total 7.659 100 Remarques : les valeurs non existantes sont symbolisées par un tiret ("‐"), de même que les valeurs de pourcentage inférieures à 0,1 % (non significatives) sont indiquées par la valeur "0". Cette remarque est d'application pour tous les taleaux de cette fiche. L’ensemble des calculs est réalisé sur la base des natures cadastrales issues de la matrice cadastrale et du PLI V07 du 1er janvier 2008 ainsi que de la version coordonnée vectorielle du plan de secteur de février 2008. -

NATURE NAMUR 2006», Bruxelles C’Est L’Ensemble Des Organisateurs Hannut
Du 28 septembre au 22 octobre NATURE ������ NAMUR 2006 ����� LE rendez-vous nature! Plus de 200 activités à ne pas manquer dans Namur et sa région : expositions, conférences, balades découvertes, animations, Festival du Film Nature, visites guidées, ... Le Ministre wallon Direction Générale des de l’Agriculture, Ressources Naturelles et de la Ruralité, de l’Environnement de l’Environnement Division de la Nature et du Tourisme et des Forêts Edition mai 2006 - Editeur responsable : Ph. Taminiaux, chemin des Vignerons 32, 5100 Wépion - Imprimé sur papier recyclé Ne pas jeter la voir publique. 5100 32, Vignerons chemin des Taminiaux, Ph. Edition mai 2006 - Editeur responsable : ������ ����� Sous le label «NATURE NAMUR 2006», Bruxelles c’est l’ensemble des organisateurs Hannut d’activités nature de la région namuroise E411 N80 BIERWART qui se coordonnent pour offrir Eghezée Gembloux aux amateurs un programme FERNELMONT E42 Liège le plus large possible. N91 N4 LA BRUYÈRE GELBRESSÉE Sombreffe Huy N93 BONINNE SEILLES N90 Charleroi VEDRIN Meuse LES ENTITÉS La BEEZ PARTICIPANTES NAMUR ANDENNE N90 (voir détail en Sambreville pages intérieures) La Sambre JAMBES MOZET ANDOY N98 OHEY FAULX-LES TOMBES Charleroi FLOREFFE DAVE WÉPION GESVES se eu COURRIÈRE M N922 FOSSES-LA-VILLE La SORINNE-LA-LONGUE MAILLEN N988 PROFONDEVILLE CRUPET ASSESSE N98 St-Gérard N951 N4 Mettet N92 Marche Dinant Luxembourg GARE SQUARE BO i LÉOPOLD U LEV T P ARD BOULEVARD MELO CAUC HY RU E RO GIER P ES P PARC RM A P P LOUISE-MARIE P P C P ES CENTRE DE NAMUR R D RUE E FE DE P BRU RU X N ELLE LA MEUSE Place Marché aux Légumes S RUE DE RU RUE PEPI P E E. -

Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium
Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium Aline Clara Poliart ( [email protected] ) ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique https://orcid.org/0000-0003-1510-0648 Fati Kirakoya-Samadoulougou ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Mady Ouédraogo ULB School of Public Health: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Philippe Collart ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Dominique Dubourg ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Sékou Samadoulougou ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Research article Keywords: geographically weighted Poisson regression, Wallonia, hysterectomy, socioeconomic factors Posted Date: May 11th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-505108/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License 1 Using geographically weighted Poisson regression to examine the 2 association between socioeconomic factors and hysterectomy 3 incidence in Wallonia, Belgium 4 Aline Poliart1, Fati Kirakoya-Samadoulougou1, Mady Ouédraogo1, Philippe Collart1,2, Dominique 5 Dubourg2, Sékou Samadoulougou 3,4 6 1 Centre de Recherche en Epidémiologie, Biostatistiques et Recherche Clinique, Ecole de Santé 7 Publique, Université Libre de Bruxelles, 1070 Brussels, Belgium; [email protected] (AP); 8 [email protected] (MO); [email protected] (PC) ; [email protected] (FKS) 9 2 Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), 6061 Charleroi, Belgium ; [email protected] 10 (PC), [email protected] (DD) 11 3 Evaluation Platform on Obesity Prevention, Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, QC, G1V 12 4G5, Canada; [email protected] (SS). -

Points De Vente Pour Les Habitants Des Communes De La Province De Namur Mise À Jour Le 07/03/17
Points de vente pour les habitants des Communes de la Province de Namur Mise à jour le 07/03/17 Administration Service Rue CD LOCALITE Téléphone communale ANDENNE Office du Tourisme Promenade des Ours, 33 5300 ANDENNE 085/849.640 Complexe sportif Rue du Docteur Melin, 14 5300 ANDENNE 085/84.95.23 ANHEE Service population Place Communale, 6 5537 ANHEE 082/698.610 ASSESSE Service Population Esplanade des Citoyens, 4 5330 ASSESSE 083/655.055 083/668.578 Office du Tourisme Rue Haute, 7 5332 CRUPET 0477/22.17.01 BEAURAING Service Etat-Civil Place de Seurre, 3-5 5570 BEAURAING 082/710.030 BIEVRE Service Population Rue de Bouillon, 39 5555 BIEVRE 061/239.660 CERFONTAINE Office du Tourisme Place de l’Eglise, 9 5630 CERFONTAINE 071/644.667 CINEY Office du Tourisme Place Monseu, 23 5590 CINEY 083/750.115 COUVIN Office du Tourisme Rue de la Falaise, 3 5660 COUVIN 060/340 .140 DINANT Service Recette Rue grande, 112 5500 DINANT 082/213.299 DOISCHE Service Population Rue Martin Sandron, 114 5680 DOISCHE 082/214.722 EGHEZEE Service Population Route de Gembloux, 43 5310 EGHEZEE 081/810.132 FERNELMONT Service population Rue Goffin, 2 5380 FERNELMONT 081/830.250 FLOREFFE Service population Rue Romedenne, 9 5150 FLOREFFE 081/447.115 Office du Tourisme Rue Romedenne, 9 5150 FLOREFFE 081/44.71.19 FLORENNES Service Population Place de l'Hôtel de Ville, 1 5620 FLORENNES 071/681.118 FOSSES-LA- Service Culture - FOSSES-LA- Place du Marché, 12 5070 071/712.701 VILLE Tourisme VILLE Maison Languilier GEDINNE Office du Tourisme 5575 GEDINNE 061/587.484 Place Languillier, 6 GEMBLOUX Office du Tourisme Rue Sigebert, 1 5030 GEMBLOUX 081/626.960 Chaussée de Gramptinne, GESVES Service Population 5340 GESVES 083/670.339 112 HAMOIS Service Population Rue du Relais, 1 5360 HAMOIS 083/615.230 Service Cartes HASTIERE Av. -

Mobilité Au Quo@Dien Mobilité De Loisir
ViciGAL Mobilité au quo@dien Mobilité de loisir Ermeton sur Biert – InterGAL– le 13/12/2016 LE GAL Le GAL • GAL Pays des @ges et chavées • Groupe d’Ac@on Locale • ASBL ac@ve depuis 15 ans – Assesse / Gesves (depuis 2002) – Assesse / Gesves / Ohey (depuis 2008) • Equipe – Chargés de mission – Coordinateur • Un partenariat privé/public Le GAL • Ou@l d’anima@on territoriale • Facilitateur de projets sur le territoire : – Développement durable – Supra-communalité – Innova@on – Démarche par@cipa@ve • Complémentarité avec d’autres plans et programmes • Pérennité des projets • Cadre du programme LEADER (objec@fs, évalua@on…) Le GAL • Programma@on LEADER 2014-2020 • 9 fiches projets théma@ques - Agriculture - Logement - ViciGAL - Filière Bois - Ac@on Sociale - Tourisme - Energie Verte - Paysages - Filière équestre • Partenaires Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe inves7t dans les zones rurales LE PROJET VICIGAL Contexte • Réflexion des Groupes de Travail « Mobilité » et « Tourisme » – 35 personnes, citoyens et acteurs du territoire – 4 réunions en soirée • 29/04/2014 • 06/05/2014 • 27/05/2014 • 03/06/2014 Contexte • Difficulté de mobilité en milieu rural • Volonté des communes de développer des liaisons douces entre les villages • Le maillage des chemins, une priorité depuis longtemps (pédestres, équestres, VTT) • Atouts touris@ques indéniables : Nature / biodiversité, patrimoine, terroir, cheval • Réseau d’acteurs touris@ques • Partenariat avec les Maisons du Tourisme Condroz-Famenne et Pays de Namur Contexte Difficulté