PI. XI, Fig. 9-12) Fam
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
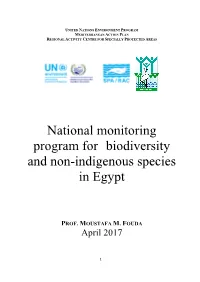
National Monitoring Program for Biodiversity and Non-Indigenous Species in Egypt
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM MEDITERRANEAN ACTION PLAN REGIONAL ACTIVITY CENTRE FOR SPECIALLY PROTECTED AREAS National monitoring program for biodiversity and non-indigenous species in Egypt PROF. MOUSTAFA M. FOUDA April 2017 1 Study required and financed by: Regional Activity Centre for Specially Protected Areas Boulevard du Leader Yasser Arafat BP 337 1080 Tunis Cedex – Tunisie Responsible of the study: Mehdi Aissi, EcApMEDII Programme officer In charge of the study: Prof. Moustafa M. Fouda Mr. Mohamed Said Abdelwarith Mr. Mahmoud Fawzy Kamel Ministry of Environment, Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA) With the participation of: Name, qualification and original institution of all the participants in the study (field mission or participation of national institutions) 2 TABLE OF CONTENTS page Acknowledgements 4 Preamble 5 Chapter 1: Introduction 9 Chapter 2: Institutional and regulatory aspects 40 Chapter 3: Scientific Aspects 49 Chapter 4: Development of monitoring program 59 Chapter 5: Existing Monitoring Program in Egypt 91 1. Monitoring program for habitat mapping 103 2. Marine MAMMALS monitoring program 109 3. Marine Turtles Monitoring Program 115 4. Monitoring Program for Seabirds 118 5. Non-Indigenous Species Monitoring Program 123 Chapter 6: Implementation / Operational Plan 131 Selected References 133 Annexes 143 3 AKNOWLEGEMENTS We would like to thank RAC/ SPA and EU for providing financial and technical assistances to prepare this monitoring programme. The preparation of this programme was the result of several contacts and interviews with many stakeholders from Government, research institutions, NGOs and fishermen. The author would like to express thanks to all for their support. In addition; we would like to acknowledge all participants who attended the workshop and represented the following institutions: 1. -

Development of Species-Specific Edna-Based Test Systems For
REPORT SNO 7544-2020 Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring of non-indigenous Decapoda in Danish marine waters © Henrik Carl, Natural History Museum, Denmark History © Henrik Carl, Natural NIVA Denmark Water Research REPORT Main Office NIVA Region South NIVA Region East NIVA Region West NIVA Denmark Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns vei 3 Sandvikaveien 59 Thormøhlensgate 53 D Njalsgade 76, 4th floor NO-0349 Oslo, Norway NO-4879 Grimstad, Norway NO-2312 Ottestad, Norway NO-5006 Bergen Norway DK 2300 Copenhagen S, Denmark Phone (47) 22 18 51 00 Phone (47) 22 18 51 00 Phone (47) 22 18 51 00 Phone (47) 22 18 51 00 Phone (45) 39 17 97 33 Internet: www.niva.no Title Serial number Date Development of species-specific eDNA-based test systems for monitoring 7544-2020 22 October 2020 of non-indigenous Decapoda in Danish marine waters Author(s) Topic group Distribution Steen W. Knudsen and Jesper H. Andersen – NIVA Denmark Environmental monitor- Public Peter Rask Møller – Natural History Museum, University of Copenhagen ing Geographical area Pages Denmark 54 Client(s) Client's reference Danish Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen) UCB and CEKAN Printed NIVA Project number 180280 Summary We report the development of seven eDNA-based species-specific test systems for monitoring of marine Decapoda in Danish marine waters. The seven species are 1) Callinectes sapidus (blå svømmekrabbe), 2) Eriocheir sinensis (kinesisk uldhånds- krabbe), 3) Hemigrapsus sanguineus (stribet klippekrabbe), 4) Hemigrapsus takanoi (pensel-klippekrabbe), 5) Homarus ameri- canus (amerikansk hummer), 6) Paralithodes camtschaticus (Kamchatka-krabbe) and 7) Rhithropanopeus harrisii (østameri- kansk brakvandskrabbe). -

Deep-Water Decapod Crustacea from Eastern Australia: Lobsters of the Families Nephropidae, Palinuridae, Polychelidae and Scyllaridae
Records of the Australian Museum (1995) Vo!. 47: 231-263. ISSN 0067-1975 Deep-water Decapod Crustacea from Eastern Australia: Lobsters of the Families Nephropidae, Palinuridae, Polychelidae and Scyllaridae D.J.G. GRIFFIN & H.E. STODDART Australian Museum, 6 College Street, Sydney NSW 2000, Australia ABSTRACT. Twenty-three species of deep-water lobsters in the families Nephropidae, Palinuridae, Polychelidae and Scyllaridae are recorded from the continental shelf and slope off eastern Australia. Ten species and two genera have not been previously recorded from Australia. These are Acanthacaris tenuimana, Projasus parkeri, Polycheles baccatus, P. euthrix, P. granulatus, Stereomastis andamanensis, S. helleri, S. sculpta, S. suhmi and Willemoesia bonaspei. The deep water lobster fauna of eastern Australia is compared with those of other Indo-Pacific areas. A key is given to all deep-water lobster species recorded from Australian waters. GRIFFIN, D.J.O. & H.E. STODDART, 1995. Deep-water decapod Crustacea from eastern Australia: lobsters of the families Nephropidae, Palinuridae, Polychelidae and Scyllaridae. Records of the Australian Museum 47(3): 231-263. The deep-water lobster fauna of the Australian region fauna of southern Australia is as yet poorly known but first became known from collections made by the British extensive collections have been made by the Museum Challenger Expedition (Bate, 1888), the 1911-14 of Victoria on the continental shelf and slope of south Australasian Antarctic Expedition (Bage, 1938), the eastern Australia and Bass Strait. Commonwealth of Australia fishing experiments on the This paper is the third of a series dealing with deep Endeavour (1909-1914); various local trawling excursions water decapods taken by the New South Wales Fisheries (e.g., Grant, 1905) and serendipitous catches by Research Vessel Kapala, which has carried out trawling professional fishermen (e.g., McNeill, 1949, 1956). -

Implementation of Recommendations on Invasive Alien Species / Mise En Œuvre Des Recommandations Sur Les Espèces Exotiques Envahissantes
Strasbourg, 13 May 2011 T-PVS/Inf (2011) 3 [Inf03a_2011.doc] CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS Bern Convention Group of Experts on Invasive Alien Species / Groupe d’experts de la Convention de Berne sur les espèces exotiques envahissantes St. Julians, Malta (18-20 May 2011) / St Julians, Malte (18-20 mai 2011) __________ Implementation of recommendations on Invasive Alien Species / Mise en œuvre des recommandations sur les espèces exotiques envahissantes National reports and contributions / Rapports nationaux et Contributions-- Document prepared by the Directorate of Culture and of Cultural and Natural Heritage This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. Ce document ne sera plus distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire. T-PVS/Inf (2011) 3 - 2 - CONTENTS / SOMMAIRE __________ 1. Armenia / Arménie ................................................................................................................ 3 2. Belgium / Belgique ................................................................................................................ 7 3. France / France....................................................................................................................... 16 4. Ireland / Irlande...................................................................................................................... ²19 5. Italy / Italie............................................................................................................................ -
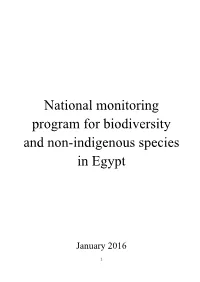
National Monitoring Program for Biodiversity and Non-Indigenous Species in Egypt
National monitoring program for biodiversity and non-indigenous species in Egypt January 2016 1 TABLE OF CONTENTS page Acknowledgements 3 Preamble 4 Chapter 1: Introduction 8 Overview of Egypt Biodiversity 37 Chapter 2: Institutional and regulatory aspects 39 National Legislations 39 Regional and International conventions and agreements 46 Chapter 3: Scientific Aspects 48 Summary of Egyptian Marine Biodiversity Knowledge 48 The Current Situation in Egypt 56 Present state of Biodiversity knowledge 57 Chapter 4: Development of monitoring program 58 Introduction 58 Conclusions 103 Suggested Monitoring Program Suggested monitoring program for habitat mapping 104 Suggested marine MAMMALS monitoring program 109 Suggested Marine Turtles Monitoring Program 115 Suggested Monitoring Program for Seabirds 117 Suggested Non-Indigenous Species Monitoring Program 121 Chapter 5: Implementation / Operational Plan 128 Selected References 130 Annexes 141 2 AKNOWLEGEMENTS 3 Preamble The Ecosystem Approach (EcAp) is a strategy for the integrated management of land, water and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way, as stated by the Convention of Biological Diversity. This process aims to achieve the Good Environmental Status (GES) through the elaborated 11 Ecological Objectives and their respective common indicators. Since 2008, Contracting Parties to the Barcelona Convention have adopted the EcAp and agreed on a roadmap for its implementation. First phases of the EcAp process led to the accomplishment of 5 steps of the scheduled 7-steps process such as: 1) Definition of an Ecological Vision for the Mediterranean; 2) Setting common Mediterranean strategic goals; 3) Identification of an important ecosystem properties and assessment of ecological status and pressures; 4) Development of a set of ecological objectives corresponding to the Vision and strategic goals; and 5) Derivation of operational objectives with indicators and target levels. -

Eucrate Crenata Ordine Decapoda De Haan, 1835 Famiglia Goneplacidae
Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene Classe Malacostraca Eucrate crenata Ordine Decapoda de Haan, 1835 Famiglia Goneplacidae SINONIMI RILEVANTI Nessuno. zoea (z) megalopa (m) DESCRIZIONE COROLOGIA / AFFINITA’ Carapace sub-quadrato, più largo che lungo, liscio, Tropicale e sub-tropicale indo-pacifico. minutamente punteggiato, regioni non definite. Margine fronto-orbitale diritto, fronte divisa in due lobi squadrati. Margine antero-laterale corto, DISTRIBUZIONE ATTUALE convesso, con quattro denti, il penultimo dei quali Dal Mar Rosso alle Hawaii più grande degli altri; margini postero-laterali convergenti. Segmento basale del peduncolo PRIMA SEGNALAZIONE IN MEDITERRANEO antennale che chiude la cavità orbitale. Peduncoli Port Said, 1924 (Calman, 1927). oculari corti, robusti. Chelipedi robusti, lisci, subeguali, superficie esterna del carpo con chiazze setose, propodio liscio, arrotondato, con una carena PRIMA SEGNALAZIONE IN ITALIA longitudinale ventrale. Pereiopodi allungati, il - quinto con propodio e dattilo appiattiti. Pleopodio maschile ricurvo nei due terzi prossimali, con l’estremità minutamente spinulosa. ORIGINE Indo-Pacifico COLORAZIONE Carapace color crema, finemente punteggiato di Identificazione e distribuzione nei mari italiani di specie non indigene porpora, due macchie scure ben visibili nella VIE DI DISPERSIONE PRIMARIE regione epatica. Probabile migrazione lessepsiana attraverso il Canale di Suez. FORMULA MERISTICA - VIE DI DISPERSIONE SECONDARIE TAGLIA MASSIMA - Lunghezza massima del carapace 35 mm. STADI LARVALI STATO DELL ’INVASIONE (ZOEA ) Non nativo Z1-Z5. SR e SD, sottili ed appuntite, poste sullo stesso asse; SR sempre più corta di SD. SL lunghe MOTIVI DEL SUCCESSO 1/3 di SR in Z1-Z2, più corte in Z3-Z5. Eso A2 spinoso nella metà distale e lungo come PS. -

On the Clawed Lobsters of the Genus Nephropsis Wood-Mason, 1872
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 833: 41–58 On(2019) the clawed lobsters of the genus Nephropsis Wood-Mason, 1872... 41 doi: 10.3897/zookeys.833.32837 RESEARCH ARTICLE http://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research On the clawed lobsters of the genus Nephropsis Wood-Mason, 1872 recently collected from deep- sea cruises off Taiwan and the South China Sea (Crustacea, Decapoda, Nephropidae) Su-Ching Chang1, Tin-Yam Chan1,2 1 Institute of Marine Biology, National Taiwan Ocean University, Keelung 20224, Taiwan 2 Center of Excel- lence for the Oceans, National Taiwan Ocean University, Keelung 20224, Taiwan Corresponding author: Tin-Yam Chan ([email protected]) Academic editor: S. De Grave | Received 4 January 2019 | Accepted 13 February 2019 | Published 25 March 2019 http://zoobank.org/2309E59F-5CB1-471F-8C00-73008352A515 Citation: Chang S-C, Chan T-Y (2019) On the clawed lobsters of the genus Nephropsis Wood-Mason, 1872 recently collected from deep-sea cruises off Taiwan and the South China Sea (Crustacea, Decapoda, Nephropidae). ZooKeys 833: 41–58. https://doi.org/10.3897/zookeys.833.32837 Abstract Recent deep-sea cruises using Taiwanese research vessels off Taiwan and in the South China Sea yielded seven species of the clawed lobster genus Nephropsis Wood-Mason, 1872. Four species are new records for Taiwan (Nephropsis acanthura Macpherson, 1990, N. holthuisi Macpherson, 1993, N. serrata Macpherson, 1993, and N. suhmi Bate, 1888) and three species are new records of Dongsha (under the jurisdiction of Taiwan) in the South China Sea (N. ensirostris Alcock, 1901, N. stewarti Wood-Mason, 1872, and N. -

ISSN: 1173-5988 Cont
Invasive Species Specialist Group of the IUCN Species Survival Commission ALIENS Issue Number 27, 2008 FROM THE NEW CHAIR OF ISSG – Piero GENOVESI As you know, Mick Clout has recently decided to step back from the Chair of ISSG, and Simon Stuart – elected Chair of IUCN SSC at last WCC in Barcelona - has invited me to take this role. I cannot say how challenging it is to take this role after Mick, who is the “father” of ISSG and - as Chair of the group - has been incredibly active globally in conservation in the last decades. Mick was in fact the founder of ISSG in 1993, and since then he has been the main actor of the success of the group - one of the most active and influential within the Species Survival Commission. In particular by making the GISD portal the most widely used tool on alien species, by organising keystone meetings, by providing scientific and policy advice to global programs such as GISP, by creating synergies with programs – among others - on protected areas and islands. But beyond the important results gathered within the IUCN world, Mick’s constant work and commitment have contributed substantially to the advances we have seen in the last decade in the knowledge and awareness on biological invasions. Mick’s role was acknowledged by the recent attribution of the Peter Scott Award , which was awarded in the WCC meeting at Barcelona in October 2008. So, I believe it is clear to you all that taking Mick’s role is for me a tremendous challenge, and I hope with your advice and support to be a good Chair of the group. -

Homarus Americanus H
BioInvasions Records (2021) Volume 10, Issue 1: 170–180 CORRECTED PROOF Rapid Communication An American in the Aegean: first record of the American lobster Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 from the eastern Mediterranean Sea Thodoros E. Kampouris1,*, Georgios A. Gkafas2, Joanne Sarantopoulou2, Athanasios Exadactylos2 and Ioannis E. Batjakas1 1Marine Sciences Department, School of the Environment, University of the Aegean, University Hill, Mytilene, Lesvos Island, 81100, Greece 2Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, Fytoko Street, Volos, 38 445, Greece Author e-mails: [email protected] (TEK), [email protected] (IEB), [email protected] (GAG), [email protected] (JS), [email protected] (AE) *Corresponding author Citation: Kampouris TE, Gkafas GA, Sarantopoulou J, Exadactylos A, Batjakas Abstract IE (2021) An American in the Aegean: first record of the American lobster A male Homarus americanus individual, commonly known as the American lobster, Homarus americanus H. Milne Edwards, was caught by artisanal fishermen at Chalkidiki Peninsula, Greece, north-west Aegean 1837 from the eastern Mediterranean Sea. Sea on 26 August 2019. The individual weighted 628.1 g and measured 96.7 mm in BioInvasions Records 10(1): 170–180, carapace length (CL) and 31.44 cm in total length (TL). The specimen was identified https://doi.org/10.3391/bir.2021.10.1.18 by both morphological and molecular means. This is the species’ first record from Received: 7 June 2020 the eastern Mediterranean Sea and Greece, and only the second for the whole basin. Accepted: 16 October 2020 However, several hypotheses for potential introduction vectors are discussed, as Published: 21 December 2020 well as the potential implication to the regional lobster fishery. -

Marine Science
Western Indian Ocean JOURNAL OF Marine Science Volume 17 | Issue 1 | Jan – Jun 2018 | ISSN: 0856-860X Chief Editor José Paula Western Indian Ocean JOURNAL OF Marine Science Chief Editor José Paula | Faculty of Sciences of University of Lisbon, Portugal Copy Editor Timothy Andrew Editorial Board Louis CELLIERS Blandina LUGENDO South Africa Tanzania Lena GIPPERTH Aviti MMOCHI Serge ANDREFOUËT Sweden Tanzania France Johan GROENEVELD Nyawira MUTHIGA Ranjeet BHAGOOLI South Africa Kenya Mauritius Issufo HALO Brent NEWMAN South Africa/Mozambique South Africa Salomão BANDEIRA Mozambique Christina HICKS Jan ROBINSON Australia/UK Seycheles Betsy Anne BEYMER-FARRIS Johnson KITHEKA Sérgio ROSENDO USA/Norway Kenya Portugal Jared BOSIRE Kassim KULINDWA Melita SAMOILYS Kenya Tanzania Kenya Atanásio BRITO Thierry LAVITRA Max TROELL Mozambique Madagascar Sweden Published biannually Aims and scope: The Western Indian Ocean Journal of Marine Science provides an avenue for the wide dissem- ination of high quality research generated in the Western Indian Ocean (WIO) region, in particular on the sustainable use of coastal and marine resources. This is central to the goal of supporting and promoting sustainable coastal development in the region, as well as contributing to the global base of marine science. The journal publishes original research articles dealing with all aspects of marine science and coastal manage- ment. Topics include, but are not limited to: theoretical studies, oceanography, marine biology and ecology, fisheries, recovery and restoration processes, legal and institutional frameworks, and interactions/relationships between humans and the coastal and marine environment. In addition, Western Indian Ocean Journal of Marine Science features state-of-the-art review articles and short communications. -

No Frontiers in the Sea for Marine Invaders and Their Parasites? (Research Project ZBS2004/09)
No Frontiers in the Sea for Marine Invaders and their Parasites? (Research Project ZBS2004/09) Biosecurity New Zealand Technical Paper No: 2008/10 Prepared for BNZ Pre-clearance Directorate by Annette M. Brockerhoff and Colin L. McLay ISBN 978-0-478-32177-7 (Online) ISSN 1177-6412 (Online) May 2008 Disclaimer While every effort has been made to ensure the information in this publication is accurate, the Ministry of Agriculture and Forestry does not accept any responsibility or liability for error or fact omission, interpretation or opinion which may be present, nor for the consequences of any decisions based on this information. Any view or opinions expressed do not necessarily represent the official view of the Ministry of Agriculture and Forestry. The information in this report and any accompanying documentation is accurate to the best of the knowledge and belief of the authors acting on behalf of the Ministry of Agriculture and Forestry. While the authors have exercised all reasonable skill and care in preparation of information in this report, neither the authors nor the Ministry of Agriculture and Forestry accept any liability in contract, tort or otherwise for any loss, damage, injury, or expense, whether direct, indirect or consequential, arising out of the provision of information in this report. Requests for further copies should be directed to: MAF Communications Pastoral House 25 The Terrace PO Box 2526 WELLINGTON Tel: 04 894 4100 Fax: 04 894 4227 This publication is also available on the MAF website at www.maf.govt.nz/publications © Crown Copyright - Ministry of Agriculture and Forestry Contents Page Executive Summary 1 General background for project 3 Part 1. -

5. Index of Scientific and Vernacular Names
click for previous page 277 5. INDEX OF SCIENTIFIC AND VERNACULAR NAMES A Abricanto 60 antarcticus, Parribacus 209 Acanthacaris 26 antarcticus, Scyllarus 209 Acanthacaris caeca 26 antipodarum, Arctides 175 Acanthacaris opipara 28 aoteanus, Scyllarus 216 Acanthacaris tenuimana 28 Arabian whip lobster 164 acanthura, Nephropsis 35 ARAEOSTERNIDAE 166 acuelata, Nephropsis 36 Araeosternus 168 acuelatus, Nephropsis 36 Araeosternus wieneckii 170 Acutigebia 232 Arafura lobster 67 adriaticus, Palaemon 119 arafurensis, Metanephrops 67 adriaticus, Palinurus 119 arafurensis, Nephrops 67 aequinoctialis, Scyllarides 183 Aragosta 120 Aesop slipper lobster 189 Aragosta bianca 122 aesopius, Scyllarus 216 Aragosta mauritanica 122 affinis, Callianassa 242 Aragosta mediterranea 120 African lobster 75 Arctides 173 African spear lobster 112 Arctides antipodarum 175 africana, Gebia 233 Arctides guineensis 176 africana, Upogebia 233 Arctides regalis 177 Afrikanische Languste 100 ARCTIDINAE 173 Agassiz’s lobsterette 38 Arctus 216 agassizii, Nephropsis 37 Arctus americanus 216 Agusta 120 arctus, Arctus 218 Akamaru 212 Arctus arctus 218 Akaza 74 arctus, Astacus 218 Akaza-ebi 74 Arctus bicuspidatus 216 Aligusta 120 arctus, Cancer 217 Allpap 210 Arctus crenatus 216 alticrenatus, Ibacus 200 Arctus crenulatus 218 alticrenatus septemdentatus, Ibacus 200 Arctus delfini 216 amabilis, Scyllarus 216 Arctus depressus 216 American blunthorn lobster 125 Arctus gibberosus 217 American lobster 58 Arctus immaturus 224 americanus, Arctus 216 arctus lutea, Scyllarus 218 americanus,