Dossier L'art De L'inventaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
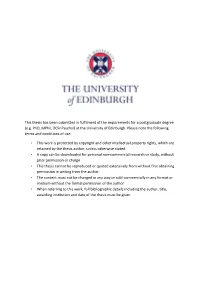
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Touching the Void: The museological implications of theft on public art collections Jillian Seaton Ph.D. University of Edinburgh 2014 Abstract Of central importance to this thesis is the way security measures contradict the process through which museums have been seeking to divest themselves of theoretical hierarchies and value judgments in recent years. A context for investigation is established that considers how a perceptible increase in art theft, complicated by the escalating value of individual objects and the proliferation of museums as represented by a rise in attendance figures has produced a climate of vulnerability for arts collections around the world. In response, museums are installing unprecedented levels of security that are having a significant impact on established viewing conditions and redefining museum space. Further hindering this situation is the disparity between the fields of museology and museum security. -

Nonverbal Dictionary
The The NONVERBAL DICTIONARY of GESTURES, SIGNS & BODY LANGUAGE CUES From Adam's-Apple-Jump to Zygomatic Smile By David B. Givens © 2002 (Spokane, Washington: Center for Nonverbal Studies Press) Items in this Dictionary have been researched by anthropologists, archaeologists, biologists, linguists, psychiatrists, psychologists, semioticians, and others who have studied human communication from a scientific point of view. Every effort has been made to cite their work in the text. Definitions, meanings, and interpretations left uncredited are those of the author. Gestures and consumer products with http://members.aol.com/nonverbal2/diction1.htm (1 of 2) [27/04/02 05:54:42] The current trademark registrations are identified with the ® symbol. Entries in The Dictionary. There have been many who, not knowing how to mingle the useful and the pleasing in the right proportions, have had all their toil and pains for nothing . --Cervantes (Don Quixote) Dedication "A masterful piece of work" --American Library Association "Highly recommended" --New Scientist "Very interesting reading" --The Houston Chronicle "Monumental" --Yahoo! Picks of the Week "Site of the Day Award" --WWW Virtual Library WWW Virtual Library "Best" Site © 2002 by David B. Givens, Ph.D. Center for Nonverbal Studies http://members.aol.com/nonverbal2/diction1.htm (2 of 2) [27/04/02 05:54:42] adajum ADAM'S-APPLE-JUMP Body movement. 1. A conspicuous up-and-down motion of the Adam's apple. 2. A movement of the throat visible while gulping or swallowing, as in nervousness. Usage: The Adam's-apple-jump is an unconscious sign of emotional anxiety, embarrassment, or stress. -

Mitteilungen Des Kunsthistorischen Institutes Lxiii
MITTEILUNGEN DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES LXIII. BAND — 2021 IN FLORENZ HEFT 1 Bad Reception Expressing Disapproval of Art in Early Modern Italy LXIII. BAND — 2021 MITTEILUNGEN HEFT 1 DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTES IN FLORENZ Bad Reception: Expressing Disapproval of Art in Early Modern Italy edited by Diletta Gamberini, Jonathan K. Nelson, Alessandro Nova Redaktionskomitee | Comitato di redazione Alessandro Nova, Gerhard Wolf, Samuel Vitali _ 83 _ Maddalena Spagnolo _ 3 _ Diletta Gamberini - Efmere saette: sfide e limiti Redakteur | Redattore Jonathan K. Nelson Samuel Vitali Preface di una satirico- Kunstliteratur Editing und Herstellung | Editing e impaginazione burlesca Ortensia Martinez Fucini _ 7 _ Alessandro Nova Kunsthistorisches Institut in Florenz Bad Reception in Early Modern Max-Planck-Institut _ 99 _ Paolo Celi Via G. Giusti 44, I-50121 Firenze Italy: An Introduction “Che non l’arebbe fat’a pena Tel. 055.2491147, Fax 055.2491155 s.vitali@khi.fi.it – martinez@khi.fi.it Cuio”. Porte, apparati e www.khi.fi.it/publikationen/mitteilungen facciate fiorentine in tre testi Die Redaktion dankt den Peer Reviewers dieses Heftes _ 15 _ Jonathan K. Nelson - für ihre Unterstützung | La redazione ringrazia i peer pasquineschi dello Zoppo reviewers per la loro collaborazione a questo numero. Richard J. Zeckhauser Italian Renaissance Portraits Carrozziere e dell’Etrusco Graphik | Progetto grafico RovaiWeber design, Firenze that Disappoint: Isabella d’Este, Francesco del Giocondo, and Produktion | Produzione _ 115 _ Sefy Hendler Centro Di edizioni, Firenze Other Displeased Patrons “Broken into pieces and its Die erscheinen jährlich in drei Heften und head thrown into the square”: könnenMitteilungen im Abonnement oder in Einzelheften bezogen werden durch | Le escono con cadenza The Numerous Failures of quadrimestrale e possonoMitteilungen essere ordinate in abbonamento _ 33 _ David Ekserdjian o singolarmente presso: Bad Reception and the Michelangelo’s Bronze Statue Centro Di edizioni, Via dei Renai 20r of Pope Julius II I-50125 Firenze, Tel. -

Henri-Matisse Retrospective Exhibition : November 3-December 6, 1931
Henri-Matisse retrospective exhibition : November 3-December 6, 1931 Author Matisse, Henri, 1869-1954 Date 1931 Publisher The Museum of Modern Art Exhibition URL www.moma.org/calendar/exhibitions/1903 The Museum of Modern Art's exhibition history— from our founding in 1929 to the present—is available online. It includes exhibition catalogues, primary documents, installation views, and an index of participating artists. MoMA © 2017 The Museum of Modern Art Archive MOMA 13 c .2 LIBRARY Museumof ModernArt ARCHIVE I* L f+4*m — }/ M"W ^ ?l/V $Y (j»Y' / )jAdyYv^» (/} (fUi ^McJPK T^^ru>M /J* tl £41 Juf iM.gu *j ^Jh^. 14VV ,Wo * go "- ' * " 5UV 11^ dltu +^ ^ i ^11- l-s- 1,_ ' PLEASERETURN TO OFFICEOF ONROE WHEELER AY tfr MUSEUM OF MODERN ART LIBRARY Museumof ModernArt ARCHIVE HENRI - MATISSE RETROSPECTIVE EXHIBITION NOVEMBER 3 1931 DECEMBER 6 730 FIFTH AVENUE NEW YORK COPYRIGHT, NOVEMBER I93I THE MUSEUM OF MODERN ART NEW YORK, N. Y. CONTENTS LIST OF LENDERS; ACKNOWLEDGMENTS 5 INTRODUCTION 9 NOTES OF A PAINTER (1908) 29 CHRONOLOGIES 37 PAINTINGS BY HENRI-MAT ISSE IN OTHER MUSEUMS 39 BIBLIOGRAPHY 40 CATALOG 45 PAINTINGS DRAWINGS ETCHINGS LITHOGRAPHS MONOTYPES WOODCUTS SCULPTURE ILLUSTRATIONS THE EXHIBITION HAS BEEN SELECTED FROM THE FOLLOWING COLLECTIONS: DR. AND MRS. HARRY BAKWIN, NEW YORK LORD BERNERS, LONDON M. GASTON BERNHEIM DE VILLERS, PARIS M. HENRI BERNHEIM'JEUNE, PARIS M. JOSSE BERNHEIMJEUNE, PARIS MESSRS. BERNHEIMJEUNE ET CIE, PARIS M. JEAN BIETTE, LE HAVRE M. ETIENNE BIGNOU, PARIS THE CHESTER DALE COLLECTION, NEW YORK LORD IVOR SPENCER CHURCHILL, LONDON MR. STEPHEN C. CLARK, NEW YORK THE CONE COLLECTION, BALTIMORE MR. -

Recherches Régionales N°104
RECHERCHES REGIONALES --- Alpes-Maritimes et Contrées limitrophes SOMMAIRE 29e année 1988 – N°3 Juillet - septembre Henri CHRETIEN par un groupe de parents et d’amis p. 2 104 Quelques camps du Sud-Est (1939-1940) par André FONTAINE p. 23 La Méditerranée dans l’imaginaire de notre temps par jean ONIMUS p. 51 HENRI CHRETIEN PAR UN GROUPE DE PARENTS ET D’AMIS 2 Henri CHRETIEN, astronome à Nice 3 C'est par un souvenir d'enfance de ma fille cadette Nicole que nous allons ouvrir ce récit : "Le souvenir que j'ai du Professeur est un souvenir d'enfance. Nous venions de quitter Lyon pour nous installer dans son ancien laboratoire au 16 rue Pigache à Saint-Cloud. Lors d'une invitation à une réunion familiale, il nous recevait dans le vestibule d'entrée de sa maison de Saint-Cloud (rue Preschez). Il n'était pas grand, aussi je voyais distinctement son visage et l'affleurement de sa barbe me recouvrait le visage et me chatouillait. J'avais envie de rire. Il était gai, heureux, ainsi que Madeleine, sa femme, toute souriante, et Yvonne, sa fille, bras ouverts. C'est donc le souvenir que j'ai de lui : un baiser". Après la guerre de 1914-1918, mes parents, parisiens, sont venus s'installer à Saint- Cloud, comme Henri Chrétien et sa famille. La proximité des noms dans l'annuaire téléphonique fit qu'ils se retrouvèrent. Ils étaient cousins germains, issus d'un ancêtre commun de la région de Toulouse. C'est peut-être cette origine commune qui leur avait donné, pour Henri Chrétien le goût de la musique, et pour mon père le goût de l'opéra. -

Neugass, Fritz; Papers Ger007
Neugass, Fritz; Papers ger007 This finding aid was produced using ArchivesSpace on March 01, 2021. M.E. Grenander Department of Special Collections & Archives Neugass, Fritz; Papers ger007 Table of Contents Summary Information .................................................................................................................................... 3 Biographical Sketch ....................................................................................................................................... 3 Scope and Contents ........................................................................................................................................ 5 Arrangement of the Collection ...................................................................................................................... 6 Administrative Information ............................................................................................................................ 6 Controlled Access Headings .......................................................................................................................... 7 Collection Inventory ....................................................................................................................................... 7 Art and Artists ............................................................................................................................................. 7 Museums & Private Collections .............................................................................................................. -

Thanks to the Agreement with the Primoli Foundation the Naked Gioconda, Oil on Canvas After Leonardo's Cardboard, Was Lent to T
A Mona Lisa for the banker at Villa Farnesina Thanks to the agreement with the Primoli Foundation “The Naked Gioconda" now exhibited in the hall that housed Agostino Chigi's studio July 6, 2020 - October 3, 2020 The Naked Gioconda, oil on canvas after Leonardo's cardboard, was lent to the Accademia Nazionale dei Lincei thanks to the generosity of the Primoli Foundation, and will be exhibited at Villa Farnesina, just inside the Chigi Room, which housed once the studio of the banker Agostino Chigi. The artwork derived from the cardboard Femme nue dite La Joconde nue in the Musée Condé (Chantilly), attributed to Leonardo da Vinci or his atelier, has already been exhibited at Villa Farnesina during the exhibition “Leonardo in Rome. Influences and Inheritance” held from October 2019 until January 2020, and restored for such purpose. The only certain datas in the sequence of origins (which however can be imagined more complex and excited) are its belonging to the very rich gallery of Fesch, cardinal and uncle of Napoleon (who settled in Rome from 1814 until his death in 1839), and the following transition to Palazzo Primoli, among the artworks of Count Giuseppe. The catalog of the Fesch sale, which was among the main events in the artistic and social market of the mid-nineteenth century - "avec 20.000 francs on aurait pu gagner 40.000 à la vente du cardinal Fesch", will write Balzac in 1846, returning from Rome -, thus presented the artwork: "dans une galerie d'où la vue s'étend entre deux colonnes sur un campagne semée de rochers arides, la jeune beauté est représentée nue et assise", dressed only "d’une draperie violette, dont l’un des pans recouvre ses genoux et entoure son bras droit ". -
© Supersoniks 2016 Célébration Du 500Ème Anniversaire De L’Arrivée De Léonard De Vinci Au Château Du Clos Lucé À Amboise (1516-1519)
© Supersoniks 2016 Célébration du 500ème anniversaire de l’arrivée de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé à Amboise (1516-1519). À l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos Lucé à Amboise, à l’automne 1516. A l’âge de 64 ans, il traverse les Alpes avec certains de ses disciples, dont Francesco Melzi et Batista de Vilanis son fidèle servant milanais. Il vit là, travaille à de nombreux projets pour le Roi et s’éteint le 2 mai 1519 dans sa chambre du Château du Clos Lucé. La mission du Château du Clos Lucé, menée par la famille Saint Bris depuis 1954, est de transmettre au plus grand nombre l’héritage et le patrimoine de ce génie de la Renaissance. Ce cinq centenaire est donc une formidable occasion de restituer l’atelier vivant de la Joconde, de rendre hommage aux œuvres et travaux réalisés par Léonard de Vinci en France, mais aussi de réactualiser ses idées visionnaires et ses valeurs humanistes. L’année 2016 sera marquée par une programmation exceptionnelle. Une exposition temporaire, la restitution de la demeure après 60 ans de travaux, des spectacles inédits, la remise du Prix Léonard de Vinci et le Festival Européen de Musique Renaissance. Leonardo da Vinci’s house The Leonardo da Vinci Park A top cultural attraction – a real journey of discovery, on the trail of Leonardo da Vinci’s visionary genius. Enter the universe of Leonardo’s creativity, enjoying a walk which is both fun and educational… Leonardo’s garden The Château du Clos Lucé brings to life the Master’s botanical drawings, geological studies and landscapes. -

Léonard De Vinci Et Les Amis Du Louvre
ÉDITORIAL septembre 2019 – 4e trimestre 2019 Le Président, Louis-Antoine PRAT Madame, Monsieur, cher Ami du Louvre, la société des amis du louvre a offert au musée Chacun connaît le vilain mot de « blockbuster » et sait qu’il désigne une exposition promise à une haute fréquentation. Dans le cas de la célébration au Louvre de l’œuvre n coffret de la Duchesse De Berry de Léonard de Vinci, qui ouvrira en octobre dans l’ensemble du hall Napoléon, c’est peu de dire que l’on s’attend à ce que des records de visites soient battus, comme ils l’ont été cet été dans l’ensemble du musée. Grâce à votre carte d’Amis, vous demeurez parmi les rares privilégiés à bénéficier de l’entrée libre sans réservation dans les collections. Concernant l’exposition Léonard, alors que la réservation est obligatoire pour tous les visiteurs, notre équipe a pris toutes les précautions pour faciliter vos accès prioritaires à cet événement, et nous avons même été jusqu’à installer, pour ceux d’entre vous qui ignorent encore internet (sont-ils ou non à classer parmi les heureux ou les sages du monde, je ne saurais le dire) un comptoir spécifique dans le salon d’accueil qui nous est dédié sous la pyramide, afin que les désirs de chacun soient satisfaits. On ignore cependant encore si la « mostra » Léonard battra les records de fréquentation de la rétrospective Delacroix, qui réunit de façon assez surprenante il y a deux ans en ce même lieu davantage de visiteurs que celle consacrée à Vermeer, et qui se déroula sans la moindre anicroche. -

Italian Renaissance Portraits That Disappoint: Isabella D'este
Italian Renaissance Portraits that Disappoint: Isabella d’Este, Francesco del Giocondo and Other Displeased Patrons Faculty Research Working Paper Series Jonathan K. Nelson Syracuse University Florence and Harvard Kennedy School Richard Zeckhauser Harvard Kennedy School July 2019; Revised April 2021 RWP19-024 Visit the HKS Faculty Research Working Paper Series at: https://www.hks.harvard.edu/research-insights/publications?f%5B0%5D=publication_types%3A121 The views expressed in the HKS Faculty Research Working Paper Series are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the John F. Kennedy School of Government or of Harvard University. Faculty Research Working Papers have not undergone formal review and approval. Such papers are included in this series to elicit feedback and to encourage debate on important public policy challenges. Copyright belongs to the author(s). Papers may be downloaded for personal use only. www.hks.harvard.edu Italian Renaissance Portraits that Disappoint: Isabella d’Este, Francesco del Giocondo and Other Displeased Patrons∗ Jonathan K. Nelson± and Richard J. Zeckhauserδ Abstract The successful fruits of Italian Renaissance patronage were often prominently displayed by the original owners and written up favorably by their contemporaries and ours. By contrast, paintings and sculptures that displeased or, worse, disgraced their patrons, though occasionally mentioned in publications about the patrons or artists, tended to get lost in historical accounts. As a result, standard assessments convey an unrealistically favorable picture. To facilitate a more balanced understanding of the patronage process, this essay addresses the risks inherent in commissioned portraits made in Italy from the late fifteenth through the late sixteenth century, including paintings by Andrea Mantegna, Domenico Ghirlandaio, and Leonardo da Vinci. -

Cézanne in Philadelphia Collections
Digitized by the Internet Archive in 2014 https://archive.org/details/czanneinphiladelOOrish CEZANNE IN PHILADELPHIA COLLECTIONS THIS CATALOGUE AND EXHIBITION WERE SUPPORTED BY GRANTS FROM THE PEW MEMORIAL TRUST AND THE NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS, A FEDERAL AGENCY CEZANNE IN PHILADELPHIA COLLECTIONS BY RISHEL JOSEPH J. PHILADELPHIA MUSEUM OF ART This book is published in conjunction with an exhibition at the Philadelphia Museum of Art, June 19 to August 21, 1983 cover; The Large Bathers (detail), no. 22 frontispiece: Self-Portrait, no. 40 Designed by Joseph B. Del Valle Printed by Lebanon Valley Offset, Annville, Pa. Copyright 1983 Philadelphia Museum of Art Printed in the United States of America All rights reserved ISBN 87633-055-3 Photography by Will Brown: nos. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 30; all other works in the exhibition photographed by Eric Mitchell. Fig. 33a from Leon Deshairs, Aix- en-Provence: Architecture et decoration aux dix-septieme et dix-huitieme siecles (Paris, 1909), pi. 6. PREFACE VII CEZANNE AND COLLECTING IN PHILADELPHIA IX CHRONOLOGY XX BIBLIOGRAPHICAL ABBREVIATIONS XXIII PAINTINGS I DRAWINGS & WATERCOLORS 49 PRINTS 79 CEZANNE IN PHILADELPHIA COLLECTIONS Preface The city of Philadelphia and its surrounding area are fortunate indeed in their great holdings of works by French masters of the late nineteenth century. An impressive number of Philadelphia's artists and collectors were attracted to advanced painting in France by the first decade of this century and their enthusiasm is reflected in both the Museum's holdings and private collections nearby. The Barnes Foundation in Merion, Pennsylvania, presents the paintings of Renoir, Seurat, and Cezanne in extraordinary richness, within a vast collec- tion of the period. -

Photokina 1956: a Revolt Against the Universal Language of Photography
Photokina 1956: A Revolt Against the Universal Language of Photography Alise Tifentale, the Graduate Center, City University of New York Email: [email protected] Web site: www.alisetifentale.net Summary: Photography is a universal language, “understood on all five continents, irrespective of race, creed, culture or social level”—this announcement by Maurice van de Wyer, the president of the International Federation of Photographic Art (Fédération internationale de l'art photographique, FIAP) echoed numerous other assertions made at the opening of the fifth annual photography trade fair and exhibition complex Photokina 1956, which took place in Cologne, West Germany, from September 29 to October 7, 1956. The leaders of the U.S. and West Germany, international organizations such as the UN and UNESCO, the photography industry, and photographers around the world all shared a similar idealism. Their praise of photography as a universal language, however, was unanimous only in theory. In practice, art exhibitions organized within the framework of Photokina 1956 revealed a chasm between two radically different understandings of photography. On one hand, there were exhibitions featuring narrative photo-essays by a small elite of Western European and U.S. magazine photographers. On the other, was the fourth FIAP Biennial of photographic art, displaying creative photography from thirty-six countries in Western and Eastern Europe, Latin America, Asia, and Africa. The FIAP Biennial revolted against the predominant principles of exhibiting photography in terms of content and aesthetics, exhibition design strategies, and the concept of authorship. This article analyzes this revolt and traces the reasons why it went largely unnoticed.