Mise En Page 1 13/11/09 15:48 Page 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Sans Titre-86
À PARTIR DU 29 AOÛT 2016 AOÛT DU 29 PARTIR À 78 LANCHE B Horaires HIVER 2016/2017 HIVER Horaires ROIX LINSELLES BONDUES C QUESNOY-SUR-DEÛLE TOURCOING ● ● ● ● ● ● ● ● transpole.fr Vers QUESNOY-SUR-DEÛLE 78 T TER WASQUEHALDesmoulins WASQUEHALWasquehal Isly Triez Place deRue la Paixde Londres Mouvaux Cimetière Lamartine Collège Van Der Meersch QUESNOYQuesnoy Le Pont Stade Léo Lagrange 4 Bonniers Gare T Linselles Cimetière TOURCOINGVictoire Austerlitz Saint FrançoisLorthiois Les FougèresLe Vélo Institution La Croix Collège St Marie Calais JB Lebas BlancheDomaine deRobert DescampsLinselles Place Frères d’HalluinLes Trois FétusLe ChéneauLa ChapellePetit PerleLes Olympiades QuesnoyQUESNOY Centre Lycée Gambetta La Croix Blanche Quesnoy Mairie Blanche porte TOURCOING WASQUEHAL / MOUVAUX BONDUES LINSELLES QUESNOY-SUR-DEÛLE CORRESPONDANCES T Tramway Tourcoing Du lundi au vendredi 78 Note m m z z z z LEO LAGRANGE 07:27 WASQUEHAL LAMARTINE 07:30 MOUVAUX CIMETIERE 07:39 LYCEE GAMBETTA 12:18 16:55 17:55 INSTITUTION LA CROIX BLANCHE 07:47 12:10 12:37 17:20 18:13 LINSELLES PLACE 12:16 12:43 17:00 17:26 18:00 18:19 QUESNOY MAIRIE 12:30 12:56 17:14 17:40 18:13 18:31 QUESNOY CENTRE 12:32 17:16 QUESNOY BLANCHE PORTE 12:33 17:18 QUESNOY GARE 12:36 12:59 17:21 17:44 18:16 18:35 4 BONNIERS 12:37 17:22 17:45 18:36 m = mercredi uniquement z = Sauf mercredi Samedi 78 Note A LEO LAGRANGE WASQUEHAL LAMARTINE MOUVAUX CIMETIERE LYCEE GAMBETTA 12:18 INSTITUTION LA CROIX BLANCHE 12:33 LINSELLES PLACE 12:40 QUESNOY MAIRIE 12:52 QUESNOY CENTRE QUESNOY BLANCHE PORTE QUESNOY GARE 12:54 4 BONNIERS A = SAMEDIS SCOLAIRES UNIQUEMENT - Crédits photos : ©Thinkstock / Ne pas jeter sur la voie publique. -

La Demande D'emploi
La Demande d’emploi au 31 Décembre 2017 Ensemble pour l’emploi sur la Métropole Européenne de Lille Mars 2018 - N°39 SITUATION de la demande d’emploi L’année 2017 se termine par une hausse du Cette progression du nombre de demandeurs nombre de demandeurs d’emploi de catégories d’emploi s’inscrit dans un contexte de crois- Arrondissement de Lille ABC dans l’arrondissement de Lille sur un an : sance économique plus soutenue. Si le chô- 1 236 000 habitants + 5 343 personnes, soit +4,4%. Cette hausse est mage de longue durée progresse encore, témoi- 124 communes un peu plus importante qu’en région Hauts de gnant de la difficulté à bénéficier des créations 2 France (+3,9%). d’emploi, c’est le chômage de moins longue 880 km Parmi les différents profils de demandeurs d’em- durée (- de 12 mois) qui connaît la plus forte ploi observés dans ce bulletin, les jeunes conti- augmentation (+5%). Est-ce la progression des nuent de voir leur nombre diminuer (-0,7%) mais offres d’emploi qui génère une (ré) inscription +4,4% en 1 an moins fortement que les trois trimestres précé- de certaines personnes sans emplois ? Est-ce soit +5 340 dents. Tous les indicateurs évoluent plus fortement un effet de la baisse des contrats aidés mise en sur le bassin d’emploi de Roubaix-Tourcoing-Val- œuvre en 2017 ? lée de la Lys sauf pour les jeunes. Public Part dans la DEFM ABC Evolution sur un an Seniors (+ de 50 ans) 22% (27 425) +5,7% (+1 470) Femmes 48% (61 292) +6,3% (+3 652) Non diplômés 17% (21 982) + 3,3% (+708) Longue durée (1 an et +) 47% (58 880) + 3,7% (+ 2 -

Séance Du Conseil Des Communes De Neuville-En-Ferrain, Tourcoing
Séance du Conseil des communes de Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, Roubaix, Hem, Leers, Lys-lez-Lannoy 29 avril 2019 Le 29 avril 2019, à 18h15, le Conseil des Communes, Composé des élus des communes de Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, Roubaix, Hem, Leers et Lys-lez- Lannoy, Et en présence de représentants des communes de Wattrelos, Wasquehal, Forest-sur-Marque, Mouvaux, Roncq et Villeneuve d’Ascq, S’est réuni à l’Hôtel de Ville de Roubaix, pour convenir d’une contribution commune en faveur du développement des infrastructures de transports collectifs structurants sur le versant Nord-est du territoire Métropolitain, à horizon 2035. Le vœu a été adopté à la majorité. Détail des votes : 201 votes en faveur du vœu, 5 abstentions. 0 contre. Vœu en faveur d’une contribution des communes de Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, Roubaix, Hem, Leers, Lys-lez-Lannoy dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur des Infrastructures de Transports Vu la délibération n°18 C 0983 prise par la Métropole européenne du Lille du 14 décembre 2018, lançant la concertation du SDIT ; Considérant l’invitation de la MEL à échanger sur l’avenir des infrastructures de transports collectifs structurants sur le territoire métropolitain, et en particulier sur son versant Nord- Est, à échéance 2035 ; Considérant l’urgence climatique et la volonté de nos communes de répondre à la demande de nos populations réclamant, à juste titre, des efforts sans précédent pour contribuer à la transition écologique et à nos changements de comportements en termes de déplacements ; Considérant -

Circuit De Robigeux : Roubaix : La Piscine, Musée D’Art Et D’Industrie En Novembre (03.20.43.55.75)
à PIED dans le NORD à PIED dans le NORD L’ambassadrice du Nord Lille Métropole Lille Métropole o Sur les chemins Sur les chemins de campagne N 19 de campagne A 22 Tourcoing N 17 de la de la Bondues de la Pévèle, de la Pévèle, Mouvaux du Mélantois et du Mélantois et N 354 de la Haute-Deûle Circuit de la Haute-Deûle Marcq-en-Barœul Roubaix Wasquehal de Robigeux N 356 Sailly-lez O ND NN Lannoy A EZ Lille Sailly-lez-Lannoy, Willems R D L A 1 Villeneuve d'Ascq A (10 km - 2 h 30 à 3 h 20) E N R S 3 Toutes les informations pratiques mentionnées mai (03.28.38.20.43), Lille aux Saveurs en mai, La U Ferme de Meurchin, Sally-les-Lannoy. de Meurchin, Ferme couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit. Braderie en septembre (0890.39.2004), Cinérail, U T A festival train et cinéma en novembre N Elle participe à la ferveur régnant l’autre ; le résultat de leur travail Activités et curiosités E N (01.40.10.98.07). M SPACE dans le Nord, ses couleurs vives et dépendant des conditions météo- Bondues : Musée de la Résistance Marcq-en-Barœul : É IN Saint Vincent TR A chatoyantes aidant. Elle est issue rologiques et de la qualité de leur (03.20.28.88.32). d’Automne en septembre (03.20.45.46.37). OPOLIT du mariage savant de l’argile, des four, était souvent aléatoire. Bouvines : Vitraux de l’église St-Pierre Roubaix : « Le Paris-Roubaix » en avril, Fête de (03.20.79.46.15). -

Hem Croix Roubaix Wattrelos Leers Toufflers Lys-Lez
r. Le Duc vers Tourcoing rue L4 vers Halluin L8 Patriotes Parc Jules CH Dron Gounod vers Tourcoing r. G. Philippot du Lion 2 Fauré 35 Risquons Tout rue Roubaix r. de Union L8 de St Liévin Mercure Le Hutin Wattrelos Centre bd de Metz CIT5 r. de Tourcoing CIT5 17 30 Guinguette Rollin Canal L4 r. Briffaut De Gaulle Foch Bd de r. d’Oran Vallon Metz 10 R. de Herriot CIT5 La Roselière rue du Blanc Seau Tourcoing La Vigne r. de la Baillerie Alsace Fosse aux Z6 Wattrelos Place Wattrelos Chênes Quartier Beaulieu Centre Commercial MWR La Paix L3 35 E. Moreau Pellart République Carnot Collège St Rémi ROUBAIX Carnot Z6 TER L3 WATTRELOS Gare Jean Place Avelghem Hommelet rue Lebas Roubaix 33 Chaptal Nations Galon Roubaix d'Eau Mouvaux Unies r. de Grand Place L8 Liane L4 Condition 35 Publique Un nouvel itinéraire de Leers Centre Eurotéléport Commercial35 à Roubaix Fosse aux Chênes, 2 R P. de Carnot Tourcoing et Halluin Roubaix 10 L3 L4 L8 C12 Roubaix rue Roubaix Charles 33 34 35 36 L4 34 Dunant de Gaulle 226 MWR 33 av. de rue de l’Épeule Ste Élisabeth de Epeule A.Mongy Verdun Leers LEERS Montesquieu St Jean Guesde Roubaix r. Kléber Trois C. Commercial rue du Mal. Leclerc Manufacture Vélodrome Wattrelos vers Lomme r. DammartinR. de Montgolfier Ponts L4 66 St Philibert Denain Coq Français Fraternité Van Der r. de Lannoy Verdun Meersch 2 J. Moulin Danièle Bd. de CIT5 Mulhouse Beaumont Lesaffre Coubertin Manufacture Mairie L8 Dupuy Fraternité Avenue des Sports Lys Liane 33 Hôpital de Lôme Pont Rouge 66 de Croix av. -

Résultats De La Competition Départementale Finalité Nationale Mouvaux 31 Janvier Et Le 1 Février 2009 1
Résultats de la competition Départementale Finalité Nationale Mouvaux 31 Janvier et le 1 Février 2009 1. FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (individuels) 1.1. Résultats par équipes Equipe Club Total 1 Wattrelos La patriote de 26.6 26.5 24.8 26.9 104.8 wattrelos 2 Douai 2 Douai 25.5 25.7 24.9 25.9 102.0 3 Mouvaux Mouvaux 24.5 26.1 23.5 24.8 98.9 4 fives fives 25.7 23.7 22.3 24.1 95.8 5 Loos Loos 24.8 22.5 22.4 24.9 94.6 6 Hazebrouck hazebrouck 24.5 22.4 22.9 24.5 94.3 7 Emmerin A.G.Emmerin 25.0 20.7 20.8 24.1 90.6 8 Cuincy Cuincy 16.4 12.1 13.0 16.5 58.0 9 Douai 1 Douai 13.1 14.2 12.0 13.4 52.7 1.2. Résultats individuels Gymnaste Equipe Annee Total 1 BAUDUIN Carol-anne Douai 1 1990 6.7 7.2 6.5 6.9 27.3 2 LEFEBVRE Oceane Wattrelos 1995 7.0 6.5 6.0 7.1 26.6 3 SMAILLE Neige Wattrelos 1993 6.5 6.9 6.1 6.6 26.1 BINAUT Celia Douai 2 1994 6.4 6.7 6.2 6.8 26.1 5 BACQUEVILLE CHLOE Wattrelos 1996 6.6 6.4 6.3 6.6 25.9 6 DURIEZ Julie Douai 2 1992 6.2 6.5 6.4 6.5 25.6 7 DELFORGE Camille Douai 1 1988 6.4 7.0 5.5 6.5 25.4 8 OBIN Adeline Loos 1991 6.9 6.4 5.4 6.5 25.2 9 BOURGEOIS EMILIE Hazebrouck 1992 5.8 7.2 5.8 6.3 25.1 10 COZZO Fiona Wattrelos 1992 6.1 6.3 6.4 6.2 25.0 DURAND Matea Mouvaux 1993 6.7 7.0 5.2 6.1 25.0 12 PANNEQUIN Julie Douai 2 1992 5.8 6.5 6.3 6.3 24.9 13 ROUSSEAUX Camille Wattrelos 1993 6.5 6.7 5.0 6.6 24.8 burette antonine fives 1992 6.8 6.1 5.3 6.6 24.8 15 MARESCAUX Sophie Emmerin 1989 6.6 5.7 5.6 6.6 24.5 PUTMAN Joséphine Loos 1993 6.3 5.8 5.9 6.5 24.5 planque pauline fives 1988 6.5 6.1 6.2 5.7 24.5 18 BULTE Maud Douai 2 -

Plaquette CMP 59I07 Roubaix Rue De Lille
Autres structures Contact Le CMP infanto-juvénile couvre les secteurs suivants : Centre Médico-Psychologique Roubaix Ouest Roubaix - Croix - Wasquehal - Hem - Lannoy. Croix - Wasquehal Le CMP travaille en lien étroit avec l’unité intersectorielle : 55-57 rue de Lille, 59100 Roubaix UFA (Unité Fonctionnelle pour Adolescents) T : 03 20 20 61 90 - F : 03 20 20 61 99 Clinique de l’Ado M : [email protected] 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille T : 03 59 09 03 70 et Hôpital de jour le Mikkado 45/3 avenue de Flandre, 59290 Wasquehal T : 03 20 89 48 90 CMP 59i07 Prévention SOINS Consultations pour adolescents Consultations Rue de Soubise 12 rue Rémy Cogghe, 59100 Roubaix V’Lille Station Orientation T : 03 20 26 00 22 Rue de Rohan prise en charge Rue de la Tour Rue des Arts Métro : Ligne 2 Centre psychothérapeutique de jour « Arc-en-ciel » arrêt Roubaix Charles de Gaulle Rue de Lille 55 rue de Lille, 59100 Roubaix Rue des Loups M T : 03 20 20 61 61 Rue de l’industrie Rue du Général Chanzy Et les autres unités fonctionnelles du secteur : Rue Charles Quint CMP 86 rue Pellart Rue de Lille 59100 Roubaix – T : 03 20 73 97 88 Rue de Soubise CMP 304 avenue Alfred Motte, T Tramway : Ligne Lille 59100 Roubaix – T : 03 20 75 09 81 Bd du Général Roubaixde Gaulle - Tourcoing B arrêt J.Moulin Rue Colbert Bus : Ligne 30 CMP 56/58 rue du Docteur Leplat, arrêt J.Moulin 59150 Wattrelos – T : 03 20 89 39 11 Consultations pour adolescents 12 rue Rémy Cogghe, 59100 Roubaix Centre Médico T : 03 20 26 00 22 Le CMP rue de Lille à Roubaix fait partie Flashez le code du secteur 59i07 Roubaix - Croix - Wasquehal pour plus d'infos Hem - Lannoy. -

T4 À Vendre Saint-André-Lez-Lille Alerte Immo
Magnifique appartement T4 de 89 m2 habitables comprenant 3 chambres, une très belle terrasse et 2 places de parking 330 000 € 89 m² 4 pièces Saint-André-lez-Lille Type d'appartement T4 Surface 89.00 m² Séjour 33 m² Balcon 16 m² Pièces 4 Chambres 3 Salle de bains 1 WC 1 Indépendant Étage 1 Epoque, année 2007 État général En excellent état Chauffage Electrique Aménagée et équipée, Coin Cuisine cuisine Ouvertures PVC, Double vitrage Exposition Sud-Est Charges 157 € /mois Référence VA2080, Mandat N°512 SOUS COMPROMIS DE VENTE EXCLUSIVITE ALERTE IMMO LILLE ET LINSELLES L'INTEGRALITE DES PHOTOS ET LA VIDEO DU BIEN SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET Saint-André-lez-Lille, à 10 min de Lille A proximité des commerces, des axes routiers et de la Gare de Saint-André-lez-Lille Au premier étage d’une résidence récente et sécurisée de 3 étages composée de 16 appartements dans un cadre calme, magnifique appartement T4 de 89 m2 habitables comprenant 3 chambres, une très belle terrasse et 2 places de parking Ce bien soigné et joliment décoré se compose de: - Un grand hall d’entrée avec 2 placards de rangement dont un comprenant le cumulus - Une belle pièce de vie de 33,25 m2 lumineuse grâce à 2 doubles portes-fenêtres donnant sur la terrasse Cette pièce comprend: - Un salon / salle à manger avec parquet - Un coin cuisine (carrelage au sol) avec cuisine aménagée grâce à de nombreux rangements et équipée d’un four, d’un micro-ondes, d’un lave-vaisselle et d’un frigidaire- congélateur La cuisine est équipée d’un bar donnant sur le salon - Une chambre -

Centre Médico Psychologique
Autres structures Contact Le CMP infanto-juvénile couvre les villes de Marquette-lez-Lille, Centre Médico-Psychologique La Madeleine 59i06 La Madeleine, Marcq-en-Barœul et Wambrechies. 55 avenue Saint-Maur, 59110 La Madeleine Le CMP travaille en lien étroit avec les autres unités T : 03 20 74 63 80 - F : 03 20 74 63 85 fonctionnelles du secteur : M : [email protected] CMP 92 rue du Général de Gaulle 59370 Mons-en-Baroeul T : 03 20 84 22 84 Avenue Saint-Maur CMP 1 rue des Comices CMP 59i06 Rue Carnot 59650 Villeneuve d’Ascq T : 03 20 19 04 70 SOINS Consultations CMP 72 rue Nationale Rue Jean Bart Orientation 59710 Pont-à-Marcq prise en charge D57 T : 03 20 41 53 80 Rue Faidherbe Tramway Lille - Roubaix Hôpital de jour L’Opéra bleu T Tourcoing 83 avenue de Flandre, 59650 Villeneuve d’Ascq D670 Arrêt Saint-Maur T : 03 20 81 94 30 Rue du Maréchal Foch Rue AmpèreRue Berthelot Et sur l’ensemble des secteurs couverts Rue Saint-Henri par l’EPSM de l’agglomération lilloise : Avenue de la République Rue de Paris UFA (Unité Fonctionnelle pour Adolescents), D670 Clinique de l’adolescent 45/3 avenue de Flandre, 59290 Wasquehal D5A T : 03 20 89 48 90 D5 Centre Médico Le CMP de La Madeleine couvre le secteur 59i06. C'est une structure gérée par l'Établissement Public de Santé Mentale de l'agglomération lilloise dont le siège se situe à Saint-André-lez-Lille. Psychologique www.epsm-al.fr Secteur de psychiatrie infanto-juvénile La Madeleine Service communication de l'EPSM de l'agglomération lilloise - Septembre 2016 lilloise - Septembre de l'EPSM l'agglomération communication Service 59i06 L'offre de soins sectorisée Prises en charge En France, les services de psychiatrie et de santé mentale Le CMP est un lieu d'accueil et de soins. -

Lettre-Vaccination-29-01-2021
Chère Marcquoise, cher Marcquois, Depuis le début de cette crise inédite, la Ville de Marcq-en-Barœul s’est mobilisée pour vous accompagner et apporter des réponses, notamment auprès de celles et ceux qui avaient besoin d’un soutien. C’est grâce à l’action des services municipaux que nous avons pu agir et je les remercie du fond du cœur. Leur mobilisation nous a notamment permis de fournir un masque à l’ensemble des Marcquois, ou encore mettre en place un service sms gratuit afin de répondre à toutes vos questions et rester en contact avec les personnes les plus fragiles. Je veux également associer dans mon propos les nombreuses personnes (couturières et couturiers, distributeurs…) qui ont agi bénévolement et dans l’anonymat aux côtés de la Ville, permettant d’organiser une chaîne de solidarité indispensable durant cette période difficile. Récemment, nous, Maires des communes de Bondues, La Madeleine, Marquette-lez-Lille, Marcq-en-Barœul, Mouvaux, Saint-André-Lez-Lille, Wambrechies, avons proposé à Monsieur le Préfet l’ouverture d’un grand centre de vaccination à l’hippodrome de Marcq-en-Barœul. Le manque actuel de vaccins disponibles ne permet pas, pour l’heure, l’ouverture de ce centre, laquelle pourra toutefois intervenir – je cite les propos du Préfet – « dans un second temps ». Sans attendre cette échéance, et afin de renforcer le contact et l’aide nécessaires à ceux qui en ont besoin, j’ai décidé la mise en place d’une plateforme d’information téléphonique exclusivement dédiée à la vaccination contre la COVID-19. 03 20 45 63 20 (prix d’un appel local) Cette plateforme téléphonique est opérationnelle à compter du vendredi 29 janvier et fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. -

LIAISON INTERCOMMUNALE NORD-OUEST Partie
LIAISON INTERCOMMUNALE NORD -OUEST Partie Sud Communes de Lambersart, Lomme, Sequedin, Loos, Haubourdin et Emmerin DOSSIER D ’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DOSSIER CONCERNANT L ’UTILITE DU PROGRAMME PIECE F : ETUDE D ’IMPACT AOUT 2012 - MIS A JOUR FEVRIER 2013 Liaison Intercommunale Nord-Ouest – partie Sud Dossier d’enquête publique unique 2 08/2012 – 02/2013 Dossier concernant l’utilité du programme ETUDE D’IMPACT Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un document individualisé, distinct du présent document. Liaison Intercommunale Nord-Ouest – partie Sud Dossier d’enquête publique unique 1 08/2012 – 02/2013 Dossier concernant l’utilité du programme Liaison Intercommunale Nord-Ouest – partie Sud Dossier d’enquête publique unique 2 08/2012 – 02/2013 Dossier concernant l’utilité du programme AAUUTTEEUURRSS DDEE LL’’’EETTUUDDEE Cette étude d’impact a été réalisée par la société : Egis Aménagement 40 avenue de la Marne BP 87 59 442 WASQUEHAL Cedex La rédaction du présent document a été assurée par Séverine Facchin, ingénieur d’études, Eric Verbeke et Frédéric Dehont, assistants d’études, sous la direction de Françoise Marcinkowski, responsable du service Urbanisme, Environnement et Paysage. Liaison Intercommunale Nord-Ouest – partie Sud Dossier d’enquête publique unique 3 08/2012 – 02/2013 Dossier concernant l’utilité du programme Liaison Intercommunale Nord-Ouest – partie Sud Dossier d’enquête publique unique 4 08/2012 – 02/2013 Dossier concernant l’utilité du programme DDOOSSSSIIIEERR DD’’’EETTUUDDEE DD’’’IIIMMPPAACCTT 1 DESCRIPTION DU PROJET 12 1.1 HISTORIQUE DU PROJET ....................................................................................................... 12 1.1.1 De la VINO… ............................................................................................................................................... 12 1.1.2 … A la LINO… ............................................................................................................................................ -
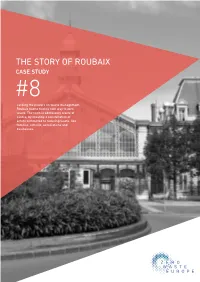
THE STORY of ROUBAIX CASE STUDY #8 Lacking the Powers on Waste Management, Roubaix Had to Find Its Own Way to Zero Waste
THE STORY OF ROUBAIX CASE STUDY #8 Lacking the powers on waste management, Roubaix had to find its own way to zero waste. The town is addressing waste at source, by creating a constellation of actors committed to reducing waste, like families, schools, associations and businesses. Case study 1 FIRST STEPS Municipal waste in France is collect- shift its neighbouring towns’ posi- ed, managed and treated by associa- tions. Stuck in a low-performing sys- tions of cities and towns. This means tem of separate collection, relying that those municipalities willing to mostly on end-of-pipe solutions for transition towards Zero Waste need waste, Roubaix started developing a to count on the support of the neigh- new approach to Zero Waste. bouring towns, or they find them- selves unable to act. The town of Roubaix, situated in THE CITY AS ECOSYSTEM Northern France, just on the border with Belgium, isn’t well-known for In order to implement a Zero Waste being a beacon of environmentalism Strategy, Roubaix initiated an origi- in France. Rather on the contrary, nal strategy. Lacking the competenc- Roubaix is a post-industrial area, es of collection and treatment, the considered to be the poorest town in town changed the approach. Rather France, with 46% of people below the than considering waste as a set of poverty line and high unemployment streams to manage, the strategy rate. However, who said zero waste considered it as the consequence of was reserved for well-off towns? a certain lifestyle and pattern of con- sumption. In this sense, Roubaix’s Roubaix Municipal elections of 2014 were strategy focused, therefore, on the hotly contested in Roubaix with the source of the problem, aiming at de- .> 95.866 inhabitants emergence of four civic lists that veloping a transversal policy.