Schema De Prevention Des Risques Naturels a La Reunion
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'île De La Réunion Sous L'œil Du Cyclone Au Xxème Siècle. Histoire
L’île de La Réunion sous l’œil du cyclone au XXème siècle. Histoire, société et catastrophe naturelle Isabelle Mayer Jouanjean To cite this version: Isabelle Mayer Jouanjean. L’île de La Réunion sous l’œil du cyclone au XXème siècle. Histoire, société et catastrophe naturelle. Histoire. Université de la Réunion, 2011. Français. NNT : 2011LARE0030. tel-01187527v2 HAL Id: tel-01187527 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01187527v2 Submitted on 27 Aug 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE DE LA REUNION FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES L’île de La Réunion sous l’œil du cyclone au XXème siècle. Histoire, société et catastrophe naturelle. TOME I Thèse de doctorat en Histoire contemporaine présentée par Isabelle MAYER JOUANJEAN Sous la direction du Professeur Yvan COMBEAU Le jury : -Pascal Acot, C.R.H. C.N.R.S., H.D.R., Université de Paris I – Panthéon Sorbonne ; C.N.R.S. -Yvan Combeau, Professeur d’Histoire contemporaine, Université de La Réunion -René Favier, Professeur d’Histoire moderne, Université Pierre Mendès France – Grenoble II -Claude Prudhomme, Professeur d’Histoire contemporaine, Université Lumière - Lyon II -Claude Wanquet, Professeur d’Histoire moderne émérite, Université de La Réunion Soutenance - 23 novembre 2011 « Les effets destructeurs de ces perturbations de saison chaude, dont la fréquence maximale est constatée en février, sont bien connus, tant sur l’habitat que sur les équipements collectifs ou les cultures. -
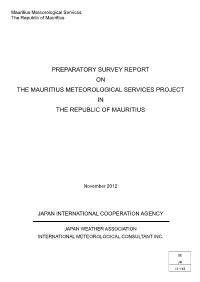
Preparatory Survey Report on the Mauritius Meteorological Services Project in the Republic of Mauritius
Mauritius Meteorological Services The Republic of Mauritius PREPARATORY SURVEY REPORT ON THE MAURITIUS METEOROLOGICAL SERVICES PROJECT IN THE REPUBLIC OF MAURITIUS November 2012 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY JAPAN WEATHER ASSOCIATION INTERNATIONAL METEOROLOGICAL CONSULTANT INC. GE JR 12-143 Summary Summary Mauritius, a country consisting of small islands, is located in the cyclone-prone area of the Southwest Indian Ocean and is often affected by natural disasters such as heavy storms, tidal waves and floods caused by tropical cyclones, landslides and so on. Recently, climate change caused by global warming has posed a serious problem for Mauritius as it is predicted to have significant negative impacts on small island nations which are particularly vulnerable to a change in the natural environment. In addition, it is said that climate change has a potential to become the greatest threat to the sustainability of the very foundations of human survival. Thus, it is a significant global issue which developed and developing countries alike must deal with in mutually beneficial cooperation. In line with increasing global concerns on the intensification of disasters caused by climate change, the establishment of effective countermeasures against disasters such as severe storms, storm surges, and floods caused by tropical cyclones, rising sea level, tsunami, etc. has been an urgent task in Mauritius as well as in other countries in the Southwest Indian Ocean. In order for Mauritius to contribute to the alleviation of natural disasters in the Southwest Indian Ocean, the following are required and strongly desired: 1) An efficient meteorological observation system; and, 2) An Exchange of meteorological observation data and information about cyclones with neighboring countries in the Southwest Indian Ocean on a timely basis. -

A 275 Annexes 061102
Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Etat des connaissances sur les causes de dégradation des milieux récifaux Fiches pressions - impacts - Juillet 2007 - Maître d’ouvrage : DIREN Dossier n° : A. 275 Nb pages : 47 Synthèse de l’état des connaissances sur les causes de Nb figures : 0 dégradation des milieux récifaux – Fiches pressions - impacts Nb cartes : 0 Nb photos : 0 Date : Juillet 2007 Auteur : ARVAM Diffusion • Libre CAMBERT Harold, NICET Jean Benoit, PINAULT Mathieu, QUOD • Restreinte Jean Pascal, TURQUET Jean • Confidentielle Résumé : L’île de la Réunion se situe dans un contexte océanographique caractérisé par des eaux oligotrophes et sténohalines, ainsi que par une absence de plateau continental. Pourtant, les récifs coralliens situés majoritairement au niveau de la côte sous le vent (Ouest et Sud- Ouest) connaissent depuis la décennie 70 des dégradations de leur état de santé, phénomène commun à l’ensemble des récifs de la planète. Cette dégradation tend à augmenter dans les différentes parties du monde du fait de l’accroissement des pressions d’origine anthropique et, constat plus récent, du réchauffement climatique. Si le constat d’une dégradation globale est aisé à établir, il est pourtant souvent délicat d’évaluer les parts respectives des perturbations d’origines anthropiques et naturelles (Dahl et Salvat, 1988 ; Grigg et Dollar, 1990 ; Salvat, 1992). Un bilan-diagnostic des dégradations devait donc être établi pour mieux connaître en termes qualitatifs et quantitatifs les pressions exercées et les réponses qui pourraient être amenées dans les années à venir d’une part en matière de connaissances structurelles et fonctionnelles des écosystèmes et d’autre part en relation avec l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). -

Tourist Destinations N5
NATIONAL CERTIFICATE TOURIST DESTINATIONS N5 (22030115) 21 November 2019 (X-Paper) 09:00–12:00 OPEN-BOOK EXAMINATION Candidates may take student portfolios containing notes, maps, brochures, guides, case studies, assignments and tests, and textbooks, GSA magazine, pocket calculator and an atlas into the examination venue. Candidates are entitled to 15 minutes reading time. This question paper consists of 17 pages and two addenda of 6 pages. Copyright reserved Please turn over (22030115) -2- DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION AND TRAINING REPUBLIC OF SOUTH AFRICA NATIONAL CERTIFICATE TOURIST DESTINATIONS N5 TIME: 3 HOURS MARKS: 200 NOTE: If you answer more than the required number of questions, only the required number of questions will be marked. Clearly cross out ALL work you do NOT want to be marked. INSTRUCTIONS AND INFORMATION 1. SECTION A is COMPULSORY. 2. Answer any FOUR questions from SECTION B. 3. Read ALL the questions carefully. 4. Number the answers according to the numbering system used in this question paper. 5. Start each question on a NEW page. 6. Write each question number in CAPITAL LETTERS at the top of each page. 7. Write neatly and legibly. Copyright reserved Please turn over (22030115) -3- SECTION A (COMPULSORY) QUESTION 1 1.1 AFRICAN SECTION Identify in which country the following national parks or game reserves are. Choose FIVE countries from the given list and match FOUR national parks/game reserves (from the given list) with those chosen countries. Write the country's name, then the FOUR matching national parks/game -

Dossier Départemental Des Risques Majeurs
DOSSIER DÉPARTEM ENTAL DES RISQUES MAJEURS DE LA RÉUNION PREFACE L’île de la Réunion est une des régions françaises les plus exposées aux risques naturels majeurs : chaque année, et surtout durant l’été austral, elle est affectée par des phénomènes naturels qui perturbent sa vie économique et impactent son environnement. Juiillllet 2016 LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS DE LA REUNION Elle est confrontée périodiquement aux ravages de cyclones tropicaux. Les pluies, les vents et les houles générés par ces phénomènes engendrent de graves conséquences, les plus destructrices sont les inondations et les mouvements de terrain. Hors cyclone, elle peut être frappée par des houles australes ou des fortes pluies dont les conséquences sont tout aussi importantes. A cela s'ajoute l'activité volcanique ou les tsunamis. Côté risques technologiques, le département de la Réunion est soumis à cinq risques: le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et les risques de ruptures de barrage et de digue. Ainsi, la connaissance des risques existants dans le département est fondamentale pour ses habitants. Mieux informés, les citoyens peuvent mieux se préparer à faire face aux situations dangereuses et l’exemple suivant en est une illustration incontestable : avec des rafales de vents identiques, supérieures à 250 km/h, le cyclone de 1948 causa la mort de 165 personnes tandis que celui de 2002 (cyclone DINA) n’a provoqué que des dégâts matériels. C’est en 1987 que le législateur a fait de l’information préventive sur les risques technologiques et naturels majeurs un droit, aujourd’hui inscrit dans le code de l’environnement (article L125-2). -

Cyclone Dina a La Reunion Les 22 Et 23 Janvier 2002 Caracterisation, Consequences Et Retour D’Experience
Affaire IGE/02/008 29 Janvier 2003 CYCLONE DINA A LA REUNION LES 22 ET 23 JANVIER 2002 CARACTERISATION, CONSEQUENCES ET RETOUR D’EXPERIENCE Après phase contradictoire établi par Monsieur Philippe HUGODOT Inspection Générale de l’Environnement Monsieur Pierre DUBOIS Conseil Général des Ponts et Chaussées avec l’appui technique du CSTB MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION..................................................................................................3 2. CARACTERISATION DU CYCLONE DINA, AU REGARD DU VENT................5 3. CONSIDERATIONS VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION .............................8 3.1. Approche règles neige et vent......................................................................................8 3.2. Approche Eurocode......................................................................................................9 3.3. Le cyclone Dina : quelle réglementation appliquer ?..............................................10 3.4. Aspects complémentaires...........................................................................................12 3.4.1. Pour une meilleure prise en compte de l’orographie............................................12 3.4.2. L’effet du changement climatique........................................................................12 4. CONSEQUENCES DU CYCLONE ....................................................................14 4.1. Un faible effet dévastateur ?......................................................................................14 -

Des Risques D'inondation 2011
L’évaluation préliminaire des risques d’inondation 2011 Bassin réunion pollution connaissance torrent patrimoine inondation réseaux préliminaire remontée de nappe potentielle ruissellement phénomènes vulnérabilité population nationale côtier historique agriculture directive ouvrages analyse gouvernance débordements inondable bassin risque densité économie extrême gestion acteurs impacts rupture tsunami crue synthèse emplois environnement évaluation indicateurs enjeux conséquences diagnostic submersion marine méthode enveloppe Europe établissements changement climatique Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr Sommaire Introduction.............................................................................................................................5 Présentation du district.........................................................................................................11 Géographie.......................................................................................................................13 Topographie et occupation du sol.................................................................................15 Principaux cours d'eau, bassins hydrographiques et zones littorales..........................16 Types d'inondations sur le district....................................................................................18 Nature des principaux enjeux...........................................................................................20 Politique -

Note De Présentation PPRL Trois-Bassins Approuvé
DEPARTEMENT DE LA REUNION Commune de Trois-Bassins PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX « Submersion marine et recul du trait de côte » ——————————— NOTE DE PRESENTATION Décembre 2019 ——————————— APPROBATION publique PPRL de Trois Bassins Note de présentation – Approbation Décembre 2019 Avertissement général sur les limites d’étude du document PPR Les débats soulevés pendant et après les enquêtes publiques sur les premiers PPR réalisés à La Réunion ont amené à rédiger cet avertissement général mettant l’accent particulièrement sur les limites d’étude des documents. Le terme de « risques naturels » communément employé dans des contextes très variés, est largement popularisé par les médias. Ce terme est pourtant souvent utilisé de manière impropre, et cela peut constituer une source de confusion. Il convient donc de préciser tout d’abord que le risque résulte de la conjonction de l’aléa (phénomène de mouvements de terrain, inondations, submersion, érosion, ou autre) et de la vulnérabilité (présence d’enjeux). Le présent Plan de Prévention des Risques littoraux prend en compte le risque « submersion marine » et le risque « recul du trait de côte » pour lesquels l’état des connaissances était suffisant pour pouvoir formuler des prescriptions réglementaires détaillées. Ce document a été établi dans une logique de prévention (et non d’exposition) en s’appuyant sur les connaissances disponibles. Ainsi, le PPR a été dressé au regard des risques recensés dans les études antérieures à son établissement. Le classement réglementaire rouge/bleu ne tient pas compte dans sa cartographie des travaux de protection à venir. A partir des données existantes sur le plan cartographique, des zonages réglementaires avec les interdictions et les prescriptions correspondantes ont été établis afin de constituer la servitude d’utilité publique. -

World Record Rainfalls (72-Hour and Four-Day Accumulations) at Cratère
1 2 3 4 World record rainfalls (72-hour and four-day accumulations) at Cratère 5 Commerson, Réunion Island, during the passage of Tropical Cyclone 6 Gamede 7 8 9 1 10 Hubert Quetelard 2 11 Pierre Bessemoulin 3 12 Randall S. Cerveny 4 13 Thomas C. Peterson 5 14 Andrew Burton 6 15 Yadowsun Boodhoo 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 Météo-France, La Réunion 30 2 Météo-France, France 31 3 Arizona State University, United States 32 4 NOAA’s National Climatic Data Center, United States 33 5 Bureau of Meteorology, Australia 34 6 Mauritius Meteorological Services, Mauritius 1 ABSTRACT 2 The World Meteorological Organization (WMO) Commission for Climatology (CCl) 3 evaluation process is applied to two extreme rainfall records occurring at Cratère Commerson on 4 La Réunion Island during the passage of the major Tropical Cyclone (TC) Gamede for inclusion 5 into the WMO CCl World Weather and Climate Extremes Archive. In February 2007, TC 6 Gamede made two approaches to La Réunion Island as it traversed a rather complex path in the 7 Indian Ocean. Gamede’s main feature was massive rainfall accumulation inland, with several 8 three- and four-day rainfall totals exceeding two meters. Specifically, an extreme rainfall rate of 9 3929 mm over 72 hours was recorded at Cratère Commerson, well above previous world record 10 of 3240 mm which had been measured at Grand-Ilet during TC Hyacinthe in 1980. Additionally, 11 the Cratère Commerson raingauge registered a rainfall total of 4869 mm over four days; also 12 well above the previous world record. -

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION Commune De Salazie
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION Commune de Salazie PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES « Inondations et mouvements de terrain » ——————————— NOTE DE PRÉSENTATION Juillet 2019 ——————————— Approbation publique PPR de Salazie Note de présentation Juillet 2019 Avertissement général sur les limites d’étude du document PPR Les débats soulevés pendant et après les enquêtes publiques sur les premiers PPR réalisés à La Réunion ont amené à rédiger cet avertissement général mettant l’accent particulièrement sur les limites d’étude des documents. Le terme de « risques naturels » communément employé dans des contextes très variés, est largement popularisé par les médias. Ce terme est pourtant souvent utilisé de manière impropre, et cela peut constituer une source de confusion. Il convient donc de préciser tout d’abord que le risque résulte de la conjonction de l’aléa (phénomène de mouvements de terrain, inondations, ou autre) et de la vulnérabilité (présence d’enjeux). Le présent Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles prend en compte le risque « mouvements de terrain » et le risque « inondations » pour lesquels l’état des connaissances était suffisant pour pouvoir formuler des prescriptions réglementaires détaillées. Ce document a été établi dans une logique de prévention (et non d’exposition) en appliquant le principe de précaution et en s’appuyant sur les connaissances disponibles. Ainsi, le PPR a été dressé au regard des risques recensés dans les études antérieures à son établissement. Le classement réglementaire ne tient pas compte dans sa cartographie des travaux de protection à venir. A partir des données existantes sur le plan cartographique, des zonages réglementaires avec les interdictions et les prescriptions correspondantes ont été établis afin de constituer la servitude d’utilité publique. -

Long-Term Monitoring of Two Shallow Coral Reef Communities
FRINGING REEFS OF REUNION ISLAND AND EUTROPHICATION EFFECTS. PART 1: LONG-TERM MONITORING OF TWO SHALLOW CORAL REEF COMMUNITIES BY CATHERINE TOURRAND,1 2* ODILE NAIM,3 2 LIONEL BIGOT,2 CHRISTOPHE CADET,4 BRUCE CAUVIN4, STUART SEMPLE,5 LUCIEN F. MONTAGGIONI,6 PASCALE CHABANET7 and HENRICH BRUGGEMANN2 ABSTRACT This study assesses changes in subtidal benthic communities on the largest reef flat in Reunion, Saint-Gilles La Saline, using several types of surveys. Temporal and spatial trends are documented over a 22 year period (1987-2009), thus spanning the 1998 and 2000s bleaching events. The most plausible explanations for the observed trends are proposed. We chose two sites that are characterized by two types of community and metabolism: (1) an oligotrophic site dominated by Acropora corals (Site-Toboggan), where sea-urchins are numerous and macroalgae rare and (2) a dystrophic site dominated by non-Acropora corals, mostly massive and submassive, where macroalgae abound and sea-urchins are almost absent (Site-Planch’Alizés). Results are presented in three parts : Part 1 : general trends of the communities, part 2 : primary producers, part 3 : living corals. Part 1 presents three surveys. Survey 1 reports status and trends across the reef flats in 1993, 1996, and 2002, with all attached benthic components reported at the level of the species where possible. Survey 2 reports composition and changes in associated sedentary organisms such as sea urchins, holothurids, and the Pomacentridae fish Stegastes. Survey 3 focuses on the period 1998 to 2009 on permanent transects established in 1987 and monitored periodically, partly as a contribution to the Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN). -

New Development on PMP Estimation in China 8Th
The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location. New Development on PMP Estimation in China Prof. Bingzhang Lin [email protected] Applied Hydrometeorological Research Institute (AHMRI)、 College of Hydrometeorology (COHM) Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST), CHINA 8th IWS/2nd TRCG Forum 2-6 December, 2013 Macao, China Page 1 Key issues in Engineering Hydrologic Studies --Hydrologic frequency & PMP estimation in China Page 2 100 years of AMS rainfall data at a station in the U.S. • (011901) 28-4229 ANMAX • 100 • 3.46 2.60 5.65 4.90 3.02 7.15 2.97 2.86 2.70 3.18 • 3.39 2.13 2.34 2.61 4.39 2.04 3.06 3.92 3.00 3.67 • 1.97 1.45 2.78 2.73 3.98 1.98 2.17 2.00 1.80 2.08 • 1.72 2.61 3.10 3.73 2.82 2.17 2.10 6.78 6.05 4.55 • 1.92 3.20 3.50 3.45 2.78 3.33 1.42 2.62 3.23 4.20 • 2.42 3.23 2.22 4.25 3.21 4.02 1.37 4.16 1.81 5.05 • 2.44 3.84 2.80 2.29 3.35 3.18 5.06 2.41 3.58 2.10 • 4.29 3.80 3.78 6.63 2.77 3.42 2.25 2.71 2.84 2.35 • 2.83 1.90 2.63 2.46 4.68 4.10 2.51 1.95 2.59 4.71 • 4.94 3.88 2.81 2.51 2.85 3.72 2.91 2.26 4.88 2.63 Page 3 100 years of AMS rainfall data (Sorted + Grouped) (011901) 28-4229 ANMAX 100 1.55 1.61 1.64 1.95 2.04 2.05 2.15 2.18 2.21 2.23 2.25 2.27 2.31 2.36 2.38 2.38 2.42 2.46 2.46 2.52 2.55 2.56 2.60 2.65 2.66 2.73 2.74 2.77 2.79 2.85 2.85 2.94 2.95 2.96 2.96 2.97 2.98 2.98 3.06 3.07 3.10 3.14 3.15 3.15 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.30 3.37 3.40 3.42 3.47 3.52 3.61 3.61 3.63 3.64 3.66 3.66 3.78 3.80 3.84 3.88 3.91 3.92 3.97 4.06 4.16 4.22 4.23 4.29 4.31 4.35 4.40 4.45 4.51 4.56 4.65 4.72 4.76 4.82 4.86 4.98 5.16 5.31 5.34 5.53 5.56 5.60 5.73 5.74 6.41 6.86 7.52 7.69 8.11 Page 4 Theoretical frequency curve 19 18 15 14 Empirical frequency curve 9 8 4 5 3 1 1 2 1 0 0 0 97 99 100 96 97 87 90 95 79 70 56 38 19 4 ( Increment = 0.5 in ) +∞ b ? Fx()==== f () xdx f () xdx f () xdx 1 ∫∫∫−∞ a ? f (x) pdf curve fx() ? ? a b x Page 6 Fig.