<Intitulé Du Projet>
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

EPCI À Fiscalité Propre Et Périmètre De La Loi Montagne
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE EPCI à fiscalité propre et périmètre de la loi Montagne Limony Charnas St-Jacques- Vinzieux Périmètre de la Loi Montagne d'Atticieux Lapeyrouse-Mornay Brossainc Félines Serrières Epinouze 11 Communautés d'agglomération Savas 11 Peyraud St-Marcel- Saint-Rambert-d'Albon lès-Annonay Peaugres Bogy Saint-Sorlin-en-Valloire 2 - Bassin d'Annonay St-Clair Champagne Anneyron Boulieu- Colombier- 15 - Privas Centre Ardèche lès-Annonay le-Cardinal St-Désirat Davézieux St-Cyr Andancette Annonay St-Etienne- Chateauneuf-de-Galaure Communautés de communes de-Valoux Albon Thorrenc Villevocance 22 1 - Vivarhône Vanosc Vernosc-lès- Talencieux Fay-le-clos Roiffieux Annonay 44 Mureils 3 - Val d'Ay Andance Beausemblant 4 - Porte de DrômArdèche ( 07/26) Monestier Ardoix Vocance Quintenas Saint-Uze 5 - Pays de St-Félicien St-Alban-d'Ay Sarras Saint-Vallier Claveyson 6 - Hermitage-Tournonais (07/26) St-Julien- Vocance St-Romain-d'Ay Ozon Saint-Barthélémy-de-Vals 7 - Pays de Lamastre St-Symphorien- Eclassan de-Mahun 8 - Val'Eyrieux 33 St-Jeure-d'Ay Arras- s/RhôneServes-sur-Rhône Satillieu 9 - Pays de Vernoux Préaux Cheminas St-André- St-Pierre-s/Doux Sécheras Chantemerle-les-Blés 10 - Rhône-Crussol en-Vivarais Erome Lalouvesc Gervans Vion 11 - Entre Loire et Allier Vaudevant Larnage St-Victor 12 - Source de la Loire Etables Lemps Crozes-Hermitage St-Jean- Rochepaule Pailharès Veaunes 13 - Ardèche des Sources et Volcans 55 de-Muzols Lafarre St-Félicien Tain-l'Hermitage Mercurol 14 - Pays d'Aubenas Vals Colombier- 66 Chanos-Curson Devesset -

Rapport Annuel D'activité
JUIN 2016 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2015 Z.I. LE PATY ROUTE DU BARRAGE 07250 LE POUZIN TEL 04 75 63 81 29 – FAX 04 75 63 77 40 [email protected] 32 SOMMAIRE : Page Editorial 2 I - Présentation du Syndicat 3 II - Fonctionnement du Conseil Syndical 6 III - Finances 8 IV - Prix du service 10 V - Facturation 2015 11 VI - Bilan des Abonnements 12 VII- Bilan des consommations 13 VIII- Rendement du réseau de distribution 13 IX - Incidents sur le réseau 20 X - Qualité et sécurité du réseau 21 XI - Qualité de l’eau distribuée 21 XII- Investissements 2015 24 Annexes : Bilan qualité 2015 1 Editorial Le rapport, établi en application des Articles L – 2224 et D 2224 -1 à D 2224 – 5 du code général des collectivités territoriales, présente l’activité du service public de l’eau potable du syndicat pour l’exercice 2015. Il comprend les caractéristiques techniques, indicateurs de performances et détails financiers exigés par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007, et l’arrêté d’application daté de ce même jour. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable est un document important car il permet de revenir sur les faits marquants d’une année d’activité tout en rappelant les missions essentielles du service. Ce rapport répond à un besoin d’information, une volonté de transparence et d’explication afin que les usagers comprennent les choix stratégiques des élus, qu’ils soient informés des travaux réalisés et qu’ils sachent où va l’argent des factures d’eau. -

Jazz En Vivarais
BULLETIN MUNICIPAL N°6 Juillet 2017 en Vivarais Lana Nogueira (CM1) Ecole Présentation de Marie L’AGENDA… ÉDITORIAL LES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX er Ce bulletin marque la fin du ➤ Vendredi 1 septembre à 20h30, salle du conseil 1er semestre 2017, cadencé par les ➤ Vendredi 22 septembre à 20h30, salle du conseil élections présidentielles et ➤ Vendredi 20 octobre à 20h30, salle du conseil législatives. Je remercie le ➤ Vendredi 17 novembre à 20h30, salle du conseil personnel administratif, les élus et ➤ Vendredi 15 décembre à 20h30, salle du conseil tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ces quatre scrutins. Le Président de la République a annoncé des modifications portant sur les « Temps d’Accueil SOMMAIRE Périscolaire » pendant sa campagne électorale, les parents d’élèves sont bien évidemment inquiets, et • P AGE 3 : LES TRAVAUX nous espérons une clarification rapide de l’Etat sur ce sujet très sensible. Pour l’instant aucun changement • P AGES 4-5 : BUDGET DE LA n’est prévu à la prochaine rentrée scolaire. COMMUNE Le bulletin municipal nous permet de faire le point des • P AGE 6 : LA PAGE VERTE projets et de suivre leur réalisation. CENTRALE VILLAGEOISE Après le débat d’orientation budgétaire, le vote du DU VAL D’E YRIEUX budget de la commune en avril (dont vous trouverez les principaux chiffres dans cette édition), des actions et • P AGES 7-9 : SANTÉ projets se préparent ou se poursuivent : la rénovation FRELON ASIATIQUE de la place Pasteur sera terminée mi-juillet avec l’installation du kiosque fin août ; la réfection des MAISON DE SANTÉ réseaux assainissement de la rue Boissy d’Anglas ET DE SERVICES s’achèveront en septembre en raison de la période estivale. -
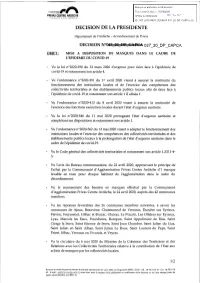
037 20 Dp Capca 05/06/2020
037_20_DP_CAPCA 05/06/2020 05/06/2020 publication sur www.privas-centre-ardeche.fr REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DE MASQUES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DU COVID-19 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-4-3. Vu l’avis du Bureau communautaire, du 22 avril 2020, approuvant le principe de l'achat par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche de masques lavables en tissu pour chaque habitant de l'agglomération afin de préparer le déconfinement. Vu le recensement des besoins en masques effectué par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, le 24 avril 2020, auprès des 42 communes membres. Vu les réponses favorables des 26 communes membres suivantes, à savoir les communes de Ajoux, Beauvène, Chateauneuf de Vernoux, Dunière sur Eyrieux, Flaviac, Freyssenet, Gilhac et Bruzac, Gluiras, Le Pouzin, Les Ollières sur Eyrieux, Lyas, Marcols les Eaux, Pourchères, Rompon, Saint Appolinaire de Rias, Saint Cierge la Serre, Saint Etienne de Serre, Saint Jean Chambre, Saint Julien du Gua, Saint Julien en Saint Alban, Saint Julien Le Roux, Saint Laurent du Pape, Saint Priest, Silhac, Vernoux en Vivarais, et Veyras. Vu la circulaire du 6 mai 2020 du Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales relative à la contribution de l’Etat aux achats de masques par les collectivités locales. Vu la décision n°033_20_DP_CAPCA, du 29 avril 2020, de la Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche attribuant le marché public intitulé « Achat de masques de protection à destination des habitants dans le cadre du covid-19 » à l’entreprise ROCLE pour un montant total de 45 510 € HT (soit 48 013,05 € TTC) représentant une commande de 24 600 masques (soit 1,95 € TTC/masque). -

Bulletin 2012
Marcols les Eaux –– Bulletin municipal 2012 – 1 2 Editorial J de bonne et heureuse année 2013. Cette nouvelle année verra la mise en service d'une Maison de retraite moderne, fonctionnelle, accueillante et confortable. Nous espérons qu'elle apportera bien sûr entière satisfaction à ses résidents, mais aussi à l'ensemble de son personnel qui verra ainsi son cadre de travail s'améliorer. De plus, gageons que les investissements réalisés pérenniseront les 90 emplois qu'elle génère et dont tout le monde connaît l'importance pour la vie de notre vallée. 2012 aura été l'année des balbutiements pour notre Communauté d'agglomération Centre Ardèche dans laquelle nous allons partager avec l'ensemble des communes qui la composent certaines compétences. Les élus et moi-même avons participé à de nombreuses réunions préparatoires. Sans pouvoir dire que tout nous semble limpide, nous restons confiants quant à l'avenir de ce territoire. Il faudra néanmoins que la solidarité entre le monde rural et le péri urbain soit réelle et surtout réciproque. C'est la condition sine qua non de sa réussite. En ce qui concerne la vie de notre village, 2012 aura connu un hiver particulièrement rigoureux. Je tiens à remercier ici les employés communaux et les élus qui ont sans relâche pour rétablir l'alimentation en eau potable de vos habitations. Je tiens enfin à saluer toutes les bonnes volontés et les associations qui animent la vie sociale de notre village. Je pense en particulier à l'ensemble des bénévoles qui, pour une première, ont contribué à faire du 11 août une journée sportive, culturelle et conviviale d'une grande réussite et j'en appelle à toutes et tous pour renouveler l'expérience en 2013. -

Rompon Mag 2017
Photo pour la une : Encart en haut de la une en plus petit : La première édition de la Romponnaise Encart haut troisième : Commémoration à la stèle de Lauvie Second encart en Commémoration à la stèle de Un city stadehaut : Un city à stade Rompon ! Intégrer une annonce : à Rompon ! VLauvieœux aux habitants vendredi 6 décembre à 19h, salle polyvalente. Photo pour la une : Encart haut troisième : Commémoration à la stèle de Lauvie ag m 26 Rompon N° Intégrer une annonce : Vœux aux habitants vendredi 6 décembre à 19h, salle polyvalente. 2 0 1 7 Vœux aux habitants vendredi 6 décembre à 19h, salle polyvalente. Encart en haut de la une en plus petit : La première édition de la Romponnaise Bulletin municipal n° 27 de la mairie de rompon Second encart en haut : Un city stade à Rompon ! SommaiRe État Civil du 1er septembre au 30 août 2016���������������������������������������������������������������������������4-5 la vie MuniCipale Plan local d’urbanisme���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Buste de la République de Rompon��������������������������������������������������������������������������� 7 Adresse postale�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8-9 CCAS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Accessibilité����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 -

Secteurs Géographiques 2021
Carte des secteurs géographiques 2021 Annonay (secteur 1) Tournon (secteur 10) Des «secteurs» pour... Andance - Annonay - Ardoix - Arras/Rhône - Bogy - Boulieu les Annonay - Brossainc - Cheminas - Colombier le Jeune - ...indiquer un voeu géo- Champagne - Charnas - Colombier le Cardinal - Davézieux - Eclassan - Félines - Limony Colombier le Vieux - Etables - Lemps graphique - Peaugres - Peyraud - Preaux - Quintenas - Roiffieux - Saint Alban d’Ay - Saint Clair - - Mauves - Plats - Saint Félicien - Saint Saint Cyr - Saint Désirat - Saint Jacques d’Atticieux - Saint Jeure d’Ay - Saint Marcel les Jean de Muzols -Tournon sur Rhône Il est possible de décliner ce Annonay - Saint Romain d’Ay - Sarras - Satillieu - Serrières - Talencieux - Vanosc - Vion voeu géographique en fonc- - Vernosc les Annonay - Villevocance - Vocance tion de la nature des postes Saint Péray (secteur 11) Le Cheylard (secteur 5) Alboussière - Boffres - Charmes/ souhaités: maternelle, élémen- Arcens - Belsentes (les Nonières) - Cheylard (Le) - Devesset - Mariac - Saint Rhône - Cornas - Guilherand Granges taire, remplacement. Agrève - Saint Martin de Valamas - Saint Michel d’Aurance - Saint Georges les Bains - Saint Pé- Sur la base de ce voeu tous les ray - Saint Romain de Lerps - Saint Sylvestre - Soyons - Toulaud postes vacants du secteur de la Aubenas (secteur 2) nature souhaitée pourront être Ailhon - Aizac - Vallée Antraigues Asperjoc - Aubenas - Genes- Vernoux Lamastre attribués à titre définitif. telle - Labastide sur Besorgues - Labégude - Lachapelle sous (secteur -

Expositions 15H À 19H
Tous les jours. Chalencon Chasse aux trésors Le village Cette chasse au trésor vous conduira à travers les ruelles du village et vous 04 75 58 19 72 permettra de découvrir de façon ludique le village médiéval. Les cartons de jeu sont à retirer au point d'Information de Chalencon ou dans les Offices de Tourisme. Gratuit. Jusqu'au dimanche 28 Rompon Visites de carrière et ateliers de fouilles août 2016. Paléodécouvertes - Salle du Visite carrière Lafarge Le Pouzin Du lundi au vendredi : Chambaud Adulte : 7 €, Enfant : 3,50 €. 04 28 40 00 35 Visite de l'exposition de Rompon incluse. http://www.paleodecouvertes.org 10h-12h. Du samedi 30 juillet au Saint-Laurent-du-Pape Grande Sesshin d'Eté vendredi 5 août 2016. Centre Zen de la Falaise Verte Semaine de pratique intensive de la méditation assise dans la tradition zen 04 75 85 10 39 japonaise. Ouvert à tous, même débutants complets. Inscription auprès de la Falaise Verte nécessaire. Participation aux frais d'hébergement en pension complète 312 € (1/2 tarif moins de 26 ans). http://falaiseverte.org Lundi 1er août 2016 de Saint-Sauveur-de- Pot d'accueil 10h à midi. Montagut Chaque lundi, le Point d'Information de Saint-Sauveur-de-Montagut, Point d'Information Touristique de propose un pot d'accueil avec dégustation de produits locaux, Saint-Sauveur-de-Montagut offerts par les commerçants du village. 04 75 65 43 13 Gratuit. http://www.tourisme-coeur-ardeche.fr Lundi 1er août 2016 de Privas Karaoké 19h à minuit. La Croix d'Or Organisé par La Croix d'Or. -

Compte Rendu De La Reunion Du 10 Decembre 2019
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX OUVEZE-PAYRE COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2019 Etaient présents : Commune d’Alissas : Messieurs Leynaud, Chabal Commune de Baix : Monsieur Boyer Commune de Chomérac : Monsieur Martin Commune de Flaviac : Monsieur Béal, Vicente, Commune de Meyse : Monsieur Mazzini, Commune de le Pouzin : Messieurs Vignal, Ambert, Commune de Rochemaure : Monsieur Cheynet Commune de Rochessauve : Monsieur Lafond, Commune de Rompon : Monsieur Dutrieux, Commune de St Bauzile : Madame Pollard-Boulogne, Commune de Julien en St Alban : Messieurs Fougeirol, Bernay Commune de St Martin sur Lavezon : Monsieur Arto, Commune de St Pierre la Roche : Monsieur Dusserre Commune de St Vincent de Barrès : Monsieur Jourdan Pouvoirs : Monsieur Amblard a donné pouvoir à Monsieur Martin, Monsieur Jimenez a donné pouvoir à Monsieur Cheynet Excusés : Mesdames Bacconier, Audouard, Meniaud, Messieurs Leclere, Cotta, Tonkens, Tognetty, Jimenez, Reynaud, Vivat, Avon, Bernard, Ascari, Périco, Labeille, Bastide, Chebance. Monsieur Paul André Trésorier est excusé Assistaient également à la réunion : Bureau d’Etudes Naldéo : Vincent Chassard Technique : Messieurs Vergnaud, Chazot Administratif : Madame Noharet. Le quorum étant atteint, la Présidente déclare la séance ouverte. Désignation secrétaire de séance : Monsieur Christophe Vignal Avant de commencer Madame Pollard-Boulogne informe que suite à la démission de Madame D’Aloia, sur la commune de Cruas ; La commune de Cruas a désigné Madame Audouard Andrée déléguée suppléante qui la remplacera -

Carte Des Secteurs « Kisaimouv’07 » Édition 2019 14
Carte des secteurs « Kisaimouv’07 » Édition 2019 14 Annonay Tournon Andance - Annonay - Ardoix - Arras/Rhône - Bogy - Boulieu les Annonay - Brossainc - Des «secteurs» pour... Cheminas - Colombier le Jeune - Co- Champagne - Charnas - Colombier le Cardinal - Davézieux - Eclassan - Félines - Limony lombier le Vieux - Etables - Lemps - ...indiquer un voeu - Peaugres - Peyraud - Preaux - Quintenas - Roiffieux - Saint Alban d’Ay - Saint Clair Mauves - Plats - Saint Félicien - Saint - Saint Cyr - Saint Désirat - Saint Jacques d’Atticieux - Saint Jeure d’Ay - Saint Marcel Jean de Muzols - Sécheras -Tournon géographique les Annonay - Saint Romain d’Ay - Sarras - Satillieu - Serrières - Talencieux - Vanosc - sur Rhône - Vion Il est possible de décliner Vernosc les Annonay - Villevocance - Vocance ce voeu géographique en Saint Péray fonction de la nature des Le Cheylard Alboussière - Boffres - Charmes/ Rhône - Cornas - Guilherand Albon d’Ardèche - Arcens - Cheylard (Le) - Devesset - Mariac - Nonières postes souhaités: mater- Granges - Saint Georges les Bains (Les) - Saint Agrève - Saint Martin de Valamas - Saint Michel d’Aurance - - Saint Péray - Saint Romain de nelle, élémentaire, rempla- Saint Pierreville cement. Lerps - Saint Sylvestre - Soyons - Toulaud Sur la base de ce voeu tous Aubenas les postes vacants du sec- Ailhon - Aizac - Antraigues sur Volane - Asperjoc - Aubenas - Ge- Vernoux Lamastre teur de la nature souhaitée nestelle - Labastide sur Besorgues - Labégude - Lachapelle Desaignes - Empurany - Labatie sous Aubenas - Lavilledieu - -

LES 42 COMMUNES Laetitia SERRE MEMBRES PRÉSIDENTE
LES 42 COMMUNES Laetitia SERRE MEMBRES PRÉSIDENTE Ajoux Édito Alissas Beauchastel Beauvène Chalencon Châteauneuf de Vernoux Chomérac Coux Creysseilles Dunière sur Eyrieux Flaviac Freyssenet vec la fusion de la Communauté d’Agglomération Gilhac et Bruzac Privas Centre Ardèche et de la Communauté de Gluiras Acommunes du Pays de Vernoux, c’est une étape importante du développement et de l’attractivité du Gourdon centre-Ardèche qui vient d’être franchie. Cette fusion a La Voulte sur Rhône été préparée ensemble, de façon constructive et dans Le Pouzin un bon état d’esprit, tout en gardant en tête une volonté Les Ollières sur Eyrieux forte de mieux vous servir. La solidarité anime nos actions pour construire un territoire Lyas ambitieux, un territoire qui compte. En toute confiance, en Marcols les Eaux toute transparence, nous allons amplifier la dynamique entre Pourchères les bourgs-centres et les périphéries en faisant jouer les Pranles complémentarités, l’expérience capitalisée et en répondant avec équité aux attentes de chaque habitant. Privas Les mois qui viennent seront rythmés par des échéances Rochessauve importantes : débat d’orientation budgétaire et vote du Rompon budget 2017, mise en œuvre harmonisée et progressive des Saint Apollinaire de Rias compétences. Les compétences de notre nouvelle agglomération Saint Cierge la Serre composée de 42 communes sont vastes et diversifiées ; Saint Étienne de Serre c’est une opportunité pour inventer avec fierté et Saint Fortunat sur Eyrieux détermination un nouveau cadre de vie avec une vision -

Rapport Du Commissaire-Enquêteur À Monsieur Le Maire De La Commune De Cruas ******
Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cruas – arrêté n°17 mairie du Cruas du 31 mai 2018 Projet de Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cruas Rapport du commissaire-enquêteur à monsieur le maire de la commune de Cruas ****** Du jeudi 21 juin 2018 au mardi 24 juillet 2018 inclus Jean-François EUVRARD Commissaire-enquêteur Dont photocopies à : Monsieur le Président du Tribunal Administraf de Lyon, Monsieur le Préfet du département de l’Ardèche, Le commissaire-enquêteur (pour archive) Page 1 Décision Tribunal Administraf de Lyon E18000117/69 du 17/05/2018 Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cruas – arrêté n°17 mairie du Cruas du 31 mai 2018 SOMMAIRE - Généralités page 3 1 – Organisaon et déroulement de l’enquête page 3 1/1 - Objet de l’enquête : 1/2 - Cadre juridique de l’enquête et disposions administraves : page 5 1/3 - Le respect des disposions administraves et le déroulement de l’enquête publique : page 7 2 - Présentaon et analyse du dossier mis à la disposion du public : page 14 2/1 - La présentaon du dossier mis à disposion du public : 2/2 - L’analyse du dossier par le commissaire-enquêteur : page 16 Sur la forme : Sur le fond : La procédure de consultaon préalable à l’enquête publique L’analyse du dossier d’enquête publique proprement dite o Le Rapport de Présentaon (RP) page 17 La jusficaon à la révision du PLU, page 19 Les enjeux de développement et les objecfs, page 20 L’évaluaon environnementale.