(CC2V) Synthèse Des Enjeux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Communes D'intervention
COMMUNES D'INTERVENTION ACTIVITE PERSONNES AGEES ACTIVITE PERSONNES EN SITUATION HANDICAP ACTIVITE ESA Attichy Moulin-sous-Touvent Armancourt Marest-sur-Matz Amy Couloisy Lassigny Rethondes Autreches Nampcel Attichy margny les compiègne Appilly Courtieux Le Plessis-Brion Ribécourt-Dreslincourt Bailly Noyon Autreches Mélicocq Attichy Crapeaumesnil Le Plessis-Patte-d'Oie Roye-Sur-Matz Berneuil sur Aisne Orrouy Bailly Montmacq Autreches Crisolles Libermont Saint-Crépin-aux-Bois Bethisy-Saint-Martin Passel Berneuil sur Aisne Moulin-sous-Touvent Avricourt Croutoy Longueil-Annel Saint-Etienne-Roilaye Béthisy-Saint-Pierre Pierrefonds Bienville Nampcel Baboeuf Cuise-La-Motte Machemont Saint-Jean-aux-Bois Bitry Pimprez Bitry Noyon Bailly Cuts Marest-sur-Matz Saint-Léger-aux-Bois Cambronne-les-Ribécourt Pont Leveque Cambronne-les-Ribécourt Pierrefonds Beaugies-sous-Bois Cuy Mareuil-la-Motte Saint-Pierre-Les-Bitry Carlepont Rethondes Carlepont Pimprez Beaulieu-les-Fontaines Dives Margny-aux-Cerises Saint-Sauveur Chelles Ribécourt-Dreslincourt Chelles Rethondes Beaurains-les-Noyon Ecuvilly Maucourt Salency Chevincourt Saint-Crépin-aux-Bois Chevincourt Ribécourt-Dreslincourt Béhéricourt Elincourt-Ste-Marguerite Mélicocq Sempigny Chiry-Ourscamps Saint-Etienne-Roilaye Chiry-Ourscamps Saint-Crépin-aux-Bois Berlancourt Evricourt Mondescourt Sermaize Couloisy Saintines Choisy au Bac Saint-Etienne-Roilaye Berneuil sur Aisne Flavy-le-Meldeux Montmacq Solente Courtieux Saint-Jean-aux-Bois Clairoix Saint-Jean-aux-Bois Bethisy-Saint-Martin Fréniches Morienval -

Mise En Page
Annexe 6 Structures avec la compétence dépollution de l'assainissement collectif OffoyOffoy SIASIA dede Coudun,Coudun, SIVOMSIVOM dede Chevincourt,Chevincourt, BeaudéduitBeaudéduit Giraumont,Giraumont, VillersVillers SIVOMSIVOM dede Machemont,Machemont, MélicocqMélicocq MoliensMoliens GrandvilliersGrandvilliers LeLe Mesnil-ContevilleMesnil-Conteville Thourotte,Thourotte, PaillartPaillart sursur Coudun,Coudun, BraisnesBraisnes Thourotte,Thourotte, SIVOMSIVOM desdes FléchyFléchy CempuisCempuis FléchyFléchy LongueilLongueil annelannel FormerieFormerie FeuquièresFeuquières LongueilLongueil annelannel FontainesFontaines (eau,(eau,(eau, assainisement)assainisement)assainisement) AvricourtAvricourt BreteuilBreteuil AmyAmy DoméliersDoméliers CrisollesCrisolles GaudechartGaudechart CrisollesCrisolles LeLe Mesnil-Saint-FirminMesnil-Saint-Firmin LeLe Mesnil-Saint-FirminMesnil-Saint-Firmin Conchy-les-PotsConchy-les-Pots Saint-MaurSaint-Maur Crèvecoeur-le-GrandCrèvecoeur-le-Grand LassignyLassigny SIVOMSIVOM dede lala MorvillersMorvillers SalencySalency NoyonNoyon ValléeVallée estest dede Haute-ÉpineHaute-Épine Sainte-EusoyeSainte-Eusoye SIVOMSIVOM dede TRICOTTRICOT ValléeVallée estest dede SIASIA SuzoySuzoy LarbroyeLarbroye Marseille-en-BeauvaisisMarseille-en-Beauvaisis Courcelles-EpayellesCourcelles-Epayelles SIASIA SuzoySuzoy LarbroyeLarbroye l'Oisel'Oisel'Oise (SIVOM(SIVOM(SIVOM --- VEO)VEO)VEO) FroissyFroissy TricotTricot SongeonsSongeons Pont-l'ÉvêquePont-l'Évêque SongeonsSongeons Maignelay-MontignyMaignelay-Montigny Maignelay-MontignyMaignelay-Montigny -
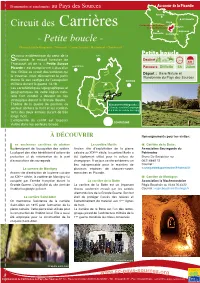
Circuit Carrières
Promenades et randonnées au Pays des Sources Circuit des Carrières - Petite boucle - Élincourt-Sainte-Marguerite - Thiescourt - Cannectancourt - Machemont - Chevincourt Petite boucle ecteur embl ématique du cœur de la ROYE SPicardie, le massif forestier de Destiné Thiescourt dit de la « Petite Suisse MONTDIDIER Picarde » est exceptionnel à plus dʼun Parcours Difficile 6h 24km titre. Grâce au circuit des carrières qui Départ : Base Nature et le traverse, vous découvrirez le patri- Randonnée du Pays des Sources moine lié aux vestiges de lʼoccupation NOYON militaire durant la guerre 14-18. Lassigny Les caractéristiques topographiques et géographiques de cette région natu- A1 - Elincourt-Ste- Marguerite relle lʼont conduit à devenir un lieu TVG Ressons- stratégique durant la Grande Guerre. sur-Matz Théâtre de la guerre de position, ce Elincourt-Ste-Marguerite à secteur abritera le front et les combat- 12 km au nord de Compiègne et à 6 km au sud de Lassigny. tants des deux armées durant de très longs mois. Lʼempreinte du conflit est toujours COMPIEGNE visible dans les secteurs boisés. À DÉCOUVRIR Renseignements pour les visites : es anciennes carrières de pierres La carrière Martin Y Carrière de la Botte : Ltémoignent de lʼoccupation des soldats. Ancien site dʼexploitation de la pierre Association Sauvegarde du La plupart des sites bénéficient dʼactions de calcaire au XIX ème siècle, la carrière Martin a Patrimo ine protection et de valorisation de la part été également utilisé pour la culture du Bruno De Saedeleer au dʼassociations de sauvegarde. champignon. À ce jour, ce site est devenu un 06 21 68 61 72 lieu indispensable pour le maintien de Courriel : La carrière de Montigny plusieurs espèces de chauves-souris [email protected] Ancien site dʼextraction de la pierre calcaire menacées en Picardie. -

Les Carrières De La Grande Guerre
Élincourt-Sainte-Marguerite < Oise < Picardie ELINCOURT- Les carrières SAINTE-MARGUERITE de la Grande Guerre Le circuit des carrières, comme son Informations pratiques nom l’indique, permettra la décou- très très GRP KM 181 difficile verte d’anciennes carrières et souter- difficile GR 56 38 790 rains militaires généralement visibles > 1 jour 3:45 NC PR depuis certains chemins. Les carrières Niveau / Durée Altitude Dénivelé ne sont pas les seuls vestiges du Type de randonnée Distance Balisage Mini/Maxi cumulé conflit : les tranchées, trous d’obus, ruines sont toujours présents après 90 ans. L’itinéraire traverse le massif de Thiescourt ; un espace forestier escarpé au cœur de la “Petite Suisse picarde“. Il offre de magnifiques panoramas sur la campagne environ- nante et sur les vallées du l’Oise, du Matz et de la Divette. 3 lieux de départ possibles : Pays des Sources : Base Nature et Randonnée Pays Noyonnais : Ville Deux Vallées : Maison du Tourisme à Ourscamp (parking) 1 8 Au départ de la Base Nature et Randonnée, prendre la direc- En arrivant sur la commune de Chevincourt, prendre à gauche, tion du château de Bellinglise et tourner sur la gauche, pour suivre rue Zélaine, puis à nouveau à gauche pour suivre le circuit de ran- ensuite la liaison en direction du circuit de la Montagne du Paradis. donnée “la boucle de la Cense”. Longer le plan d’eau et poursuivre sur le chemin de la Croisette. Prendre à gauche dans le chemin enherbé et poursuivre tout droit. 9 Arrivé sur la route, emprunter le GR®123 par la gauche. A l’intersection, monter sur la gauche rue Payot. -

L'oise Angy Saint- D811 D22 Jouy- Liancourt D137 Cinqueux Monceaux 9 Sauveur Sous-Thelle D137 Mouy Les Éragny- Bury Cauffry Mogneville Ageux
L’OISE TERRE DE MEMOIRE Des champs de bataille à l’alliance de la Paix l’ Oise, une mémre vive 18 51 GARE T.G.V. D62 D211 A16 31 32 A29 HAUTE PICARDIE L' Hornoy- A29 33 52 Omignon Saint- A29 D1029 D116 53 D920 le-Bourg 17 A29 D96 D138 D934 Quentin D51 D141 D42 D935 D337 D79 54 A26 A28 Boves D1015 D38 D32 6 D210 D18 D7 D16 D28 A16 D930 D1001 Rosières- D316 A1 Luce D920 La en-Santerre D49 Chaulnes 13 11 D23 D28 e A29 m D103 m o S D1029 Basse Forêt d'Eu D18 D934 a SOMME L D1901 CARTE DE SITUATION D930 D928 Poix-de- 80 D321 La Selle D28 Picardie D138 Bois Moreuil SEINE- D337 Aumale D1029 D937 de Wailly D15 D935 D72 D7 D920 l’OISE 7 D920 La So MARITIME m m A29 12 e Ailly- D34 D2930 D929 D53P D901 D1001 D920 76 A28 D1015 sur-Noye D14 Nesle D930 Ham 11 D26 en Neufchâtel- 8 D1017 Saint- Conty D920 en-Bray D919 Sites perpétuant la mémoire D930 D138 Simon La Noye D934 D316 D937 HISTOIRE D1314 D16 D210 D9 D8 D315 D329 D4221 12 D1017 D108 D14 L' Roye D54 Abancourt Av D56 re D186 La B Ercheu e D932 th D934 u n D135 e D901 D38 D7 D36 D26 Grand Bois D236 D7 D124 D221 des Housseaux Bonneuil- D128 D1001 Moliens Grandvilliers les-Eaux Paillart D329 D124 A1 D1314 D9A D919 D35 Racte-m... Esquennoy Guiscard Tergnier D106 Feuquières Montdidier D930 D338 e réseau Oise en Histoire est un ré- Formerie D124 D901 D937 D151 D28 Bois de D11 D930 Bois de D7 Breteuil Berny seau d’accueillants composé de près l'Épinay D930 D935 D1017 D135 Bois Forges- D919 D934 Crisolles du Grand Carré D150 Chauny de 30 professionnels du tourisme : les-Eaux Bois D1 Crèvecoeur- D1001 D930 D916 d'Autrecourt D7 L le-Grand D935 D142 D7 se 16 Oi hébergeurs, offices de tourisme, asso- Bois de la D1032 l’ l à D11 a D151 Morlière D932 r D1 té D929 8 la D930 Salency al D119 D938 n ciations, entreprises etc. -

Plan Départemental Pour Une Mobilité Durable
PLAN DÉPARTEMENTAL POUR UNE MOBILITÉ DURABLE Concilier les besoins de déplacement des Isariens avec les impératifs de développement économique du territoire, le maintien de la cohésion sociale et la préservation de l’environnement PRÉAMBULE PLAN DÉPARTEMENTAL POUR UNE MOBILITÉ DURABLE e Département de l’Oise possède plus de 4 000 km autocar et autobus en ont besoin pour circuler tout comme de routes départementales. À l’issue de deux les vélos. C’est aussi un vecteur essentiel du désenclavement années de travail préparatoire, la nouvelle majorité des zones rurales et un pourvoyeur d’activités et d’emplois L départementale élue en 2004, a adopté en 2006 directs et indirects important pour le dynamisme économique un plan pluriannuel d’investissement sur l’ensemble de son territorial ; ce peut-être enfin un surprenant refuge pour la réseau routier, considérant le retard considérable pris en la faune et la flore chassées des champs agricoles. matière les années précédentes. Ainsi, à l’occasion de son cinquième anniversaire, il apparaît Ce plan prévoit la modernisation et le développement du opportun, non seulement d’actualiser le plan routier maillage du territoire par la création de 6 itinéraires d’intérêt pluriannuel en raison de la concrétisation de plusieurs régional, de 14 déviations d’agglomérations, le calibrage de opérations inscrites et déjà en service ou à un niveau avancé 120 km de routes départementales ainsi que la construction de réalisation mais aussi de lui conférer une dimension ou remise en état d’ouvrages d’art et enfin l’achèvement de élargie à la mobilité en général afin de rendre plus évidente 4 opérations du contrat de plan État Région 2000-2006. -

CHARLES FAROUX a - CHARLES COMPIEGNE COMPIEGNE FAROUX B Globalisée - JACQUES DECOUR 2 - JACQUES MONTATAIRE NOGENT SUR OISE DECOUR I
Nom école Commune école Circonscription Ecole maternelle LOUIS PERGAUD NOYON NOYON Ecole maternelle JEAN MOULIN MERU MERU Globalisée - CHARLES FAROUX A - CHARLES COMPIEGNE COMPIEGNE FAROUX B Globalisée - JACQUES DECOUR 2 - JACQUES MONTATAIRE NOGENT SUR OISE DECOUR I Globalisée - JEAN DE LA FONTAINE - MOLIERE CREIL CREIL Ecole élémentaire CH.PERRAULT NOYON NOYON Ecole élémentaire PIERRE ET MARIE CURIE MOUY GOUVIEUX Globalisée - PHILEAS LEBESGUE - JACQUES BEAUVAIS BEAUVAIS SUD PREVERT Ecole élémentaire ALAIN FOURNIER NOYON NOYON Ecole élémentaire BELLONTE MERU MERU Ecole élémentaire JEAN MOULIN BEAUVAIS BEAUVAIS NORD Ecole élémentaire JEAN MOULIN MERU MERU Ecole élémentaire ROBERT FLOURY MOUY GOUVIEUX Ecole élémentaire HENRI VILLETTE CREVECOEUR LE GRAND GRANVILLIERS Globalisée - GEORGES POMPIDOU GROUPE A - COMPIEGNE COMPIEGNE GEORGES POMPIDOU GRP B Ecole élémentaire ALBERT CAMUS CREIL CREIL Ecole élémentaire L OBIER NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE Globalisée - ALBERT ROBIDA GRP A - ALBERT COMPIEGNE COMPIEGNE ROBIDA GROUPE B Globalisée - MONTAIGNE - RABELAIS CREIL CREIL Ecole primaire MAURICE BAMBIER MONTATAIRE NOGENT SUR OISE Ecole élementaire JEAN MOULIN VILLERS ST PAUL NOGENT SUR OISE Ecole maternelle DESNOS-LEBESGUE COMPIEGNE COMPIEGNE Ecole primaire PERRAULT VERNE KERGOMARD NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE RPI AUCHY A MONTAGNE LUCHY LUCHY GRANDVILLERS Ecole maternelle LES SABLES DE RAMECOURT CLERMONT CLERMONT Ecole maternelle JULES MICHELET BEAUVAIS BEAUVAIS SUD Ecole maternelle BORAN SUR OISE GOUVIEUX Ecole maternelle GOURNAY CREIL CREIL -

Boucle De La Cense
Promenad e randonné d l Chevincourt / Machemont < Oise < Hauts-de-France Communaut d Commun d Deu Vallé Noyon Circuit de la Chevincourt Ribécourt-Dreslincourt Thourotte BOUCLE DE MLAachemont CENSE / Chevincourt Compiègne Noyon BOUCLE (10 km) : suivre n°1 à n°17 P Parking Balisage : Direction à suivre (continuer tout droit) Mauvaise direction (ne pas prendre ce À déco rir sur l parcour : chemin) Tourner à gauche • Pupitres d’interprétation sur le patrimoine de Machemont (prendre la prochaine à gauche) • Église Saint-Pierre de Chevincourt Tourner à droite • Monument aux morts (prendre la prochaine • Plaque sur Norbert Hilger, off icier de la résistance à droite) • Blockhaus • Monument aux morts du 86ème RI. • Carrières de Montigny • Tour et château Saint-Amand • Bancs et tables de pique-nique Ce parcours a été mis en place par la CC2V avec le concours de : Service animation du patrimoine Communauté de Communes des Deux Vallées 9, rue du Maréchal Juin - 60150 THOUROTTE cc2v.fr CC2V60 DeuxVallees cc2v60 [email protected] Tél : 03 44 96 31 00 Promenad e randonné d l Chevincourt / Machemont < Oise < Hauts-de-France Communaut d Commun d Deu Vallé 8 7 6 4 5 Élincourt-Sainte-Marguerite 9 10 P 11 12 Marest-sur-Matz 3 Chevincourt 13 17 16 Cambonne-lès-Ribécourt 15 14 2 P Machemont 1 ©OpenStreetMap ©Orthophoto IGN Itinérair : Création : service communication CC2V - PB/LD 06/21 ne pas jeter sur la voie publique Départ : Parking de la « place des Tilleuls » à Chevincourt. 11 - Prendre à gauche à la prochaine intersection. Suivre le 1 - Face au panneau de départ, monter la « rue principale » sur GRP tout droit. -

Inventaire Départemental Des Cavités Souterraines Hors Mines De L’Oise (60) Rapport Final
Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de l’Oise (60) Rapport final BRGM/RP-60320-FR Octobre 2011 I M 003 - AVRIL 05 Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de l’Oise (60) Rapport final Convention MEDDTL n°0007326 BRGM/RP-60320-FR Octobre 2011 P. Pannet, JM. Schroetter Avec la collaboration de M. Mulot, P.Mallard et Ö. Yilmaz Vérificateur : Approbateur : Nom : G. Noury Nom : D. Maton Date : le 07/11/2011 Date : le 25/10/2011 En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique, l’original signé est disponible aux Archives du BRGM. Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. I M 003 - AVRIL 05 Mots clés : Cavités souterraines, base de données, inventaire, cavités naturelles, carrières souterraines, ouvrages civils, ouvrages militaires, karst, Oise, Picardie. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : P. Pannet, JM. Schroetter avec la collaboration de P. Mallard, M. Mulot et Ö. Yilmaz (2011) - Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de l’Oise Rapport final, BRGM/RP-60320-FR, 135 p., 19 ill., 3 ph., 2 annexes, 1 carte hors-texte. © BRGM, 2011, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Inventaire des cavités souterraines hors mines du département de l’Oise Synthèse ans le cadre de la constitution d’une base de données nationale des cavités Dsouterraines hors mines, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, du Transport et du Logement (MEDDTL) a chargé le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de réaliser l’inventaire des cavités souterraines hors mines dans le département de l’Oise (Convention MEDDTL n°0007326). -
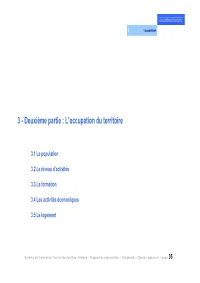
Diagnostic Part
L’occupation du territoire La population 3 - Deuxième partie : L’occupation du territoire 3.1 La population 3.2 Le niveau d’activités 3.3 La formation 3.4 Les activités économiques 3.5 Le logement Schéma de Cohérence Territoriale des Deux Vallées – Rapport de présentation – Diagnostic – Dossier approuvé – page 35 L’occupation du territoire La population 3.1 La population des Deux Vallées Les 6 Une densité différenciée entre la vallée et les secteurs ruraux Communautés de Communes Le territoire d’étude présente des densités urbaines très contrastées avec : - De vastes territoires faiblement peuplés : Communauté de communes du Pays des Sources et Communauté de communes du Canton d’Attichy ; - Des territoires dont les densités se situent à proximité des moyennes régionales (96 hab. / km²) et départementales (131 hab. / km²) qui encadrent la moyenne nationale (108 hab. / km²) : Communauté de communes du Pays Noyonnais, Communauté de communes de la Plaine d’Estrées ; - La Communauté de communes des Deux Vallées qui se caractérise par sa taille : elle est la plus petite des Communautés de communes en superficie (114 km²) et la plus Deux Vallées importante en terme d’habitants après les agglomérations de Compiègne et de Noyon. Sa densité (203 habitants au km²) est forte et supérieure à celle de la Communauté de communes du Pays Noyonnais. - L’Agglomération de la Région de Compiègne dont la densité urbaine et le poids démographique dominent largement l’ensemble des autres Communautés de communes. Les Deux Vallées n’ont une population inférieure à celle du Noyonnais que dans une proportion de 2/3. Par contre sa population est trois fois inférieure à celle de la région de Compiègne, qui, de ce fait, polarise le territoire. -

Balades Avec Papi Et Mamie Envie D’Explorer L’Oise Dans Ses Moindres Recoins ?
Balades avec papi et mamie Envie d’explorer l’Oise dans ses moindres recoins ? Ce guide présente des idées de très courtes balades à faire à pied avec papi et mamie. En quelque sorte, la flânerie du dimanche après-midi ! Les mini-guides Coups de cœur 100% Habitant sont faits pour vous ! Pourquoi « 100% Habitant » ? Eh bien car ces bons plans sont issus de témoignages uniques et authentiques d’habitants de l’Oise qui ont eu à cœur de partager les lieux qu’ils affectionnent tout particulièrement. Un geste bien sympathique puisque nous comptabilisons déjà plus d’une centaine d’idées de sorties et de balades à faire en toutes saisons afin de profiter pleinement de notre #BelleOise #Oisetourisme ! Photo de couverture : © SofitoS 2 Balades avec papi et mamie À votre disposition sur coupsdecoeur-oise.com pourUne localiser carte facilement interactive les coups de cœur. 9 autres guides Gourmandises Divertir Panoramas Où aller locales les enfants pique-niquer ? Bons plans Couchers Coins de paradis En terrasse Faune et flore anti-canicule de soleil en plein air locales Balades avec papi et mamie 3 La voie verte entre Bienville et Clairoix Une balade très accessible grâce à la voie verte : chemin plat pour piétons et vélos. Bancs et aire de pique-nique à proximité de l’ancienne gare réhabilitée, et sur la voie verte entre Bienville et Clairoix. Benjamin, Compiègne © Bruno Beucher Bienville et Clairoix (60200) Bienville ou Clairoix : se rendre au village directement La balade autour Les étangs du Plessis-Brion des étangs est agréable et facile d’accès, les chemins sont aménagés et arborés. -

Les Cantons Et Communes De La 6Ème Circonscription De L'oise CANTON
Les cantons et communes de la 6ème circonscription de l'Oise CODE CANTON COMMUNE ARRONDISSEMENT POSTAL COMPIEGNE-NORD 60200 BIENVILLE COMPIEGNE COMPIEGNE-NORD 60750 CHOISY AU BAC COMPIEGNE COMPIEGNE-NORD 60200 CLAIROIX COMPIEGNE COMPIEGNE-NORD 60200 COMPIEGNE Nord COMPIEGNE COMPIEGNE-NORD 60150 JANVILLE COMPIEGNE COMPIEGNE-NORD 60200 MARGNY-LES-COMPIEGNE COMPIEGNE GUISCARD 60640 BEAUGIES SOUS BOIS COMPIEGNE GUISCARD 60640 BERLANCOURT COMPIEGNE GUISCARD 60400 BUSSY COMPIEGNE GUISCARD 60640 CAMPAGNE COMPIEGNE GUISCARD 60640 CATIGNY COMPIEGNE GUISCARD 60400 CRISOLLES COMPIEGNE GUISCARD 60640 FLAVY-LE-MELDEUX COMPIEGNE GUISCARD 60640 FRENICHES COMPIEGNE GUISCARD 60640 FRETOY-LE-CHATEAU COMPIEGNE GUISCARD 60640 GOLANCOURT COMPIEGNE GUISCARD 60640 GUISCARD COMPIEGNE GUISCARD 60640 LIBERMONT COMPIEGNE GUISCARD 60640 MAUCOURT COMPIEGNE GUISCARD 60640 MUIRANCOURT COMPIEGNE GUISCARD 60310 OGNOLLES COMPIEGNE GUISCARD 60640 PLESSIS-PATTE-D'OIE (le) COMPIEGNE GUISCARD 60640 QUESMY COMPIEGNE GUISCARD 60400 SERMAIZE COMPIEGNE GUISCARD 60310 SOLENTE COMPIEGNE GUISCARD 60640 VILLESELVE COMPIEGNE LASSIGNY 60310 AMY COMPIEGNE LASSIGNY 60310 AVRICOURT COMPIEGNE LASSIGNY 60310 BEAULIEU-LES-FONTAINES COMPIEGNE LASSIGNY 60310 CANDOR COMPIEGNE LASSIGNY 60310 CANNECTANCOURT COMPIEGNE LASSIGNY 60310 CANNY-SUR-MATZ COMPIEGNE LASSIGNY 60310 CRAPEAUMESNIL COMPIEGNE LASSIGNY 60310 CUY COMPIEGNE LASSIGNY 60310 DIVES COMPIEGNE LASSIGNY 60310 ECUVILLY COMPIEGNE LASSIGNY 60157 ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE COMPIEGNE LASSIGNY 60310 EVRICOURT COMPIEGNE LASSIGNY 60310 FRESNIERES