Dossier De La Concertation Préalable
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Transoceanic 1755 Lisbon Tsunami in Martinique
Pure Appl. Geophys. 168 (2011), 1015–1031 Ó 2010 Springer Basel AG DOI 10.1007/s00024-010-0216-8 Pure and Applied Geophysics The Transoceanic 1755 Lisbon Tsunami in Martinique 1,2 1 3 2,3 4 4 J. ROGER, M. A. BAPTISTA, A. SAHAL, F. ACCARY, S. ALLGEYER, and H. HE´ BERT Abstract—On 1 November 1755, a major earthquake of esti- 1. Introduction mated Mw=8.5/9.0 destroyed Lisbon (Portugal) and was felt in the whole of western Europe. It generated a huge transoceanic tsunami that ravaged the coasts of Morocco, Portugal and Spain. Local Martinique Island is part of a subduction volcanic extreme run-up heights were reported in some places such as Cape arc of 850 km length, resulting from the convergence St Vincent (Portugal). Great waves were reported in the Madeira of the Atlantic Plate under the Caribbean Plate at an Islands, the Azores and as far as the Antilles (Caribbean Islands). An accurate search for historical data allowed us to find new average rate of 2 cm/year (STEIN et al., 1982) (Fig. 1). (unpublished) information concerning the tsunami arrival and its This subduction is the cause of shallow earthquakes, consequences in several islands of the Lesser Antilles Arc. In some some of them with magnitude greater than 7, as was places, especially Martinique and the Guadeloupe islands, 3 m wave heights, inundation of low lands, and destruction of buildings the case of the 5 April 1690, 8 February 1843 and boats were reported (in some specific locations probably more (FEUILLET et al., 2002) the 18 November 1867 Virgin enclined to wave amplification). -

TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE TERRITOIRE DE CAP NORD MARTINIQUE Répertoire Des Transporteurs Année 2014-2015
TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE TERRITOIRE DE CAP NORD MARTINIQUE Répertoire des transporteurs Année 2014-2015 COMMUNES TRANSPORTEURS TITULAIRES ÉTABLISSEMENTS DESSERVIS EVASION TRANSPORT E.E.P.U Mixte A – Bourg BASSE-POINTE Jerôme Mesmin Sainte-Rose E.E.P.U Hauteurs Bourdon Morne Balai E.E.P.U Morne Balai 97218 BASSE-POINTE E.M.PU Les Coccinelles 0696 36.13.14 CLG BASSE-POINTE BASSE-POINTE TRANSPORT SASSON Pauline MOUTOUSSAMY Lieu dit 50 Pas CLG BASSE-POINTE 97218 MACOUBA 0596 24.69.42 / 0596 78.50.30 TRANSPORTS DOHAM Sylvestre DOHAM E.E.P.U Aristide Hardion BELLEFONTAINE Bourg E.M.P.U Belle Fontaine Maternelle 97222 BELLEFONTAINE 0696 25.64.97 / 0596 55.00.55 JULIANS VOYAGES Jean Max JULIANS E.M.P.U Les Abeilles CASE-PILOTE Route de la Démarche E.E.P.U Saint-Just Orville 97233 SCHOELCHER 0596 64.37.10 E.E.P.U Dumaine E.E.P.U Glotin COMPAGNIE ANTILLAISE DE DEPLACEMENT E.E.P.U Bois Lezard Christian CATORC E.E.P.U Gros-Morne B – La Fraicheur GROS-MORNE Quartier La Fraîcheur E.M.P.U La Fraicheur Rue de la Liberté E.E.P.U Rivière Lezarde 97213 GROS-MORNE E.E.P.U Gros-Morne A 0596 67.95.65 E.E.P.U Gros-Morne C CLG Euzhan Palcy CLG Hubert Nero E.E.P.U Léon Cécile TRANSPORT BONIFACE LPO Joseph Pernock Jean Luc BONIFACE E.E.P.U Berteau Marie-Rose LORRAIN 14, Rue de la Belle Épine Redoute E.M.P.U Carabin 97200 FORT-DE-France E.M.P.U Georges Oliny 0696 25.22.71 / 0596 55.30.04 E.E.P.U Maxime E.E.P.U Isidore Pierre-Louis E.M.P.U Gilbert Tarquin TRANS PV Olivier VIEU E.E.P.U Valentine Bredas MARIGOT Quartier Dominante CLG Eugène Mona (ex La Marie) 97225 -

Calendrier Sportif Saison 2019-2020
Calendrier sportif saison 2019-2020 Mot du président Alex BADIAN Président de la LNM Permet de revenir au sommaire 2/54 Sommaire MOT DU PRÉSIDENT ................................................................................................................................................................ 2 SOMMAIRE ........................................................................................................................................................................... 3 ORGANIGRAMME DE LA LNM ................................................................................................................................................... 5 CLUBS MARTINIQUE AFFILIÉS..................................................................................................................................................... 6 LES CATÉGORIES D’ÂGE 2019-2020 ........................................................................................................................................... 7 NATATION COURSE ............................................................................................................................................................................... 7 EAU LIBRE .............................................................................................................................................................................................. 8 LES MAÎTRES ......................................................................................................................................................................................... -

Fort-De-France Le Marin Le Trinité Saint-Pierre
o o Martinique: Nord Plage Perpigna Grand'Rivière Macouba La Lave Perpigna Perriolat Cheneaux Nord Basse-Pointe Hauts Sud Cheneaux Fond Moulin Sud Bijou Lotissement Souffleur du Bourg Sud Tapis Vert Fond Beauséjour Habitation Lottière Charmiette Gradis Chalvet Anse Capot Couleuvre Bois Jean Hallay Vivé Ilet Desiles Montagnier Savane Anatole Sancé Le Lorrain Cité L'Ajoupa-Bouillon Fond d'Or Anse La Marie Belleville Le Marigot La Garenne Les La Girard Abymes Le Prêcheur La Pirogue Le Paillaca Épineux Préville Boisville Chamonix Four La Charmeuse Petite Habitation Citron à Chaux Savane Savane Savan Simonet Pointe du Perinelle Diable Fond Fond l'Afrique Guillet Sainte-Marie Savane Petit Habitation Limbé Case Dujon Pointe la Table Habitation Résidence Eudorcait Pointe de Pointe Balata Quartier Depaz Lotissement la Batterie Calebassier Les Loups du Fort Parnasse Bon Air Pointe Morne Rochelle Ferré Abel Lotissement MouillagSe AINT-PIERRE Saint-James LE TRINRueITÉ Saint-Pierre Mulatre Rivière La Croix Canaris Lotissement La Trinité Plateau Sapote Brin d'Amour Le Trou Palourde Tamarins Bois Lézar Quartier La Borelli Deux Choux Darcourt Côte Habitation Pointe d'Or Jean-Claude Morne Fonds-Saint-Denis la Denel Gabillon Saint-Michel Plateau La Vierge Quartier Le Carbet Quartier Boucher Flamboyants Lessema Croix Pointe Lotissement Lotissement Fond Savane Morne Charlote Jean Courbaril Jubilé Banane Bois Lézard Pointe Grand Anse Nord Au Coeur Savane Grand La Médaille de Bouliki Gros-Morne Chère Anse Les Épice Habitation Canton Montjoly -

MARTINIQUE the Yachting Sector
GENERAL LC/CAR/G.710 20 November 2002 ORIGINAL: ENGLISH MARTINIQUE The Yachting Sector Acknowledgement The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) Subregional Headquarters for the Caribbean wishes to acknowledge the assistance of Mr. Cuthbert Didier in the preparation of this document. This document is prepared as part of the Dutch-funded project NET/00/79 “Development of a Regional Marine-based Tourism Strategy”. TABLE OF CONTENTS Executive Summary................................................................................................................................................ 1 Country Background...........................................................................................................................2 Social and Economic Background....................................................................................................2 Overview of the Tourism Sector........................................................................................................ 3 Description of Yachting Sector..........................................................................................................6 Composition of Fleets.......................................................................................................................13 Government Incentives and Legislations....................................................................................... 13 Patterns of Use................................................................................................................................... -
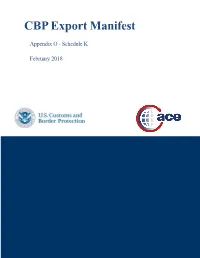
ACE Export Manifest
CBP Export Manifest Appendix O - Schedule K February 2018 CBP Export Manifest Schedule K Appendix O This appendix provides a complete listing of foreign port codes in Alphabetical order by country. Foreign Port Codes Code Ports by Country Albania 48100 All Other Albania Ports 48109 Durazzo 48109 Durres 48100 San Giovanni di Medua 48100 Shengjin 48100 Skele e Vlores 48100 Vallona 48100 Vlore 48100 Volore Algeria 72101 Alger 72101 Algiers 72100 All Other Algeria Ports 72123 Annaba 72105 Arzew 72105 Arziw 72107 Bejaia 72123 Beni Saf 72105 Bethioua 72123 Bona 72123 Bone 72100 Cherchell 72100 Collo 72100 Dellys 72100 Djidjelli 72101 El Djazair 72142 Ghazaouet 72142 Ghazawet 72100 Jijel 72100 Mers El Kebir 72100 Mestghanem 72100 Mostaganem 72142 Nemours 72179 Oran Schedule K Appendix O F-1 CBP Export Manifest 72189 Skikda 72100 Tenes 72179 Wahran American Samoa 95101 Pago Pago Harbor Angola 76299 All Other Angola Ports 76299 Ambriz 76299 Benguela 76231 Cabinda 76299 Cuio 76274 Lobito 76288 Lombo 76288 Lombo Terminal 76278 Luanda 76282 Malongo Oil Terminal 76279 Namibe 76299 Novo Redondo 76283 Palanca Terminal 76288 Port Lombo 76299 Porto Alexandre 76299 Porto Amboim 76281 Soyo Oil Terminal 76281 Soyo-Quinfuquena term. 76284 Takula 76284 Takula Terminal 76299 Tombua Anguilla 24821 Anguilla 24823 Sombrero Island Antigua 24831 Parham Harbour, Antigua 24831 St. John's, Antigua Argentina 35700 Acevedo 35700 All Other Argentina Ports 35710 Bagual 35701 Bahia Blanca 35705 Buenos Aires 35703 Caleta Cordova 35703 Caleta Olivares 35703 Caleta Olivia 35711 Campana 35702 Comodoro Rivadavia 35700 Concepcion del Uruguay 35700 Diamante 35700 Ibicuy Schedule K Appendix O F-2 CBP Export Manifest 35737 La Plata 35740 Madryn 35739 Mar del Plata 35741 Necochea 35779 Pto. -

Public Transport on Martinique - Current State and Recent Developments
Transport and Communications, 2019; Vol. I. DOI: 10.26552/tac.C.2019.1.11 ISSN: 1339-5130 51 Public Transport on Martinique - Current State and Recent Developments Sönke Reise1 1University of Applied Sciences, Business and Design Wismar, Department of Maritime Studies, Richard-Wagner-Str. 31, 18119 Rostock, Germany, [email protected] Abstract Despite being part of the European Union, the French West Indies are not often in the focus of research. This paper aims to introduce Martinique and its public transport systems. Starting with an overview over Martinique, the present transport situation will be analysed with findings as follows: the most important suppliers of public transport services are buses in the capital area and taxi collectives on routes to/from the capital. Individual transport by (rental) car plays a major role, so road congestion is a major issue. Recent developments and innovations that may improve the present situation will be discussed as well. Keywords Public transport, Martinique, bus, taxis collectifs, TCSP JEL R40 traffic jams are not unknown and happen regularly. Figure 1 1. Introduction shows Martinique with its major roads. In addition, Marti- nique is a famous tourist spot, main attractions are scattered Located in the Caribbean Sea, Martinique is one of the over the whole island and cause dispersed traffic. Windward Islands in the Lesser Antilles. The east coast borders the Atlantic Ocean and the west coast touches the Caribbean Sea. It is an overseas region of France and therefore an integral part of the European Union. The cur- rency is the EURO and all European regulations apply. -

Intestinal Schistosmiasis in Martinique
Intestinal Schistosomiasis due tu Schistosoma mansoni in Martinique Nicoleisland DESBOIS - NOGARD University Hospital – Martinique FWI Schistosomiasis Regional Meeting – PAHO/WHO San-Juan, Puerto-Rico October 21, 22, Atlantic Ocean 2 « Windward coast » 1 128 km « Côte au vent » 14°30 N latitude Wet tropical climate Hygrométry : 78 - 80% °C : 25 - 28 °F : 77 – 82,4 Caribbean sea « Leeward coast » « Côte sous le vent » History First reports: 1906 (Lahille), 1908 (Leger), and 1910 (Noc) 1951 (Deschiens) : prevalence rate estimation = 6,4% 1961 : prevalence of Schistosoma mansoni infection = 8,4% (routine parasitological examinations in Institut Pasteur - Martinique) 1970 : combined parasitological and serological survey among schoolchildren (10/34 communes of Martinique) : Stool analysis : prevalence of 0,3% to 18% Immunodiagnostic tests : prevalence of 37% to73% 1971 : large-scale serological survey (5000 persons, mostly female, 5-20 years old, in 20 communes : wide variation in prevalence between communes, (range: 5,3% - 73,5%) Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni = real public health problem in Martinique island 10.July.1973: decree n°73-705 to organize and to finance epidemiological inquiries 1978 : Creation of the department of fight against intestinal parasitosis (DDAS* – Martinique). *Direction Dèpartmentale des Affaires Sanitaires et Sociales History Enquête INSERM* 1977 - 1978 Systematic survey of intestinal schistosomiasis 800 families 3880 persons Prevalence rate : 30% Basse-Pointe, St-Pierre, Morne-Rouge, -

De La Martinique
Fruits - vol . 211 . n 0 5 . 1971 3 - 33 5 Quelques caractéristiques de sols des zones bananières de la Martinique J. GUILLEMOT, J .L . LACHENAUD et M . DORMOY* QUELQUES CARACTERISTIQUES DE SOLS DES ZONE S BANANIERES DE LA MARTINIQU E J . GUILLEMOT, J.L . LACHENAUD et M . DORMOY (IFAC) . Fruits, mai 1973, vol . 28, n° 5, p . 335-349 . RESUME - A la suite de séries danalyses effectuées dans les laboratoi - res de lIFAC sur des sols de bananeraies de la Martinique, les auteur s font une synthèse des résultats . Ils ont distingué cinq zones suivant le s types de sol et la délimitation géographique, chacune divisée en secteurs et sous-secteurs. Pour chaque zone lexploitation,la topographie, la climatologie ont ét é étudiées avant dexposer les caractéristiques physicochimiques de s secteurs et sous-secteurs. Principes généraux de la fumure en fonction des pratiques habituelle s et des expérimentations. En conclusion ils insistent sur le fait que s i lon a sur une zone assez étendue (secteur ou sous-secteur) une certai - ne unité, au niveau de la plantation ou de la parcelle, des solution s différentes doivent être envisagées à cause du passé cultural, de s apports extérieurs et des altérations mécaniques ou climatiques . Cette note a été rédigée à partir de résultats provenant déchantillons prélevés dans de nombreuse s bananeraies martiniquaises, par lIFAC et le Service agro-technique de la SICABAM , depuis 1957 . Les analyses sont faites au laboratoire de lIFAC à Fort-de-France sous la responsabilité de Mme DOR- MOY . Avant 1969 le laboratoire des sols de IORSTOM (Bondy) prêtait son concours pour lanalyse de s cations échangeables . -

Variabilité Spatiale Et Temporelle De La Structure Des Peuplements Ichtyques Exploités À La Martinique : Impacts Des Réserves Marines De Pêche
École Pratique des Hautes Études Mention « Systèmes Intégrés, Environnement et Biodiversité » Pour l’obtention du grade de Docteur Spécialité : Écologie marine Présentée par Géraldine CRIQUET Variabilité spatiale et temporelle de la structure des peuplements ichtyques exploités à la Martinique : Impacts des réserves marines de pêche Dirigée par Philippe LENFANT Soutenue publiquement le 24 septembre 2009 Jury Eric Feunteun Examinateur Philippe Lenfant Directeur Bertrand Gobert Examinateur Raquel Goñi Examinateur Raymonde Lecomte Examinateur Lionel Reynal Examinateur Patrice Francour Rapporteur Jocelyne Ferraris Rapporteur École Doctorale de l’École Pratique des Hautes Études Mention Systèmes Intégrés, Environnement et Biodiversité Thèse de Doctorat Spécialité : Écologie marine Présentée par Géraldine CRIQUET Variabilité spatiale et temporelle de la structure des peuplements ichtyques exploités à la Martinique : Impacts des réserves marines de pêche Sous la direction de Philippe LENFANT UMR 5244 CNRS EPHE UPVD Biologie et Écologie Tropicale et Méditerranéenne Université de Perpignan, 66000 Perpignan Soutenue publiquement le 24 septembre 2009 Devant un jury composé de : Eric Feunteun Examinateur Philippe Lenfant Directeur Bertrand Gobert Examinateur Raquel Goñi Examinateur Raymonde Lecomte Examinateur Lionel Reynal Examinateur Patrice Francour Rapporteur Jocelyne Ferraris Rapporteur À ma mère. Le Grand Fossé / GRAN KANNAL LA ©1980 Les Éditions Albert René / GOSCINNY-UDERZO ©2008 Les Éditions Albert René / GOSCINNY-UDERZO Publié par CARAÏBEDITIONS Traduction en créole de Hector Poullet et Jean Marc Rosier REMERCIEMENTS Mes remerciements s’adressent en premier lieu au Président du Conseil Régional de la Martinique, Alfred MARIE-JEANNE, pour le financement de ce travail. Au sein du Conseil Régional, je remercie vivement Marie-Christine VARTEL, Gertrude BOIS DE FER et Sylvain BOLINOIS pour leur disponibilité et leur soutien dans les différentes démarches administratives. -

2019-08-08 Attestationsdeposees
Attestations et Ad'AP simplifiés déposés au 08/08/2019 N° Ad'AP-S ou d’attestation Commune Nom de l’établissement Adresse de l’établissement Observation (AC) CABINET DE MEDECINE ANSES D’ARLET AC 972-188 GENERALE Docteur DEJEAN 7, bis rue Eugène LARCHER (LES) Catherine ANSES D’ARLET CHEZ MARIE-JO -Mme Suzanne AC 972-488 Anse Dufour (LES) LETUR ANSES D’ARLET AC 972-499 SARL MON REFUGE Grande Anse (LES) ANSES D’ARLET AC 972-520 EHPAD LES MADREPORES 7 Rue Docteur MORESTIN (LES) CABINET MEDICAL Docteur BASSE POINTE AC 972-01 15, rue Joseph Zéphir HALNA DU FRETAY Iris BASSE POINTE AC 972-159 CÉ CÉDILLE 26, rue du Docteur Morestin CENTRE DE REEDUCATION - Mr BASSE POINTE AC 972-359 Cité Lacroix – 2 rue du Malfini Thomas PAPAUREILLE CABINET D’ORTHOPHONIE - 13 lotissement Molinard- Fond BELLEFONTAINE AC 972-02 GOUTE PAULINE ET VILLETTE Boucher HELENE ASSOCIATION LA PERLE RARE – Quartier Cour Tamarin – Rue BELLEFONTAINE AC 972-344 Mme Pascale MAUVOIS Joseph LAGROSILLERE 13 Lotissement Molinard – Fond BELLEFONTAINE AC 972-406 CABINET D’ORTHOPHONIE Boucher OFFICE CARBETIEN DE 17, rue Morne Charlotte - 97221 CARBET Ad'AP-S : 972 204 16 D 0001 TOURISME (OCARTOUR) CARBET SARL LE PETIT TUBE, CARBET Ad'AP-S : 972 204 15 D0002 Anse Latouche - 97221 LE CARBET RESTAURANT 1643 Habitation Latouche - 97221 LE CARBET Ad'AP-S : 972 204 16 D 0004 SARL LA LANTERNE CARBET 1, rue du Professeur Jude Turiaf - CARBET Ad'AP-S : 972 204 15 D 0003 RESTAURANT L’IMPREVU 97221 LE CARBET 22, cité Maniba - 97222 CASE- CASE PILOTE Ad'AP-S : 972 205 15 D0001 CABINET DE KINESITHERAPIE PILOTE CABINET MEDICAL DU Docteur CASE PILOTE Ad'AP-S : 972 205 16 D0002 Maniba – 97222 CASE-PILOTE GRAPINDOR Corinne Lotissement la Caraibe – 179 allée CASE PILOTE AC 972-259 SELAS JurisCarib des Grenadines CABINET DE REEDUCATION – Mr CASE PILOTE AC 972-343 3 Rue Gambetta Maxime LACARRAU CASE PILOTE AC 972-370 FRIANDISES DES ILES Rue Gambetta - Bourg Non conforme CABINET D’ANGIOLOGIE de M. -

16MAG100 Avril 2018
16MAG100 Avril 2018 Caractérisation des zones inondées lors du passage de la tempête tropicale Matthew et actualisation des seuils d’inondabilité de la RD3 et de l’Autoroute Plaine du Lamentin - Martinique SUEZ CONSULTING SAFEGE Agence de Martinique 1 Zone Artisanale de Manhity Immeuble Grémeau 97232 LE LAMENTIN Martinique Direction France Sud Outre-Mer SAFEGE SAS - SIÈGE SOCIAL Parc de l’Ile - 15/27 rue du Port 92022 NANTERRE CEDEX www.safege.com Version : 5 Date : 11/06/2018 Caractérisation des zones inondées lors du passage de la tempête tropicale Matthew et actualisation des seuils d’inondabilité de la RD3 et de l’Autoroute Plaine du Lamentin - Martinique Vérification des documents IMP411 Numéro du projet : 16MAG100 Intitulé du projet : Caractérisation des zones inondées lors du passage de la tempête tropicale Matthew et actualisation des seuils d’inondabilité de la RD3 et de l’Autoroute - Plaine du Lamentin COMMENTAIRES Version Rédacteur Vérificateur Date d’envoi Documents de référence / Description des NOM / Prénom NOM / Prénom JJ/MM/AA modifications essentielles 1 GUILLOT Nicolas BONNAFE Arnaud 31/03/2017 Version initiale 2 CHEREAU Edouard BONNAFE Arnaud 23/06/2017 Mise à jour et intégration topographie travaux A1 3 CHEREAU Edouard BONNAFE Arnaud 18/07/2017 Intégration des remarques P. MARRAS du 4/07/2017 Intégration des données topographiques A1 4 CHEREAU Edouard BONNAFE Arnaud 18/04/2018 (recollement) et du centre technique du TCSP Intégration des remarques P. MARRAS du 31/05/2018 5 CHEREAU Edouard BONNAFE Arnaud 11/06/2018 et S. FRANCOIS 30/05/2018 (mail) Intégration des remarques S. FRANCOIS du 6 CHEREAU Edouard BONNAFE Arnaud 02/07/2018 28/06/2018 (mail) 16MAG100 Caractérisation des zones inondées lors du passage de la tempête tropicale Matthew et actualisation des seuils d’inondabilité de la RD3 et de l’Autoroute Plaine du Lamentin - Martinique Sommaire 1 .....