MYTHOLOGIE » Florent Favard
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reexamining the Link Between Fringe Banking and Financial Distress
Indiana Law Journal Volume 86 Issue 4 Article 4 Fall 2011 Regulating on the Fringe: Reexamining the Link Between Fringe Banking and Financial Distress Jim Hawkins University of Houston Law Center, [email protected] Follow this and additional works at: https://www.repository.law.indiana.edu/ilj Part of the Banking and Finance Law Commons Recommended Citation Hawkins, Jim (2011) "Regulating on the Fringe: Reexamining the Link Between Fringe Banking and Financial Distress," Indiana Law Journal: Vol. 86 : Iss. 4 , Article 4. Available at: https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol86/iss4/4 This Article is brought to you for free and open access by the Law School Journals at Digital Repository @ Maurer Law. It has been accepted for inclusion in Indiana Law Journal by an authorized editor of Digital Repository @ Maurer Law. For more information, please contact [email protected]. Regulating on the Fringe: Reexamining the Link Between Fringe Banking and Financial Distress ∗ JIM HAWKINS INTRODUCTION .................................................................................................... 1362 I. FINANCIAL DISTRESS AS A JUSTIFICATION FOR REGULATION ........................... 1364 A. INVOKING FINANCIAL DISTRESS ............................................................ 1365 B. DEFINING FINANCIAL DISTRESS ............................................................. 1367 C. THE LINK BETWEEN CREDIT CARDS AND FINANCIAL DISTRESS ............ 1371 II. THE DUBIOUS LINK BETWEEN FRINGE BANKING AND FINANCIAL DISTRESS .. 1376 A. ACADEMICS -

Jim Hawkins Critics of Fringe Banking—Products Like Payday Loans, Pawn
Draft – Forthcoming 86 INDIANA LAW JOURNAL (2011). REGULATING ON THE FRINGE: REEXAMINING THE LINK BETWEEN FRINGE BANKING AND FINANCIAL DISTRESS Jim Hawkins∗ Critics of fringe banking—products like payday loans, pawn loans, and rent-to-own leases—frequently argue that these products cause borrowers to experience financial distress. This argument has enormous intuitive appeal: Fringe credit is very costly, and usually the borrowers who use it are already in a serious financial bind. Taking on additional debt and paying high prices for it, the reasoning goes, drive them over the brink. Surprisingly, however, linking financial distress to fringe banking is extremely difficult to do. This Article represents the first attempt to uncover the relationship between fringe banking and financial distress by systematically analyzing the structure of fringe credit markets and characteristics of specific fringe credit transactions. Contrary to the assumptions made by the bulk of the literature, I argue that the link between fringe banking and financial distress is dubious. Because fringe creditors cannot rely on borrowers’ credit scores to predict whether they will be repaid, creditors structure fringe credit products to virtually guarantee repayment. Because repayment is guaranteed by the structure of the transaction, it is nearly impossible for borrowers to take on unmanageable debt loads. Yet, a significant amount of regulatory intervention into fringe banking markets is premised upon the relationship between fringe banking and financial distress. Policymakers lump fringe credit together with other forms of credit that do cause financial distress, resulting in misguided and overly broad policies. The Article concludes by exploring the policy implications of determining that fringe banking products do not cause distress. -

Fringe Series 3 Episode Guide
Fringe series 3 episode guide Continue The apparently haunted building takes several lives. The group tracked down the source as Apartment 6B, in which an elderly woman mourns the loss of her husband. It's a case of ghosts or the beginning of the end of the world. Autonomous history goes well with the main story arc, although it feels artificial and made to do just that. The moments when Peter makes passionate speeches about love that inspire Olivia in their troubled relationship never feel natural and, at best, obvious. In the first days after being kidnapped from another universe, young Peter struggled against his parents and the world that he just knew wasn't his. He then met Olivia Dunham, a young girl who was involved in experiments conducted by a man who called himself his father, and he developed an unlikely relationship. After a few very ordinary episodes, FRINGE bounces back to form with this retro episode set in the 80s and complete with 80s titles, fonts and props. Apeing filming styles of decades goes a little far, since half the long shots don't seem to be in focus, but there's some fun to be had with the period of time. Much more interesting is the fantastical plot that weaves together the mythology of the show to bring the characters together in a way that is both satisfying and entertaining, though it asks the question of how Peter and Olivia could be so significant to each other, and yet never realized that they had met before. -

NYU.1287 Style Guide 5.13
film C COMING OFAGE A CROWD-PLEASING FESTIVAL MARKS U ITS NEW PLACE IN THE FILM INDUSTRY by Renée Alfuso / CAS ’06 here’s no doubt park set up for movies premiering Robert De Niro (HON ’96), her that the TriBeCa on TriBeCa/ESPN Sports Day. film partner of more than 20 L Film Festival has Since it was launched from the years, is retooling the festival to T had something of a ashes of 9/11—in just 120 days— be both a neighborhood carnival Willy Wonka ef - more than two million visitors and a serious cinematic con - fect on its community. Each have flocked to the festival, and it tender. In 2007, she created a spring, it temporarily transforms has screened over 1,100 films year-round industry department T the neighborhood into a giant from more than 80 countries. It to put those who acquire films di - playground where movies come has also generated more than $530 rectly in touch with the artists to life—blankets and lawn chairs million in economic activity for who make them. That same year, lined the Hudson for a lavish luau lower Manhattan. 34 films that premiered at when the animated comedy Surf’s The purpose of most film fes - TriBeCa were acquired for distri - Up screened, and thousands joined tivals, however, is not just to bution—almost double the num - in a zombie dance disco to cele - screen movies but to sell films to ber from the previous year. brate the 25th anniversary of distributors and reach the broadest Documentaries have found the Michael Jackson’s Thriller . -

Retail Innovations in American Economic History the Rise of Mass-Market Merchandisers
Retail Innovations in American Economic History The Rise of Mass-Market Merchandisers Revised March 29, 2012 Art Carden 100 Swan Way, Oakland, CA 94621-1428 • 510-632-1366 • Fax: 510-568-6040 • Email: [email protected] • www.independent.org About the Author Art Carden is a Research Fellow at the Independent Institute in Oakland, Cali- fornia, Assistant Professor of Economics at Samford University, Senior Fellow with the Beacon Center of Tennessee, Senior Research Fellow with the Institute for Faith, Work, and Economics, a columnist for Forbes.com, and an occasional contributor to the Washington Examiner... Art Carden Assistant Professor of Economics Brock School of Business Samford University 800 Lakeshore Drive Birmingham AL 35229 [email protected] Retail Innovations in American Economic History The Rise of Mass-Market Merchandisers1 Revised March 29, 2012 Prepared for The Handbook of Major Events in Economic History, Routledge, Forthcoming Abstract The American retail sector is undergoing a long-term structural shift away from small “mom- and-pop” stores and toward national chains. Retail establishments have gotten larger and more concentrated; the mass-market merchandisers of the later twentieth century continued a trend toward consolidation of the retail sector into national chains operating large stores that started before their widespread emergence. In the late twentieth century, Wal-Mart emerged as the world’s most important (and controversial) retailer. The evidence on Wal-Mart’s effects on retail employment suggests either mild positive or mild negative effects, but Wal-Mart’s effect on prices suggests increases in real income. 2 | the independent institute Introduction also inevitably a story about Wal-Mart Stores, Retail changed in the twentieth century as Inc. -

The Life and Death of Great Cities in the Time of Climate Change and the Covid-19 Pandemic
Journal of Comparative Urban Law and Policy Volume 4 Issue 1 Festschrift II in Honor of Julian Conrad Juergensmeyer on the Occasion of His Article 16 Retirement: International Perspectives on Urban Law & Policy 2020 The Life and Death of Great Cities in the Time of Climate Change and the Covid-19 Pandemic James Kushner Southwestern Law School, [email protected] Follow this and additional works at: https://readingroom.law.gsu.edu/jculp Part of the Comparative and Foreign Law Commons, Environmental Law Commons, Land Use Law Commons, and the Urban Studies Commons Recommended Citation Kushner, James (2020) "The Life and Death of Great Cities in the Time of Climate Change and the Covid-19 Pandemic," Journal of Comparative Urban Law and Policy: Vol. 4 : Iss. 1 , Article 16, 133-220. Available at: https://readingroom.law.gsu.edu/jculp/vol4/iss1/16 This Article is brought to you for free and open access by Reading Room. It has been accepted for inclusion in Journal of Comparative Urban Law and Policy by an authorized editor of Reading Room. For more information, please contact [email protected]. Kushner: The Life and Death of Great Cities in the Time of Climate Change THE LIFE AND DEATH OF GREAT CITIES IN THE TIME OF CLIMATE CHANGE AND THE COVID-19 PANDEMIC James A. Kushner* TABLE OF CONTENTS Prologue I. History and Culture A. Security B. The Effects of War C. Internal Revolt D. The Automobile E. Tourism and its Effects F. Regulatory Traditions II. Current Dilemmas A. Public Transport 1. Combatting the Effects of Automobile Use 2. -

The Uses of Shakespeare on American TV 1990-2010
The Uses of Shakespeare on American TV 1990-2010 By Kendra Ann Whitmire A Thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of Masters of Philosophy. Shakespeare Institute Department of English College of Arts and Law University of Birmingham February 2011 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract Certain social, formal and technological aspects of television impact the creation of television, one of which is its being a postmodern medium full of intertextual references. Shakespeare is a common tool from which to draw for these references, and there are several types of appropriations of Shakespeare found on television. These include textual quotation, referencing a character name or play title, enacting or adapting the plays, sharing a similar plot, and alluding to famous scenes, actors, or adaptations of Shakespeare. There are two major categories of references: lengthy appropriations related to enaction/education and shorthand references. Seeing how Shakespeare references, especially the small, brief ones, are used within a show demonstrates how Shakespeare is a tool used in the creation and movement of a show. -

Austrian Economics Re-Examined
Austrian Economics Re-Examined Austrian Economics Re-Examined: the economics of time and ignorance is an expanded version of the 1996 edition of The Economics of Time and Ignorance . This work is a classic statement of the role of subjectivism, radical uncertainty and change through real time in Austrian economics specifi cally, and in modern economics more generally. The new book contains the full text and Introduction of the earlier edition as well as the comprehensive, previously unpublished essay “What Is Austrian Economics?” and a new Introduction. The essay is a comprehensive overview of the central themes of the book from a somewhat different perspective than in the book itself. It supplements the analysis in the book. The new Introduction explains that the 2007–08 fi nancial crisis and recent developments in behavioral economics have made the book more relevant than ever before. Austrian Economics Re-Examined develops and systematizes the funda- mental principles of the Austrian tradition and applies them to the analysis of rational expectations, business cycles, monetary theory, competition and monopoly, and capital theory. Gerald P. O’Driscoll, Jr. is Senior Fellow, Cato Institute, USA. Mario J. Rizzo is a Professor in the Department of Economics at New York University. He is also Director of the Program on the Foundations of the Market Economy and Co-director of the Classical Liberal Institute at the New York University School of Law, USA. Routledge Foundations of the Market Economy Series editors: Mario J. Rizzo New York University Lawrence H. White George Mason University A central theme in this series is the importance of understanding and assessing the market economy from a perspective broader than the static economics of perfect competition and Pareto optimality. -
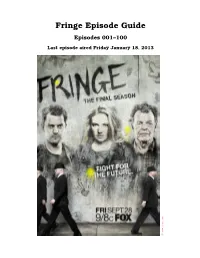
Fringe Episode Guide Episodes 001–100
Fringe Episode Guide Episodes 001–100 Last episode aired Friday January 18, 2013 www.fox.com c c 2013 www.tv.com c 2013 www.fox.com c 2013 www.imdb.com The summaries and recaps of all the Fringe episodes were downloaded from http://www.tv.com and http://www. fox.com and http://www.imdb.com and processed through a perl program to transform them in a LATEX file, for pretty printing. So, do not blame me for errors in the text ^¨ This booklet was LATEXed on June 28, 2017 by footstep11 with create_eps_guide v0.59 Contents Season 1 1 1 Pilot ...............................................3 2 The Same Old Story . .7 3 The Ghost Network . 11 4 The Arrival . 15 5 Power Hungry . 19 6 TheCure ............................................ 23 7 In Which We Meet Mr. Jones . 27 8 The Equation . 31 9 The Dreamscape . 35 10 Safe ............................................... 39 11 Bound . 43 12 The No-Brainer . 47 13 The Transformation . 51 14 Ability . 55 15 Inner Child . 59 16 Unleashed . 63 17 Bad Dreams . 67 18 Midnight . 71 19 The Road Not Taken . 75 20 There’s More Than One of Everything . 79 Season 2 83 1 A New Day in the Old Town . 85 2 Night of Desirable Objects . 89 3 Fracture . 93 4 Momentum Deferred . 97 5 Dream Logic . 101 6 Earthling . 105 7 Of Human Action . 109 8 August . 113 9 Snakehead . 117 10 Grey Matters . 121 11 Unearthed . 125 12 Johari Window . 129 13 What Lies Below . 133 14 The Bishop Revival . 135 15 Jacksonville . 139 16 Peter . 143 17 Olivia. -

Regulating on the Fringe: Reexamining the Link Between Fringe Banking and Financial Distress
Regulating on the Fringe: Reexamining the Link Between Fringe Banking and Financial Distress ∗ JIM HAWKINS INTRODUCTION .................................................................................................... 1362 I. FINANCIAL DISTRESS AS A JUSTIFICATION FOR REGULATION ........................... 1364 A. INVOKING FINANCIAL DISTRESS ............................................................ 1365 B. DEFINING FINANCIAL DISTRESS ............................................................. 1367 C. THE LINK BETWEEN CREDIT CARDS AND FINANCIAL DISTRESS ............ 1371 II. THE DUBIOUS LINK BETWEEN FRINGE BANKING AND FINANCIAL DISTRESS .. 1376 A. ACADEMICS FREQUENTLY ARGUE THAT FRINGE BANKING CAUSES FINANCIAL DISTRESS.................................................................................. 1377 B. POLICY MAKERS RELY ON FINANCIAL DISTRESS TO JUSTIFY FRINGE BANKING REGULATION .............................................................................. 1380 C. QUESTIONING THE LINK BETWEEN CURRENT FRINGE BANKING PRODUCTS AND FINANCIAL DISTRESS .......................................................................... 1385 D. STRUCTURAL COMPONENTS OF THE FRINGE ECONOMY THAT MAKE LINKS TO FINANCIAL DISTRESS UNLIKELY IN THE FUTURE .................................. 1399 III. POLICY IMPLICATIONS ................................................................................... 1402 A. REVEALING AND REJECTING A FAULTY HEURISTIC ............................... 1402 B. THE IMPORTANCE OF PATERNALISM .....................................................