Etude Sanitaire Microbiologique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gouesnou Se Projette À L'horizon 2030
www.gouesnou.bzh LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE GOUESNOU GOUESNOU MAGAZIN KELAOUIN GOUENOÙ #44 LEMAG JAN. 2021 RENOUVELLEMENT URBAIN P.6-7 GOUESNOU SE PROJETTE À L'HORIZON 2030 PLEIN CADRE P.5 RENOUVELLEMENT PORTRAIT P.14 Point d'étape sur les travaux URBAIN P.6 Jean-Christophe Cagnard - Asten de l'église Étude grand-angle 2. BON À SAVOIR - MAT DA C’HOUZOUT LUDIQUE L’ŒIL DES GOUESNOUSIENS LES PHOTOGRAPHES SONT AU RENDEZ-VOUS Merci à Julien Guéguéniat d'avoir saisi cette vue captivante de Gouesnou. Retrouvez l’ensemble des clichés qui nous ont été envoyés sur la page Facebook Ville de Gouesnou et sur www.gouesnou.bzh. Pour la prochaine édition, merci de nous transmettre vos clichés pour le lundi 15 mars 2021 à [email protected] Circumpolaire © Julien Guéguéniat Carnet Urbanisme Naissances Déclaration préalable Aëla Mikolajczak, le 21 août / Gabin Le Borgne, GORREC Raymond, 3 rue Park-ar-Maner, clôture / PERRY Sébastien, 10 rue d'Anjou, clôture et abri de jardin / le 2 septembre / Léon Helias, le 7 septembre / COURTÉ David, 65 imp des Châtaigniers, ravalement / KÉRÉBEL Yohann, 10 imp des Noisetiers, abri de jardin Louisa Le Buanic, le 15 septembre /Maël Pierre, / APPERRY Christian, 3 rue des Bleuets, ravalement / BOUROULLEC Thierry, 2 bis rue du Bocage, abri de le 15 septembre / Virgile Le Duff, le 22 septembre jardin / CALVEZ Jean-Pascal, 11 rue de la Vallée-Verte, piscine / CALVEZ Jean-Pascal,11 rue de la Vallée-Verte, / Nina Provost, le 7 novembre /Inès Boudéhen, le clôture / CAVAREC Christian, 13 rue des Rochers, -

Pjt AP Protection Loutre&Castor Liste Communes-2017-Part P…
PRÉFET DU FINISTÈRE Direction départementale des territoires et de la mer Service eau et biodiversité Unité nature forêt Arrêté préfectoral fixant les modalités de piégeage des animaux d’espèces classées nuisibles afin de protéger la Loutre et le Castor. AP n° Le préfet du Finistère, Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre national du Mérite, VU le code de l'environnement ; VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain ; VU l’arrêté préfectoral fixant l’ouverture et la clôture de la chasse dans le département du Finistère pour la campagne 2017-2018 ; VU l’avis de la fédération départementale des chasseurs du 11 avril 2017 ; VU la procédure de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement qui s’est déroulée du ………..2017 au ……….2017 inclus et les (ou l’absence) d’observations recueillies lors de cette dernière procédure ; VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du ; Considérant que la Loutre et le Castor, espèces protégées, sont susceptibles d’être piégées accidentellement ; Considérant la présence avérée de la Loutre et du Castor dans un grand nombre de communes du département du Finistère, et leurs capacités de colonisation ; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère, ARRETE Article 1 – Restrictions d’usage des pièges pour détruire les nuisibles sur une liste de communes du département afin de protéger la Loutre et le Castor Sur le territoire des communes figurant dans la liste annexée au présent arrêté, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres. -

Zones À Risque Particulier Vis-À-Vis De L'infection De L'avifaune Par Un Virus
Zones à risque particulier vis-à-vis de l'infection de l'avifaune par un virus Influenza aviaire hautement pathogène - FINISTERE (Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque) NOM_DEPT INSEE_COMCommune ZONE A RISQUE PARTICULIER FINISTERE 29001 ARGOL RADE DE BREST FINISTERE 29004 BANNALEC DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29005 BAYE DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29006 BENODET DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29011 BOHARS RADE DE BREST FINISTERE 29015 BOURG-BLANC RADE DE BREST FINISTERE 29016 BRASPARTS RADE DE BREST FINISTERE 29019 BREST RADE DE BREST FINISTERE 29020 BRIEC DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29021 BRIGNOGAN-PLAGES DPM : COTES D'ARMOR A Pte St MATHIEU FINISTERE 29022 CAMARET-SUR-MER RADE DE BREST FINISTERE 29023 CARANTEC DPM : COTES D'ARMOR A Pte St MATHIEU FINISTERE 29026 CHATEAULIN RADE DE BREST FINISTERE 29030 CLEDER DPM : COTES D'ARMOR A Pte St MATHIEU FINISTERE 29031 CLOHARS-CARNOET DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29032 CLOHARS-FOUESNANT DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29037 COMBRIT DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29039 CONCARNEAU DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29042 CROZON RADE DE BREST FINISTERE 29043 DAOULAS RADE DE BREST FINISTERE 29044 DINEAULT RADE DE BREST FINISTERE 29045 DIRINON RADE DE BREST FINISTERE 29047 LE DRENNEC DPM : COTES D'ARMOR A Pte St MATHIEU FINISTERE 29048 EDERN DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29051 ERGUE-GABERIC DPM : Pte DE PENMARC'H AU MORBIHAN FINISTERE 29053 LE FAOU -

Download the PDF File
http:www.francevelotourisme.com 30/09/2021 Roscoff / Goulven The Coastal cycle path in Brittany From the port of Roscoff, let yourself be tempted by a coastal escape to Goulven. A bicycle tour that makes you want to go out to sea and offers a beautiful variety of views: coves, coves, granite chaos, cultivated fields, stone villages... it smells like authentic Brittany! The route The east-west direction from Roscoff allows you to make the most of the proximity to the sea. A route marked only on shared low-traffic roads, with two passages on agricultural roads and a section of bicycle path. Départ Arrivée Relief pronounced before Guillec Cove in Créac'h Roscoff Goulven Bihan. Bicycle path in Plouescat going down towards Kernic cove. Durée Distance Strong relief around Lochrist where the road is 2 h 56 min 44,54 Km otherwise narrow. It will therefore be necessary to be vigilant here. Niveau Thématique Liaison I cycle a lot Seaside, Nature & small heritage Links between the V5 coastal cycle route and the Brest harbour From the coastal cycle route, cycle links connect the Channel coast to the bay of Brest: - From Goulven, a link leads up to Lesneven and then to Landerneau, Drennec, Brest or the Abers region. Mainly on shared roads with occasional relief. - From the port of Aber Wrac'h, the Abers cycle route (35 km) provides a quiet link between Brest, via Landéda, Lannilis, Plouvien, Plabennec, Le Drennec, Gouesnou and Brest. Old railway, alternating asphalt roads and developed roads, very little relief, easy. In the 19th century, a railway occupied the area and saw daily shipments of vegetables, shellfish and other goods passing between Brest and the port of Aber Wrac'h. -

Le Pays De Lesneven-Côte Des Légendes En Chiffres
LE PAYS DE LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES EN CHIFFRES Atlas sociodémographique I avril 2012 Réf. 12/35 2 Le Pays de Lesneven Côte des Légendes en chiffres Atlas sociodémographique I avril 2012 Avant propos L’agence d’urbanisme du Pays de Brest réédite les atlas socio-démographiques des commu- nautés du Pays de Brest. Ces atlas sont fondés en grande partie sur les résultats du recensement de la population de l’INSEE et ont pour objectif de proposer une analyse transversale des territoires composant le Pays de Brest. Ils offrent l’occasion de présenter la situation actuelle et d’analyser les évolutions constatées depuis le recensement de 1999. 3 grandes thématiques sont abordées : Population Habitat Economie. La Communauté de communes du Brignogan-Plage Kerlouan Pays de Lesneven Côte des Légendes Plounéour-Trez dans le Pays de Brest Guissény Goulven St-FrégantC.C. du Pays deKernouës LesnevenPlouider Kernilis Le Folgoët Lesneven Lanarvilyet Côte des LégendesSt-Méen Trégarantec Ploudaniel Le Pays de Lesneven Côte des Légendes en chiffres 3 Atlas sociodémographique I avril 2012 4 Le Pays de Lesneven Côte des Légendes en chiffres Atlas sociodémographique I avril 2012 Sommaire Avant propos ..................................................................3 1. La population .........................................................6 26 311 habitants en 2008 ..............................................6 Une densité supérieure à la moyenne......................6 Une population qui progresse de nouveau ..............7 Une population vieillissante.........................................8 Les origines de la progression de la population ......9 4 400 habitants ne résidaient pas dans la commu- nauté 5 ans auparavant ............................................. 10 Un quart des nouveaux habitants résidaient dans Brest métropole océane ............................................ 10 Des revenus fiscaux inférieurs à la moyenne ........ -
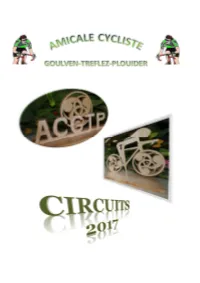
Circuits 2017
A C G T P dimanche 01 janvier 2017 A C G T P Longue Distance 9h00 Moyenne Distance 9h00 Vélo Loisir 9h00 à définir sur place Circuit N°13 Circuit N°10 #VALEUR! Distance: 44 Km Distance: 42 Km #VALEUR! GOULVEN GOULVEN #VALEUR! KEREMMA LESNEVEN #VALEUR! KÉRIOGAN EN TRÉFLEZ LE GROUANNEC #VALEUR! GARE DE TRÉFLEZ PLOUGUERNEAU #VALEUR! LANHOUARNEAU GUISSENY #VALEUR! TRAON-KERNÉ KERLOUAN #VALEUR! LESVÉOC GOULVEN #VALEUR! ST DERRIEN #VALEUR!A définir sur place LANHOUARNEAU #VALEUR! PLOUNÉVEZ #VALEUR! KÉREMMA #VALEUR! GOULVEN #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! A C G T P dimanche 08 janvier 2017 A C G T P Longue Distance 9h00 Moyenne Distance 9h00 Vélo Loisir 9h00 Circuit N°61 Circuit N°11 Circuit N°13 Distance: 70 Km Distance: 50 Km Distance: 44 Km GOULVEN GOULVEN GOULVEN PLOUNÉOUR-TREZ LESNEVEN KEREMMA BRIGNOGAN LE GROUANNEC KÉRIOGAN EN TRÉFLEZ KERLOUAN PLOUGUERNEAU GARE DE TRÉFLEZ PLOUGUERNEAU GUISSENY LANHOUARNEAU LANNILIS KERLOUAN TRAON-KERNÉ PLOUVIEN BRIGNOGAN-PLAGES LESVÉOC PLABENNEC PLOUNÉUR-TREZ ST DERRIEN KERSAINT- PLABENNEC GOULVEN LANHOUARNEAU ST THONAN PLOUNÉVEZ PLOUDANIEL KÉREMMA LESNEVEN GOULVEN PLOUIDER GOULVEN Page 2 de 33 A C G T P dimanche 15 janvier 2017 A C G T P Longue Distance 9h00 Moyenne Distance 9h00 Vélo Loisir 9h00 Circuit N°55 Circuit N°32 Circuit N°20 Distance: 54 Km Distance: 56 Km Distance: 47 Km GOULVEN GOULVEN GOULVEN PLOUIDER PLOUESCAT TRÉFLEZ ( GARE ) ST MÉEN KÉRIDER LANHOUARNEAU LANDIVISIAU BERVEN PLOUNÉVENTER LANDERNEAU ST VOUGAY PLOUÉDERN ST ELOI ST DERRIEN ST ELOI PLOUDANIEL -

Bulletin Du 10 Juillet 2015
Bulletin du 10 juillet 2015 Le bulletin est disponible sur le site de la commune www.mairie-goulven.fr et sur celui de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie. Le prochain bulletin paraîtra le 24 juillet 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 22 juillet 2015. Mairie : 02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : [email protected] Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi. Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous. En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91. Exposition sculptures, Art mor Pagan, à Goulven, Promenade dans le bourg et les jardins privés, jusqu’au 20 septembre 2015, Organisée par l’association Goulven-Découverte. Concours de pétanque organisé par la FNACA – UNC, le samedi 18 juillet 2015, concours en doublette, inscription 14h, Préau de l’école. Jet du bouchon : 14h45. Prix : mise + 20%. Tarifs : 5 € x 2, 10 € par équipe. Ouvert à tous et à toutes. Rendez-vous au bourg. Exposition : « Goulven, sites et monuments », les lundis de juillet et août de 14h à 16h dans l’ossuaire de l’église de Saint-Goulven, entrée libre, puis visite guidée, de l’église de Saint-Goulven à 16h, rendez-vous devant l’ossuaire. Invitation au vernissage de l’exposition des œuvres de Marion ZYLBERMANN, chapelle de Penity lundi 20 juillet à 18h dans le cadre de la 10ème édition de l’Art dans les chapelles du Léon. -

Vivre À Bulletin D’Informations - Keleier
Vivre à Bulletin d’informations - Keleier Bevãn e Goulc’hen Bulletin du 30 août 2019 Le bulletin est disponible sur le site de la commune : www.mairie-goulven.fr et sur celui de la CLCL : www.clcl.bzh Pour recevoir régulièrement le bulletin d’informations dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie. Le prochain bulletin paraîtra le 13 septembre 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 10 septembre 2019. INFOS PRATIQUES VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES Mairie : 02.98.83.40.69. – Courriel : [email protected] Le nombre d’enfants inscrits à l’école du vieux poirier pour cette rentrée Horaires d’ouverture : 30 2019-2020. Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h. Classes, où les élèves sont ainsi Permanence du maire et ses adjoints sur rendez-vous. répartis : 2 En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91. - 12 élèves en CE/CM (5 CM2, 1 CM1, 4CE2, 2 CE1) Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n’engage que leurs rédacteurs. - 18 élèves en maternelle CP (1TPS, 5PS, 5MS, 5GS, 2CP) Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 4 septembre. Ramassage des bacs gris le jeudi 12 septembre. Pensez à sortir vos bacs la veille au A noter qu’en cette rentrée, le hasard soir. fait qu’il n’y a que des filles en toute petite et petite section. Parcours botanique, du 17 juin au 17 septembre, les plantes sauvages comestibles, sentier de découverte du patrimoine botanique. www.goulven-decouverte.fr Foire aux puces, bourg de Goulven, le dimanche 1er septembre 2019, entrée gratuite, 3.50€ le ml. -

Année 2014/2015 Livret Horaires Scolaires Desserte Des
Charte graphique du Conseil général du Finistère 56 1.27 L’évolution proposée pour la livrée du Réseau Penn-ar-Bed de transport par autocars L’identité visuelle du Conseil général est associée à celle du Réseau Penn-ar-bed et opte pour la couleur segmentée da la politique « Déplacements ». Le logotype se place obligatoirement à gauche de l’identité du transport et ses contours restent rectilignes et non modifiés par les obliques de la frise. Mise à jour : le 07/07/2014 Année Livret horaires scolaires 2014/2015 desserte des établissements de Landerneau La frise du Réseau Penn-ar-bed sans le logotype du Conseil général n’est utilisée que rarement et reste déconseillée. Dans ce cas, l’identité visuelle de l’institution doit impérativement apparaître sur le support de communication. Lignes scolaires en service sur le secteur de Landerneau http://www.viaoo29.fr Cette identité graphique associant deux logotypes n’est pas graphiquement adaptable par un tiers. Il est impératif de faire la demande du fichier informatique à la Direction de la communication. TABLE DES MATIÈRES PAR COMMUNES ↘ LANDERNEAU Gare Routière : les emplacements • Page 54, 55, 56 BODILIS • Page 44, 45 BRIGNOGAN-PLAGE • Page 6, 7 DAOULAS • Page 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 43 DIRINON • Page 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41 GOULVEN • Page 6, 7 GUIPAVAS • Page 16, 17 GUISSÉNY • Page 6, 7 HANVEC • Page 36, 37, 38, 39 HÔPITAL-CAMFROUT • Page 32, 33, 38, 39 IRVILLAC • Page 34, 35, 42, 43 KERLOUAN • Page 6, 7 KERNOUËS • Page 6, 7 KERSAINT-PLABENNEC • Page 20, 21 LAMPAUL-GUIMILIAU -

AP 5Ème PADN Consolidé COMPLET-1
ANNEXE 1 Carte des zones I et II fixant les périodes d’interdictions d’épandage de fertilisants de type II sur culture de maïs et liste des communes situées en zone II 13 Liste des communes situées en zone II Communes situées dans le département des Côtes d’Armor ALLINEUC GAUSSON LANGAST LOGUIVY-PLOUGRAS PLEHEDEL PLOULEC'H BEGARD GLOMEL LANGOAT LOHUEC PLELAUFF PLOUMAGOAR BELLE-ISLE-EN-TERRE GOMMENEC'H LANGUEUX LOUANNEC PLELO PLOUMILLIAU BERHET GOUAREC LANISCAT LOUARGAT PLEMY PLOUNERIN BINIC GOUDELIN LANLEFF LOUDEAC PLENEE-JUGON PLOUNEVEZ-MOEDEC BOQUEHO GRACES LANMERIN MAEL-CARHAIX PLERIN PLOUNEVEZ-QUINTIN BOURBRIAC GRACE-UZEL LANNEBERT MAEL-PESTIVIEN PLERNEUF PLOURAC'H BREHAND GUINGAMP LANNION MAGOAR PLESIDY PLOURHAN BRELIDY GURUNHUEL LANRIVAIN MANTALLOT PLESSALA PLOURIVO BRINGOLO HEMONSTOIR LANRODEC MELLIONNEC PLESTAN PLOUVARA BULAT-PESTIVIEN HENGOAT LANTIC MERLEAC PLESTIN-LES-GREVES PLOUZELAMBRE CALANHEL HENON LANVELLEC MESLIN PLEUDANIEL PLUDUAL CALLAC HILLION LANVOLLON MINIHY-TREGUIER PLEUMEUR-BODOU PLUFUR CAMLEZ KERGRIST-MOELOU LE BODEO MONCONTOUR PLEVIN PLUSQUELLEC CANIHUEL KERIEN LE FAOUET MOUSTERU PLOEUC-SUR-LIE PLUSSULIEN CAOUENNEC-LANVEZEAC KERMARIA-SULARD LE FOEIL MUR-DE-BRETAGNE PLOEZAL PLUZUNET CARNOET KERMOROC'H LE GOURAY PABU PLOUAGAT POMMERET CAUREL KERPERT LE HAUT-CORLAY PAULE PLOUARET POMMERIT-JAUDY CAVAN LA CHAPELLE-NEUVE LE LESLAY PEDERNEC PLOUBEZRE POMMERIT-LE-VICOMTE CHATELAUDREN LA HARMOYE LE MERZER PENGUILY PLOUEC-DU-TRIEUX PONT-MELVEZ COADOUT LA MALHOURE LE MOUSTOIR PENVENAN PLOUFRAGAN PORDIC COATASCORN LA MEAUGON -

SSIAD 7 Personnes Handicapées Bureau Administratif 10, Rue Des 3 Frères Cozian - 29490 GUIPAVAS Tél
81 personnes âgées SSIAD 7 personnes handicapées Bureau administratif 10, rue des 3 Frères Cozian - 29490 GUIPAVAS Tél. 02 98 84 61 44 - Fax 02 98 32 16 65 SSIAD [email protected] www.amities-armor.asso.fr Anne-Sophie MAUFFRÉ ©UNA Territoires Brignogan-Plages d’intervention Kerlouan Guissény Plounéour-Trez Plouider SSIAD GUIPAVAS Lampaul Saint-Frégant Goulven pour Ploudalmézeau Landunvez Lesneven 10, rue des 3 Frères Cozian Lanhouarneau Saint-Pabu 29 490 Guipavas Ploudalmézeau Le Folgoët Porspoder SSIAD Tréouergat Ploudaniel Tél. 02 98 84 61 44 Plourin Bréles Saint-Thonan Coat Méal et handicapées Lanildut Lanrivoaré Guipronvel Saint-Divy personnes âgées Lampaul SSIAD GOULVEN Plouarzel Gouesnou Plouarzel Milizac Ploumoguer Guipavas Ty Ruz à Domicile Locmaria 29 890 Goulven Plouzané Trebabu Tél. 02 98 25 42 76 Le Conquet Plougonvelin SSIAD LANRIVOARÉ Soins Infirmiers Résidence du Park 29 290 Lanrivoaré Tél. 02 98 32 42 32 FÉVRIER 2014 FÉVRIER Service de Soins Infirmiers À Domicile Missions et objectifs du SSIAD Sur prescription médicale et 7 jours sur 7, nous dispen- LE PERSONNEL sons des soins d’hygiène et infirmiers financés à 100 % SSIAD par la Sécurité Sociale. L’équipe d’aide-soignant(e)s est placée sous la responsa- Nous attachons beaucoup d’importance au respect de bilité d’une infirmière coordonnatrice. Grâce à ses trois antennes situées la personne et travaillons avec tout le réseau social et Lors de la visite d’admission, l’infirmière coordonnatrice à Guipavas, Goulven et Lanrivoaré, médical. définit avec le patient et son entourage, un projet individuel de soins sur la base de la prescription médicale. -

Desserte Des Établissements Scolaires De Landerneau
Desserte des établissements scolaires de Landerneau Livret horaires 2021/2022 Signatures condensées Dans le cadre d’opérations, d’événements avec lesquels des conventions de partenariat sont signées, un bloc-marque est proposé en plusieurs déclinaisons (couleurs ou monochrome). Celui-ci a vocation à être employée avec les autres logotypes, signatures des partenaires. Exemple Réseau TER BreizhGo Les horaires et les itinéraires des lignes figurant dans ce livret sont susceptibles d’évoluer,Lignes maritimes yBreizhGo compris en cours d’année scolaire. Mise à jour : le 02/07/2021 Réseau cars BreizhGo 43 TABLE DES MATIÈRES PAR COMMUNES ↘ LANDERNEAU Gare Routière : les emplacements • Page 64, 65, 66 BODILIS • Page 48, 49 DAOULAS • Page 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45 DIRINON • Page 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 GOULVEN • Page 6, 7 GUIPAVAS • Page 18, 19 GUISSÉNY • Page 6, 7 HANVEC • Page 38, 39, 40, 41 HÔPITAL-CAMFROUT • Page 34, 35, 40, 41 IRVILLAC • Page 36, 37, 44, 45 KERLOUAN • Page 6, 7 KERNILIS • Page 62, 63 KERNOUËS • Page 6, 7 KERSAINT-PLABENNEC • Page 22, 23 LAMPAUL-GUIMILIAU • Page 50, 51 LANDIVISIAU • Page 48, 49, 50, 51, 52, 53 LANNEUFFRET • Page 16, 17 LESNEVEN • Page 4, 5, 6, 7, 62, 63 LA FOREST-LANDERNEAU • Page 18, 19, 24, 25 LA MARTYRE • Page 56, 57, 58, 59, 60, 61 LA ROCHE-MAURICE • Page 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 LE FAOU • Page 38, 39, 40, 41 LE TRÉHOU • Page 58, 59 02 99 300 300 2 - Livret Landerneau LOGONNA-DAOULAS • Page 34, 35 LOPERHET • Page 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42, 43 PENCRAN • Page 30,