Vers L'élaboration De Codes De Relations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
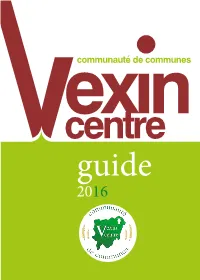
Guide Pratique Ccvc
communauté de communes exincentre guide 2016 3 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VEXIN CENTRE VEXIN COMMUNES DE COMMUNAUTÉ Sommaire édito ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 La communauté de communes Vexin Centre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 G uide Pratique 2016 uide Pratique À quoi sert la communauté de communes Vexin Centre ? ������������������������������������������������������������������� 6 Qui fait quoi ? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 L’équipe du Vexin Centre ���������������������������������������������������������������������������������������� 9 Vous êtes parent ou futur parent ? ������������������������������������������������������ 10 Le point conseil petite enfance ����������������������������������������������������������������������������� 10 Les crèches ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 Les assistant(e)s maternel(le)s ����������������������������������������������������������������������������� 12 Le lieu d’accueil enfants/parents - LAEP �������������������������������������������������������������� 14 L’accueil de loisirs des mercredis ������������������������������������������������������������������������� 17 Vous souhaitez vous déplacer ? ����������������������������������������������������������� -
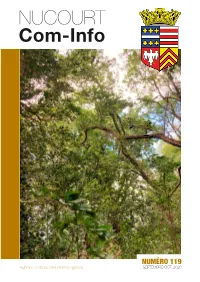
Nucourt Com-Info N°
NUCOURT Com-Info NUMÉRO 119 Automne en fleurs, hiver plein de rigueurs. SEPTEMBRE-OCT. 2020 Organisation municipale Chers Nucourtoises et Nucourtois, Pendant l’été, la principale préoccupation des élus et du personnel communal a été d’assurer la meilleure rentrée possible pour les enfants dans les conditions actuelles liées au coronavirus. Quatre nouvelles armoires ont été acquises et un grand rangement de l’école a été réalisé par le personnel communal et les maîtresses. Trois d’entre elles sont nouvelles. municipal mais si vous rencontrez des difficultés, Nous souhaitons la bienvenue à Aurélie Pardo- n’hésitez pas à nous le faire savoir via la page de Jacques qui est directrice de l’école et prend en contact sur le sitenucourt.fr (la commission charge la classe des CM, Mélodie Dupuis la travaux est en train de réfléchir à un classe des PS/MS et Anne-Sophie Loubel et fonctionnement différent). Le tracteur de la Claudie Bequet s’occupent de la classe des CE. commune a subi une longue réparation et nous Bénédicte Gacel reste en poste pour la classe comptons sur lui pour être opérationnel encore des GS/CP et la décharge de direction est longtemps. Les travaux d’enrobés ont été assurée le mardi par Stéphanie Magne. réalisés également. Les conditions sanitaires ont été allégées mais le La réhabilitation des cinq logements sociaux nettoyage et la désinfection des locaux doivent s’est achevée fin août et la commission respecter les mêmes conditions qu’en juin. C’est logement est en train de les attribuer. pourquoi un seul service de cantine est possible car il n’y a pas assez de temps pour le nettoyage Enfin, nous attendons le rapport de l’Apave entre deux services. -

Répertoire Des Sections D'inspection Du Travail
Val d’Oise DDTEFP : Immeuble Atrium – 3 boulevard de l’Oise – 95014 CERGY PONTOISE Standard : 01 34 35 49 49 Directeur départemental : Jean LE GAC ; - Sec 01 34 35 48 51 Données février 2010 - Découpage février 2010 Sec Secteur Inspecteur ou Contrôleurs Coordonnées tion Directeur adoint 1 Ableiges, Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arronville, Arthies, Artheuil, Avernes, Banthelu, Berville, Boisemont, Julie COURT Thierry BOIROT Tel sec 01 34 35 49 33 Boissy l’Aillerie, Bray et Lû, Bréançon, Brignancourt, Buhy, Cergy le Haut, Cergy Saint-Christophe, Charmont, Chars, Marielle GUEZOU Fax 01 34 22 13 62 Chaussy, Chérence, Cléry en Vexin, Commeny, Condécourt, Cormeilles en Vexin, Courcelles sur Viosne, Courdimanche, Ennery, Épiais Rhus, Frémainville, Frémécourt, Frouville, Gadancourt, Genainville, Génicourt, Gouzangrez, Grisy les Plâtres, Guiry en Vexin, Haravilliers, Haute-Isle, Hédouville, Hérouville, Hodent, Jouy le Moutier, Labbebille, La Chapelle en Vexin, La Roche Guyon, Le Bellay en Vexin, Le Heaulme, Le Perchay, Livilliers, Longuesse, Magny en Vexin, Marines, Maudetour en Vexin, Menouville, Menucourt, Montgeroult, Montreuil sur Epte, Moussy, Nesles la Vallée, Neuilly en Vexin, Nucourt, Omerville, Ronquerolles, Sagy, Saint Clair sur Epte, Saint Cyr en Arthies, Saint Gervais, Santeuil, Seraincourt, Théméricourt, Theuville, Us, Vallangoujard, Vetheuil, Vienne en Arthies, Vigny, Villiers en Arthies, Wy dit Joli Village 2 Argenteuil, Mériel, Montsoult, Villiers Adam Martine MILLOT Fatima BAIBOU Tel sec 01 34 35 49 29 Nathalie LASMARRIGUES -

Bray-Et-Lû Pontoise
Livret 95-04_90X150 21/08/2014 12:48 Page1 95 04 BRAY-ET-LÛ ǡǠ PONTOISE Horaires valables à compter du 2 Septembre 2014 • Horaires périodes scolaires pages 8 à 27 • Horaires vacances scolaires pages 28 à 39 Livret 95-04_90X150 21/08/2014 12:47 Page2 Sommaire Vos titres de transport Carte Navigo : zone 5 ( hebdomadaire - mensuelle - annuelle) Titres de transport …………………………………………………………… p. 3 Ticket vendu à l’unité. Il est conseillé de préparer l’appoint. Liste des dépositaires ……………………………………………………… p. 3 Ticket t+ (plein tarif ou demi tarif) Cartographie de la ligne ……………………………………………… p. 4 et 5 Carte Scolaire Bus (délivrée par TIM BUS) Schéma de ligne ………………………………………………………… p. 6 et 7 Carte Imagine’R : zone 5 Carte Mobilis Carte « Paris visite » : zone 5 PERIODES SCOLAIRES Ticket Jeune (samedis, dimanches et jours fériés) Du lundi au vendredi Tous les titres de transport devront faire l’objet d’une validation De BRAY-ET-LÛ à PONTOISE ……………………………………… p. 8 à 13 à chaque montée dans le bus. De PONTOISE à BRAY-ET-LÛ ……………………………………… p. 14 à 21 Samedi Liste des dépositaires vente de titres De BRAY-ET-LÛ à PONTOISE ……………………………………… p. 22 à 24 MAGNY-EN-VEXIN ST CLAIR SUR EPTE De PONTOISE à BRAY-ET-LÛ ……………………………………… p. 25 à 27 Agence Tim Bus Viveco 7 rue des Frères alimentation générale Montgolfier 6 place Rollon Du lundi au vendredi Arrêt le plus proche : Arrêt le plus proche : Demi-Lune Demi-Lune De BRAY-ET-LÛ à PONTOISE ……………………………………… p. 28 à 31 De PONTOISE à BRAY-ET-LÛ ……………………………………… p. 32 à 35 Bar-PMU Le Saint Clairois « Le Longchamp » Tabac Samedi 4 rue de Paris 1 place Rollon De BRAY-ET-LÛ à PONTOISE …………………………………… p. -

95-46 Magny-En-Vexin <> Chars Marines
95-46 MAGNY-EN-VEXIN CHARS (MARINES) 95-46 MAGNY-EN-VEXIN CHARS (MARINES) Marines Chars Du lundi au vendredi Numéro de courses 21 26 22 23 28 24 27 19 20 29 19 20 25 19 Le-Bellay-en-Vexin MAGNY-EN-VEXIN Porte de Rouen 12:43 16:50 18:00 Nucourt Magny-en-Vexin Nucourt Magny-en-Vexin Nucourt Le Bellay-en-Vexin, Marines Nucourt Bouconvillers et Chars Magny Serans Gare Routière 6:28 6:34 7:45 7:45 7:45 8:55 11:55 12:48 12:50 16:15 16:55 17:25 17:20 18:05 Bouconvillers Nucourt Lierville en Vexin en-Vexin Le Bellay Hadancourt Lierville Bouconvillers Clos des Aulnes l l l l 7:47 8:56 l l 12:52 16:17 l 17:27 l l le-Haut-Clocher Hadancourt-Le-Haut-Clocher Dame Noire l l l l 7:48 8:57 l l 12:53 16:18 l 17:28 l l Hadancourt Croisement de la route Hôpital Porte de RouenGare RoutièreBlamécourtSerans le Haut-ClocherLierville BouconvillersHardevilleRue du BoisRue de d'Hardeville CharsClos des AulnesDame NoirePaul GauguinBois PierreWenings Grande RueVélannesWenings Rue du BoisHardeville De CharsÉglise Bouconvillersde BercagnyCentre VilleL.E.P Métairie Zone ArtisanaleJean-BaptisteGendarmerie CartryCollège lesWenings Hautiers Serans 19 19 Rue Gauguin l l l l l l l l 12:55 16:20 l 17:30 l l Nucourt 20 20 Magny-en-Vexin Bois Pierre l l l l 7:50 8:58 l l 12:57 16:22 l 17:32 l l 21 21 22 22 Vélannes l l l l l l l l 13:03 16:28 l 17:38 l l CHARS (MARINES) CHARS 23 23 NUCOURT 24 24 Wenings l l l 7:52 7:55 9:04 l l 16:35 l l l MAGNY-EN-VEXIN MAGNY-EN-VEXIN 25 25 Rue du Bois de Chars l l l l 7:56 l l l l l l 26 26 27 27 Hardeville l l l l 7:57 l l l l l l Horaires -

Plaquette RAM Rectoverso
Responsable et animatrice du RAM Bernadette Rousselin, éducatrice de jeunes enfants. Pour les Communes de : Ableiges, Avernes,Condécourt,Courcelles/Viosne, Frémainville, Gadancourt, Longuesse, Sagy, Seraincourt, Accueil téléphonique et sur rendez-vous Théméricourt, Us, Vigny,Bellay en Vexin, Cléry en Vexin, Commeny, Guiry en Vexin, Gouzangrez, Moussy, Nucourt, Le Perchay. Lundi, mardi, jeudi, 13h30 - 17h Mercredi : 9h30 - 17h30 RAM « À petits pas » Vendredi : 2 ème et 4 ème du mois : 8h-9h30 et 13h30 - 27 rue de Dampont 16h / 1ers et 3èmes du mois : 13h30-16h30 Le Relais Assistantes 95450 Us Maternelles est un service ( 01 34 66 08 95 Eventuellement, possibilité de rendez-vous le gratuit de la Communauté de [email protected] samedi matin et en dehors de ces horaires. Communes Vexin Centre. Responsable : Bernadette Rousselin Accueils-jeux Temps collectifs de rencontres où l’adulte Il fonctionne en partenariat ac compagne l’enfant et favorise son éveil et sa avec la Caisse d’Allocations socialisation. Familiales du Val d’Oise et la Protection Maternelle et RELAIS ASSISTANTS Pendant le temps scolaire : Infantile. MATERNELS Us (RAM) : lundis, mercredis et vendredis de 9h30 Lieu d’accueil, d’information, d’animations, à 11h30 au service des parents et des assistantes mate rnelles pour l’éveil et le bien être de Sagy (salle des fêtes) : 2èmes et 4èmes lundis du l’enfant. mois et tous les jeudis de 9h30 à 11h30. Seraincourt (Centre de Loisirs) : les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 9h30 à 11h30. Pour les Communes de : Chars, Marines, Brignancourt, Santeuil, Neuilly en Vexin,Le Heaulme, Haravilliers,Theuville, Bréançon, Nucourt (Camp de César) : les 1ers et 3èmes Grisy les Plâtres ; Frémécourt, Cormeilles en Vexin, Montgeroult, mardis du mois de 9h30 à 11h30. -

NUCOURT Com-Info
NUCOURT Com-Info RESTEZ À LA MAISON PRENEZ SOIN DE VOUS NUMÉRO 117 En mars et d'avril, la campagne est un tapis de fleurs, d'une franchise de couleurs incomparable. MARS-AVRIL 2020 Actualités municipales Site web de Nucourt Le site web de Nucourt est en ligne. Connectez-vous dès maintenant sur https://www.nucourt.fr et retrouvez toutes les informations liées à l’épidémie de Covid-19. Nucourt Com-Info : le journal du Conseil municipal Mairie de Nucourt – rue de la Boutrolle – 95420 Nucourt | Tél : 01 34 67 41 11 | [email protected] | www.nucourt.fr Directeur de publication : Philippe Flahaut. Rédaction : les conseillers municipaux. Conception et réalisation : Émilie et Baptiste Vallet. Imprimé par nos soins à 300 exemplaires. Pour préserver l’environnement, ce journal est imprimé sur un papier norme PEFC. 2 NUCOURT COM-INFO #117 / MARS-AVRIL 2020 Application mobile illiwap Pendant la durée du confinement, la mairie de Nucourt a décidé d’utiliser l’application mobile illiwap pour informer les Nucourtois. Téléchargez l’application et recevez automatiquement des notifications. Téléchargez lʼapplication Recherchez votre commune illiwap Entrez manuellement le nom de la commune dans la barre de recherche de votre application Sur votre Google Play (Android) OU Scannez le QRCode via le lecteur intégré Sur votre AppStore (iOS) Suivez votre commune Recevez les notifications sur votre smartphone Cliquez sur le bouton SUIVRE Tous les messages que vous recevrez seront pour vous abonner à disponibles dans le fil d'actualité de votre l'actualité de la commune application pendant 30 jours illiwap, c'est l'appli : SANS INSCRIPTION Pas d'email, pas de téléphone, aucune coordonnée, pas de fichier GRATUITE Téléchargement gratuit et sans engagement 3 Actualités municipales Conseil municipal du 4 mars 2020 Communauté de Communes Vexin Centre Le conseil municipal a adopté à l'unanimité les modifications des statuts, proposées et votées par la CCVC selon une nouvelle rédaction. -

Le Maire Et L'ensemble Du Conseil Municipal Vous Convient À
Janvier 2007 ENNERY INFOS ISSN : 0999-1670 VIE MUNICIPALE Changement de nom Le Lors de sa séance du 27 mai 2005, le Conseil Le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal Municipal décidait de modifier le nom de la commune en : ENNERY en Vexin vous convient à la cérémonie des vœux Nous venons d’apprendre que suite à l’avis favorable donné par le Conseil Général du le samedi 27 janvier 2007 Val d’Oise, la commission des changements à 18H30 au Foyer Rural de noms du ministère de l’intérieur a examiné notre dossier ainsi que celui d’HEROUVILLE (qui souhaite : HEROUVILLE en Vexin) le Conseil Municipal du 18 décembre, 7 décembre dernier. - Retient la société STUR pour assurer la mission d’élaboration du projet Nous attendons la décision du ministère. d’enfouissement de réseaux programme 2006-2007. - Autorise le Maire ou M. LUCAS à signer une convention avec France TELECOM Tennis pour les travaux d’enfouissement des réseaux programme 2006-2007. Par courrier du 15 décembre, le club de - Décide de verser un acompte de subvention de fonctionnement 2007 à l’ AOJE. Tennis informait la mairie du démontage de - Décide de passer au paiement mensuel les loyers des logements de fonction des son chalet «club house» situé près des courts écoles à compter du 1er Janvier 2007. en raison de : - Accepte les modifications de modalités de versement de la participation pour «l’occupation quasi systématique aussi bien raccordement à l’égout (PRD). le jour que la nuit de notre chalet par des - Nomme Monsieur DELAHAYE comme coordonnateur pour le recensement de la individus extérieurs au tennis qui causent population ainsi que Madame DUQUENOY et Mlle GERIN comme suppléantes. -

REGISTRES MUNICIPAUX Extraits
REGISTRES MUNICIPAUX Extraits Registre des délibérations 1966 – 1977 Maire : Gérard CLAUDEL Adjoints : 1er Pierre BAZIN et 2ème Yves BORGES Conseillers : Gaston BOURESCHE – Gabriel DESABRES – Jean DEBOISSY – Joseph LYPICK – Guy LUCAS – Claudine COUTANT – Eugène LAURAIN – Lucien CAILLEUX – Geneviève COUBRICHE – Roland DUMOND Séance du 16 septembre 1966 (suite) 189 élèves à l’école dont 113 filles et 76 garçons Séance du 10 décembre 1966 Compte administratif Budget supplémentaire : 892 288, 63 f Subvention pour les bordures de trottoirs et le caniveau de la RN 327 Vente de la pompe de Louville et le terrain où elle est (12 m2) à André CHARPENTIER pour 120 f Guy LUCAS rapporte les plaintes des riverains de la cabine téléphonique mal isolée, installation d’un poste en coffret fonte place de la mairie Goudronnage de la cours de l’école rue De Gaulle Aménagement du trottoir pour un arrêt de bus face à la rue de l’Herbette refus du devis Raccordement au réseau d’égouts de la FMP Séance du 21 janvier 1967 Projet d’équipement sportif (architecte BADER) terrain lieu dit « la Croix » L Ŕ 157 Subvention pour le reprofilage de l’ancien CV 4 : manque 32 670 f envisagé un emprunt de ce montant La rue de l’herbette est en très mauvais état, circulation difficile et écoulement des eaux déplorable. Donc reprofiler la chausser et poser de nouveaux caniveaux envisagé un emprunt de 50 000 f Un contrôle d’hygiène scolaire vient d’être effectué, nombre assez important de primo-infections qui alarment les parents. Demande que ce contrôle soit -

Charmont Santeuil Magny En Vexin Marines Clery En
VILLE DATE MAGNY EN VEXIN Semaine 17 et Semaine 18 MARINES Semaine 17 et Semaine 18 CLERY EN VEXIN Semaine 17 CHARS Semaine 17 NUCOURT Semaine 17 LE BELLAY EN VEXIN Semaine 17 WY DIT JOLI VILLAGE Semaine 17 MOUSSY Semaine 17 BANTHELU Semaine 17 BRIGNANCOURT Semaine 17 CHARMONT Semaine 17 SANTEUIL Semaine 17 MAUDETOUR EN VEXIN Semaine 17 NEUILLY EN VEXIN Semaine 17 ARTHIES Semaine 17 et Semaine 18 LE HEAULME Semaine 17 et Semaine 18 AINCOURT Semaine 17 et Semaine 18 FREMECOURT Semaine 17 et Semaine 18 SAINT CYR EN ARTHIES Semaine 17 et Semaine 18 CORMEILLES EN VEXIN Semaine 18 VIENNE EN ARTHIES Semaine 17, Semaine 18 et Semaine 19 BREANCON Semaine 18 VILLERS EN ARTHIES Semaine 18 GRISY LES PLATRES Semaine 18 et Semaine 19 GENAINVILLE Semaine 18 et Semaine 19 EPIAIS RHUS Semaine 18 et Semaine 19 HODENT Semaine 18 et Semaine 19 THEUVILLE Semaine 18 SAINT GERVAIS Semaine 18 , Semaine 19 et Semaine 20 HARAVILLIERS Semaine 18 et Semaine 19 LA CHAPELLE EN VEXIN Semaine 19 MENOUVILLE Semaine 18 MONTREUIL SUR EPTE Semaine 19 ARRONVILLE Semaine 18 et Semaine 19 BUHY Semaine 19 et Semaine 20 BERVILLE Semaine 19 SAINT CLAIR SUR EPTE Semaine 19 et Semaine 20 BOISSY L'AILLERIE Semaine 19 et Semaine 20 AMBLEVILLE Semaine 19 GENICOURT Semaine 19 OMERVILLE Semaine 19 et Semaine 20 LIVILLIERS Semaine 19 et Semaine 20 CHAUSSY Semaine 19 et Semaine 20 ENNERY Semaine 19, Semaine 20 et Semaine 21 BRAY ET LU Semaine 20 HEROUVILLE EN VEXIN Semaine 20 AMENUCOURT Semaine 20 VALLANGOUJARD Semaine 20 LA ROCHE GUYON Semaine 20 LABBEVILLE Semaine 20 HAUTE ISLE Semaine -

Liste Piegeurs 95
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES SAFE − Pôle Forêt Chasse Pêche LISTE DES PIEGEURS AGREES DANS LE VAL D’OISE Nom Prénom Adresse CodeP Ville Téléphone Portable FAX LEFEVRE Michel 13, rue des Sablons 95650 GENICOURT GRAIS Gérard 18, bis rue du Val 95650 COURCELLES−SUR−VIOSNE 01−34−66−97−73 06−11−85−21−46 THIOUX Pascal 17, bis rue de la Gare 95470SURVILLIERS ANASTASI Jean 14, rue Fontaine 95770 MONTREUIL−SUR−EPTE FROMENT Claude 3, rue du Fruchot 95650 MONTGEROULT ARNOLD Didier 3, rue Neuve St Martin 95430 AUVERS SUR OISE MILORD Marcel Chemin de Méru BP 27 95690LABBEVILLE 01,30,34,70,37 DEMULDERS Sylvain 7 ter, rue de l’Isle Adam 95260 BEAUMONT−SUR−OISE 01−34−69−52−77 06−70−89−78−02 PHILIPP Patrick 12, rue de l’Onglet 95300ENNERY VAN HOLLEMEERSCH Pascal 1, chemin des Vanneaux − Golf Isle Adam 95290L’ISLE ADAM 01 34 69 25 45 01 34 69 25 45 GUILLET Jean Paul 131, Avenue de la République 95550BESSANCOURT DEPREZ Jacques 16 Bis, rue Pasteur 95470 SURVILLIERS EMERY Alain 5, rue d’Arthies 95510AINCOURT 06−88−18−36−94 CAVAN Jean−Louis 21, rue de la Vallée Saillancourt 95450SAGY 01−34−66−34−08 PERSELLO Bruno 37, bis quai de l’Ecluse 95310SAINT OUEN L’AUMONE 01−30−30−22−37 BURE Jean−Bernard 12, rue Baleydier 95640MARINES 01−30−39−−82−71 BAUDOIN Christian 3, rue Joseph Rigault 95410GROSLAY 06−61−56−65−84 MYSZOR Michel La Brêche − Les Coutumes − 49 route Dépt 64 95590 NERVILLE LA FORET 01−34−08−28−58 NICOLAS Henri 3, rue de Dampont 95450US ZASKORSKI Stéphane 1, Avenue des Millonets 95510VETHEUIL WATTIGNY Alain 1, route de Bouconvilliers 95420NUCOURT -

Ableiges Boissy L'aillerie Nucourt Commeny Chars
Les inscriptions se font directement auprès des structures. Contactez-les pour retirer les documents nécessaires. Capacité Lieux des accueils Périodes d’ouverture Horaires Gestion des accueils - Contacts/renseignements/inscriptions d’accueil . Mercredi (période scolaire). ASSOCIATION ‘LES PETITES CANAILLES’ 7h15- ABLEIGES . Vacances : celles Hiver et du printemps + 48 19h Rue Veuve Quatremain - Boissy L’Aillerie 01 34 42 17 91 / 06 20 80 05 40 mois de Juillet + dernière sem. d’août [email protected] . Mercredi (période scolaire) [email protected] (administratif et facturation) BOISSY . Petites et grandes vacances scolaires 7h30- 75 L’AILLERIE Fermeture : 11/2 semaine vacances 19h ABLEIGES : situé à l’école F. Vaudin de La Villeneuve St Martin 01 34 66 01 12 de noël et 3 semaines en août [email protected] 7h30- [email protected] (administratif et facturation) NUCOURT . Vacances : Mois de juillet 72 19h https://www.lespetitescanailles-site.fr/ . Mercredi (période scolaire) 14 COMMUNE DE COMMENY [email protected] . Vacances : celles de la Toussaint, 2j. à 8h- COMMENY (vacances) Mairie - 39 Grande rue - 95450 Commeny - 01 34 67 40 05 (Mairie) noël, vac. d’hiver et du printemps, dernière 18h30 30 Lieu d’accueil : 4 rue des écoles à Commeny - Tél. 01 34 67 42 34 sem. d’août (mercredi) . Mercredi (période scolaire) Structures gérées par : ASSOCIATION « LES LUTINS DU VEXIN » 7h30- CHARS . Vacances : 1ère sem. des vac. Toussaint, 40 http://www.lutinsduvexin.fr/ 19h Hiver et printemps et 3 sem. en juillet CHARS : Accueil de loisirs « Les tournesols » 7h30- HARAVILLIERS . Mercredi (période scolaire) 40 19h 2 rue des écoles - 95750 Chars 06 74 95 64 14 ou 01 34 42 06 39 [email protected] .