Plan De Prévention Des Risques Naturels De Glissement De Terrain
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne Dates D'ouverture De
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne Dates d'ouverture de la vendange 2020 - MARNE Crus Chardonnay Pinot noir Meunier ALLEMANT 24/08 22/08 22/08 AMBONNAY 22/08 20/08 20/08 ARCIS-LE-PONSART 24/08 24/08 24/08 AUBILLY 26/08 24/08 AVENAY-VAL-D'OR 24/08 20/08 20/08 AVIZE 25/08 (4) 25/08 (4) 25/08 (4) AY 20/08 20/08 20/08 BARBONNE-FAYEL 22/08 20/08 20/08 BASLIEUX-SOUS- 26/08 26/08 24/08 CHATILLON BASSU 23/08 24/08 22/08 BASSUET 21/08 24/08 20/08 BAYE 27/08 24/08 24/08 BEAUMONT-SUR-VESLE 24/08 24/08 24/08 BEAUNAY 22/08 22/08 20/08 BELVAL-SOUS-CHATILLON 28/08 26/08 24/08 BERGERES-LES-VERTUS 26/08 (4) 26/08 (4) 26/08 (4) BERGERES-SOUS- 27/08 24/08 24/08 MONTMIRAIL BERRU 26/08 24/08 24/08 BETHON 18/08 18/08 18/08 BEZANNES 24/08 BILLY-LE-GRAND 22/08 22/08 BINSON-ET-ORQUIGNY 21/08 20/08 20/08 BISSEUIL 20/08 20/08 20/08 BLIGNY 26/08 24/08 BOUILLY 28/08 26/08 26/08 BOULEUSE 24/08 24/08 22/08 BOURSAULT 25/08 24/08 24/08 BOUZY 22/08 20/08 20/08 BRANSCOURT 27/08 25/08 21/08 BRIMONT 24/08 18/08 18/08 BROUILLET 24/08 24/08 24/08 BROUSSY-LE-GRAND 22/08 20/08 BROYES 24/08 21/08 21/08 BRUGNY-VAUDANCOURT 28/08 26/08 24/08 CAUROY-L'HERMONVILLE 24/08 24/08 CERNAY-LES-REIMS 25/08 24/08 24/08 CHALONS-SUR-VESLE 24/08 24/08 CHAMBRECY 24/08 22/08 22/08 CHAMERY 26/08 24/08 21/08 CHAMPILLON 25/08 24/08 22/08 CHAMPLAT-BOUJACOURT 28/08 24/08 CHAMPVOISY 28/08 26/08 24/08 CHANGY 24/08 CHANTEMERLE 18/08 18/08 CHATILLON-S-MARNE 21/08 (3) 19/08 (3) 19/08 (3) CHAUMUZY 26/08 26/08 24/08 CHAVOT-COURCOURT 29/08 29/08 24/08 CHENAY 24/08 24/08 22/08 CHIGNY-LES-ROSES 24/08 -

Dates Des Vendanges 2015
Dates d'ouverture de la vendange 2015 Département de l'AISNE Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier AZY-SUR-MARNE 7/9 9/9 7/9 ETAMPES-SUR-MARNE 10/9 10/9 7/9 BARZY-SUR-MARNE 7/9 7/9 5/9 FOSSOY 11/9 10/9 7/9 BAULNE-EN-BRIE 12/9 14/9 11/9 GLAND 11/9 10/9 7/9 BEZU-LE-GUERY 8/9 9/9 8/9 JAULGONNE 11/9 10/9 7/9 BLESMES 11/9 7/9 MEZY-MOULINS 11/9 10/9 7/9 BONNEIL 7/9 9/9 7/9 MONTHUREL 14/9 12/9 10/9 BRASLES 11/9 10/9 7/9 MONTREUIL-AUX-LIONS 8/9 9/9 8/9 CELLES-LES-CONDE 10/9 10/9 10/9 MONT-SAINT-PERE 11/9 10/9 7/9 LA-CHAPELLE-MONTHODON 14/9 14/9 12/9 NESLES-LA-MONTAGNE 10/9 10/9 7/9 CHARLY-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 NOGENTEL 10/9 10/9 7/9 CHARTEVES 7/9 NOGENT-L'ARTAUD 8/9 CHATEAU-THIERRY 11/9 11/9 9/9 PASSY-SUR-MARNE 7/9 7/9 5/9 CHEZY-SUR-MARNE 10/9 10/9 7/9 PAVANT 7/9 8/9 7/9 CHIERRY 11/9 10/9 7/9 REUILLY-SAUVIGNY 10/9 7/9 CONNIGIS 14/9 12/9 10/9 ROMENY-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 COURTEMONT-VARENNES 11/9 10/9 7/9 SAINT-AGNAN 12/9 12/9 10/9 CREZANCY 11/9 10/9 7/9 SAULCHERY 7/9 8/9 7/9 CROUTTES-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 TRELOU-SUR-MARNE 7/9 11/9 7/9 DOMPTIN 7/9 8/9 7/9 VILLIERS-SAINT-DENIS 7/9 8/9 7/9 ESSOMES-SUR-MARNE 10/9 10/9 8/9 Département de l'AUBE Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier AILLEVILLE 3/9 3/9 3/9 FONTETTE 3/9 3/9 3/9 ARCONVILLE 4/9 4/9 4/9 FRAVAUX 4/9 4/9 4/9 ARGANCON 3/9 3/9 3/9 GYE-SUR-SEINE 3/9 3/9 3/9 ARRENTIERES 3/9 3/9 2/9 JAUCOURT 3/9 3/9 3/9 ARSONVAL 3/9 3/9 3/9 LANDREVILLE 3/9 3/9 3/9 AVIREY-LINGEY 4/9 2/9 2/9 LIGNOL-LE-CHATEAU 7/9 7/9 4/9 BAGNEUX-LA-FOSSE 6/9 (4) 4/9 (4) -

Archives Départementales De La Marne 2020 Commune Actuelle
Archives départementales de la Marne 2020 Commune actuelle Commune fusionnée et variante toponymique Hameau dépendant Observation changement de nom Ablancourt Amblancourt Saint-Martin-d'Ablois Ablois Saint-Martin-d'Amblois, Ablois-Saint-Martin Par décret du 13/10/1952, Ablois devient Saint-Martin d'Ablois Aigny Allemanche-Launay-et-Soyer Allemanche-Launay Allemanche et Launay Par décret du 26 septembre 1846, Allemanche-Launay absorbe Soyer et prend le nom d'Allemanche-Launay-et- Soyer Allemanche-Launay-et-Soyer Soyer Par décret du 26 septembre 1846, Allemanche-Launay absorbe Soyer et prend le nom d'Allemanche-Launay-et- Soyer Allemant Alliancelles Ambonnay Par arrêté du 12/12/2005 Ambonnay dépend de l'arrondissement d'Epernay Ambrières Ambrières et Hautefontaine Par arrêté du 17/12/1965, modification des limites territoriales et échange de parcelles entre la commune d'Ambrières et celle de Laneuville-au-Pont (Haute-Marne) Anglure Angluzelles-et-Courcelles Angluzelle, Courcelles et Angluselle Anthenay Aougny Ogny Arcis-le-Ponsart Argers Arrigny Par décrets des 11/05/1883 et 03/11/1883 Arrigny annexe des portions de territoire de la commune de Larzicourt Arzillières-Neuville Arzillières Par arrêté préfectoral du 05/06/1973, Arzillières annexe Neuville-sous-Arzillières sous le nom de Arzillières-Neuville Arzillières-Neuville Neuville-sous-Arzillières Par arrêté préfectoral du 05/06/1973, Arzillières annexe Neuville-sous-Arzillières sous le nom de Arzillières-Neuville Athis Aubérive Aubilly Aulnay-l'Aître Aulnay-sur-Marne Auménancourt Auménancourt-le-Grand Par arrêté du 22/11/1966, Auménancourt-le-Grand absorbe Auménancourt-le-Petit et prend le nom d'Auménancourt Auménancourt Auménancourt-le-Petit Par arrêté du 22/11/1966, Auménancourt-le-Grand absorbe Auménancourt-le-Petit et prend le nom d'Auménancourt Auve Avenay-Val-d'Or Avenay Par décret du 28/05/1951, Avenay prend le nom d'Avenay- Val-d'Or. -

CC Des Paysages De La Champagne
Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier Saint-Martin-d'Ablois, Le Baizil, Bannay, Baslieux-sous-Châtillon, Baye, Beaunay, CC des Paysages Belval-sous-Châtillon, Binson-et-Orquigny, Boursault, Le Breuil, La Caure, Champaubert, Champlat-et-Boujacourt, Champvoisy, La Chapelle-sous-Orbais, Châtillon-sur-Marne, Coizard-Joches, Congy, Cormoyeux, Corribert, Courjeonnet, Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, Étoges, Fèrebrianges, Festigny, Fleury-la- de la Champagne Rivière, Igny-Comblizy, Leuvrigny, Mareuil-en-Brie, Mareuil-le-Port, Margny, Montmort-Lucy, Nesle-le-Repons, La Neuville-aux-Larris, ?uilly, Orbais-l'Abbaye, Passy-Grigny, Reuil, Romery, Sainte-Gemme, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Troissy, Vandières, Vauciennes, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, La Ville- sous-Orbais, Villevenard, Vincelles 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC des Paysages de la Champagne Périmètre Communes membres 01/2019 54 ( Marne : 54) Surface de l'EPCI (km²) 593,88 Dépt Marne Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 36 Poids dans la ZE Épernay*(99,2%) Reims(0,8%) ZE 47 Pop EPCI dans la ZE Épernay(19,6%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 21 649 2016 21 503 Évolution 2006 - 2011 64 hab/an Évolution 2011 - 2016 -29 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Dormans 2 922 13,6% Damery 1 444 6,7% 0 Saint-Martin-d'Ablois 1 438 6,7% Mareuil-le-Port 1 179 -

Tableaux RPQS
Année 2019 Année 2019 Rapport AnnuelAnnée sur 2019 le Prix et la Qualité du Service Eau Potable Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’Eau potable Année 2019 Table des matières I. Introduction ............................................................................................................................................3 I.1. Définition du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’Eau Potable (RPQS) ..3 I.2. Présentation de la CCPC ..................................................................................................................4 I.3. Périmètre d’activité et mode de gestion .........................................................................................6 I.4. Ressources en eau exploitées sur le territoire de la CCPC ..............................................................7 II. Indicateurs descriptifs du service .............................................................................................................9 II.1. Nombre d’habitants desservis (D101.0) ..........................................................................................9 II.2. Nombre d’abonnements (VP.056) ............................................................................................... 10 II.3. Linéaire de réseaux de desserte hors branchements (VP.077) .................................................... 11 II.4. Prix du service de l’eau TTC (D102.0) ........................................................................................... 12 III. Indicateurs -

Les Documents De Mémorialgenweb LES NÉCROPOLES NATIONALES
Les documents de MémorialGenWeb LES NÉCROPOLES NATIONALES DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE Par Alain Girod Ossuaire de « La Gruerie », Vienne-le-Château (51) AUBERIVE Accès au relevé Créée en 1920. Le Bois du Puits située à l'est de la ville de Reims sur la RD 31. Rassemble les corps de 6553 soldats français de la Première Guerre Mondiale et les corps de 385 soldats polonais dont 256 de la seconde Guerre Mondiale, décédés dans le Nord-Est de la France. L'ossuaire regroupe 2908 corps. Les corps proviennent des cimetières de guerre de La Voie Romaine E. de Moscou Village Gascon d'Estival Mont sans Nom Mont Blond Mont Haut Mont Cornillet Mont du Casque Mont Téton Bois Sacré Bois Liévin Bois de la Chapelle Bois du Puits. Présence de deux monuments aux Polonais des Première et Deuxième Guerre Mondiale. Mitoyen d'un cimetière militaire allemand. Batailles de Champagne 1915 bataille du Chesne juillet-octobre 1918. BLIGNY Accès au relevé Créée en 1918. La Croix Ferlin située au nord-ouest d'Epernay, sur la RD 380. Rassemble les corps de 4651 soldats français de la première Guerre Mondiale et de 3 soldats russes dont 2 de la seconde Guerre Mondiale L'ossuaire regroupe 2506 corps de 14/18. Les corps proviennent des cimetières de guerre de Romigny Bligny Bouilly Sacy Champigny Ville-Domange Bouleuse Courmas Savigny sur Ardres Pargny lès Reims Lagery Ciourville Saint Gilles Saint Euphraise Tramery Lhéry Vrigny Poilly Aubilly Ville en Tardenois. Mitoyen d'un cimetière militaire allemand. Bataille de l'aisne septembre octobre 1914 deuxième bataille de la Marne juillet 1918 bataille de l'Ailette mai septembre 1918. -
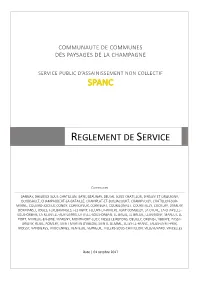
Règlement De Service Du SPANC
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SPANC REGLEMENT DE SERVICE Communes BANNAY, BASLIEUX-SOUS-CHATILLON, BAYE, BEAUNAY, BELVAL-SOUS-CHATILLON, BINSON-ET-ORQUIGNY, BOURSAULT, CHAMPAUBERT-LA-BATAILLE, CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT, CHAMPVOISY, CHATILLON-SUR- MARNE, COIZARD-JOCHES, CONGY, CORMOYEUX, CORRIBERT, COURJEONNET, COURTHIEZY, CUCHERY, DAMERY, DORMANS, ETOGES, FEREBRIANGES, FESTIGNY, FLEURY-LA-RIVIERE, IGNY COMBLIZY, LA CAURE, LA CHAPELLE- SOUS-ORBAIS, LA NEUVILLE-AUX-LARRIS, LA VILLE-SOUS-ORBAIS, LE BAIZIL, LE BREUIL, LEUVRIGNY, MAREUIL LE PORT, MAREUIL-EN-BRIE, MARGNY, MONTMORT-LUCY, NESLE LE REPONS, OEUILLY, ORBAIS-L'ABBAYE, PASSY- GRIGNY, REUIL, ROMERY, SAINT MARTIN D'ABLOIS, SAINTE GEMME, SUIZY-LE-FRANC, TALUS-SAINT-PRIX, TROISSY, VANDIERES, VAUCIENNES, VENTEUIL, VERNEUIL, VILLERS-SOUS-CHATILLON, VILLEVENARD, VINCELLES Date | 01 octob re 2017 SPANC CCPC 2 Règlement de service Table des matières PREAMBULE .............................................................................................................................................. 3 PARTIE 1. DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................... 4 ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT .................................................................................................................4 ARTICLE 2 : CHAMP D ’APPLICATION TERRITORIAL ...............................................................................................4 ARTICLE -

Commune De ROMERY COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de ROMERY COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 16 OCTOBRE 2018 Absents excusés: Carine GOBERT, Sébastien TRIBAUT Secrétaire de séance : Karine LECLERE Lecture et approbation des derniers Conseils Municipaux Lors de la Réunion du Conseil Municipal du 16 octobre 2018, les questions suivantes ont été débattues : Lecture et approbation des derniers Conseils Municipaux Participation de la commune aux travaux d’aménagement de la voirie « rue de l’église » Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis concernant les travaux d’aménagement de la voirie pour la « rue de l’église ». Ces travaux seront engagés par la CCPC mais une partie de ces travaux restera à la charge de la commune (réalisation d’un escalier +pose de pavés). Le montant estimatif total du cout à charge de la commune s’élève à environ 12 000 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : - D’accepter de prendre en charge la part des travaux revenant à la commune - D’autoriser le maire à signer tous les documents en rapport avec ces travaux. Constitution d’un groupement de commande pour les prestations de maintenance, vérification et fourniture d’extincteurs, entre la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne et certaines de ses Communes membres Vu l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, Vu la délibération de la Communauté de communes des Paysages de la Champagne n° 18-034 en date du 12 février 2018 ayant pour objet la constitution d’un groupement de commande pour la maintenance des extincteurs. -

Dormans Info N°4 – Juillet 2009
N°04 JUILLET 2009 Dormansmagazineinfo LE MÉMORIAL un éternel Rempart contre l’Oubli et un site touristique en devenir Dormanswww.dormans.fr Info • NOVEMBRE 2008 2 SOMMAIRE EDITO info Dormans magazine Sommaire 3 Edito Football 4 Informations pratiques 5 Tourisme 6 Urbanisme 7 Sapeurs Pompiers 8-9 Scolaire 10-11 SNCF 12 Commerce 13 Culture 14-15 Hommages Etat-civil 16 Concours de pétanque Votre bulletin municipal est en ligne Vous pouvez désormais consulter ou télécharger votre bulletin municipal directement sur le site internet de la commune www.dormans.fr Dormans info • JUILLET 2009 Dormans info • JUILLET 2009 EDITO 3 EDITO es travaux dans la commune vont bon train et même si cela provoque Lquelques désagréments, nous n’allons pas nous en plaindre. Ainsi, alors que la construction de la cantine de l’école maternelle se termine, la caserne des Sapeurs Pompiers va sortir de terre. Dans le domaine de l’habitat, le lotissement des Cèdres porté par le Toit Champenois est prêt à la commercialisation, tandis qu’une nouvelle phase d’extension des Quartiers prend forme, sous maîtrise d’ouvrage de Christian BRUYEN la commune. Maire de Dormans Vice-Président Les travaux de réfection de voirie, portés par la Communauté de du Conseil Général Communes et largement financés par le Conseil Général, ont commencé et amènent quelques difficultés de circulation. D’autant que dans le même temps, le remplacement des branchements plomb sur le réseau eau potable est entrepris dans la rue principale. Merci à toutes et tous pour votre compréhension et votre patience. LE SCD MONTE EN 1ère SÉRIE MARNE ravo aux joueurs du Sporting Club Bde Dormans qui permettent à l’équipe fanion de retrouver la 1ère série départementale. -
From the Kitchen
FROM THE KITCHEN All fries served with housemade champagne aoili. Additional orders of aoli will incur a charge of $1.00. DUCK FAT FRIES A M PA G Tossed with truffe salt and servedH with champagne aioliN E Regular | $8 C Large | $15 PESTO FRIES Tossed with housemade pesto, balsamic reduction drizzle, and topped with shaved parmigiano reggiano Family Size | $18 BALLER FRIES These take our regular duck fat fries to a whole other level! Duck fat truffe fries drizzled with champagne aioli and creme fraiche, topped with a soft boiled egg, fresh chopped avocado, chives, fried prosciutto, and a dollop of caviar. Family Size | $25 OYSTERS IN THE HALF SHELL* Served with champagne mignonette sauce and lemon wedge Half Dozen | $20 B Dozen | $36 R U B A CHEESE BOARDSH B L E S B Served with baguette, almond nuts & fg jam 3 Cheeses | $15 - 5 Cheeses | $19 - 7 Cheeses | $24 RUSTIC WHITE BEAN CROSTINI | $14 Seasoned white beans tossed with a blend of carrots, cellary, and onions topped fried sage on house made crostini OLIVES | $8 Pitted olives, marinated with herbs & red wine CHARCUTERIE & CHEESE BOARD | $21 CROQUE MONSIEUR | $13 French sandwich of grilled french ham, gruyere cheese, with champagne apple honey sauce - Add a sunnyside up egg for + $2 CAVIAR* 30g 50g Classic Sturgeon $40 $60 Supreme Sturgeon $65 $95 Served with choice of gluten free crackers or chips and crème fraiche with chives WILD MUSHROOM & ARUGULA SALAD | $12 With shaved fennel, parmigiano reggiano, crushed almond nuts, tossed with champagne vinaigrette AVOCADO TOAST WITH SOFT BOILED EGG* | $12 With Caviar | $12 Seasoned with truffe salt & fresh ground pepper CHOCOLATE MOUSSE | $12 STRAWBERRY RICOTTA CHEESECAKE | $12 *CONTAIN (or may contain) raw or undercooked ingredients. -

Ecole Maternelle Des Erables... Une
N°02 JANVIER 2009 Dormansmagazine info ECOLE MATERNELLE DES ERABLES... UNE RENOVATION REUSSIE ! Dormanswww.dormans.fr Info • NOVEMBRE 2008 2 SOMMAIRE info Dormans magazine Sommaire 3 Recensement 4-7 Affaires scolaires 8-10 Commerce 11 Brèves 12 Culture 13 Sport 14-15 Hommages Etat-civil 16 Agenda BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2009 Le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel communal vous adressent leurs meilleurs Voeux. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bien-être et réussite dans vos projets. Dormans info • JANVIER 2009 Dormans info • JANVIER 2009 RECENSEMENT 3 RECENSEMENT es chiffres du recensement de la population font apparaître une diminution de population par rapport à 1999. Ce n’est pas à proprement parler une Lsurprise car l’enquête date de janvier 2005 et ne prend pas en compte certains projets d’urbanisme aujourd’hui aboutis. Néanmoins, cette tendance doit nous conduire à redoubler d’efforts pour renforcer notre capacité d’accueil de nouveaux habitants. Heureusement, à l’échelle du bassin de vie, les résultats sont plus satisfaisants et tiennent à la croissance retrouvée des communes de moins de 2000 habitants, Christian BRUYEN qui témoigne d’un renouveau démographique dans nos campagnes. Maire de Dormans Vice-Président Un phénomène rendu possible grâce aussi au dynamisme économique et à du Conseil Général l’attractivité du pôle intermédiaire que représente Dormans au coeur de notre vallée champenoise. L’enjeu des prochaines années sera bien de profiter de tous nos atouts et en particulier du potentiel que nous confère -

Compétences Marne
Communes du departement de la Marne en A Ablancourt Aigny Allemanche-Launay-et-Soyer Allemant Alliancelles Ambonnay Ambrières Anglure Angluzelles-et-Courcelles Anthenay Aougny Arcis-le-Ponsart Argers Arrigny Arzillières-Neuville Athis Aubérive Aubilly Aulnay-l'Aître Aulnay-sur-Marne Auménancourt Auve Avenay-Val-d'Or Avize Ay Communes du departement de la Marne en B Baconnes Bagneux Bannay Bannes Barbonne-Fayel Baslieux-lès-Fismes Baslieux-sous-Châtillon Bassu Bassuet Baudement Baye Bazancourt Beaumont-sur-Vesle Beaunay Beine-Nauroy Belval-en-Argonne Belval-sous-Châtillon Bergères-lès-Vertus Bergères-sous-Montmirail Berméricourt Berru Berzieux Bétheniville Bétheny Bethon Bettancourt-la-Longue Bezannes Bignicourt-sur-Marne Bignicourt-sur-Saulx Billy-le-Grand Binarville Binson-et-Orquigny Bisseuil Blacy Blaise-sous-Arzillières Blesme Bligny Boissy-le-Repos Bouchy-Saint-Genest Bouilly Bouleuse Boult-sur-Suippe Bourgogne Boursault Bouvancourt Bouy Bouzy Brandonvillers Branscourt Braux-Saint-Remy Braux-Sainte-Cohière Bréban Breuil Breuvery-sur-Coole Brimont Brouillet Broussy-le-Grand Broussy-le-Petit Broyes Brugny-Vaudancourt Brusson Bussy-le-Château Bussy-le-Repos Bussy-Lettrée Communes du departement de la Marne en C Caurel Cauroy-lès-Hermonville Cernay-en-Dormois Cernay-lès-Reims Cernon Chaintrix-Bierges Châlons-en-Champagne Châlons-sur-Vesle Chaltrait Chambrecy Chamery Champaubert Champfleury Champguyon Champigneul-Champagne Champigny Champillon Champlat-et-Boujacourt Champvoisy Changy Chantemerle Chapelaine Charleville Charmont Châtelraould-Saint-Louvent