Quelques Repères Sur Gavray (Du Xie Au Xixe Siècle)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jeu-Concours Participez À Notre Jeu-Concours Et Gagnez Un Week-End Pour Deux Personnes Dans La Ville Du Havre ! Rendez-Vous À L’Office De Tourisme Pour Participer !
Coutances ays de P Canton de Montmartin-sur-MerJeu-concours Participez à notre jeu-concours et gagnez un week-end pour deux personnes dans la ville du Havre ! Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour participer ! L’Office de Tourisme du canton de Montmartin-sur-Mer, organisateur de cette deuxième édition de la Fête de la Gastronomie, tient à remercier ses nombreux partenaires pour leur aide technique et/ou financière : Fleurs en scène, la boulangerie Joret, Carrefour Contact, Diminu…tif à Montmartin-sur-Mer, la boulangerie « Au bon pain d’autrefois » de Jean Claude Lengronne à Lingreville et l’ostréiculteur André Rucinski à Hauteville- sur-Mer ainsi que l’Office de Tourisme de l’agglomération havraise, France Bleu Cotentin. •••••• Renseignements & réservations •••••• Office de Tourisme du canton de Montmartin-sur-Mer«« 30 avenue de l’Aumesle 02 33 50 38 95 50590 Hauteville-sur-Mer Tél. 02.33.47.51.80 www.otcm.fr [email protected] sur le canto Pour toutes ces animations, renseignements et réservations conseillés. n Tous droits réservés. Copie et/ou reproduction interdites. Tous 02 33 50 38 95 er de Montmartin-Sur-M COMM UNA UTE DE COMM UNE S la manche pays de coutances la manche pays de coutances DU CANTON DE MONTMARTIN SUR MER 3 journées gourmandes sur le canton de Montmartin-sur-Mer LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE 2013 Un rendez-vous gourmand vous est donné pour célébrer la Fête de la Gastronomie. L’Office de Tourisme du canton de Montmartin-sur-Mer vous propose un programme alléchant DIMANCHE 22 SEPTEMBRE pour les enfants et les familles. -

204 J / … - Fonds Michel LE PESANT (Suite)
204 J / … - Fonds Michel LE PESANT (suite). Inventaire succinct des archives de M. Michel LE PESANT, versées par sa femme et son fils le 22 mai 2001. Etat du classement au 30 juillet 2001. PREMIèRE PARTIE : 19 boîtes de couleur bordeaux, anneau sur le devant : 204 J 128 : « 1 – Famille Le Pesant ». Rouge : Famille Le Pesant ; alliance Le Dey, Piffaud, Yvinec. Courrier, copie d’actes, faire-part ; descendance Thomas Le Pesant (1666-1741) – Charlotte Hurel. Rose : Alliances côté Le Pesant. Gabriel LP, Albert LP, famille Bouvattier, Robin-Prévallée… Bleu : Pierre Marie LP (baccalauréat, conseil de révision). Généalogie A. J. Le Pesant (né 1833). Analyse du chartrier Jacqueline LP. Inventaire après le décès de Jacques Hervez LP, 1929. Répertoire du chartrier LP, 203 J. 204 J 129 : « 2 – Famille Le Pesant ». Rouge : Famille Le Pesant – Gouisserie. Faire-part, copie d’actes… Bulle : Inventaire après le décès d’Albert Jacques LP, 1893. Rouge : Jacque – Hervez LP. Contrat de mariage, 1912. Faire-part. Baccalauréat ès-lettres1892, en droit 1896, licence en droit 1897. Carte d’électeur 1928, carte d’alimentation 1916, permis de chasse 1912 et 1913, contrat d’assurance 1912. Certificat de bonne conduite au 103 e Rgt d’Infanterie 1894. Abonnement à l’octroi de Coutances 1912. Lettres à son fils 1882, à Mlle Cousin 1890 et 1893. Livret de famille 1913 (duplicata), carte de réduction chemins de fer 1928. 204 J 130 : « 3 – Famille Le Pesant ». Rouge : Michel LP. Bulle : situation militaire : Père Cent 1938, livret militaire 1935, détail des services 1954, services militaires (1973). Démobilisé, libéré, rapatrié. Bulle : Etat-civil, contrat de mariage, passeport 1970. -
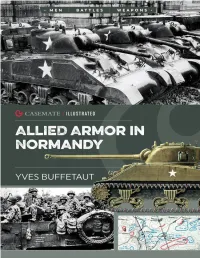
Allied Armor in Normandy Allied Armor in Normandy
ALLIED ARMOR IN NORMANDY ALLIED ARMOR IN NORMANDY YVES BUFFETAUT An unusually idyllic view of the landings: the LCTS have come close to shore on calm seas with no German opposition. This photograph was not taken on the Normandy coasts on June 6, in NNW force 6 winds, but in England, during a large-scale rehearsal. Contents page image: British Sherman crews waiting to embark. Shoreham and Portsmouth were the main embarkation ports for the British, while the Americans could be found farther west, notably at Portland, which served the 1st U.S. Infantry Division, and Torquay and Dartmouth, which served the 4th U.S. Infantry Division. (IWM H 38986) Contents page map: August 6, 1944, HQ Twelfth Army Group situation map. (Library of Congress, Geography and Map Division) CIS0004 Print Edition: ISBN 978-1-61200-6079 Digital Edition: ISBN 978-1-61200-6086 Kindle Edition: ISBN 978-1-61200-6086 This book is published in cooperation with and under license from Sophia Histoire & Collections. Originally published in French as Militaria Hors-Serie No 52, © Histoire & Collections 2004 Typeset, design and additional material © Casemate Publishers 2018 Translation by Hannah McAdams Design by Paul Hewitt, Battlefield Design Color illustrations by Jean Restayn © Histoire & Collections Infographics by Jean-Marie Mongin © Histoire & Collections Photo retouching and separations by Remy Spezzano Additional text by Chris Cocks CASEMATE PUBLISHERS (US) Telephone (610) 853-9131 Fax (610) 853-9146 Email: [email protected] www.casematepublishers.com CASEMATE -

COMMUNES En Zone Vulnérable
COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable COMMUNES en zone vulnérable AGNEAUX CHEVRY LA-GODEFROY MONTBRAY SAINT-CYR-DU-BAILLEUL SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE AGON-COUTAINVILLE CONDE-SUR-VIRE LA-GOHANNIERE MONTCHATON SAINT-DENIS-LE-GAST* SAINTENY AIREL CONTRIERES* LA-HAYE-PESNEL MONTCUIT* SAINT-EBREMOND-DE-BONFOSSE SARTILLY ANCTEVILLE COULOUVRAY-BOISBENATRE LA-LANDE-D'AIROU MONTFARVILLE SAINT-FROMOND SAUSSEY* ANGEY COURTILS LA-LUCERNE-D'OUTREMER MONTHUCHON SAINT-GEORGES-D'ELLE SAVIGNY-LE-VIEUX ANNEVILLE-EN-SAIRE COUVAINS LA-LUZERNE MONTJOIE-SAINT-MARTIN SAINT-GEORGES-DE-BOHON SERVIGNY ANNEVILLE-SUR-MER COUVILLE* LA-MANCELLIERE-SUR-VIRE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE SERVON ARGOUGES CREANCES LA-MEAUFFE MONTMARTIN-SUR-MER* SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE SIDEVILLE AUCEY-LA-PLAINE CROLLON LA-MEURDRAQUIERE* MONTRABOT SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY SOTTEVILLE* AUVERS CUVES LA-MOUCHE MONTSURVENT SAINT-GEORGES-MONTCOCQ SOULLES AUXAIS DANGY LA-ROCHELLE-NORMANDE MONTVIRON SAINT-GERMAIN-D'ELLE SOURDEVAL AVRANCHES DENNEVILLE LA-RONDE-HAYE MOON-SUR-ELLE SAINT-GERMAIN-SUR-AY SOURDEVAL-LES-BOIS BACILLY DOMJEAN LA-TRINITE MORIGNY SAINT-GERMAIN-SUR-SEVES SUBLIGNY BARENTON DONVILLE-LES-BAINS LA-VENDELEE MORTAIN SAINT-GILLES SURVILLE BARFLEUR DRAGEY-RONTHON LAMBERVILLE MOULINES SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET TANIS BARNEVILLE-CARTERET DUCEY LAPENTY MOYON SAINT-HILAIRE-PETITVILLE TESSY-SUR-VIRE BAUDRE EQUILLY LE-CHEFRESNE MUNEVILLE-LE-BINGARD SAINT-JAMES TEURTHEVILLE-HAGUE* -

Statuts-MN AP-30-12-2020.Pdf
ANNEXE I LISTE DES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMERIQUE 1) Au titre de la compétence « Aménagement numérique du territoire » Le département de la Manche Les Communautés d’Agglomérations : − Le Cotentin − Mont-Saint-Michel-Normandie − Saint-Lô Agglo Les Communautés de communes de l’arrondissement d’Avranches − Granville, Terre et Mer Les Communautés de communes de l’arrondissement de Coutances − Coutances, Mer et Bocage − Côte Ouest Centre Manche Les Communautés de communes de l’arrondissement de Saint-Lô − Baie du Cotentin − Villedieu Intercom Statuts de Manche Numérique Annexe 1 – 11-12-2020 1 / 5 2) Au titre de la compétence « Services Numériques » Les départements − Conseil départemental de Seine-Maritime (76) − Conseil départemental du Calvados (14) − Conseil départemental de la Sarthe (72) Les Communautés d’Agglomérations − Le Cotentin (en substitution des anciennes communautés de la Côte des Isles, du Canton de Saint-Pierre-Eglise, des Pieux, de Douve et Divette, de la Région de Montebourg, du Val de Saire, de la Vallée de l'Ouve et de La Saire). − Mont-Saint-Michel-Normandie − Saint-Lô Agglo (en substitution de l’ancienne Communauté de Canisy et pour l’ensemble des communes membres de l’ex communauté de communes de Canisy) Les communautés de communes de l’arrondissement d’Avranches − Granville, Terre et Mer ) Les communautés de communes de l’arrondissement de Coutances − Coutances, Mer et Bocage − Côte Ouest Centre Manche Les communautés de communes de l’arrondissement de Saint-Lô − Baie du Cotentin (en substitution de l’ancienne -

Publicité Des Demandes D'autorisation D'exploiter Pour Une
Publicité des demandes d'autorisation d'exploiter 15/06/2017 pour une mise en valeur agricole enregistrées par la DDTM de la Manche Date Date limite no enregistre Référence cadastrales Superficie de dépôt Demandeur Adresse demandeur Localisation biens demandés Propriétaire Adresse propriétaire interne ment parcelles demandées (ha) demande demande concurrente EARL La Marelle 5017356 02/06/2017 (changement de statut) Sacey MONTANEL, SACEY, ANTRAIN 28,03 Sans objet EARL La Marelle 5017358 02/06/2017 (changement de statut) Sacey MONTANEL, SACEY 16,86 Sans objet 5 route Gravier 50390 St Sauveur 5017359 02/06/2017 EARL Vimond Lefaix Saint Sauveur le Vicomte NEHOU A-66-394-419 3,07 Francis SOREL le Vicomte 15/08/2017 A-24-25-114-116-125- 383-132-131, 111 à 113, 117 à 121, 123- 55, Le Lude 50390 St Sauvuer le 5017359 02/06/2017 EARL Vimond Lefaix Saint Sauveur le Vicomte SAINT SAUVEUR LE VICOMTE 124-136-149 39,22 René LE MAROIS Vicomte 15/08/2017 G-227-323, 326 à 330, 5017360 02/06/2017 Gilles LENGRONNE Hudimesnil HUDIMESNIL 693 6,59 Jean TURGIS Annoville 15/08/2017 5017360 02/06/2017 Gilles LENGRONNE Hudimesnil HUDIMESNIL D-132 2,70 Frédéric ROUSSIN Roully 50510 Hudimesnil 15/08/2017 5017360 02/06/2017 Gilles LENGRONNE Hudimesnil BRICQUEVILLE LA BLOUETTE ZE-39 1,48 Norbert LENGRONNE 50510 Hudimesnil 15/08/2017 5017360 02/06/2017 Gilles LENGRONNE Hudimesnil BRICQUEVILLE LA BLOUETTE ZE-40 0,95 Thérèse LENGRONNE Tourville sur Sienne 15/08/2017 5017360 02/06/2017 Gilles LENGRONNE Hudimesnil BREHAL ZE-34 0,70 Jean-Pierre GODEFROY Villechabut 23380 -

14-La-Voix-Le-Bocage (Page 1)
Votre hebdomadaire dans le Calvados apa Seulles Cheux La Ronde- Le Mesnil- Saint- Longraye Saint-Michel- Le sur-Lozon La La Juvigny- Verson Haye Mesnilbus Rouxelin Georges-d'Elle Litteau Torteval- de-la-Pierre Chapelle- Luzerne Quesnay sur-Seulles en-Juger Foulognes Hottot-les- Tessel Mouen Saint-Sauveur- Saint-André- Eterville Hauteville- Saint-Georges- de-l'Epine Bérigny Bagues Vendes Mondrainville la-Guichard Sainte-Honorine- Lendelin Hébécrevon Montcocq Saint-Vaast- Grainville- Tourville- Montcuit Cormolain de-Ducy sur-Odon Fontaine- Saint-Pierre- Saint- sur-Seulles sur-Odon ncteville Marigny Le de-Semilly Etoupefour La Voix - Le Bocage Agneaux Germain-d'Elle Noyers- Mesnil- Saint-Germain- Baron- Maltot Amey SAINT- Sallen d'Ectot Monts- Bocage sur-Odon Cambernon La Barre- Notre-Dame- en-Bessin Monthuchon Le Lorey de-Semilly Livry Missy d'Elle Gavrus Vendelée Saint-Gilles LO Caumont- Villy- Esquay- Parution : jeudi Camprond Montrabot l'Eventé Anctoville Bocage Bougy Notre- Vieux Feug Le Locheur Dame Canisy Saint- Baudre Saint-Jean- Rouxeville Vidouville La Vacquerie Saint-Louet- Tournay- Cametours Ebremond- des-Baisants sur-Seulles sur-Odon Amayé- de-Bonfossé Sainte- La Lande- Evrecy sur-Orne Quibou Suzanne- Précorbin Amayé- Parfouru- Avenay Belval Carantilly Lamberville sur-Drôme sur-Odon UTANCES Savigny Gourfaleur sur-Vire sur-Seulles Villers- Vacognes- Clinch Landes- sur- Courcy Biéville Tracy- Neuilly e- La Mancellière- Sept-Vents Bocage sur-Ajon Maizet e Saint- Cahagnes Bocage sur-Vire Epinay- Sainte-Honorine- aint-Pierre- Samson- -

Consulter Le Bulletin Hiver 2009
- 3 - Sommaire Edito Il y a différentes sortes de communes … celles où l’on Le commerce de proximité: travaille, celles où l’on habite, un atout pour Lingreville p4 celles que l’on fréquente pour ses études, ses achats, ses loisirs, et sans être en contra- diction avec ces différents types d’activités, celles où l’on A la rencontre de nos vit. C’est-à-dire celles où toutes ces activités commerçants p5 sont réunies, ce qui permet une vie sociale plus riche et plus harmonieuse. Je pense que vous serez de mon avis, Lingreville fait partie de cette dernière catégorie. Le marché de Lingreville; un marché de proximité p9 Le travail réalisé par tous ceux qui ont construit ce bulletin vous fera découvrir plus en profondeur la richesse du patrimoine commer- cial de la commune, un nouvel épisode de son passé, la vie des associations et de l’école, une Lingreville d’antan p11 page pratique pour améliorer notre démarche citoyenne dans la gestion des déchets, ainsi qu’une rétrospection sur l’année 2008. La vie des associations p13 Après avoir parcouru ce bulletin, j’en suis convaincu, vous vous sentirez un peu plus Lingremais ou Lingremaise. Tourisme p16 Votre Maire, Jean-Benoît RAULT Lingreville et nos enfants p17 Le mot de la commission « communication » Les Lingremais ont du talent p18 Voici votre deuxième bulletin. Le conseil municipal ayant souhaité consacrer une large part de ce bulletin au commerce de Lingreville, nous avons été à la rencontre de nos commerçants. Vous y découvrirez qui ils sont ainsi que l’étendue et la qualité des produits et services qu’ils proposent. -

Gavray 1940 À 1944
GAVRAY 1940 à 1944 Robert Pouchin, à l’aide des notes personnelles d’Antoinette Cardinal nous fait revivre l’occupation et la libération de Gavray. Manche Libre d’octobre à décembre 1984. De Juin 1940 à 1944 Occupation allemande La coexistence se fit au mieux avec les Allemands installés dans la « Kommemdantur » au Clos Michel , les écoles furent réquisitionnées pour loger les troupes, la classe se faisant ensuite dans différentes maisons chez les particuliers. Peu d’événements majeurs nous ont été relatés pour la période des quatre années de l’occupation, sinon un fait important, mais ne concernant pas la population, c’est l’odyssée malheureuse d’ un jeune soldat polonais de 17 ans, incorporé de force dans l’armée allemande qui voulait revoir sa mère. Il déserta, fut retrouvé, jugé et condamné à mort après avoir été dégradé, et c’est en cortège dans le bourg, musique en tête, le pauvre condamné alla au lieu de son supplice portant sur son épaule le poteau devant lequel attaché il fut fusillé à la « Parquerie ». Le corps fut mis dans un sac et, sur une charrette, amené au cimetière où il fut enterré. Émile Jamet racontait, avec son accent roulant les R, avoir assisté à la Baleine à une scène identique. Le jeune soldat était parti rejoindre sa fiancée sans permission. A son retour il fut déclaré déserteur et condamné à mort. Toute la troupe en garnison à Saint-Lo et Granville, rangée comme sur une Place d’Armes, était rassemblée dans un champ de la « Blanquerie » ou à proximité. Çà ne rigolait pas avec la discipline dans l’armée allemande. -

TERRITOIRE MAIA CENTRE MANCHE Répartition Géographique D'interventions Des SSIAD
Créée le 24/09/2018 TERRITOIRE MAIA CENTRE MANCHE Répartition géographique d'interventions des SSIAD Ravenoville - ain m er lle -G vi St rre Sainte Mère Eglise Va e- e- n-d Neuville- d rti e Ma vill au-Plain St- rre 30 places PA Va e vill ou ud ert A ub Ste-Mère-Eglise -H Turqueville -la Ste-Marie-du-Mont Boutteville Picauville Sébeville Portbail Carquebut 44 places PA Blosville Hiesville Canville- la-Rocque Beuzeville- Liesville- Vierville Brucheville la-Bastille sur-Douve St-Sauveur- Doville Varenguebec de-Pierrepont St-Nicolas- Appeville Carentan les marais Denneville de-Pierrepont Carentan Neufmesnil Montsenelle 30 places PA Baupte Catz St-Hilaire- La Haye Auvers Petitville Le Plessis-Lastelle Méautis Bretteville-sur-Ay Gorges Montmartin-en-Graignes Laulne Pont Hébert Vesly St-Germain-sur-Ay Nay 42 places PA Terre-et-Marais Graignes Lessay Gonfreville St-André- St-Patrice- de-Bohon de-Claids St-Jean- St-Germain- Le Mesnil- de-Daye Véneron sur-Sèves Auxais Le Mesnil- Angot St-Fromond Créances Raids Le Dézert St- Tribehou Airel Périers Sébastien- Périers Moon-sur-Elle de-Raids Millières Marchésieux 70 places PA Le Cavigny Hommet- St-Jean- d'Arthenay St-Clair- de-Savigny Cerisy-la-Forêt La Feuillie Remilly- sur-l'Elle Pirou St-Martin-d'Aubigny les-Marais Vaudrimesnil Le La Meauffe Mesnil- Pont-Hébert St-Aubin- Eury Amigny Villiers-Fossard Couvains du-Perron Feugères Muneville-le-Bingard Le Mesnilbus Rampan Le Geffosses St-Michel- Montreuil- Mesnil- La St-Georges- La de-la-Pierre Rouxelin d'Elle Anneville- sur- Luzerne Ronde- St-Georges- -

Catalogue 2021
Liste des éleveurs Earl des Rousses Flottemanville – La Hague EARL de la Campagnette La Hague Jean-Marc Laumonier Montreuil sur Lozon Régine Ledoux Coutances Earl de Turgisière Savigny Éric Lengronne Coutances Laurence Duroy Milly Réné Hamel Gaec Aquitaine Grandparigny Lapenty Pôle Allaitant de la Manche – 06 83 60 04 63 - 02 33 06 49 98 Pour tous vos achat de bovins, pensez sanitaire Lors de l’introduction de bovins, des analyses sanitaires doivent être réalisées dans leur intégralité afin de ne pas hypothéquer l’avenir de son élevage par une omission qui peut sembler mineure mais s’avérer catastrophique. Toujours privilégier les analyses avant l’achat, si elles sont faites après l’introduction du bovin sur l’exploitation, il doit être isolé jusqu’aux résultats des analyses. Quoi Qui Quand raea Pour tous les bovins provenant d’un Sérologie 15 jours avant le cheptel vendeur non indemne d’IBR départ de l’animaux IBR Pour tous les bovins provenant d’un - Sérologie 15 à 30 jours après cheptel vendeur indemne d’IBR l’arrivée du bovin - Dérogation possible si : -> Bovin non IPI -> attestation de transport direct remise dans les 8 jours au GDS Tous les bovins de plus de 24 mois Sérologie ayant transité en plus de 6 jours 30 jours suivants l’introduction (sauf si le dépistage a eu lieu Brucellose dans les 30 jours précédent la sortie de l’élevage) Maladie réglementée * réglementée Maladie Tous les bovins de plus de 24 mois Sérologie ayant transité en moins de 6 jours et 30 jours précédant la sortie de provenant d’un cheptel à risque l’élevage -

Notice D'information Du Territoire
Notice validée Région Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) Notice d’information du territoire « Petite Région Agricole du bocage de Coutances et Saint Lô » Campagne 2016 Accueil du public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. DDTM Manche Service Economie Agricole et des Territoires Aline Lelégard Laurence Lecoutey Téléphone : 02 33 77 52 36 Téléphone : 02 33 77 52 93 E mail : [email protected] E mail : [email protected] Cette notice présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) proposées sur le territoire « Petite Région Agricole du bocage de Coutances et Saint Lô » au titre de la programmation 2015-2020. Elle complète la notice nationale d’information sur les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique 2015-2020, disponible sous Télépac La notice nationale contient • Les conditions d'engagement dans les MAEC et l'AB d’information sur les • Les obligations générales à respecter MAEC et l’AB • Les contrôles et le régime de sanctions (disponible sous Télépac) • Les modalités de dépôt des demandes MAEC contient Pour l’ensemble du territoire : La notice d’information • La liste des MAEC proposées sur le territoire du territoire • Les critères de sélection des dossiers le cas échéant • Les modalités de demande d’aide La notice d’aide Pour chaque MAEC proposée sur le territoire : • Les objectifs de la mesure • Le montant de la mesure contient • Les conditions spécifiques d’éligibilité • Les critères de sélection des dossiers • Le cahier des charges à respecter • Les modalités de contrôle et le régime de sanctions Version du 03/06/2016 1/7 Notice validée Région Les bénéficiaires de MAEC doivent respecter, comme pour les autres aides, les exigences de la conditionnalité présentées et expliquées dans les différentes fiches conditionnalité qui sont à votre disposition sous Télépac.