Conduites Addictives Chez Les Adolescents
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Spatial Distribution of Tobacco Pipe Fragments at the Hudson's Bay Company Fort Vancouver Village Site: Smoking As a Shared and Social Practice
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses Spring 6-20-2013 The Spatial Distribution of Tobacco Pipe Fragments at the Hudson's Bay Company Fort Vancouver Village Site: Smoking as a Shared and Social Practice Katie Ann Wynia Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the Archaeological Anthropology Commons, and the Social and Cultural Anthropology Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Wynia, Katie Ann, "The Spatial Distribution of Tobacco Pipe Fragments at the Hudson's Bay Company Fort Vancouver Village Site: Smoking as a Shared and Social Practice" (2013). Dissertations and Theses. Paper 1085. https://doi.org/10.15760/etd.1085 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. The Spatial Distribution of Tobacco Pipe Fragments at the Hudson’s Bay Company Fort Vancouver Village Site: Smoking as a Shared and Social Practice by Katie Ann Wynia A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Anthropology Thesis Committee: Kenneth M. Ames, Chair Douglas C. Wilson Shelby Anderson Portland State University 2013 Abstract This thesis represents one of the first systematic, detailed spatial analyses of artifacts at the mid-19th century Hudson’s Bay Company’s Fort Vancouver Village site, and of clay tobacco pipe fragments in general. -

Sacred Smoking
FLORIDA’SBANNER INDIAN BANNER HERITAGE BANNER TRAIL •• BANNERPALEO-INDIAN BANNER ROCK BANNER ART? • • THE BANNER IMPORTANCE BANNER OF SALT american archaeologySUMMER 2014 a quarterly publication of The Archaeological Conservancy Vol. 18 No. 2 SACRED SMOKING $3.95 $3.95 SUMMER 2014 americana quarterly publication of The Archaeological archaeology Conservancy Vol. 18 No. 2 COVER FEATURE 12 HOLY SMOKE ON BY DAVID MALAKOFF M A H Archaeologists are examining the pivitol role tobacco has played in Native American culture. HLEE AS 19 THE SIGNIFICANCE OF SALT BY TAMARA STEWART , PHOTO BY BY , PHOTO M By considering ethnographic evidence, researchers EU S have arrived at a new interpretation of archaeological data from the Verde Salt Mine, which speaks of the importance of salt to Native Americans. 25 ON THE TRAIL OF FLORIDA’S INDIAN HERITAGE TION, SOUTH FLORIDA MU TION, SOUTH FLORIDA C BY SUSAN LADIKA A trip through the Tampa Bay area reveals some of Florida’s rich history. ALLANT COLLE ALLANT T 25 33 ROCK ART REVELATIONS? BY ALEXANDRA WITZE Can rock art tell us as much about the first Americans as stone tools? 38 THE HERO TWINS IN THE MIMBRES REGION BY MARC THOMPSON, PATRICIA A. GILMAN, AND KRISTINA C. WYCKOFF Researchers believe the Mimbres people of the Southwest painted images from a Mesoamerican creation story on their pottery. 44 new acquisition A PRESERVATION COLLABORATION The Conservancy joins forces with several other preservation groups to save an ancient earthwork complex. 46 new acquisition SAVING UTAH’S PAST The Conservancy obtains two preserves in southern Utah. 48 point acquisition A TIME OF CONFLICT The Parkin phase of the Mississippian period was marked by warfare. -
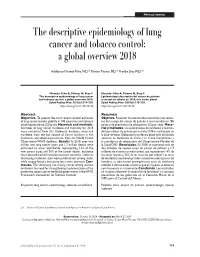
The Descriptive Epidemiology of Lung Cancer and Tobacco Control: a Global Overview 2018
Global descriptive epidemiology of lung cancer ARTÍCULO ORIGINAL The descriptive epidemiology of lung cancer and tobacco control: a global overview 2018 Adalberto Miranda-Filho, PhD,(1) Marion Piñeros, MD,(1) Freddie Bray, PhD.(1) Miranda-Filho A, Piñeros M, Bray F. Miranda-Filho A, Piñeros M, Bray F. The descriptive epidemiology of lung cancer Epidemiología descriptiva del cáncer de pulmón and tobacco control: a global overview 2018. y control de tabaco en 2018: una visión global. Salud Publica Mex. 2019;61:219-229. Salud Publica Mex. 2019;61:219-229. https://doi.org/10.21149/10140 https://doi.org/10.21149/10140 Abstract Resumen Objective. To present the most recent national estimates Objetivo. Presentar las estimaciones nacionales más recien- of lung cancer burden globally in 185 countries and tobacco tes de la carga del cáncer de pulmón a nivel mundial en 185 smoking prevalence (%) by sex. Materials and methods. países y de prevalencia de tabaquismo (%) por sexo. Mate- Estimates of lung cancer incidence and mortality for 2018 rial y métodos. Las estimaciones de incidencia y mortali- were extracted from the Globocan database; observed dad por cáncer de pulmón para el año 2018 se extrajeron de incidence, from the last volume of Cancer Incidence in Five la base de datos Globocan, la incidencia observada del último Continents, and tobacco prevalence, from the World Health volumen de Incidencia de Cáncer en Cinco Continentes y Observatory/WHO database. Results. In 2018, over two la prevalencia de tabaquismo del Observatorio Mundial de million new lung cancer cases and 1.7 million deaths were la Salud/OMS. -
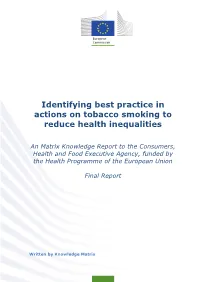
Identifying Best Practice in Actions on Tobacco Smoking to Reduce Health Inequalities
Identifying best practice in actions on tobacco smoking to reduce health inequalities An Matrix Knowledge Report to the Consumers, Health and Food Executive Agency, funded by the Health Programme of the European Union Final Report Written by Knowledge Matrix Identifying best practises in actions on tobacco smoking to reduce health inequalities © European Union, 2014 The information and views set out in this [report/study/article/publication…] are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Commission. The Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this study. Neither the Commission nor any person acting on the Commission’s behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein. ISBN: 978-92-79-37271-1 DOI: 10.2772/20144 August 2014 2 Identifying best practises in actions on tobacco smoking to reduce health inequalities Table of Contents Table of Contents ......................................................................................... 3 Introduction ...................................................................................................... 4 Background and context ..................................................................................... 4 Health inequalities in the EU .......................................................................... 4 Methods ........................................................................................................... 5 Findings .......................................................................................................... -

Tobacco Reference Points
Tobacco Reference points Sales Tobacco sales have been in steady decline since 1991, the year that the Evin Law was passed. Nevertheless, a reversal of this trend began to appear in 1997. In subsequent years a slight increase in sales can be seen. In France, the turnover in tobacco sales represents 83 billion francs, 75% of which goes to the State in the form of taxes. Consumption For the general adult population, a global downturn in consumption was noticed in the 1990s; however, this downturn masks an increase in consumption by women. In the general adult population, experimentation with tobacco is very widespread among both men (88%) and women (76%), while figures for current use stand at 39% of men and 30% of women. Those who consume tobacco every day—a figure that decreases sharply with age—represent 33% of men and 26% of women. Among young people, between the end of the 1970s and the start of the 1990s, consumption by 12-18-year-olds followed a global trend downward; however, from the start of the 1990s, a visible increase appeared among 14-18-year-olds, both in experimentation and in daily use. Experimentation with tobacco is a very common experience in late adolescence. More than three quarters of young people state that they have already tried tobacco, and experimentation is a little more common among women (79% of girls as opposed to 76% of boys, at age 17). At 17, five out of ten young people have smoked at least one cigarette during the previous month, and four out of ten have smoked on a daily basis (42 % of boys and 40 % of girls). -

Bienvenue En France «It’S Not Better, It’S Not Worse, It’S Just Different»
Bienvenue en France «It’s not better, it’s not worse, it’s just different» Welcome to France ! A guidebook for hosted students in France Your experience starts NOW. Welcome to AFS, welcome to France! We hope that you will enjoy your experience in France, an experience that we hope you will find to be both challenging and rewarding. Whether being hosted in the countryside or in a big city, you will be immersed into French culture as soon as your feet touch the ground through your host family, your school and friends, TV programs, food, architecture, well, everything that you see, eat, hear and smell! This sudden immersion can be exhausting and this guidebook has been created to help you start getting prepared for your experience in France. You’ll find information about our country, its culture and way of life, some advice to help your integration and reminders of AFS rules. Don’t forget to bring this booklet with you, you’ll use it during your national arrival orientation and it might also prove useful all along your program with tips, facts and basic vocabulary. Bonne lecture et à très bientôt ! The Program Getting Ready About France Safety Issues Page 2 Page 5 Page 6 Page 10 2 - AFS France - Bienvenue en France / Welcome to France in French families to talk about oneself expect you to respect their family rules Your host family and ask for advice. Dinner time is very and to share interests and participate in important family time in France. It is often families activities. -

The Soverane Herbe : a History of Tobacco
" :i*.; l."l liwilW(Wmmn ii«a«mi4Hftm i*Hfrff^f^'iy4rt^r-r'-Kr-ff % |; ' tyi^-ag^Kscta™^s*c\'i^^^',V'^-^l^g!^r i ljlp ..-..satauiJiiei- Cornell Unlversil GT 3020.P4 1902 The soverane herbe :a history of tobacco 3 1924 001 715 998 DATE DUE The Soverane Hcrbe Cornell University Library The original of tliis book is in tlie Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924001715998 A TOBACCONIST S SHOP, TEMP. JAMES I. From Brathwait's ' Smoaking Age,' 1617. The Soverane Herbe A History of Tobacco A Tobacco Drinker, 1623 W. A. PENN With Illustrations by W. Hartley London Grant Richards New York: E. P. Dutton & Co. 1902 — t ' Of all the weeds grown on earth, sure the nicotian is the most soothing and salutary.' Esmond. J4- O First edition, August, 1901, Second edition, February, igo2. BILLING AND SONS, LTD., PRINTERS, GUILDFORD PREFACE Fifty years ago Tobacco in England was at its lowest ebb. Snufif was declining in favour, and the increasing practice of smoking was being opposed bitterly by ' Society. To drink tobacco ' was then far from being considered the gentlemanly accomplishment that it was in the reign of Elizabeth or the harmless hobby that it is now. Smoking was regarded as a low vulgar practice, to be indulged in by only artisans, Bohemians, and the scum of society. Only within the last twenty years has smoking regained the social position that it held in the golden age of Queen Bess and the stern times of the seventeenth century. -

Saudi Arabia, UAE, Bahrain Recall Envoys from Qatar
SUBSCRIPTION THURSDAY, MARCH 6, 2014 JAMADA ALAWWAL 5, 1435 AH www.kuwaittimes.net Outgoing Torture claim Violent clashes Pistorius fired US envoy in Egypt trial as India sets gun in eatery, hails role of Jazeera dates for world’s tried to of ABCK2 journalists8 biggest10 election shift15 blame Saudi Arabia, UAE, Bahrain Max 30º Min 17º recall envoys from Qatar High Tide 03:16 & 14:57 Low Tide Speaker urges Amir’s mediation to heal rifts 09:18 & 21:55 40 PAGES NO: 16096 150 FILS By B Izzak and Agencies conspiracy theories Amir leaves hospital KUWAIT: Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain recalled their ambassadors from Qatar yester- KUWAIT: HH the Amir Sheikh Sabah Sabah, HH the Prime Minister Sheikh Unity is the day in an unusually public dispute among the clubby Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah left hos- Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, Gulf Arab states, a move analysts say centers on their pital late Tuesday after undergoing Cabinet members and all citizens and neighbor’s support for the Muslim Brotherhood and its successful minor surgery, the Amiri residents for their sincere feeling, only answer perceived aggressive meddling in regional conflicts. Diwan announced in a press state- prayers and constant inquiry about his Kuwait and Oman did not join the diplomatic rebuke to ment yesterday. health. Qatar. The Amir greatly thanked and Sheikh Sabah also expressed grati- Kuwait’s National Assembly Speaker Marzouq Al- expressed appreciation of HH the tude to leaders of Arab and friendly Ghanem expressed “deep concern and alarm” and Deputy Amir and Crown Prince countries who inquired about his hoped that HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al- Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al- health and wished him everlasting Sabah would play a role in healing the divisions. -

Bulletin Épidémologique Hebdomaire
Augmentation récente du tabagisme en France : principaux résultats du Baromètre santé, France, 2010 François Beck ([email protected])1,2, Romain Guignard1, Jean-Baptiste Richard1, Jean-Louis Wilquin1, Patrick Peretti-Watel3 1/ Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), Saint-Denis, France 2/ Cermes3 - Équipe Cesames (Centre de recherche Médecine, sciences, santé, santé mentale, société, Université Paris Descartes/CNRS UMR 8211/Inserm U988/EHESS), Paris, France 3/ Inserm UMR912 (SE4S) et ORS Paca Marseille, France Résumé / Abstract Les Baromètres santé de l’Inpes permettent d’observer de façon régulière Increasing trends in smoking in France: main results des indicateurs de surveillance épidémiologique en population générale. of the French Health Barometer, France 2010 Il s’agit d’enquêtes aléatoires réalisées par téléphone, représentatives de la population de France métropolitaine âgée de 15 à 75 ans. La dernière Every five years, the Health Barometer from the National Institute for enquête, menée en 2010 auprès de plus de 27 000 individus, montre l’aug- Prevention and Health Education (INPES) measures epidemiological mentation récente du tabagisme en France, alors qu’il était en baisse monitoring indicators in the general population. These random surveys are depuis plus de 20 ans. L’ensemble des résultats s’avère néanmoins conducted through phone interviews based on a representative sample of the contrasté : la proportion des fumeurs de plus de 10 cigarettes par jour est en 15-75 year old population living in France. The last survey, conducted in baisse, tandis que la proportion des fumeurs quotidiens apparaît en aug- 2010 with more than 27,000 interviewees, shows a recent increase in smok- mentation par rapport à 2005, en particulier chez les femmes âgées de 45 à ing in France, whereas it had been decreasing for more than 20 years. -
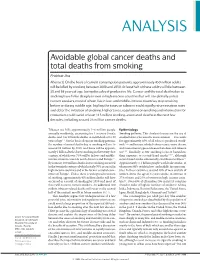
Avoidable Global Cancer Deaths and Total Deaths from Smoking
ANALYSIS Avoidable global cancer deaths and total deaths from smoking Prabhat Jha Abstract | On the basis of current consumption patterns, approximately 450 million adults will be killed by smoking between 2000 and 2050. At least half of these adults will die between 30 and 69 years of age, losing decades of productive life. Cancer and the total deaths due to smoking have fallen sharply in men in high-income countries but will rise globally unless current smokers, most of whom live in low- and middle-income countries, stop smoking before or during middle age. Tripling the taxes on tobacco could rapidly raise cessation rates and deter the initiation of smoking. Higher taxes, regulations on smoking and information for consumers could avoid at least 115 million smoking-associated deaths in the next few decades, including around 25 million cancer deaths. Tobacco use kills approximately 5–6 million people Epidemiology annually worldwide, accounting for 1 in every 5 male Smoking patterns. This Analysis focuses on the use of deaths and 1 in 20 female deaths in individuals over 30 smoked tobacco because it is more common — it accounts years of age1–4. On the basis of current smoking patterns, for approximately 85% of all tobacco produced world- the number of annual deaths due to smoking will rise to wide7 — and because inhaled tobacco causes more disease around 10 million by 2030, and there will be approxi- and more diverse types of disease than does oral tobacco mately 1 billion deaths due to smoking in the twenty-first use8–10. Similarly, active smoking is more hazardous century, of which over 70% will be in low- and middle- than exposure to second-hand smoke8,9,11, although income countries outside north America and Europe1,5. -

Christine Dang Thesis 031521
COMPARING SMOKING BEHAVIORS BETWEEN FRANCE AND THE UNITED STATES: A HISTORICAL AND CULTURAL ANALYSIS by CHRISTINE DANG DISSERTATION Presented to the Faculty of the Medical School The University of Texas Southwestern Medical Center In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF MEDICINE WITH DISTINCTION IN GLOBAL HEALTH The University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX 2 ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank Dr. Angela Mihalic, my chief thesis mentor and advisor during the International Medical Exchange Program. I would also like to thank Dr. Adriane Dela Cruz and Dr. Mary Chang for the guidance during their thesis writing process and perspectives on smoking behavior from an addiction psychiatry and global health standpoint. 3 ABSTRACT COMPARING SMOKING BEHAVIORS BETWEEN FRANCE AND THE UNITED STATES: A HISTORICAL AND CULTURAL ANALYSIS CHRISTINE DANG The University of Texas Southwestern Medical Center, 2021 Supervising Professor: Angela Mihalic, M.D. BACKGROUND: The early 20th century represented a time of remarkable growth for the tobacco industry. After the link between smoking and lung cancer was solidified in the mid 20th century, smoking prevalence in developed countries has largely decreased. However, a subset of developed countries has not seen as large a decrease in smoking rates. The reasons for this divergence in smoking prevalence patterns have not been fully explored in the literature. France is one of the countries that has shown a decrease in smoking prevalence, yet their smoking prevalence is still much higher at 30% when compared to other developed countries such as the United States at 16%. These high rates of smoking in the general public also coincide with high rates amongst health professionals. -

Tobacco Control in Practice Article 13: Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship
Tobacco Control in Practice Article 13: Tobacco advertising, promotion and sponsorship Case studies of implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control in the WHO European Region Address requests about publications of the WHO Regional Office for Europe to: Publications WHO Regional Office for Europe Scherfigsvej 8 DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark Alternatively, complete an online request form for documentation, health information, or for permission to quote or translate, on the Regional Office web site (http://www.euro.who.int/pubrequest). © World Health Organization 2012 All rights reserved. The Regional Office for Europe of the World Health Organization welcomes requests for permission to reproduce or translate its publications, in part or in full. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either express or implied.