Verdun 1916 Des Mêmes Auteurs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

American Armies and Battlefields in Europe 533
Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

80Th Division, Summary of Operations in the World
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. http://books.google.com -NRLF .3 B 3 11D 80tK ; .5 80TH DIVISION .UMMARY OF OPERATIONS IN THE WORLD WAR PREPARED BY THE . _> , AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION UNITED STATES GOVERNMENT PRINTiNG OFFiCE 1944 FOR SALE BY THE SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS U. S. GOVERNMENT PRINTiNG OFFICE WASHiNGTON 25, D. C. Foreword THE AMER1CAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION was created by Congress in 1923 for the purpose of commemorating the serv ices of American forces in Europe during the World War. In the accomplishment of this mission, the Commission has erected suitable memorials in Europe and improved and beautified the eight American cemeteries there. It has also published a book entitled "American Armies and Battlefields in Europe" which gives a concise account of the vital part played by American forces in the World War and detailed information regarding the memorials and cemeteries. In order that the actions of American troops might be accu rately set forth, detailed studies were made of the operations of each division which had front-line battle service. In certain cases studies of sector service were also prepared. It is felt that the results of this research should now be made available to the public. Therefore, these studies are being published in a series of twenty-eight booklets, each booklet devoted to the operations of one division. In these booklets only the active service of the divisions is treated in detail. -
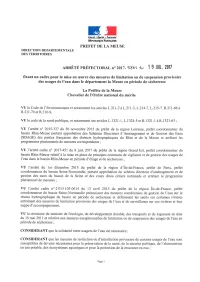
Arrêté Cadre Secheresse 2017
Page 1 Annexe 2 – Répartition des communes par zones d’alerte Zone d’alerte 1 : Aisne amont 55014 AUBREVILLE 55285 LAVOYE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE 55116 LE CLAON 55023 AVOCOURT 55379 LE NEUFOUR 55032 BAUDREMONT 55253 LES ISLETTES 55033 BAULNY 55497 LES SOUHESMES-RAMPONT 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE 55254 LES TROIS-DOMAINES 55040 BEAUSITE 55289 LEVONCOURT 55044 BELRAIN 55290 LIGNIERES-SUR-AIRE 55065 BOUREUILLES 55295 LISLE-EN-BARROIS 55068 BRABANT-EN-ARGONNE 55301 LONGCHAMPS-SUR-AIRE 55081 BRIZEAUX 55343 MONTBLAINVILLE 55082 BROCOURT-EN-ARGONNE 55346 MONTFAUCON-D'ARGONNE 55103 CHARPENTRY 55380 NEUVILLE-EN-VERDUNOIS 55108 CHAUMONT-SUR-AIRE 55383 NEUVILLY-EN-ARGONNE 55113 CHEPPY 55384 NICEY-SUR-AIRE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE 55389 NUBECOURT 55128 COURCELLES-SUR-AIRE 55395 OSCHES 55129 COUROUVRE 55404 PIERREFITTE-SUR-AIRE 55518 COUSANCES-LES-TRICONVILLE 55409 PRETZ-EN-ARGONNE 55141 DAGONVILLE 55442 RAIVAL 55155 DOMBASLE-EN-ARGONNE 55416 RARECOURT 55174 EPINONVILLE 55419 RECICOURT 55175 ERIZE-LA-BRULEE 55446 RUMONT 55177 ERIZE-LA-PETITE 55453 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS 55178 ERIZE-SAINT-DIZIER 55454 SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 55179 ERNEVILLE-AUX-BOIS 55000 SEIGNEULLES 55185 EVRES 55517 SEUIL-D'ARGONNE 55194 FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 55498 SOUILLY 55199 FROIDOS 55525 VADELAINCOURT 55202 FUTEAU 55527 VARENNES-EN-ARGONNE 55208 GESNES-EN-ARGONNE 55532 VAUBECOURT 55210 GIMECOURT 55536 VAUQUOIS 55251 IPPECOURT 55549 VERY 55257 JOUY-EN-ARGONNE 55555 VILLE-DEVANT-BELRAIN 55260 JULVECOURT 55567 VILLE-SUR-COUSANCES 55266 LACHALADE 55570 VILLOTTE-SUR-AIRE 55282 LAVALLEE -

285 Km (Itinéraire Sens Positif)
De l'Ardenne à l'Argonne 285 km (itinéraire sens positif) 0 0 BERTRIX © Départ grand-place. Descendre à droite de l'église. Dir : Cugnon - Vallée de la Semois. 7,5 7,5 MORTEHAN A droite, dir. Bouillon - Dohan. Franchir le pont sur la Semois. Après le pont, prendre immédiatement à gauche devant une petite chapelle (pas d'indication) Toujours dans Mortehan, poursuivre en côte la route principale vers la gauche. On quitte Mortehan en passant devant un cimetière 0,5 8 4,5 12,5 Bifurcation : poursuivre la route principale vers la droite (pas d'indic.) 1,5 14 Jonction avec route principale Bouillon-Florenville que l'on emprunte vers la gauche (pas d'indication). 3,3 17,3 Carrefour avec route secondaire Bertrix-Muno. Poursuivre tout droit (dir. Florenville). 0,7 18 Carrefour avec route secondaire Sainte-Cécile - Muno. Poursuivre tout droit (dir. Florenville). 0,4 18,4 Petit carrefour avec route secondaire Ste-Cécile - Muno. Prendre à droite piste cycl. vers Muno (petite indic. : sentier Muno - Ste-Cécile) 8 26,4 Fin de piste cyclable. Jonction avec route que l'on emprunte vers la droite. Panneau "France". 1,4 27,8 Bifurcation. Poursuivre sur la gauche D17, dir. Carignan. 1,6 29,4 PURE Poursuivre D17 qui devient D317, dir. Carignan. 4,3 33,7 CARIGNAN (BPF) Jonction avec N43 que l'on emprunte à gauche, dir. Carignan 1 34,7 Centre. Prendre à droite D19, dir. Mouzon. 7,3 42 MOUZON © Traverser D964 et poursuivre vers centre ville. 0,7 42,7 Centre. Traverser la ville et poursuivre D19 (Dir. -

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 Sur 111
21 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 111 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-166 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meuse NOR : INTA1401593D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général de la Meuse en date du 18 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département de la Meuse comprend dix-sept cantons : – canton no 1 (Ancerville) ; – canton no 2 (Bar-le-Duc-1) ; – canton no 3 (Bar-le-Duc-2) ; – canton no 4 (Belleville-sur-Meuse) ; – canton no 5 (Bouligny) ; – canton no 6 (Clermont-en-Argonne) ; – canton no 7 (Commercy) ; – canton no 8 (Dieue-sur-Meuse) ; – canton no 9 (Etain) ; – canton no 10 (Ligny-en-Barrois) ; – canton no 11 (Montmédy) ; – canton no 12 (Revigny-sur-Ornain) ; – canton no 13 (Saint-Mihiel) ; – canton no 14 (Stenay) ; – canton no 15 (Vaucouleurs) ; – canton no 16 (Verdun-1) ; – canton no 17 (Verdun-2). -

ARGONNE TERRE DE COULEURS ‐ Liste De Hébergements Et Restaurants
ARGONNE TERRE DE COULEURS ‐ Liste de hébergements et restaurants TYPE RAISON SOCIALE ADRESSE CP VILLE TEL 1 TEL 2 MAIL CAMPING CAMPING MUNICIPAL DU VAL D’ANTE Rue de la Champagne 51330 Givry‐En‐Argonne 03 26 60 04 15 03 26 60 18 22 [email protected] CAMPING CAMPING À LA FERME DE PATIZEL 3 rue Saint Bernard 51330 Les Charmontois 03 26 60 31 60 scea‐[email protected] CAMPING LE GROSEILLIERS 3 rue d'Avocourt 55120 Neuvilly‐En‐Argonne 03 29 87 42 84 [email protected] CAMPING FANTESSIQUE 2 rue Basse 51800 Berzieux [email protected] CAMPING LE PAQUIS rue Saint Jean 55270 Varennes‐en‐Argonne 03 29 80 71 01 CAMPING DOMAINE DE LA GRELETTE ** Chemin de l’Alleval, BP 90, 51800 Sainte‐Ménehould 03 26 60 24 76 06 80 30 20 95 [email protected] CHBR HOTES RÊVE D'ARTISTE 55250 Beaulieu‐En‐Argonne 03 29 70 72 42 [email protected] CHBR HOTES LES ÂNERIES §§§ 24 grande rue, 51800 Braux‐Saint‐Remy 06 80 68 48 23 [email protected] CHBR HOTES DOMAINE DE VAUX 14 Chemin de Vaux , 51800 Chaudefontaine 03 26 60 61 48 06 83 59 68 17 CHBR HOTES CHAMBRES D'HÔTES A RARECOURT Lieu Dit La Neuve Tuilerie 55120 Rarecourt 06 71 00 61 56 [email protected] CHBR HOTES LA FLORENTINE 5 Place Carnot, 51800 Florent‐En‐Argonne 03 26 60 27 77 [email protected] CHBR HOTES LE MARRONNIER §§§ 5 rue Saint Bernard, 51330 Les Charmontois 03 26 60 39 53 06 80 52 86 51 [email protected] CHBR HOTES VILLA LES ROSES 1 rue du Centre, La Vignette 51800 Les Islettes 03 26 60 00 51 06 08 21 25 56 contact@villalesroses‐marne.com -

Map Inventory
Map Inventory 1. Middle East briefing map, edition 3-DMATC, series 1308 2. West Bank and Vicinity, 1 color and laminated and 1 black and white 3. Coles Hill 4. Briefing Maps: A. Africa B. Western hemisphere (2) C. Eastern hemisphere D. Lebanon (2) E. Syria F. Middle East G. Iraq H. Middle East I. Ukraine (in Russian) J. Middle East and Central Asia K. The Middle East L. Soviet Union Administrative Divisions, 1983 M. North-Eastern Africa, World Scale 1:5,000,000 N. Gaza Strip and Vicinity, September 1980 O. West Bank Arab Population, 1967 P. The Eastern Mediterranean, Scale 1:1,000,000 Q. Southwest Asia, Scale 1:1,650,000 R. Political Map of the World, April 1, 1983 (2) S. Eastern Europe, Scale 1:2,200,000 T. Europe, Scale 1:1,400,000 U. South America, Scale 1:8,000,000 V. United States W. Soviet Union, Scale 1:5,000,000 5. WWI War Maps A. Zusammendruck I, Map 9 (2) B. Germany, Diekirch 1:25,000 (2) C. American Operations in the St. Mihiel Region, September 12-November 11, 1918 (5) D. 80th Division Meuse-Argonne Offensive, September 30-October 13, 1918 E. 80th Division in the Somme Offensive, August 8-18, 1918 F. 80th Division in the Meuse-Argonne (3) G. Google Earth Natillois, France H. WWI Map, Gercourt Area and Derillancourt Area and Dannevoux (3) I. Provisional Map, Scale 1: 1000,000 Paris J. DUN-sur-Meuse (4) K. Argonne Special Secret Map #7 (3) L. Map 3, Strand 12.6.18, Zusarnmendruck III (Maas-West) M. -

ME10 - Cimetière Militaire Allemand De Consenvoye
Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » ME10 - Cimetière militaire allemand de Consenvoye Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif Liste de(s) élément(s) ME10 Cimetière - ME10 Cimetière militaire allemand de constitutif(s) et de leur(s) militaire Consenvoye attribut(s) majeur(s) allemand de Consenvoye Eventuellement, liste de(s) Elément(s) Aucun attribut(s) secondaire(s) constitutif (s) Zone(s) Aucun tampon(s) Zone - ME10-i1 Cimetière allemand de Dannevoux d’interprétation - ME10-i2 Cimetière allemand de Dun-sur-Meuse - ME10-i3 Cimetière allemand de Liny-devant-Dun - ME10-i4 Cimetière allemand de Brieulles-sur- Meuse - ME10-i5 Cimetière allemand de Romagne-sous- Montfaucon - ME10-i6 Cimetière allemand de Nantillois - ME10-i7 Cimetière allemand d’Epinonville - ME10-i8 Cimetière allemand de Cheppy - ME10-i9 Monument de la Cote 304 Association « Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre » ELEMENT CONSTITUTIF ME10 ICONOGRAPHIE (ME10 Cimetière militaire allemand de Consenvoye, Mission Histoire – Département de la Meuse, 2016) Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif Le cimetière allemand de Consenvoye est entouré de parcelles cultivées sur trois côtés. Au sud- ouest, il est bordé par la D964. 1. Identification de l’élément constitutif 1.1 Liste des attributs majeurs de ME10 Cimetière militaire allemand de Consenvoye l’élément constitutif 1.2 Coordonnées géographiques Coordonnées géographiques de 5°29’70.78"E / 49°28’00.87"N l’élément constitutif 5°29’74.08"E / 49°28’08.91"N -

Mise En Page
LES DOCUMENTS D'URBANISME APPROUVES Breux Moulis 07 avril 2015 Saint Hubert Thonne le Thil Avioth Thonne la Long Autréville Olizy St Lambert Inor sur Chiers Thonnelle Verneuil Lamouilly Chauvency Petit Pouilly Direction Saint Hubert Ecouviez sur Martincourt Nepvant Thonne Verneuil Meuse sur les Près Grand Départementale des Luzy Meuse Brouennes St Martin Chauvency Territoires le Château Vigneul Villécloye sous Montmédy de la Meuse Cesse Montmédy Bazeilles Laneuville sur Meuse Stenay Velosne Quincy sur Othain Landzécourt Han 12 11 lès Juvigny 11 Flassigny Beaufort Baâlon Iré le Sec en Argonne Juvigny Beauclair Wiseppe sur Loison Remoiville Halles Mouzay Marville sous les Saulmory Louppy Côtes et sur Villefranche Loison Jametz Arrancy Montigny Rupt Lion sur devant sur Sassey devant Dun Delut Crusnes Sassey Murvaux Othain Sorbey Mont sur devant Sassey Meuse Brandeville Saint Laurent Villers Milly sur Othain Rouvrois devant Dun Dombras sur sur Bradon Murvaux Bréhéville Vittarville Othain Saint Doulcon Pierrevillers Dun Pillon Merles sur Meuse Lissey sur Peuvillers Villers Nouillonpont Aincreville Cléry Fontaines Loison les Duzey14 10le St Clair Cléry Ecurey en Verdunois Mangiennes Petit Liny Sivry le Grand devant sur Meuse Bantheville Reville aux Bois Mangiennes Dun Damvillers Muzeray Spincourt 13 Billy Romagne sous Vilosnes Etraye Cunel Brieulles Haraumont sous les côtes Mangiennes Romagne Sivry sur Meuse Wavrille sous sur Vaudoncourt Montfaucon Meuse Chaumont 25 Dvt Damvillers Azannes Loison Domremy Moirey Gouraincourtla Canne Gesnes Dannevoux -

The Doughboys from Clare in WW1
The Doughboys from Clare in WW1 General John J Perishing lands in France on the 15th June 1917. There were at least 400 Clare men who served with the US Forces in WW1. 43 Claremen died in the U.S. Forces, during or just after the war. Claremen served with the following 33 (of 43)US Infantry Divisions: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, 12th, 20th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 35th, 37th, 41st, 42nd, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 85th, 87th , 90th and 91st. They were also in the Ambulance Service and Hospital Corps, Ammunition Trains, Cavalry, Chaplains, Corps of Engineers, Depots, Motor Transport Corps, Ordnance Corps, Signal Corps, Spruce production Division, Training Camps, Red Cross, US Army Battery, US Coast Artillery, US Forts and US Navy. I would like to thank Tom Burnell who wrote ‘The Clare War Dead’, the research done by Peadar McNamara and Keir McNamara, Joe Power who wrote ‘Clare and the Great War’, the Kilrush Men engaged in WW1 Website (KM), Charles E Glynn’s List of Kilrush Men in the Great War, Paul O’Brien, Morgan Roughan, Paddy Waldron, The Commonwealth War Grave Commission, Burials in County Clare Graveyards (Clare Library), findagrave.com, ancestry.com, the In Flanders website. The Clare Journal (CJ), The Saturday Record (SR), The Clare Champion, The Clare People, The Clare Museum, The Clare Library Local Studies Centre, Dolores Murrihy, Sharon Carberry, Daniel McCarthy, Helen O’Connor, Eric Shaw, Joe O’Muircheartaigh, Eddie Lough, Paddy O’Meara, Brian Honan, all those who sent on information and finally Larry Brennan and the Clare Roots Society for all their help. -

On the Battlefield a Schematic of Doctrinally Ideal Evacuation from the Battlefield
On the Battlefield A schematic of doctrinally ideal evacuation from the battlefield. In practice, the American Expeditionary Forces (AEF) deviated from this model when the situation warranted. (THE MEDI ca L DEP T I N T HE WORLD WA R , VOL . VIII, P. 262) 68 | Buddy Aid (Above) Private John C. Jones, 61st Supply Company, giving a drink to a wounded comrade. 70 | Litter Bearers | 71 | 73 74 | Wounded at first aid dressing station, Boureuilles, France. | 75 Ambulances 76 | (Opposite) Ambulances stuck in the mud. This is typical of ambulances driving between the front and evacuating stations. 5th Division, Meuse, France, October 13, 1918. (Above) The 27th Ambulance Company of the 3rd Division receiving wounded on the outskirts of Nantillois, France. These men were gassed and wounded by shrapnel and machine gun fire. During the battle a constant stream of wounded were carried or helped to this station, where they were put in ambulances and rushed to hospitals. Many of these men are members of the 5th Division, which relieved the 80th Division, Nantillois, Meuse, France. | 77 (Left) Rear view of ambulance with four wounded soldiers. (Opposite) Wounded soldiers being transferred into ambulances. 78 | | 79 Field Hospitals “NURSES W ERE N O T I nt E N DED FOR A SSIG N ME nt T O FIELD HOSPI ta LS , but there were occasions in which nurses found themselves on duty with such hospitals after having been assigned to duty on special surgical teams which were moved about as the need arose. Under such conditions formal reports of this service were never submitted, as there were no chief nurses on duty with these teams, but the nurses’ individual records indicate that a number of nurses had varying lengths of service in connection with field hospitals.” (The Medical Dept in the World War, Vol. -

28Th Division — General Table of Casualties — Sources
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. http://books.google.com , 28 TH DIVISION SUMMARY OF OPERATIONS IN THE WORLD WAR PREPARED BY THE ' J? AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION / *___ UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1944 FOR SALE BY THE SUPERINTENDENT OF DOCUMENTS U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE WASHINGTON 25, D. C. Foreword THE AMER1CAN BATTLE MONUMENTS COMM1SS1ON was created by Congress in 1923 for the purpose of commemorating the serv ices of American forces in Europe during the World War. In the accomplishment of this mission, the Commission has erected suitable memorials in Europe and improved and beautified the eight American cemeteries there. It has also published a book entitled "American Armies and Battlefields in Europe" which gives a concise account of the vital part played by American forces in the World War and detailed information regarding the memorials and cemeteries. In order that the actions of American troops might be accu rately set forth, detailed studies were made of the operations of each division which had front-line battle service. In certain cases studies of sector service were also prepared. It is felt that the results of this research should now be made available to the public. Therefore, these studies are being published in a series of twenty-eight booklets, each booklet devoted to the operations of one division. In these booklets only the active service of the divisions is treated in detail. The accounts, however, are comprehensive enough to be of general interest and establish a great body of fact concerning the operations.