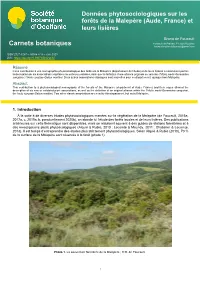Maître d’ouvrage :
PIECE 2
ETUDE D’IMPACT
Pièce 2 : Etude d’impact
Z:\STEPHANIE\Marbres Cyrnos_1618C11\DA\Pièce_2.doc
Maître d’ouvrage :
SOMMAIRE
- 2.
- ETUDE D’IMPACT...................................................................................................................................................................1
2.0. 2.1.
CONTEXTE REGLEMENTAIRE...............................................................................................................................................1 DESCRIPTION DU PROJET.....................................................................................................................................................2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ....................................................................................3
Emplacement du projet .................................................................................................................................................3
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3.
Implantation régionale ...................................................................................................................................3 Situation locale.................................................................................................................................................5 Situation parcellaire ........................................................................................................................................7
2.1.2.
2.1.2.1. 2.1.2.2. 2.1.2.3.
Contexte géologique ......................................................................................................................................................9
Contexte géologique régional........................................................................................................................9 Contexte géologique local ..............................................................................................................................9
Identification des sondages, puits, forages, sources en points singuliers localisés dans l’emprise de
la carrière ou à sa périphérie immédiate....................................................................................................11
2.1.3.
2.1.3.1. 2.1.3.2. 2.1.3.3.
Hydrogéologie .............................................................................................................................................................14
Présentation du contexte général ................................................................................................................14 Contexte local.................................................................................................................................................14 Ouvrages d’alimentation en eau potable ...................................................................................................14
2.1.4.
2.1.4.1. 2.1.4.2.
Hydrographie ..............................................................................................................................................................15
Présentation....................................................................................................................................................15 Régimes hydrologiques de référence..........................................................................................................17
2.1.5.
2.1.5.1. 2.1.5.2.
Climat et météorologie.................................................................................................................................................18
Présentation....................................................................................................................................................18 Pluviométrie...................................................................................................................................................19 Températures.................................................................................................................................................19 Intempéries.....................................................................................................................................................19 Régime des vents...........................................................................................................................................20
Records établis sur la période de 1981-2010........................................................................................20 Régime des vents ....................................................................................................................................20
2.1.5.3. 2.1.5.4. 2.1.5.5.
2.1.5.5.1. 2.1.5.5.2.
- 2.1.6.
- Paysage, occupation des sols et perception visuell e . ....................................................................................................21
- 2.1.6.1.
- Paysage local et occupation du sol..............................................................................................................21
Contexte paysager dans lequel s’inscrit la carrière ............................................................................21 Eléments remarquables du paysage local............................................................................................22
Occupation du sol dans l’emprise du projet d’exploitation, ainsi qu’à ses abords........................23
2.1.6.1.1. 2.1.6.1.2. 2.1.6.1.3.
- 2.1.6.2.
- Perceptions visuelles de la carrière actuelle...............................................................................................30
2.1.7.
2.1.7.1. 2.1.7.2.
Contexte floristique et faunistique ..............................................................................................................................32
Présentation....................................................................................................................................................32 Justification des compartiments biologiques étudiés ...............................................................................32 Intervenants ...................................................................................................................................................33 Aire d’étude ...................................................................................................................................................34 Fonctionnalité écologique locale .................................................................................................................36 Présentation des résultats obtenus..............................................................................................................40
Inventaire botanique et milieux identifiés...........................................................................................40 Entomofaune...........................................................................................................................................44 Les amphibiens .......................................................................................................................................46 Les reptiles...............................................................................................................................................50 Les Chiroptères .......................................................................................................................................53 Les mammifères (hors Chiroptères).....................................................................................................55 L’avifaune................................................................................................................................................57 Synthèse des enjeux naturalistes identifiés au droit de la zone d’étude .........................................59
2.1.7.3. 2.1.7.4. 2.1.7.5. 2.1.7.6.
2.1.7.6.1. 2.1.7.6.2. 2.1.7.6.3. 2.1.7.6.4. 2.1.7.6.5. 2.1.7.6.6. 2.1.7.6.7. 2.1.7.6.8.
Pièce 2 : étude d’impact
Z:\STEPHANIE\Marbres Cyrnos_1618C11\DA\Som_piece 2.doc
1
Maître d’ouvrage :
2.1.8.
2.1.8.1. 2.1.8.2.
Zones spécifiques établies au titre de la reconnaissance ou de la protection du patrimoine naturel............................61
Zones d’inventaire patrimonial...................................................................................................................61 Les périmètres de protection réglementaire ..............................................................................................63 Les périmètres de gestion concertée (ou protection par voie contractuelle) .........................................65 Les périmètres d’engagement international ..............................................................................................66 Autres zonages d’intérêt écologique...........................................................................................................66 Synthèse..........................................................................................................................................................71
2.1.8.3. 2.1.8.4. 2.1.8.5. 2.1.8.6.
2.1.9.
2.1.9.1. 2.1.9.2.
Les émissions atmosphériques .....................................................................................................................................71
Les odeurs ......................................................................................................................................................71 Pollution atmosphérique..............................................................................................................................72
2.1.10.
2.1.10.1.
Bruit résiduel et émergences relevées dans la situation actuelle ............................................................................72
Identification des sources sonores dans l’état actuel ................................................................................72 Contraintes imposées par la réglementation applicable et l’arrêté préfectoral en vigueur.................72
Prescriptions retenues par l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié.................................................73
Zones à émergence réglementée .................................................................................................................73
2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.10.4.
- 2.1.11.
- Vibrations et projection s . .......................................................................................................................................73
Présentation....................................................................................................................................................73 Mesures du niveau de vibrations émis dans l’état actuel ........................................................................74
2.1.11.1. 2.1.11.2.
- 2.1.12.
- Les émissions atmosphérique s . ...............................................................................................................................74
Les odeurs ......................................................................................................................................................74 Pollution atmosphérique..............................................................................................................................74
2.1.12.1. 2.1.12.2.
2.1.13. 2.1.14.
2.1.14.1. 2.1.14.2.
2.1.15.
Emissions lumineuse s . ...........................................................................................................................................75 Risques naturels et technologiques ........................................................................................................................75
Risques naturels.............................................................................................................................................75 Arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles ...............................................................................76
Voies de communication, accès à l’exploitation et trafic induit par la carrière ......................................................76
Voies de communication..............................................................................................................................76 Accès au site...................................................................................................................................................76 Transport........................................................................................................................................................82
2.1.15.1. 2.1.15.2. 2.1.15.3.
2.1.16. 2.1.17.
Habitat proche, environnement humain et activités économiques .........................................................................83
Identification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes ou en projet sur le territoire des communes situées dans l’emprise du rayon d’affichage de 3 kilomètres ...........................................86
Bâtit périphérique proch e . ......................................................................................................................................91 Patrimoine archéologique et culturel .....................................................................................................................93
Archéologie....................................................................................................................................................93 Patrimoine culturel........................................................................................................................................93
2.1.18. 2.1.19.
2.1.19.1. 2.1.19.2.
2.1.20. 2.1.21.
2.1.21.1
Servitudes d’Appellation d’Origine (AO) .............................................................................................................94 Documents planificateurs susceptibles d ’affecter l’utilisation ou l’occupation du sol ...........................................95
Les Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AMVAP) ...........................................95 Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée................................................................................................95 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA).....................................................................................96 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)...........................................................................................96 Le schéma départemental des carrières de l’Aude ...................................................................................96 Documents d’urbanisme de la commune de Caunes-Minervois............................................................97 Plan de Protection de l’Atmosphère ...........................................................................................................97 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) .................................98
Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée motorisée prévu à l’article L. 361-2 du code de
l’Environnement............................................................................................................................................98
2.1.21.2. 2.1.21.3. 2.1.21.4. 2.1.21.5. 2.1.21.6. 2.1.21.7. 2.1.21.8. 2.1.21.9.
2.1.21.10. Captage d’alimentation en eau potable......................................................................................................98 2.1.21.11. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (S.R.C.A.E)..........................................................99 2.1.21.12. Schéma régional de cohérence écologique...............................................................................................103
2.1.21.13. Plan national de prévention des déchets prévu à l’article L. 541-11 du code de l’environnement...103 2.1.21.14. Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l’article
L. 541-13 du code de l’Environnement...........................................................................................................................104
2.1.21.15. Autres plans, schémas, programmes et autres documents de planification référencés par l’article R.
122-17 du code de l’Environnement, visés dans le cadre de l’analyse, mais non concernés par
l’incidence potentielle du projet ................................................................................................................105
Pièce 2 : étude d’impact
Z:\STEPHANIE\Marbres Cyrnos_1618C11\DA\Som_piece 2.doc
2
Maître d’ouvrage :
2.1.22.
2.2.
Servitudes réglementaires affectant le site ...........................................................................................................108
SCENARIO DE REFERENCE ...............................................................................................................................................113
Justification réglementaire et objectifs recherchés .....................................................................................................113 Etat actuel de l’emprise rattachée au projet ...............................................................................................................113
Evolution probable des milieux en l’absence de concrétisation du projet de renouvellement de la carrière de Terralbe
..................................................................................................................................................................................114
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.
- 2.3.
- ANALYSE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT ...............................................................................116
Impact sur le paysage et les perceptions visuelles .....................................................................................................116 Impact sur les eaux superficielle s . .............................................................................................................................117
2.3.1. 2.3.2.
2.3.2.1. 2.3.2.2.
Impact hydrologique ..................................................................................................................................117 Incidence sur la qualité des eaux superficielles.......................................................................................119
2.3.3. 2.3.4.
Impact sur les eaux souterraine s . ..............................................................................................................................120 Impact sur la faune et la flore....................................................................................................................................121
2.3.4.1. 2.3.4.2.
Préambule ....................................................................................................................................................121 Impact du projet sur la flore ......................................................................................................................121
2.3.5.
2.3.5.1. 2.3.5.2.
Impact du projet d’exploitation sur les zones de type ZNIEFF .................................................................................127
ZNIEFF de type II, « Haut Minervois »....................................................................................................127 ZNIEFF de type I.........................................................................................................................................127
2.3.6. 2.3.7.
Im pact du projet d’exploitation sur les zones de protection rattachées au réseau NATURA 2000 ...........................128
Impact sur les commodités de voisinage....................................................................................................................129
- 2.3.7.1.
- Les bruits ......................................................................................................................................................129
Préambule..............................................................................................................................................129 Rappel concernant les zones à émergences réglementée (ZER) .....................................................129 Approche théorique .............................................................................................................................129
2.3.7.1.1. 2.3.7.1.2. 2.3.7.1.3.
- 2.3.7.2.
- Les vibrations...............................................................................................................................................137
Cas de l’activité d’extraction ...............................................................................................................137 Cas de l’installation de traitement des matériaux ............................................................................138
2.3.7.2.1. 2.3.7.2.2.
- 2.3.7.3.
- Les projections .............................................................................................................................................138
Cas de l’activité d’extraction ...............................................................................................................138 Activité de traitement des matériaux de découverte .......................................................................139
2.3.7.3.1. 2.3.7.3.2.