Notice D Impact
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ville De Felletin Procès Verbal De La Séance Du
VILLE DE FELLETIN PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2010 L’an deux mil dix , le jeudi 14 octobre 2010 à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de FELLETIN se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Renée NICOUX, Maire, au lieu habituel de ses séances, en Mairie. Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 Etaient présents Mmes NICOUX Renée, FINET Karine, SIRIEIX Nelly, MIGNATON Joëlle PERRUCHET Jeanine, FOURNET Marie-Hélène, SAINTEMARTINE Danielle ; MM. DELARBRE Jean Louis, DAROUSSIN David, LAUBY Jean-Pierre, HARTMANN Michel, NABLANC Christophe, COLLIN Philippe, CLUZEL Eric, DOUEZY Benoît, AUBRUN Michel. Etaient représentés M. Daniel THOMASSON donnant pouvoir à M. Jean-Louis DELARBRE M. Serge MARTINAT donnant pouvoir à Mme Jeanine PERRUCHET M. Denis PRIOURET donnant pouvoir à Mme Danielle SAINTEMARTINE Administration : M. le Secrétaire Général et M. le Responsable des services techniques. - Approbation du compte-rendu de la précédente réunion Madame le Maire demande aux conseillers s’ils ont pris connaissance du compte-rendu de la précédente séance et s’ils ont des observations à formuler. Après en avoir délibéré, le Conseil adopte le compte rendu de la séance précédente à l’unanimité. - Désignation d’un secrétaire de séance M. Benoît DOUEZY est désigné secrétaire de la séance conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. - Ordre du jour Madame le Maire propose au Conseil l’ajout des points suivants à l’ordre du jour : - Hygiène et sécurité : nomination d’un A.C.M.O. - Convention avec le Conseil général pour une candidature à un Pôle d’Excellence Rurale Adopté à l’unanimité. -

Conseil Communautaire Du 18 09 2019
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 18 SEPTEMBRE 2019 COMPTE RENDU L'An Deux Mille dix-neuf, le dix-huit septembre, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Creuse Confluence », convoqué le 09 septembre 2019, s'est réuni à la salle des fêtes de Pionnat, sous la présidence de Monsieur Nicolas SIMONNET. Etaient présents : MM. : ASPERTI P., BEUZE D., BRIAULT T., CHIRADE G., CONSTANTIN J., COUTURIER L., DECARD J., DELCUZE M., FOULON F., GIBARD P., GIROIX G., GRIMAUD H., HENRY G., JULLIARD C., LESAGE M., MALLERET D., MERAUD S., MORLON P., ORSAL P., PAPINEAU B., PICHON R., PRUCHON J., RIVA F., SAINTEMARTINE J-C., SIMONNET N., TOURAND B., TOURAND C., MMES : ANNEQUIN A., AUFRERE M., BUNLON D., BUNLON M-C., CHARDIN M-H., CREUZON C., DUMOND M., FERRION M., GLOMEAUD N., HENRY E., PIERRON M- T., SAUVE L., ROMAINE R., VIALLE M-T. Excusé(e)s : MM : ALANORE J-B, CHASSAGNE G., COLLINET F., DERBOULE R., JANNOT S. (pouvoir à RIVA F.), JOUANNETON M., ROBY J-P. THOMAZON G., THOMAZON Y., TURPINAT V., VICTOR C. (pouvoir à MERAUD S.). MMES : BRIAT O., GRAVERON C., MARTIN J. Absent(e)s non excusés (es) : M. : DURAND D. MMES : BRIDOUX A., ROBY C. Secrétaire de séance : Monsieur PRUCHON Jean Monsieur Gilles HENRY a quitté la séance après la délibération « Restructuration du cinéma d’Evaux-les-Bains - Résultats Consultation Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé ». Communauté de Communes Creuse Confluence CONSEIL COMMUNAUTAIRE Séance du 18 septembre 2019 Octroi de subvention aux Associations – Complément de la délibération du 12 juin 2019 A la suite de l’examen des demandes de subventions des Associations par la Commission Sports et Culture du 02 septembre 2019 et par le Bureau de la Communauté de Communes du 11 septembre 2019, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer les subventions aux associations d’intérêt communautaire présentées et donne lecture du tableau annexé à la présente délibération. -
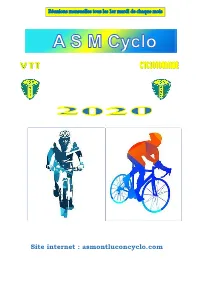
Site Internet : Asmontluconcyclo.Com
Site internet : asmontluconcyclo.com PARCOURS 2020 Parcours route 1- Départ des sorties : IMPERATIVEMENT DU TROC de L'ILE à 13h30 ou 13h15 les mercredi et samedi. Les Cyclos habitant du coté de St Jean peuvent nous attendre au carrefour de la route de VILLEBRET - Néris quand les parcours partent dans la direction de St GENEST ou VILLEBRET. 2- Vous devez IMPERATIVEMENT RESPECTER LE DEBUT DU PARCOURS car des cyclos de l'ASM viennent rejoindre le groupe dans les 20 premiers kms. 3- L'heure de départ de certains circuits pour des concentrations sont marqués sur le calendrier. 4- De janvier à fin mars et d'octobre à fin décembre le circuit est en sens inverse le mercredi. 5- De juin à fin août, les départs des sorties peuvent être à 8h du TROC de L'ILE. Voir l'info dans le menu déroulant de la page d’accueil de notre site internet asmontluconcyclo.com. 6- Les distances ont été calculées du départ au TROC de L'ILE et arrivée au TROC de L'ILE. 7- Tous les parcours ont été vérifiés sur le site openrunner, ils peuvent avoir une erreur de ± 2% . 8- Les communes traversées sont écrites en MAJUSCULES et le lieu-dit en Minuscules. 9- Sur les parcours vous pouvez trouver ces annotations : BUXIERES LES MINES - Continuer sur D68 sur 4,75km puis à gauche D11 sur 3,5km puis à droite D459 (VIEURE) - La Salle (lieu-dit), cela veut dire qu'après les 3,5km, vous prenez la D459 en direction de VIEURE sans passer dans la commune. -

National Regional State Aid Map: France (2007/C 94/13)
C 94/34EN Official Journal of the European Union 28.4.2007 Guidelines on national regional aid for 2007-2013 — National regional State aid map: France (Text with EEA relevance) (2007/C 94/13) N 343/06 — FRANCE National regional aid map 1.1.2007-31.12.2013 (Approved by the Commission on 7.3.2007) Names of the NUTS-II/NUTS-III regions Ceiling for regional investment aid (1) NUTS II-III Names of the eligible municipalities (P: eligible cantons) (Applicable to large enterprises) 1.1.2007-31.12.2013 1. NUTS-II regions eligible for aid under Article 87(3)(a) of the EC Treaty for the whole period 2007-2013 FR93 Guyane 60 % FR91 Guadeloupe 50 % FR92 Martinique 50 % FR94 Réunion 50 % 2. NUTS-II regions eligible for aid under Article 87(3)(c) of the EC Treaty for the whole period 2007-2013 FR83 Corse 15 % 3. Regions eligible for aid under Article 87(3)(c) of the EC Treaty for the whole period 2007-2013 at a maximum aid intensity of 15% FR10 Île-de-France FR102 Seine-et-Marne 77016 Bagneaux-sur-Loing; 77032 Beton-Bazoches; 77051 Bray-sur-Seine; 77061 Cannes-Ecluse; 77073 Chalautre-la-Petite; 77076 Chalmaison; 77079 Champagne-sur-Seine; 77137 Courtacon; 77156 Darvault; 77159 Donnemarie-Dontilly; 77166 Ecuelles; 77167 Egligny; 77170 Episy; 77172 Esmans; 77174 Everly; 77182 La Ferté-Gaucher; 77194 Forges; 77202 La Genevraye; 77210 La Grande-Paroisse; 77212 Gravon; 77236 Jaulnes; 77262 Louan- Villegruis-Fontaine; 77263 Luisetaines; 77275 Les Marêts; 77279 Marolles-sur-Seine; 77302 Montcourt-Fromonville; 77305 Montereau-Fault-Yonne; 77325 Mouy-sur-Seine; 77333 Nemours; 77379 Provins; 77396 Rupéreux; 77403 Saint-Brice; 77409 Saint-Germain-Laval; 77421 Saint-Mars-Vieux- Maisons; 77431 Saint-Pierre-lès-Nemours; 77434 Saint-Sauveur-lès-Bray; 77452 Sigy; 77456 Soisy-Bouy; 77467 La Tombe; 77482 Varennes-sur-Seine; 77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine; 77519 Villiers-Saint-Georges; 77530 Voulton. -
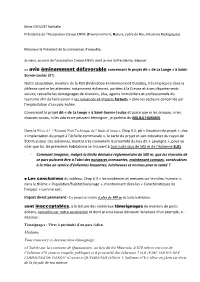
C29-Creuseenvie-03122020
Mme CROUZET Nathalie Présidente de l’Association Creuse ENVIE (Environnement, Nature, cadre de Vie, Initiatives Ecologiques) Monsieur le Président de la commission d’enquête, Je viens, au nom de l’association Creuse ENVIE dont je suis la Présidente, déposer un avis éminemment défavorable concernant le projet dit « de La Longe » à Saint- Sornin-Leulac (87). Notre association, membre de la FED (Fédération Environnement Durable), très impliquée dans la défense contre les atteintes, notamment éoliennes, portées à la Creuse et à ses départements voisins, recueille les témoignages de riverains, élus, agents immobiliers et professionnels du tourisme afin de faire savoir « les nuisances et impacts factuels » dans les secteurs concernés par l’implantation d’un parc éolien. Concernant le projet dit « de La Longe » à Saint-Sornin-Leulac et parce que ni les oiseaux, ni les chauves-souris, ni les arbres ne peuvent témoigner, je parlerai du MILIEU HUMAIN. Dans la Pièce 4.1 – Résumé Non Technique de l’étude d’impact, Chap 3.1, p6 « Situation du projet », doc « implantation du projet à l’échelle communale », la carte du projet et son indication du rayon de 500 m autour des éoliennes, montre très clairement la proximité du lieu dit « Lavergne », pour ne citer que lui, les premières habitations se trouvant à tout juste plus de 500 m de l’éolienne SL01. - Comment imaginer, malgré la limite dérisoire réglementaire de 500 m, que les riverains de ce parc puissent être à l’abri des nuisances incessantes, maintenant connues, consécutives à la mise en service d’éoliennes bruyantes, lumineuses et nocives pour la santé ? ■ Les conclusions du tableau, Chap 6.3 « les incidences et mesures sur le milieu humain », dans le thème « Population/habitat/voisinage », mentionnant dans les « Caractéristiques de l’impact » comme suit, Impact direct permanent - Le projet se trouve à plus de 500 m de toute habitation. -
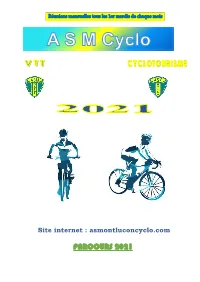
Parcours 2021
Site internet : asmontluconcyclo.com PARCOURS 2021 Parcours route 1- Départ des sorties : IMPERATIVEMENT DU TROC de L'ILE à 13h30 ou 13h15 les mercredi et samedi. Les Cyclos habitant du coté de St Jean peuvent nous attendre au carrefour de la route de VILLEBRET - NERIS quand les parcours partent dans la direction de St GENEST ou VILLEBRET. 2- Vous devez IMPERATIVEMENT RESPECTER LE DEBUT DU PARCOURS car des cyclos de l'ASM viennent rejoindre le groupe dans les 20 premiers kms. 3- L'heure de départ de certains circuits pour des concentrations sont marqués sur le calendrier. 4- De janvier à fin mars et d'octobre à fin décembre le circuit est en sens inverse le mercredi. 5- De juin à fin août, les départs des sorties peuvent être à 8h du TROC de L'ILE. Voir l'info dans le menu déroulant de la page d’accueil de notre site internet asmontluconcyclo.com. 6- Les distances ont été calculées du départ au TROC de L'ILE et arrivée au TROC de L'ILE. 7- Tous les parcours ont été vérifiés sur le site openrunner, ils peuvent avoir une erreur de ± 2%. 8- Les communes traversées sont écrites en MAJUSCULES et le lieu-dit en Minuscules. 9- Sur les parcours vous pouvez trouver ces annotations : BUXIERES LES MINES - Continuer sur D68 sur 4,75km puis à gauche D11 sur 3,5km puis à droite D459 (VIEURE) - La Salle (lieu-dit), cela veut dire qu'après les 3,5km, vous prenez la D459 en direction de VIEURE sans passer dans la commune. -

Creuse Confluence (Siren : 200067544)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Creuse Confluence (Siren : 200067544) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Boussac-Bourg Arrondissement Aubusson Département Creuse Interdépartemental non Date de création Date de création 02/11/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Nicolas SIMONNET Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Le Montet Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 23600 BOUSSAC-BOURG Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 16 853 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 16,99 Périmètre Nombre total de communes membres : 42 Dept Commune (N° SIREN) Population 23 Auge (212300909) 96 23 Bétête (212302202) 376 23 Blaudeix (212302301) 103 23 Bord-Saint-Georges (212302608) 361 23 Boussac (212303101) 1 273 23 Boussac-Bourg (212303200) 712 23 Budelière (212303507) 723 23 Bussière-Saint-Georges (212303804) 258 23 Chambonchard (212304604) 85 23 Chambon-sur-Voueize (212304505) 885 23 Clugnat (212306401) 651 23 Cressat (212306807) 548 23 Domeyrot (212307201) 232 23 Évaux-les-Bains (212307607) 1 397 23 Gouzon (212309306) -
Code Postal Code Insee 23150 Ahun 23001
P RÉFECTURE DE LA C REUSE ANNUAIRE DES MAIRIES D E L A CREUSE 12 01 2021 PRÉFÈTE DE LA CREUSE SECRETARIAT GÉNÉRAL LE SERVICE INTERMINISTÉRIEL DÉPARTEMENTAL DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION Guéret, le 12/01/2021 Cet annuaire a été réalisé par le Service Interministériel Départemental des systèmes et d'Information et de Communication Préfecture de la Creuse Place Louis Lacrocq Boîte Postale 79 23 011 GUERET Cedex TÉL : 05.55.51.59.00 FAX : 05.55.52.48.61 Site Internet des Services de L’État en Creuse http://www.creuse.gouv.fr courriel : [email protected] CODE POSTAL CODE INSEE 23150 AHUN 23001 05 55 62 40 24 F a x [email protected] Maire Monsieur Thierry COTICHE SECRÉTAIRE DE MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Autres Mairies : non Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 Samedi CODE POSTAL CODE INSEE 23380 AJAIN 23002 05 55 80 96 19 F a x 05 55 80 96 75 [email protected] Maire Monsieur Guy ROUCHON SECRÉTAIRE DE MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE Lundi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Autres Mairies : non Mardi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Mercredi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Jeudi 8h30 - 12h00 14h00 - 18h00 Vendredi 8h30 - 12h00 14h00 - 17h30 Samedi CODE POSTAL CODE INSEE 23200 ALLEYRAT 23003 05 55 66 89 50 F a x [email protected] Maire Monsieur Guy BRUNET SECRÉTAIRE DE MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE Lundi 13h30 - 18h00 Autres Mairies : Mardi 9h00- 12h00 Mercredi 9h00 - 12h00 Jeudi Vendredi -

Document D'objectifs Et Pour Lesquels Le Document D'objectifs Ne Prévoit Aucune Disposition Financière OBJECTIFS D'accompagnement
DOCUMENT D’OBJECTIFS Site Natura 2000 des Gorges de la Tardes et de la vallée du Cher FR 7401131 Mise à jour validée par le comité de pilotage du 18 octobre 2016 Document d’objectifs Natura 2000 FR7411131 « Gorges de la Tardes et vallée du Cher » (mise à jour août 2016) 2 DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR7401131 « GORGES DE LA TARDES ET VALLEE DU CHER » Maître d’ouvrage Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Nouvelle Aquitaine (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) Structure porteuse Conseil Départemental de la Creuse (depuis juin 2009) Opérateur Office National des Forêts, Agence du Limousin – Direction Territoriale Centre Ouest Auvergne Limousin Rédaction du document d’objectifs Rédaction / Coordination / Cartographie : « Laurent RIVIERE », « Erik JEANTON » Contribution au diagnostic écologique (rédaction / cartographie) : «David SIRIEIX » Contribution / Synthèse / Relecture : « Laurent RIVIERE», « Erik JEANTON » Validation scientifique : « Laurent CHABROL », Conservatoire Botanique National du Massif-Central. (flore et habitats lors de la phase de rédaction du DOCOB) Cartographie des habitats naturels et études écologiques complémentaires Mammifères, Reptiles et Amphibiens : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin Insectes : Société Entomologique du Limousin Odonates : Société Limousine d’Odonatologie Habitats forestiers : Conservatoire Botanique du Massif Central Crédits photographiques (couverture) Laurent RIVIERE, ONF -

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CREUSE Mise À Jour Faite Le 12.12.2013
LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES CREUSE Mise à jour faite le 12.12.2013 AHUN-Fontaine sur la place près de la mairie-Inscrit-Fontaine sur la place près de la mairie : inscription par arrêté du 15 juin 1926- AHUN-Château de Massenon-Inscrit et classé-Porche ; salle au décor peint, située au deuxième étage du corps de logis du 15s (cad. F 446) : classement par arrêté du 18 novembre 1986-Façades et toitures du château du 15s ainsi que celles du bâtiment du 18s et de la tour isolée près des terrasses ; la porte charretière à côté du château du 15s (cad. F 446) : inscription par arrêté du 18 novembre 1986-F 446 AHUN-Château de la Chezotte-Inscrit-Château de la Chezotte : inscription par arrêté du 15 juin 1926- AHUN-Château de Chantemille-Inscrit-Façades et toitures du bâtiment d'habitation (deux corps de bâtiments en équerre et cinq tours, dont l'une quadrangulaire); sols des parcelles correspondantes; mur de soutènement de la terrasse de l'ancienne chapelle. (cad. D 150 et 151) : inscription par arrêté du 28 mars 2000-D 150 et 151 AHUN-Viaduc de Busseau-sur-Creuse-Inscrit-Viaduc de Busseau-sur-Creuse : inscription par arrêté du 15 janvier 1975- AHUN-Eglise Saint-Sylvain-Classé-Eglise, y compris la crypte (cad. AD 85) : classement par arrêté du 2 octobre 1992-AD 85 AJAIN-Eglise de l'Assomption de la Vierge-Classé-Eglise : classement par arrêté du 26 décembre 1930- ALLEYRAT-Eglise Saint-Pierre-Inscrit-Eglise et sa crypte (cad. C 125) : inscription par arrêté du 21 octobre 1963-C 125 ANZEME-Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul-Classé-Eglise, à l'exception de la sacristie (cad. -

Calendrier De Collecte 2020 Secteur Evaux-Chambon Ordures Ménagères / Emballages Recyclables
Calendrier de collecte 2020 Secteur Evaux-Chambon Ordures Ménagères / Emballages Recyclables JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE mercredi 01 samedi 01 dimanche 01 mercredi 01 B vendredi 01 lundi 01 mercredi 01 K samedi 01 mardi 01 H jeudi 01 CL dimanche 01 mardi 01 J2 jeudi 02 FM dimanche 02 lundi 02 A jeudi 02 CI samedi 02 mardi 02 EJ1 jeudi 02 F dimanche 02 mercredi 02 B vendredi 02 D lundi 02 E mercredi 02 M vendredi 03 G lundi 03 A mardi 03 H vendredi 03 D dimanche 03 mercredi 03 K vendredi 03 G lundi 03 A jeudi 03 CL samedi 03 mardi 03 J2 jeudi 03 F samedi 04 mardi 04 H mercredi 04 B samedi 04 lundi 04 E jeudi 04 F samedi 04 mardi 04 H vendredi 04 D dimanche 04 mercredi 04 M vendredi 04 G dimanche 05 mercredi 05 B jeudi 05 CI dimanche 05 mardi 05 J1 vendredi 05 G dimanche 05 mercredi 05 B samedi 05 lundi 05 E jeudi 05 F samedi 05 lundi 06 A jeudi 06 CI vendredi 06 D lundi 06 E mercredi 06 F samedi 06 lundi 06 A jeudi 06 CL dimanche 06 mardi 06 J2 vendredi 06 G dimanche 06 mardi 07 H vendredi 07 D samedi 07 mardi 07 J1 jeudi 07 GK dimanche 07 mardi 07 H vendredi 07 D lundi 07 E mercredi 07 M samedi 07 lundi 07 A mercredi 08 B samedi 08 dimanche 08 mercredi 08 K vendredi 8 lundi 08 A mercredi 08 B samedi 08 mardi 08 J2 jeudi 08 F dimanche 08 mardi 08 H jeudi 09 CI dimanche 09 lundi 09 E jeudi 09 F samedi 09 mardi 09 H jeudi 09 CL dimanche 09 mercredi 09 M vendredi 09 G lundi 09 A mercredi 09 B vendredi 10 D lundi 10 E mardi 10 J1 vendredi 10 G dimanche 10 mercredi 10 B vendredi 10 D -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2017
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 23 CREUSE INSEE - décembre 2016 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2017 Arrondissements - cantons - communes 23 - CREUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction.....................................................................................................23-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................23-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 23-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes..........................................................23-3 INSEE - décembre 2016 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune,