Schema Directeur Modif OK FR
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Archives Départementales De L'isère
Archives départementales de l’Isère Archives du château du Pin 8 J Répertoire numérique détaillé par Elisabeth Rabut conservateur Archives départementales1972 de l’Isère Archives départementales de l’Isère 8 J – Fonds du Château du Pin Le don fait aux Archives de l’Isère en 1946 par le comte Alain du Parc Locmaria ne comprend pas l’ensemble des archives du château du Pin1, dont il était propriétaire du chef de sa mère2, mais celles des familles auxquelles cette demeure a appartenu aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce fonds est constitué pour l’essentiel d’actes et documents provenant de la famille Vincent, dont l’un des membres, Antoine Vincent, avait acquis le château du Pin dans la vente des biens de l’hoirie d’André Basset, seigneur de Saint-Nazaire, en 1646 ; son fils Jean de Vincent, auquel il l’avait donné lors de son mariage en 16633, le fit reconstruire à partir de 1670. A côté de l’éclairage qu’il apporte sur l’histoire de la famille Vincent, l’extension progressive de ses biens dans la région de Montferrat, Paladru, La Buisse, La Tour-du-Pin, son ascension sociale – Guillaume Vincent Merlin est marchand de Montferrat, son petit-fils Antoine, secrétaire au Parlement4, est anobli en 16535, et Jean de Vincent conforte l’insertion de cette famille dans la noblesse de robe par l’achat en 1649 d’un office de trésorier général de France en Dauphiné6, ce fonds est d’un intérêt premier pour les papiers de fonction qu’il contient : recette des décimes du diocèse de Grenoble, activité d’un trésorier général de France en Dauphiné dans la seconde moitié du XVIIe siècle. -

Bulletin Municipal N° 30/2017
P R I M A R E T T E BULLETIN MUNICIPAL [email protected] http://www.primarette.fr n° -2017 SOMMAIRE Le mot du Maire. Déjà décembre… Page 1 : Couverture. 2016 est déjà sur le point de tirer sa Pages 2 et 3 : Le mot du Maire. révérence. Le temps passe décidément très Pages 4 à 10 : Décisions et délibérations du vite, surtout quand, vous êtes accaparés par Conseil Municipal en 2016. la gestion et l’organisation de la vie que ce Page 10 : Etat Civil 2016. soit, à titre personnel ou, comme vos élus, Page 11 : Compte administratif 2015. pour les besoins de la commune et par tous Page 12 : Budget communal 2016. ces moments qui rythment notre quotidien à Page 13 : Hypothèses 2016. tous. Année qui n'aura pas été simple pour un Page 14 : Urbanisme. bon nombre d'entre nous... Page 15 : Travaux 2016 et Cimetière. Page 16 : Agriculture/environnement/CCAS Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai écrit dans plusieurs infos Fleurissement. mairie, mais la situation économique et sociale demeure Page 17 : 2017 : Année de recensement. préoccupante... et la crise touche toutes les corporations ou Pages 18 à 20 : Infos générales. presque sur notre territoire. A cela s’ajoutent les menaces Page 20 : le beau geste du FCC. terroristes, qui même dans nos petites communes nous obligent à Pages 21 et 22 : L'école communale. être vigilants et respectueux des consignes nationales au risque Pages 23 et 24 : Animations en 2016. parfois de vous surprendre. Page 25 : Troc à Prim' - le Livre d'Or 2016, restera pour Primarette comme une année très animée : Page 26 : le SOU des écoles dans des domaines divers et, c’est ce qui est fédérateur, pour Page 27 : les Fils d'Argent intéresser le plus grand nombre d’entre vous mais également des Page 28 : L'A.A.D.P. -

Un Comité Des Fêtes Dynamique Que Nous Ont Accordé Les Électeurs De Viriville En 2014
JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPAL DÉCEMBRE 2019 Un comité des fêtes DOSSIER dynamique www.viriville.fr RETOUR EN IMAGES 6 septembre 20 octobre Les élèves de l’école “la Pérouse de Viriville” ont relevé Le club de La Joie de Vivre a organisé ses portes le défi d’apprendre et de chanter en public une chanson ouvertes : une belle journée autour d’une grande et en quatre jours. Mission accomplie ! bonne paëlla pour les adhérents. 14 novembre 31 octobre Avec la compagnie d’artistes “Infusion”, les classes de Frissons garantis pour la fête d’halloween à l’initiative maternelle et de CP ont vécu une expérience unique sur du Comité des fêtes et du Sou des écoles. La soirée s’est le thème de l’océan, une manière ludique de sensibiliser achevée avec une soupe de potiron et plein de bonbons. à la beauté et aux enjeux de cet écosystème. 17 novembre 135 personnes ont répondu présentes pour le repas de 23 novembre Noël des seniors, un moment convivial et festif dont le La salle du Pont Neuf accueillait le groupe vocal “Les service était assuré par dix ados de 15 ans dynamiques p’tits coeurs” pour une soirée très agréable sur le thème et souriants. du temps qui passe… des chants a capella émouvants. 2 I DÉCEMBRE 2019 RETOUR EN IMAGES sommaire mot ENVIRONNEMENT 4-5 Neige : les bonnes pratiques et informations utiles du maire Les parcelles boisées soumises à rude épreuve Prime Air Bois Déchets : affaire de responsablités Bernard Gillet © AMI DOSSIER 6-7 année 2019 s’achève ainsi que le mandat Un Comité des fêtes dynamique que nous ont accordé les électeurs de Viriville en 2014. -

Rapport Annuel Du Service Déchets 2014
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS ANNEE 2014 Validé en commission le 27 mai 2015 et approuvé en conseil communautaire le 29 juin 2015 www.bievre-isere.com 1 SOMMAIRE PREAMBULE Page 3 A – LES INDICATEURS TECHNIQUES Page 4 1. LE TERRITOIRE DESSERVI Page 4 2. LA COLLECTE Page 6 2.1. Collecte des déchets provenant des ménages Page 8 2.1.1. Organisation des collectes sélectives Page 8 2.1.2. Résultat de la collecte sélective en Point Apport Volontaire Page 9 2.1.3. Résultat de la collecte sélective collecte en sac à La Côte Saint-André Page 10 2.1.4. Fréquence de la collecte Page 12 2.1.5. Collecte des encombrants, collecte spéciale et déchèteries Page 13 2.1.5.1. Collecte spéciale des plastiques agricoles Page 13 2.1.5.2. Collecte des déchets verts des professionnels Page 13 2.1.5.3. Collecte des DASRI pour les particuliers Page 14 2.1.5.4. Déchèteries Page 15 2.1.6. Flux des déchèteries Page 26 2.1.7. Récapitulatif sur l’ensemble des habitants Page 26 B – PROJET ET EVOLUTION EN 2015 Page 28 1. COLLECTE Page 28 2. DECHETERIES Page 28 3. PROJETS Page 28 2 PRÉAMBULE La loi Barnier (loi n°95-101 du 2 février 1995) relative au renforcement de la protection de l’environnement met l’accent sur la transparence et l’information des usagers. Dans cet objectif, la loi précise que chaque président d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit présenter «un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers» avant une mise à disposition du public. -

Liste Des Marchés Par Tranche
LISTE DES MARCHÉS PASSÉS EN 2017 MONTANT H.T. OBJET DATE ATTRIBUTAIRE TRANCHE 4 000 à 19 999.99 8 340,00 € Réaménagement accueil mairie - Electricité courants faibles février-17 BMEG - 38570 LE CHEYLAS 14 350,00 € Réaménagement accueil mairie - Entreprise générale février-17 Euroconfort - 38100 GRENOBLE 4 500,00 € Réparation grille stade - Réparation Immeuble le Fay février-17 EGPI – 38570 LE CHEYLAS 5 411,00 € Changement ballon eau chaude vestiaires foot février-17 MENGOLLI – 38570 LE CHEYLAS 4 450,00 € Curage bassin Abbaye mars-17 EGPI – 38570 LE CHEYLAS 13 602,78 € Travaux Electricité mars-17 ENEDIS - 38040 GRENOBLE 4 200,80 € Video Salle des Mariages - Salle du Conseil avril-17 BMEG - 38570 LE CHEYLAS 4 127,60 € Entretien Tracto Pelle TEREX 860SX avril-17 PAYANT - 38420 DOMENE 9 100,00 € MO rénovation cuisine et sanitaires Restaurant avril-17 FOGGETTI -38570 LE CHEYLAS 7 084,00 € Remplacement porte boulodrome avril-17 ALU SPINACE – 38660 LE TOUVET 4 015,32 € Vêtements de travail - Chaussures sécurité avril-17 VINAY MATERIEL 14 012,50 € Tondeuse Mulching - Broyeur à branches avril-17 AGRIMA CHATAIN 4 430,00 € Déplacement borne de puisage ZA Actisère avril-17 EGPI – 38570 LE CHEYLAS 16 081,00 € Aménagement Parc Belledonne avril-17 AVP - 38400 ST MARTIN D'HERES 4 271,24 € Plan vasques salle des Fêtes avril-17 MENGOLLI – 38570 LE CHEYLAS 6 497,80 € Blocs de secours SDF et Gymnase mai-17 M2EI - 73291 LA MOTTE SERVOLEX 4 125,00 € Peintures intérieures - Multiaccueil juin-17 SABELLA Angelo - 38570 LE CHEYLAS 12 135,50 € Peintures intérieures -

Téléchargez Le Document
MOIRANS MAGAZINE Janvier L’équipe municipale présente ses vœux aux Moirannais Rétrospective p 4 Rencontre avec le Secours Populaire p13 N° 1107 - 2021 www.ville-moirans.fr Retrouvez-nous sur Facebook / ville de Moirans-Officiel et sur l'appli Politeia France ENVIRONNEMENT Travaux Collecte des déchets : ACTUS rappel des nouvelles consignes ! La collecte de déchets ménagers est assurée par le Pays Voironnais. Depuis le 2 novembre, des évolutions dans l’organisation de cette collecte ont provoqué quelques difficultés. La situation à Moirans étant devenue inacceptable, la Municipalité a saisi le Pays Voironnais et les bailleurs pour trouver des solutions rapides et fournir davantage de containers. Des travaux à l’église Saint-Pierre Rappel des nouvelles mesures : Suite à la casse d’une pièce majeure de la charpente de la La collecte se déroule entre 4h et 17h. Il est impératif de sacristie, la Municipalité a engagé des travaux en urgence. sortir vos bacs la veille au soir de votre jour de collecte L’entreprise Annequin Frères a été retenue pour intervenir dès (poignées dirigées vers la chaussée). Rentrez-les dès que le mois de janvier : la poutre centrale a été remplacée et la possible après le passage du camion. toiture sera refaite avec toutes les précautions qu’impose cet Attention ! Les collectes les jours fériés sont supprimées et édifice classé au titre des Monuments Historiques. La DRAC rattrapées le mercredi de la même semaine du jour férié. apporte un soutien financier à hauteur de 40%. Le bac bleu ne peut plus être utilisé pour la collecte des déchets, même peint ! Si vous ne souhaitez plus le Un espace multisports au Vergeron conserver, vous pouvez apporter votre bac bleu dans l’une Afin de remplacer les équipements derrière le gymnase des 8 déchèteries du Pays Voironnais. -
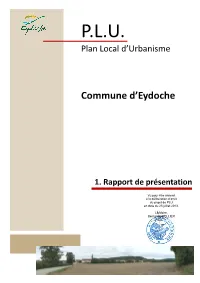
P.L.U. Plan Local D’Urbanisme
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme Commune d’Eydoche 1. Rapport de présentation Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt du projet de PLU en date du 25 juillet 2013. Le Maire, Bernard GROLLIER SOMMAIRE 1 DIAGNOSTIC COMMUNAL ................................................................................ 5 1.1 LA POPULATION ................................................................................................... 6 1.1.1 Les principales évolutions de la population .......................................................................... 6 1.1.2 Les facteurs d’évolution ........................................................................................................ 8 1.1.3 La structure par âge de la population ................................................................................... 9 1.1.4 Les ménages .......................................................................................................................... 9 1.1.5 Une mobilité faible des ménages ........................................................................................ 11 1.2 L’HABITAT .............................................................................................................12 1.2.1 Le parc immobilier ............................................................................................................... 12 1.2.2 Evolution récente de la construction .................................................................................. 15 1.2.3 La typologie du bâti ............................................................................................................ -

Baux Du Domaine Public Geres Par Les Aappma 38 Maj : 26/06/2018
BAUX DU DOMAINE PUBLIC GERES PAR LES AAPPMA 38 MAJ : 26/06/2018 Cours d'eau Lot Libellé Taille Limite amont Limite aval AAPPMA gestionnaire Bourne LAC Retenue de Choranche 24 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau PONT EN ROYANS Bréda LAC Retenue du Flumet 64,5 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau ALLEVARD Bréda PE Plan d'eau du Curtillard 4 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau LA FERRIERE Drac LAC Retenue de Monteynard-Avignonet 660 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau MONTEYNARD Drac LAC Retenue de Ndame de Commiers 170 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau ST GEORGES DE COMMIERS Drac LAC Retenue de St Pierre de Mearotz 124 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau LA MURE Drac LAC Retenue du Sautet 350 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau CORPS Drac Drac Amont 5 km Vieux pont de PONT DE CLAIX Limite communale entre GRENOBLE et ECHIROLLES PONT DE CLAIX Drac Drac Aval 5,1 km Limite communale entre GRENOBLE et ECHIROLLES Seuil DDE GRENOBLE Furon LAC Retenue d'Engins 1,2 ha Celle du plan d'eau Celle du plan d'eau SASSENAGE Isère A15 Le Cheylas 5,75 km Pont de CHEYLAS Pont de GONCELIN LE CHEYLAS Isère A16 Goncelin 11,3 km Pont de GONCELIN Pont de BRIGNOUD BELLEDONNE Isère A17 Brignoud 9,2 km Pont de BRIGNOUD Pont de DOMENE, y compris les plans d'eau de la Boucle du Bois Français BELLEDONNE Isère A18 Domène 8,2 km Pont de DOMENE Pont de la RN 87 (Rocade Sud) BELLEDONNE Isère A19 Grenoble 7,2 km Pont de la RN 87 (Rocade Sud) Pont Marius Gontard à GRENOBLE GRENOBLE Isère A20 Grenoble 4,8 km Pont Marius GONTARD à GRENOBLE Pont SNCF (limite amont du remous de la retenue de ST EGREVE) GRENOBLE Le pont SNCF (limite amont du remous de la retenue de ST EGREVE sur l'ISERE) et le Isère B1 St Egrève 4,4 km seuil le plus à l'aval sur le DRAC dit ''seuil DDE''. -

Action Cœur De Ville !
N°282 Janvier 2020 Bilieu, MCharancieu, AGPays Voironnais Charavines, Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, La Murette, La Sure en Chartreuse, Les Villages du Lac de Paladru, DOSSIER Massieu, Merlas, p Moirans, 14 Action Montferrat, Réaumont, Cœur Rives, Tullins, Saint-Aupre, de Ville ! Saint-Blaise du Buis, Saint-Bueil, Saint-Cassien, Saint-Étienne de Crossey, Saint-Geoire en Valdaine, Saint-Jean de Moirans, Saint-Nicolas de Macherin, Saint-Sulpice des Rivoires, Velanne, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey ILS FONT EN DIRECT La Communauté le Pays Voironnais de la Communauté à votre SERVICE n Décisions du Conseil n Par ici musée ! Communautaire : n Pascal n Des titres de transport adaptés Fortoul solidarités, aménagement, à vos besoins et à vos moyens ! p6 environnement, économie www paysvoironnais com n LA RÉTRO EN IMAGES n ILS FONT LE PAYS VOIRONNAIS Demain est un autre jour P7-12 ACTUALITÉS n Un syndicat au service de la mobilité des habitants n Des accompagnements pour plus de lien ! n AGENDA & CULTURE n GRAND ANGLE P13-18 EN DIRECT de la Communauté n DOSSIER ACTION Cœur DE VILLE ! n Les décisions du Conseil Communautaire JEAN-PAUL BRET Président de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais P19-23 La Communauté LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à votre SERVICE LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ vous adressent, ainsi qu’aux personnes qui vous sont chères, n Prévenir le suicide leurs meilleurs vœux n Eau-assainissement : qui fait quoi ? n Zoom sur le futur Musée archéologique n Par ici musée ! n Des titres de transport adaptés à vos besoins et à vos moyens ! n Relever ce nouveau défi Zéro Déchet ! Directeur de publication : Jean-Paul Bret Conception : New Deal Rédaction : Sandra Bonnin, Sophie Harmand, New Deal Photos : C. -

Territoire Voironnais-Chartreuse (41 Communes)
Territoire Voironnais-Chartreuse (41 communes) Code Commune Intercommunalité Code Commune Intercommunalité 38028 La Bâtie-Divisin CA du Pays Voironnais 38373 Saint-Cassien CA du Pays Voironnais 38043 Bilieu CA du Pays Voironnais 38383 Saint-Étienne-de-Crossey CA du Pays Voironnais 38061 La Buisse CA du Pays Voironnais 38386 Saint-Geoire-en-Valdaine CA du Pays Voironnais 38080 Charancieu CA du Pays Voironnais 38400 Saint-Jean-de-Moirans CA du Pays Voironnais 38082 Charavines CA du Pays Voironnais 38407 Saint-Julien-de-Raz CA du Pays Voironnais 38084 Charnècles CA du Pays Voironnais 38432 Saint-Nicolas-de-Macherin CA du Pays Voironnais 38105 Chirens CA du Pays Voironnais 38460 Saint-Sulpice-des-Rivoires CA du Pays Voironnais 38133 Coublevie CA du Pays Voironnais 38517 Tullins CA du Pays Voironnais 38222 Massieu CA du Pays Voironnais 38531 Velanne CA du Pays Voironnais 38228 Merlas CA du Pays Voironnais 38563 Voiron CA du Pays Voironnais 38239 Moirans CA du Pays Voironnais 38564 Voissant CA du Pays Voironnais 38256 Montferrat CA du Pays Voironnais 38565 Voreppe CA du Pays Voironnais 38270 La Murette CA du Pays Voironnais 38566 Vourey CA du Pays Voironnais 38292 Paladru CA du Pays Voironnais 38155 Entre-deux-Guiers CC Coeur de Chartreuse 38305 Le Pin CA du Pays Voironnais 38236 Miribel-les-Échelles CC Coeur de Chartreuse 38312 Pommiers-la-Placette CA du Pays Voironnais 38376 Saint-Christophe-sur-Guiers CC Coeur de Chartreuse 38331 Réaumont CA du Pays Voironnais 38405 Saint-Joseph-de-Rivière CC Coeur de Chartreuse 38337 Rives CA du Pays Voironnais -

GRAND DEBAT NATIONAL DU 6 FEVRIER 2019 a PLAN (ISERE) Réunion D'initiative Locale Organisée Par Les Maires De : Plan, La
GRAND DEBAT NATIONAL DU 6 FEVRIER 2019 A PLAN (ISERE) Réunion d’initiative locale organisée par les Maires de : Plan, La Forteresse, Brion, Saint-Geoirs, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Saint-Paul d’Izeaux et animée par Monique LIMON Députée 7ème circonscription Isère. FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES - Dépenses publiques : pourquoi l’Etat n’est-il pas contraint de voter son budget à l’équilibre ? C’est un premier principe d’équité à l’égard des collectivités locales. - Il faut réduire les dépenses de l’Etat, le train de vie des élus, les déplacements. - Principe d’équité sur le régime des retraites des Elus par rapport à celui des salariés. - Les privilèges des élus, durée d’indemnisation, avantages conservés après la fin de leur mandat. Le train de vie des élus est démesuré. - Les préconisations pour changer de véhicule ne sont pas réalistes, pas abordables. Les gens n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule électrique. - Les retraites devraient être indexées sur l’inflation. - Il faut contrôler les abus : les entreprises qui n’ont pas répondu aux objectifs de création d’emplois et d’investissements (modulation ISF). - Transparence : comment est utilisé l’impôt. - Taxer les dividendes et reverser aux salariés. Les salaires n’augmentent pas depuis 30 ans. - Il faut que les députés organisent des réunions pour informer de l’utilisation de l’argent public de l’Etat. - Réduction du nombre de députés et des sénateurs (avis divergents). - Empilage des collectivités. Trop de strates avec des coûts supplémentaires. - Taxe d’habitation, comment va-t-elle être compensée ? - Pourquoi la taxe d’habitation et pas le foncier bâti (impôt injuste). -

Région Rhône Alpes : Liste Commune Par Zone
Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 1 Ain Ambérieux-en-DombesRhône-Alpes C 1 Ain Ambléon Rhône-Alpes C 1 Ain Ambronay Rhône-Alpes C 1 Ain Ambutrix Rhône-Alpes C 1 Ain Andert-et-CondonRhône-Alpes C 1 Ain Anglefort Rhône-Alpes C 1 Ain Apremont Rhône-Alpes C 1 Ain Aranc Rhône-Alpes C 1 Ain Arandas Rhône-Alpes C 1 Ain Arbent Rhône-Alpes C 1 Ain Arbignieu Rhône-Alpes C 1 Ain Arbigny Rhône-Alpes C 1 Ain Argis Rhône-Alpes C 1 Ain Armix Rhône-Alpes C 1 Ain Artemare Rhône-Alpes C 1 Ain Asnières-sur-SaôneRhône-Alpes C 1 Ain Attignat Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-la-Ville Rhône-Alpes C 1 Ain Bâgé-le-Châtel Rhône-Alpes C 1 Ain Baneins Rhône-Alpes C 1 Ain Béard-GéovreissiatRhône-Alpes C 1 Ain Beaupont Rhône-Alpes C 1 Ain Belley Rhône-Alpes C 1 Ain Belleydoux Rhône-Alpes C 1 Ain Bellignat Rhône-Alpes C 1 Ain Belmont-LuthézieuRhône-Alpes C 1 Ain Bénonces Rhône-Alpes C 1 Ain Bény Rhône-Alpes C 1 Ain Béon Rhône-Alpes C 1 Ain Béréziat Rhône-Alpes C 1 Ain Bettant Rhône-Alpes C 1 Ain Bey Rhône-Alpes C 1 Ain Billiat Rhône-Alpes C 1 Ain Birieux Rhône-Alpes C 1 Ain Biziat Rhône-Alpes C 1 Ain Blyes Rhône-Alpes C 1 Ain Bohas-Meyriat-RignatRhône-Alpes C 1 Ain Boissey Rhône-Alpes C 1 Ain Bolozon Rhône-Alpes C 1 Ain Bouligneux Rhône-Alpes C 1 Ain Bourg-Saint-ChristopheRhône-Alpes C 1