Plan Local D'urbanisme Du MONT DE BERRU Annexes E2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Annuel Prix Et Qualité Du Service Public D’Élimina� on Des Déchets 2016
Rapport Annuel Prix et qualité du service public d’élimina on des déchets 2016 Sycodec Plaine et Montagne Rémoises BP 58 - 51500 Rilly-la-Montagne Tél. : 03 26 05 40 78 Fax. : 03 26 05 40 79 Sommaire Chapitre I Présenta on Générale du Service 1 I Le territoire du Sycodec 1 1.1 La popula on des collec vités adhérentes au 1er janvier 2016 2 II Organisa on générale des services 3 2.1 Compétences 3 2.2 Fonc onnement administra f 3 2.3 La collecte des déchets en porte à porte 4 2.4 La collecte des déchets en apport volontaire 5 2.5 La redevance spéciale pour les professionnels 7 Chapitre II Indicateurs techniques 8 I Schéma général de l’organisa on des déchets 8 II La collecte des déchets ménagers 9 2.1 Les tonnages collectés en porte à porte et dans les bornes à verre(1) 9 2.2 Les ordures ménagères résiduelles 10 2.3 La collecte sélec ve 11 2.4 Les taux de refus par secteur 12 III La collecte des déchets en déchèteries 13 3.1 Les tonnages collectés en déchèteries 13 3.2 Les déchets non ménagers 14 3.3 Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 15 3.4 Les déchets dangereux des ménages 16 3.5 La fréquenta on des déchèteries 17 IV Bilan des tonnages collectés en 2016 18 V La maintenance des bacs 20 5.1 Les livraisons de bacs 20 VI Les professionnels en déchèteries 21 6.1 Passages payants et m3 déposés en déchèteries des usagers professionnels et services publics 21 Chapitre III Indicateurs fi nanciers 22 I Bilan des charges et produits 22 II Les principaux inves ssements réalisés en 2016 23 III Détail des coûts de traitement et rece -

Télécharger Le Dépliant Des Horaires
Ligne 230 AUMÉNANCOURT - REIMS Ligne 240 POMACLE - WITRY - REIMS Auménancourt > Reims Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Mercredi Samedi Pomacle > Witry > Reims Période scolaire oui oui oui oui oui oui oui Période vacances scolaires oui oui oui oui oui oui oui Toute l’année Lundi à Vendredi Samedi Place de la mairie 06:59 06:59 08:00 08:11 06:59 06:59 08:00 08:11 13:40 13:40 06:59 08:59 13:40 13:40 POMACLE Grand Place 06:41 --- --- --- --- --- 13:06 --- --- --- --- --- --- 06:41 --- 13:06 ST-ETIENNE-SUR-SUIPPE Abri D20 07:00 07:00 08:01 08:12 07:00 07:00 08:01 08:12 13:41 13:41 07:00 09:00 13:41 13:41 LAVANNES Abri église 06:48 --- --- --- --- --- 13:13 --- --- --- --- --- --- 06:48 --- 13:13 AUMÉNANCOURT-LE-GRAND Mairie 07:03 07:03 08:04 08:15 07:03 07:03 08:04 08:15 13:44 13:44 07:03 09:03 13:44 13:44 CAUREL Mairie 06:53 --- --- --- --- --- 13:18 --- --- --- --- --- --- 06:53 --- 13:18 AUMÉNANCOURT-LE-PETIT Place de la mairie 07:06 07:06 08:07 08:18 07:06 07:06 08:07 08:18 13:47 13:47 07:06 09:06 13:47 13:47 Chantereine 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:25 14:55 15:50 16:50 17:55 19:20 20:05 07:00 10:00 13:25 Église 07:10 07:10 --- --- 07:10 07:10 --- --- 13:51 13:51 07:10 09:10 13:51 13:51 Gambetta 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:27 14:57 15:52 16:52 17:57 19:22 20:07 07:02 10:02 13:27 PONTGIVART WITRY- Arrêt 5 rue de la Libération 07:12 07:12 --- --- 07:12 07:12 --- --- 13:53 13:53 07:12 09:12 13:53 13:53 LÈS-REIMS Conio 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:29 14:59 15:54 16:54 17:59 19:24 20:09 07:04 10:04 13:29 BOURGOGNE -

Niveau a Niveau B
NIVEAU A NIVEAU B Poule A Poule B Poule C Poule D 4 équipes 4 équipes 4 équipes 4 équipes 1A Tinqueux 1B Vitry 1C Witry/Reims 2 1D St-Memmie 2 2A Taissy 2B Epernay 2C RS Espérance 2D Prunay 3A Fagnières 3B St-Martin/Pré 3C Sezanne RC 2 3D Berru/Lavannes 4A Dizy 4B RS Neuvillette 4C Gueux 3 4D Taissy 3 10h00 ARRIVEE DES EQUIPES : Feuille de match et dépôt des licences 10h20 REUNION AVEC LES RESPONSABLES D'EQUIPES Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain 4 Heure Match (1 x 15') Arbitre Match (1 x 15') Arbitre Match (1 x 15') Arbitre Match (1 x 15') Arbitre Tinqueux Taissy Fagnières Dizy Vitry Epernay St-Martin/Pré RS Neuvillette 10h40 Witry/Reims 2 Sezanne RC 2 St-Memmie 2 Berru/Lavannes Witry/Reims 2 RS Espérance Sezanne RC 2 Gueux 3 St-Memmie 2 Prunay Berru/Lavannes Taissy 3 Tinqueux Fagnières Vitry St-Martin/Pré 11h00 Conduite : Tinqueux Taissy Jonglages : Fagnières Dizy Conduite : Vitry Epernay Jonglages : St-Martin/Pré RS Neuvillette Tinqueux Fagnières Taissy Dizy Vitry St-Martin/Pré Epernay RS Neuvillette RS Espérance Gueux 3 Prunay Taissy 3 11h20 Conduite : Witry/Reims 2 RS Espérance Jonglages : Sezanne RC 2 Gueux 3 Conduite : St-Memmie 2 Prunay Jonglages : Berru/Lavannes Taissy 3 Witry/Reims 2 Sezanne RC 2 RS Espérance Gueux 3 St-Memmie 2 Berru/Lavannes Prunay Taissy 3 Taissy Dizy Epernay RS Neuvillette 11h40 Conduite : Fagnières Dizy Jonglages : Tinqueux Taissy Conduite : St-Martin/Pré RS Neuvillette Jonglages : Vitry Epernay Vitry RS Neuvillette Epernay St-Martin/Pré Tinqueux Dizy Taissy Fagnières Witry/Reims 2 Sezanne RC 2 St-Memmie -

Dates Des Vendanges 2015
Dates d'ouverture de la vendange 2015 Département de l'AISNE Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier AZY-SUR-MARNE 7/9 9/9 7/9 ETAMPES-SUR-MARNE 10/9 10/9 7/9 BARZY-SUR-MARNE 7/9 7/9 5/9 FOSSOY 11/9 10/9 7/9 BAULNE-EN-BRIE 12/9 14/9 11/9 GLAND 11/9 10/9 7/9 BEZU-LE-GUERY 8/9 9/9 8/9 JAULGONNE 11/9 10/9 7/9 BLESMES 11/9 7/9 MEZY-MOULINS 11/9 10/9 7/9 BONNEIL 7/9 9/9 7/9 MONTHUREL 14/9 12/9 10/9 BRASLES 11/9 10/9 7/9 MONTREUIL-AUX-LIONS 8/9 9/9 8/9 CELLES-LES-CONDE 10/9 10/9 10/9 MONT-SAINT-PERE 11/9 10/9 7/9 LA-CHAPELLE-MONTHODON 14/9 14/9 12/9 NESLES-LA-MONTAGNE 10/9 10/9 7/9 CHARLY-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 NOGENTEL 10/9 10/9 7/9 CHARTEVES 7/9 NOGENT-L'ARTAUD 8/9 CHATEAU-THIERRY 11/9 11/9 9/9 PASSY-SUR-MARNE 7/9 7/9 5/9 CHEZY-SUR-MARNE 10/9 10/9 7/9 PAVANT 7/9 8/9 7/9 CHIERRY 11/9 10/9 7/9 REUILLY-SAUVIGNY 10/9 7/9 CONNIGIS 14/9 12/9 10/9 ROMENY-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 COURTEMONT-VARENNES 11/9 10/9 7/9 SAINT-AGNAN 12/9 12/9 10/9 CREZANCY 11/9 10/9 7/9 SAULCHERY 7/9 8/9 7/9 CROUTTES-SUR-MARNE 7/9 8/9 7/9 TRELOU-SUR-MARNE 7/9 11/9 7/9 DOMPTIN 7/9 8/9 7/9 VILLIERS-SAINT-DENIS 7/9 8/9 7/9 ESSOMES-SUR-MARNE 10/9 10/9 8/9 Département de l'AUBE Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier Cru Chardonnay Pinot Noir Meunier AILLEVILLE 3/9 3/9 3/9 FONTETTE 3/9 3/9 3/9 ARCONVILLE 4/9 4/9 4/9 FRAVAUX 4/9 4/9 4/9 ARGANCON 3/9 3/9 3/9 GYE-SUR-SEINE 3/9 3/9 3/9 ARRENTIERES 3/9 3/9 2/9 JAUCOURT 3/9 3/9 3/9 ARSONVAL 3/9 3/9 3/9 LANDREVILLE 3/9 3/9 3/9 AVIREY-LINGEY 4/9 2/9 2/9 LIGNOL-LE-CHATEAU 7/9 7/9 4/9 BAGNEUX-LA-FOSSE 6/9 (4) 4/9 (4) -
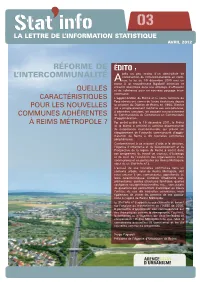
Réforme De L'intercommunalité
03 LA LETTRE DE L’informaTION STATISTIQUE AVRIL 2012 RÉFORME DE ÉDITO : près un peu moins d’un demi-siècle de L’intercOMMUNALITÉ construction de l’intercommunalité en conti- Anue, la loi du 16 décembre 2010 met un terme à un encadrement législatif minimum et s’inscrit désormais dans une stratégie d’efficacité QUELLES et de cohérence pour un nouveau paysage inter- communal. CARACTÉRISTIQUES L’agglomération de Reims et le vaste territoire du Pays rémois ont connu de fortes évolutions depuis la création du District de Reims en 1964. District POUR LES NOUVELLES qui a progressivement renforcé ses compétences, à périmètre constant, en passant successivement COMMUNES ADHÉRENTES de Communautés de Communes en Communauté d’agglomération. À REIMS MÉTROPOLE ? Par arrêté publié le 19 décembre 2011, le Préfet de la Marne a entériné le schéma départemental de coopération intercommunale, qui prévoit un élargissement de l’actuelle communauté d’agglo- mération de Reims à dix nouvelles communes périphériques. Conformément à sa mission d’aide à la décision, l’Agence d’urbanisme et de développement et de Prospective de la région de Reims a inscrit dans son programme de travail un exercice d’éclairage et de suivi de l’évolution des organisations inter- communales et en particulier sur Reims Métropole, objet de ce Stat’info n°3. L’accueil de ces nouvelles communes dans un contexte urbain, celui de Reims Métropole, doit nous amener à une connaissance approfondie de leurs caractéristiques. Combien d’habitants sup- plémentaires, quelles structures familiales, quelles catégories socioprofessionnelles, etc… sont autant de questions qui permettront d’anticiper au mieux l’arrivée de ces dix nouvelles communes, mais également de cerner les attentes de ces popula- tions à l’égard de Reims Métropole. -

Cartographie Des Réseaux De Défense Du Front Ouest Durant La Première
Cartographie des réseaux de défense du front ouest durant la Première Guerre Mondiale à différentes échelles Le programme de recherche « Emergence » IMPACT 14-18 a, entre autre, pour objectif d’étudier l’organi- 590000 680000 770000 860000 950000 1040000 sation spatiale des réseaux de défense en Champagne-Ardenne durant la Grande Guerre vis-à-vis de Légende : Dunkerque Classes d'altitude (mètres) : 7120000 R! la géomorphologie. Cette étude sous SIG replace dans leur contexte environnemental les infrastructures 0 40 Ville fortifiée du premier réseau 100 150 250 400 600 BELGIQUE 1000 2000 Séré de Rivières Frontières actuelles Ville fortifiée du second réseau militaires digitalisées à partir des plans directeurs produits par les Groupes de Canevas de Tir des Lille Frontière franco-allemande en 1914 Séré de Rivières Territoire annexé par l’Allemagne en 1871 Fort indépendant Armées (GCTA). Ces documents constituent une formidable banque de données cartographiques, posant Arras ! Réseau hydrographique Localité R!R R! Front de cuesta Couloir privilégié d’invasion ; trouée Maubeuge 7040000 Arras R! Limite des massifs anciens Front au 15/11/1914 les bases de la cartographie moderne (Projection Lambert, courbes de niveaux,...). R! R! Trouée de Massif Ardennais Chimay Amiens R! R! 765000 770000 775000 780000 La Suippe La Fère R! ! LUXEMBOURG Rideau 4 Légende : 6960000 Laon ! R! R! Classes d’altitude (mètres) : Trouée de ALLEMAGNE Reims Stenay ! Verdun Metz 40 100 135 170 205 330 Châlons- R! sur-Marne R! Paris R! 1ère ligne alliée au 12/10/1917 6880000 -

MARAIS DU MONT DE BERRU a BERRU ET CERNAY (Identifiant National : 210009834)
Date d'édition : 27/10/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009834 MARAIS DU MONT DE BERRU A BERRU ET CERNAY (Identifiant national : 210009834) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 01410001) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210009834, MARAIS DU MONT DE BERRU A BERRU ET CERNAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210009834.pdf Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E. Centroïde calculé : 731107°-2475081° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 10/08/2001 Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020 Date de première diffusion INPN : 23/10/2020 Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 5 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi
Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Grand Est Département : (51) Marne Ville : Reims Liste des communes couvertes : Aougny ((51) Marne), Arcis-le-Ponsart ((51) Marne), Aubérive ((51) Marne), Aubilly ((51) Marne), Auménancourt ((51) Marne), Baconnes ((51) Marne), Baslieux-lès-Fismes ((51) Marne), Bazancourt ((51) Marne), Beaumont-sur-Vesle ((51) Marne), Beine-Nauroy ((51) Marne), Berméricourt ((51) Marne), Berru ((51) Marne), Bétheniville ((51) Marne), Bétheny ((51) Marne), Bezannes ((51) Marne), Bligny ((51) Marne), Bouilly ((51) Marne), Bouleuse ((51) Marne), Boult-sur-Suippe ((51) Marne), Bourgogne ((51) Marne), Bouvancourt ((51) Marne), Branscourt ((51) Marne), Breuil ((51) Marne), Brimont ((51) Marne), Brouillet ((51) Marne), Caurel ((51) Marne), Cauroy-lès-Hermonville ((51) Marne), Cernay-lès-Reims ((51) Marne), Châlons-sur-Vesle ((51) Marne), Chambrecy ((51) Marne), Chamery ((51) Marne), Champfleury ((51) Marne), Champigny ((51) Marne), Chaumuzy ((51) Marne), Chenay ((51) Marne), Chigny-les-Roses ((51) Marne), Cormicy ((51) Marne), Cormontreuil ((51) Marne), Coulommes-la-Montagne ((51) Marne), Courcelles-Sapicourt ((51) Marne), Courcy ((51) Marne), Courlandon ((51) Marne), Courmas ((51) Marne), Courville ((51) Marne), Crugny ((51) Marne), Dontrien ((51) Marne), Écueil ((51) Marne), Époye ((51) Marne), Faverolles-et-Coëmy ((51) Marne), Fismes ((51) Marne), Fresne-lès-Reims ((51) Marne), Germigny ((51) Marne), Gueux ((51) Marne), Hermonville ((51) Marne), Heutrégiville -

CU Du Grand Reims
CCI Marne en Champagne Analyse économique & Data La Communauté Urbaine du Grand Reims Sa présidente : Catherine VAUTRIN Son siège : Reims Sa composition : 143 communes Pop. Pop. Pop. Pop. Commune Commune Commune Commune 2015 2015 2015 2015 Anthenay 70 Chigny-les-Roses 562 Marfaux 140 Saint-Thierry 645 Aougny 103 Cormicy 1 458 Merfy 608 Sarcy 244 Arcis-le-Ponsart 320 Cormontreuil 6 369 Méry-Prémecy 60 Savigny-sur-Ardres 262 Aubérive 225 Coulommes-la-Montagne 218 Montbré 259 Selles 396 Aubilly 50 Courcelles-Sapicourt 358 Montigny-sur-Vesle 526 Sept-Saulx 604 Auménancourt 1 007 Courcy 1 034 Mont-sur-Courville 133 Sermiers 544 Baslieux-lès-Fismes 309 Courlandon 293 Muizon 2 143 Serzy-et-Prin 185 Bazancourt 2 041 Courmas 204 Nogent-l'Abbesse 558 Sillery 1 748 Beaumont-sur-Vesle 789 Courtagnon 63 Olizy 163 Taissy 2 226 Beine-Nauroy 1 028 Courville 465 Ormes 447 Thil 295 Berméricourt 198 Crugny 627 Pargny-lès-Reims 445 Thillois 405 Berru 533 Cuisles 142 Pévy 218 Tinqueux 10 073 Bétheniville 1 281 Dontrien 243 Poilly 95 Tramery 150 Bétheny 6 663 Écueil 307 Pomacle 436 Trépail 432 Bezannes 1 522 Époye 439 Pontfaverger-Moronvilliers 1 743 Treslon 235 Billy-le-Grand 124 Faverolles-et-Coëmy 555 Pouillon 496 Trigny 540 Bligny 124 Fismes 5 434 Pourcy 177 Trois-Puits 156 Bouilly 188 Germigny 187 Prosnes 496 Unchair 163 Bouleuse 207 Gueux 1 668 Prouilly 563 Val-de-Vesle 921 Boult-sur-Suippe 1 701 Hermonville 1 476 Prunay 1 031 Vandeuil 223 Bourgogne-Fresne 1 391 Heutrégiville 406 Puisieulx 411 Vaudemange 303 Bouvancourt 197 Hourges 81 Reims 184 076 Vaudesincourt -

Recueil Des Actes Administratifs
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 10 – 2 octobre 2020 S O M M A I R E Arrêtés du Président du Conseil départemental portant Délégation de signature, Arrêtés du Président du Conseil départemental portant sur la réglementation de la circulation routière, Arrêtés du Président du Conseil départemental portant sur le secteur Médico-Social, Conventions, Délibérations du Conseil départemental Commission permanente du vendredi 25 septembre 2020 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE COMMUNIQUE que le Recueil des Actes Administratifs du Département de la Marne – N° 10 du 2 octobre 2020 - est mis à la disposition du public aux heures d’ouverture des bureaux, à l’Hôtel du Département de la Marne : Direction Générale des Services du Département 2 bis, rue de Jessaint 51038 CHALONS-en-CHAMPAGNE CEDEX ainsi que sur le site du Conseil départemental www.marne.fr (onglet « E-services » ; rubrique «administration») le 2 octobre 2020. AVERTISSEMENT En application des dispositions du règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD), certaines délibérations du Conseil Départemental de la Marne ont été anonymisées. Le texte intégral des actes cités dans ce recueil peut être consulté par les personnes ayant un intérêt légitime à en connaître en vertu du Code de justice administrative à : L’Hôtel du département Direction générale des services Service de l’Assemblée 40, rue Carnot à Châlons en Champagne Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 29/09/2020 à 13h38 Réference de l'AR : 051-225100015-20200929-LC29092020-AR -

Info Foot N° 1
16 septembre 2012 Spécialiste des sports d’équipes Partenaire de l’UFOLEP Marne 14 rue Chanteraine 5100 Reims Tél. :03 26 05 01 20 [email protected] 1/5 Vétérans A 16 septembre 2012 GPR - Auménancourt …………………………………………… 0 - 2 Gazelec - ES Sarcy …………………………………………….. 4 - 2 AC Lusitania 1 - Organismes Sociaux …………….. Vendanges Amis F. Duquesne - AV Bétheny ………………………. 7 - 0 Franco Portugais - Berru Lavanne …………………… Vendanges Forbo Sarlino - Beaumont/Vesle 1 …………………… 0 - 5 Pts J G N P F Pé BP BC D AMIS F. DUQUESNE 4 1 1 0 0 0 0 7 0 + 7 BEAUMONT VESLE 1 4 1 1 0 0 0 0 5 0 + 5 GAZELEC 4 1 1 0 0 0 0 4 2 + 2 AUMENANCOURT 4 1 1 0 0 0 0 2 0 + 2 GPR 1 1 0 0 1 0 0 0 2 - 2 ES SARCY 1 1 0 0 1 0 0 2 4 - 2 FORBO SARLINO 1 1 0 0 1 0 0 0 5 - 5 AV BETHENY 1 1 0 0 1 0 0 0 7 - 7 AC LUSITANIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BERRU LAVANNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ORG. SOCIAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FRANCO PORTUGAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/5 Vétérans B 16 septembre 2012 FC Christo - Cormontreuil ………………………………………… 1 - 1 Arizona - AS Saint Brice …………………………………………. 2 - 1 FC Verzenay - AS Gueux ………………………………………. Vendanges FC Prunay - USV Ludes …………………………………………… Vendanges Sept Saulx - Anciens Rilly ……………………………………… 0 - 4 VS Mourmelon - RFC Cheminots ……………………………. -

L'attestation De Parution Dans La Marne Agricole
ATTESTATION DE PARUTION Cette annonce est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans : Référence annonce : MA104075, N°3704 Nom du journal : La Marne Agricole Département : 51 Date de parution : 18/10/2019 Cette attestation est produite, sous réserve d’incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Le 10 Octobre 2019 P.O. le directeur, L'usage des Rubriques des Annonces des Journaux doit être conforme à leur destination. Champagne Editions s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des publications concernées. La Marne Agricole du 18/10/2019 - COMMUNES DE BETHENY, BEZANNES, CERNAY-LES-REIMS, CHAMPFLEURY, CHAMPIGNY, CORMONTREUIL, PRUNAY, PUISIEULX, REIMS, SAINT-BRICE-COURCELLES, SAINT-LEONARD, SILLERY, TAISSY, TINQUEUX, TROIS-PUITS, VILLERS-AUX-NOEUDS (51) Avis de mise à enquête publique des zonages d'assainissement des eaux usées (collectif et non collectif) et des eaux pluviales urbaines AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territo- riales, il convient de procéder à une enquête publique portant sur les projets de zonages d’assainissement des eaux usées (collectif et non collectif) et des eaux pluviales urbaines des communes de Bétheny, Bezannes, Cernay-lès-Reims, Champfleury, Champigny, Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims, Saint-Brice- Courcelles, Saint-Léonard, Sillery, Taissy, Tinqueux, Trois-Puits, Villers-aux-Nœuds (périmètre de l’ancienne Communauté d’agglomération Reims Métropole).