88-SGN-219-AQI.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Publication of a Communication of Approval of a Standard
29.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 254/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2019/C 254/03) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Haut-Médoc’ Reference number: PDO-FR-A0710-AM03 Date of communication: 10.4.2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Demarcated parcel area Description and reasons This application includes the applications with reference PDO-FR-A0710-AM01 and PDO-FR-A0710-AM02, submit ted on 7 April 2016 and 12 January 2018, respectively. The following is inserted in chapter I, point IV(2) of the specification after the words ‘16 March 2007’: ‘ 28 September 2011, 11 September 2014, 9 June 2015, 8 June 2016, 23 November 2016 and 15 February 2018, and of its standing committee of 25 March 2014’. The purpose of this amendment is to add the dates on which the competent national authority approved changes to the demarcated parcel area within the geographical area of production. Parcels are demarcated by identifying the parcels within the geographical area of production that are suitable for producing the product covered by the regis tered designation of origin in question. Accordingly, as a r esult of this amendment, a new point (b) has been added -

Télécharger L'itinéraire (PDF)
Par la route en arrivant par le nord • Emprunter l’autoroute A10 jusqu’à Saintes • Prendre la N105 en direction de Royan pour prendre le « bac » qui vous permettra de traverser la Gironde jusqu’au Verdon • Au Verdon, suivre la route départementale D1215 (route de l’océan) en direction de Lesparre, continuer sur environ 11km jusqu’à la route départementale D101e3 et tourner à droite en direction de Grayan et L’Hôpital • Entrer dans Grayan, au rond-point prendre la 2ème sortie D101 (rue des Bernaches) en direction de Vendays-Montalivet • Entrer dans L’Hôpital, au rond-point prendre la 2ème sortie D101E6 en direction de Vendays- Montalivet • Suivre la route de Vendays (D101E6) sur environ 1.5km • Tourner à gauche, route des Grigots. • Le Camping Le Tastesoule se trouvera sur votre droite. CAMPING TASTESOULE 2 route des Grigots 33590 VENSAC - Tél : 0033(0)5 56 09 54 50 – www.campingtastesoule.fr Par la route depuis Bordeaux • Emprunter la rocade • Prendre la sortie N°8 Le Verdon/Lacanau/Le Taillan Médoc • Suivre la route départementale D1215 en direction de Lesparre Médoc • Poursuivre sur la route départementale D1215 qui passe par Castelnau de Médoc, Saint-Laurent de Médoc puis Lesparre Médoc • Traverser Lesparre Médoc en suivant toujours la route départementale D1215 en direction de Soulac sur Mer/Le Verdon • Au niveau de la D102, tourner à gauche en direction de Vendays-Montalivet • Au rond-point, pendre la première sortie en direction de Montalivet • Au feu, tourner à droite sur la D101 en direction de Soulac sur Mer • Suivre la D101 qui passe par Mayan sur environ 2.5km • Tourner à droite route des Grigots (après l’intersection « déchetterie Vensac ») • Le Camping Le Tastesoule se trouvera sur votre droite. -

La-Gironde-À-Vélo-2015.Pdf
Phare du Cordouan Pte de Grave Le Verdon-sur-Mer Soulac-sur-Mer Estuaire de la Gironde Piste cyclable Talais Canal des 2 mers Grayan-et-l’Hôpital Itinéraire de liaison La Vélodyssée® en France, de Rosco à Hendaye, traverse la Gironde avec 178 km de Vensac piste sécurisée de la Pointe de Grave jusqu’au Bassin d’Arcachon. Vignobles : appellations d'origine Montalivet-les-Bains Queyrac Saint-Emilion-Libournais Station vélo Vendays-Montalivet Médoc Ville d'Art et d'Histoire Entre-Deux-Mers Surf Graves et Pessac Léognan Classé au Patrimoine mondial par l'UNESCO Bordeaux-Le Verdon 99 km St-Estèphe Bordeaux et Bordeaux supérieur Phare Blaye Côtes de Bordeaux et Côtes de Bourg Bastide Pauillac Liquoreux Île de Patiras Plage surveillée en saison Hourtin Lac d'Hourtin Haute Gironde Canoë et de Carcans Blaye Golf (9 et 18 trous) Médoc Bordeaux-Blaye 49 km Plassac Gare Carcans Cussac-Fort-Médoc Bourg Guîtres Aéroport international Lacanau Prignac-et-Marcamps Bordeaux-Lacanau 48 km Lacanau-Océan Margaux km 54 Bordeaux-Pauillac Lac St-André-de-Cubzac Pays Libournais de Lacanau Libourne Le Porge Vayres Saint-Émilion Bordeaux-Ste-Foy 92 km Bordeaux-St-Émilion 40 km BORDEAUX Castillon-la-Bataille Ste-Foy-la-Grande Mérignac Créon Rauzan Gensac Lège Arès La Sauve-Majeure Pellegrue Léognan Andernos-les-Bains Blasimon Bassin d'Arcachon La Brède Bassin St-Ferme Bordeaux-Langon 49 km Langoiran d'Arcachon Sauveterre-de-Guyenne Arcachon Monségur Gujan-Mestras Graves et Sauternais Rions Castelmoron-d’Albret Le Teich Delta de Bordeaux-Arcachon 63 km La Teste-de-Buch la Leyre Cadillac Le Cap Ferret Entre-deux-Mers Pyla-sur-Mer Dune du Pilat La Réole St-Macaire Banc d'Arguin Preignac Fontet Langon Cazaux Sauternes Pondaurat Lac de Cazaux Hostens Mazères Bazas Uzeste Villandraut N O E Préchac 0 10 Km S Sud Gironde Captieux Réalisé par l’ Agence de Développement Touristique de la Gironde. -

Session on Post-Accident
Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -
Carte Repère : Un Département Proche Des Territoires Et Des Girondins
CARTE REPÈRE : UN DÉPARTEMENT PROCHE DES TERRITOIRES ET DES GIRONDINS ROYAN LA MOBILITÉ : POINTE-de-GRAVE développer et promouvoir LE VERDON la mobilité durable SOULAC TALAIS GRAYAN " Le Gurp " ST-VIVIEN VENSAC QUEYRAC MONTALIVET " Les Bains " VENDAYS-MONTALIVET GAILLAN PLEINE-SELVE LESPARRE ST-PALAIS TER PARIS ST-CIERS / GIRONDE POITIERS NAUJAC ST-AUBIN VERTHEUIL HOURTIN PLAGE BRAUD-ST-LOUIS CONTAUT ANGLADE HOURTIN ST-SAUVEUR PAUILLAC ETAULIERS MONTGUYON EYRANS HOURTIN LA ROCHELLE Le Port NANTES ST-GENES-HAUTE-GIRONDE ST-LAURENT de-BLAYE ST-SEURIN-de-CURSAC ST-YZAN-de-S. BLAYE ST-CHRISTOLY-de-BLAYE TER MÉDOC CUSSAC ANGOULEME PARIS CARCANS PLASSAC CAVIGNAC LARUSCADE CARCANS Bombannes CARCANS LAMARQUE BERSON PLAGE CEZAC LISTRAC PUGNAC ARCINS LAPOUYADE LAGORCE GAURIAC CUBNEZAIS MOULIS SOUSSANS ST-LAURENT-d'ARCE BRACH MARGAUX GAURIAGUET GUÎTRES CASTELNAU AVENSAN CANTENAC BOURG COUTRAS LACANAU LABARDE PRIGNAC- OCEAN et-MARCAMPS ST-CIERS-d’ABZAC ABZAC LACANAU ST-SEURIN ARSAC MACAU SALIGNAC ST-DENIS-de-PILE MONTPON-MENESTEROL LACANAU ST-ANDRE-de-CUBZAC TER LA LANDE- de-FRONSAC GOURS PERIGUEUX LACANAU Le Port STE-HELENE CLERMONT-FERRAND La Grande-Escoure LE PIAN LIBOURNAIS PUYNORMAND LUGON LES ARTIGUES-de-L. SALAUNES LUSSAC VILLEFRANCHE-de-LONCHAT BLANQUEFORT ST-LOUBES FRANCS LE TAILLAN IZON LE PORGE TER TER LIBOURNE OCEAN PUISSEGUIN CARBON-BLANC VAYRES ARVEYRES LE PORGE MONTUSSAN LE TEMPLE ST-EMILION BORDEAUXLORMONT ST-GENES BEYCHAC- ST-SULPICE-de-FALEYRENS PORTE et-CAILLAU MERIGNAC DEA YVRAC ST-GERMAIN-du-PUCH BERGERAC R U POMPIGNAC GENISSAC -

Arrêté Modificatif Ouverture
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paul, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet et Vensac : « 1° la chasse du canard colvert est ouverte le 1 er samedi d’août, à 6 heures ; Ministère de l’environnement, de « 2° la chasse des autres canards de surface, des canards plongeurs, des oies et des limicoles l’énergie et de la mer (excepté le vanneau huppé) est ouverte le premier jour de la deuxième décade d'août, à 6 heures. Chargée des relations internationales « Le tir est limité sur la nappe d'eau depuis l'intérieur des installations de chasse avec fusil sur le climat déchargé à l'aller et au retour de la tonne. « III. - Par exception aux dispositions de l'article 2, dans le département de l'Hérault la chasse à la foulque macroule est ouverte le premier jour de la troisième décade d'août à 6 heures. » Article 2 Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera Arrêté du publié au Journal officiel de la République française. modifiant l’arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en ce qui concerne la chasse du canard colvert dans certaines communes du département de la Gironde Fait le NOR : La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations Pour le ministre et par délégation internationales sur le climat ; Le directeur de l’eau et de la biodiversité, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. -

Liste Des Communes Situées En Zone Sensible À Enjeu De Protection Des
Liste des communes situées en zone sensible à enjeu de protection des milieux dégradés Données de l’état des lieux 2019 – source Agence de l’Eau Adour-Garonne Page 1 / 2 Abzac Castets et Castillon Galgon Anglade Castillon-la-Bataille Gans Auriolles Caudrot Gardegan-et-Tourtirac Auros Caumont Gauriaguet Bagas Cavignac Générac Barsac Cazats Gensac Bazas Cazaugitat Gironde-sur-Dropt Bégadan Cerons Haux Berson Cezac Jau-Dignac-et-Loirac Berthez Chamadelle Juillac Beychac-et-Caillau Civrac-de-Blaye La Lande-de-Fronsac Bieujac Civrac-sur-Dordogne La Sauve Blasimon Cleyrac Ladaux Bossugan Coubeyrac Lados Brannens Cours-de-Monsegur Lalande-de-Pomerol Brouqueyran Coutras Landerrouet-sur-Ségur Cadaujac Coutures Landiras Camarsac Croignon Laruscade Camblanes-et-Meynac Cubzac-les-Ponts Le Fieu Camiran Cursan Le Haillan Campugnan Cussac-Fort-Médoc Le Pout Cantois Dieulivol Le Puy Capian Doulezon Le Tourne Carcans Eyrans Léognan Cartelègue Francs Les Billaux Casseuil Gaillan-en-Médoc Les Esseintes Castelmoron-d'Albret Gajac Lesparre-Médoc Libourne Saint-Christophe-Des-Bardes Saint-Sulpice-de-Guilleragues Ligueux Saint-Cibard Saint-Sulpice-de-Pommiers Listrac-de-Dureze Saint-Ciers-d'Abzac Saint-Vincent-de-Pertignas Loubens Saint-Denis-de-Pile Saint-Vivien-de-Blaye Lussac Sainte-Croix-du-Mont Saint-Vivien-de-Médoc Maransin Sainte-Florence Saint-Vivien-de-Monségur Marcenais Sainte-Foy-la-Longue Saint-Yzan-de-Soudiac Margueron Sainte-Gemme Salignac Marsas Saint-Emilion Salleboeuf Martillac Sainte-Radegonde Sauveterre-de-Guyenne Massugas Saint-Estephe Savignac-de-L'Isle -

Florence CLUZEAU-BON Vendays-Montalivet RAM Médoc Atlantique Antenne De Soulac 05 56 73 49 24 • 06 85 49 06 93 [email protected]
SITES d’ACCUEIL CONTACT RAM Grayan-et-l’Hôpital VOTRE CONTACT : Soulac-sur-Mer Florence CLUZEAU-BON Vendays-Montalivet RAM Médoc Atlantique Antenne de Soulac 05 56 73 49 24 • 06 85 49 06 93 [email protected] PERMANENCE téLéPHonique et AccueiL PHySique SUR RENDEZ-VOUS : LUNDI, MARDI ET VENDREDI de 13H30 à 16H00 JEUDI de 9h00 à 16h00 9 rue du Maréchal d’Ornano 33780 Soulac-sur-Mer Tél. : 05 56 73 29 26 TEMPS www.ccmedocatlantique.fr COLLECTIFS RARELAIS ASSISTANT(E)SM EN matINÉE : MATERNEL(LE)S (À destination des assistant(e)s maternel(le)s et des enfants) Nos partenaires : • Grayan-et-l’Hôpital contact LUNDI MAISON DES ASSOCIatIONS (49, rue des Goëlands) E • Soulac-sur-Mer MARDI 1 biS, rue FocH • Vendays-Montalivet 2019. Papier FSC gestion durable des forêts. Crédits photos : Thinkstock : Crédits photos des forêts. FSC gestion durable Papier 2019. VENDREDI 05/ CH rPA « LeS cHêneS » (1, chemin de la RPA) Carcans • Grayan-et-l’Hôpital • Hourtin • Jau-Dignac-et-Loirac R.C. Bx B 300 988 342. R.C. Bx B 300 988 342. Lacanau • Naujac-sur-Mer • Queyrac • Saint-Vivien-de-Médoc • Soulac-sur-Mer Talais • Valeyrac • Vendays-Montalivet • Vensac • Le Verdon-sur-Mer FI SITES d’ACCUEIL Carcans VOTRE CONTACT : Hourtin Jessy MoreAu Lacanau RAM Médoc Atlantique Antenne de Carcans 05 57 70 03 22 • 06 89 14 29 79 [email protected] LES MISSIONS PERMANENCE SERVICE DU RELAIS : POUR LES PARENTS POUR LES ASSIstant(E)S ET FUTURS PARENTS : matERNEL(LE)S ET téLéPHonique gratUIT DE • L’inForMAtion • Bénéficier d’une écoute attentive LES CANDIDat(E)S À et AccueiL PHySique en direction des parents et de vos besoins et de vos attentes SUR RENDEZ-VOUS : PROXIMITÉ des professionnel(le)s de L’AGRÉMENT : • Être informé sur l’ensemble des la petite enfance. -
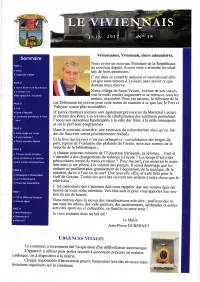
LE VIV I R "Jurn 2017 :No 18
LE VIV I r "JUrN 2017 :No 18 Viviennaises, Viviennais, chers administrés, Sommaire Nous avons un nouveau Président de la République, PAGE 1 un nouveau député, il nous reste à attendre les résul- . Edlto tats de leurs promesses. Urgences vltales C'est dans ce contexte national et international déli- cat que nous tentons que PAGE 2 d'évoluer, sans savoir ce demain nous réserve. Notre école et le Numérique . L'Oiseau Lire Notre village de Saint-Vivien, victime de son succès, . Ma commune, mâ santé voit le trafic routier augmenter et se retrouve, tous les matins, encombré. Pour ces raisons, la réfection de la PAGE 3 rue Dillemann est préwe pour cette année de manière à ce que Jau, le Port et Valeyrac soient plus accessibles. o TAP .Carte d'ldentlté D'autres chantiers routiers sont également prévus (rue du Maréchal Leclerc .Lloutenant Mondolonl à I'hon et chemin des Pins). Les travaux de réhabilitation des sanitaires permettant naur I'accès aux personnes handicapées à la salle des fêtes, à la salle ômnisports et sur le port sont programmés. PAGE 4 Dans le nouveau cimetière, une extension du columbarium ainsi qu'un Jar- a Crolx-rougê sur roseg din du Souvenir seront prochainement réalisés. a A voa cssquâs I Et la liste des travaux n'est pas exhaustive : r Notrê nouveau député consolidation des berges du port, reprise de l'isolation des plafonds de l'école, mise aux normés de la sécurité de la bibliothèque... PAGE 5 o Travaux après tempête A chaque nouveau ministre de I'Education Nationale, sa réforme.. -

Médoc Seasonal Workers Guide
MÉDOC SEASONAL WORKERS GUIDE THE MÉDOC "Winegrowing, agriculture and tourism are all vital economic sectors in the Médoc, and since they are highly seasonal, almost 21,000 seasonal workers are employed every year across the region. In order to assist you with your visit to the Médoc, the Médoc Parc Naturel Régional (PNR) (Regional Natural Park) and its partners Région Nouvelle Aquitaine, Department of the Gironde, DIRECCTE (Regional department of businesses, competition, consumption, work and employment), CAF (Family benefits agency), MSA (Welfare agency for agricultural workers) and ANEFA Gironde (National agricultural training and employment association) offer you this guide which will enable you to access basic services you may need.” Henri SABAROT President of the Médoc PNR CONTENTS HAVING AN ADDRESS TO ACCESS RIGHTS page 5 I don’t have an address: • how do I open a bank account ? • how do I get my mail ? • what address should I put on my work contract ? INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS page 6 to 7 I am a seasonal agricultural employee and I have MSA rights: • how do I contact the MSA ? • who ? • when ? • where ? I am a seasonal employee (not agricultural) and am looking for information about my benefits (e.g. RSA (earned income supplement), activity bonus, family allowances, etc.), housing aid • who ? • when ? • how ? • where ? HEALTHCARE page 8 to 10 • I am sick: who do I contact regarding paperwork? • I am sick: how do I go on sick leave? • I'm undocumented and have health problems: who can I contact? • I need emergency care, but -

Communes Zrr Gironde
DEPCOM11 NOM_COM Valeur statut 33002 Aillas 1 ZRR 33010 Arcins 1 ZRR 33012 Arsac 1 ZRR 33020 Auriolles 1 ZRR 33021 Auros 1 ZRR 33022 Avensan 1 ZRR à priori 33026 Balizac 1 ZRR données 33027 Barie 1 ZRR mises à jour 33031 Bassanne 1 ZRR le 29/03/2012 33038 Bégadan 1 ZRR 33048 Berthez 1 ZRR 33055 Blaignan 1 ZRR 33068 Bourideys 1 ZRR 33070 Brach 1 ZRR 33072 Brannens 1 ZRR 33074 Brouqueyran 1 ZRR 33091 Cantenac 1 ZRR 33095 Captieux 1 ZRR 33097 Carcans 1 ZRR 33104 Castelnau-de-Médoc 1 ZRR 33107 Castillon-de-Castets 1 ZRR 33112 Caumont 1 ZRR 33113 Cauvignac 1 ZRR 33115 Cazalis 1 ZRR 33117 Cazaugitat 1 ZRR 33125 Cissac-Médoc 1 ZRR 33128 Civrac-en-Médoc 1 ZRR 33130 Coimères 1 ZRR 33134 Couquèques 1 ZRR 33137 Cours-les-Bains 1 ZRR 33146 Cussac-Fort-Médoc 1 ZRR 33155 Escaudes 1 ZRR 33177 Gaillan-en-Médoc 1 ZRR 33188 Giscos 1 ZRR 33190 Goualade 1 ZRR 33193 Grayan-et-l'Hôpital 1 ZRR 33195 Grignols 1 ZRR 33202 Hostens 1 ZRR 33203 Hourtin 1 ZRR 33208 Jau-Dignac-et-Loirac 1 ZRR 33211 Labarde 1 ZRR 33212 Labescau 1 ZRR 33214 Lacanau 1 ZRR 33216 Lados 1 ZRR 33220 Lamarque 1 ZRR 33223 Landerrouat 1 ZRR 33232 Lartigue 1 ZRR 33235 Lavazan 1 ZRR 33239 Lerm-et-Musset 1 ZRR 33240 Lesparre-Médoc 1 ZRR 33247 Listrac-de-Durèze 1 ZRR 33248 Listrac-Médoc 1 ZRR 33251 Louchats 1 ZRR 33255 Lucmau 1 ZRR 33268 Margaux 1 ZRR 33271 Marions 1 ZRR 33276 Masseilles 1 ZRR 33277 Massugas 1 ZRR 33297 Moulis-en-Médoc 1 ZRR 33300 Naujac-sur-Mer 1 ZRR 33307 Noaillan 1 ZRR 33309 Ordonnac 1 ZRR 33310 Origne 1 ZRR 33314 Pauillac 1 ZRR 33316 Pellegrue 1 ZRR 33329 Pompéjac 1 ZRR 33331 -

Communes a Dominante Forestiere En Gironde
COMMUNES A DOMINANTE FORESTIERE EN GIRONDE AILLAS GUJAN-MESTRAS ORIGNE ANDERNOS-LES-BAINS HOSTENS PESSAC ARBANATS HOURTIN PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS ARCACHON ILLATS POMPEJAC ARES LA BREDE PORCHERES ARSAC LA TESTE-DE-BUCH PORTETS AUBIAC LABESCAU PRECHAC AUDENGE LACANAU PUYNORMAND AUROS LADOS QUEYRAC AVENSAN LAGORCE REIGNAC AYGUEMORTE-LES-GRAVES LANDIRAS ROAILLAN BALIZAC LANTON SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE BAYAS LAPOUYADE SAINT-AUBIN-DE-BLAYE BAZAS LARTIGUE SAINT-AUBIN-DE-MEDOC BELIN-BELIET LARUSCADE SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE BERNOS-BEAULAC LAVAZAN SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE BIGANOS LE BARP SAINTE-HELENE BIRAC LE FIEU SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL BOURIDEYS LE NIZAN SAINT-JEAN-D'ILLAC BRACH LE PIAN-MEDOC SAINT-LAURENT-MEDOC BUDOS LE PORGE SAINT-LEGER-DE-BALSON CABANAC-ET-VILLAGRAINS LE TAILLAN-MEDOC SAINT-MAGNE CADAUJAC LE TEICH SAINT-MEDARD-D'EYRANS CAMPUGNAN LE TEMPLE SAINT-MEDARD-EN-JALLES CANEJAN LE TUZAN SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU CAPTIEUX LE VERDON-SUR-MER SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET CARCANS LEGE-CAP-FERRET SAINT-MORILLON CARTELEGUE LEOGEATS SAINT-SAUVEUR CASTELNAU-DE-MEDOC LEOGNAN SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND CASTRES-GIRONDE LERM-ET-MUSSET SAINT-SAVIN CAUVIGNAC LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES SAINT-SELVE CAZALIS LESPARRE-MEDOC SAINT-SYMPHORIEN CERONS LIGNAN-DE-BAZAS SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC CESTAS LISTRAC-MEDOC SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC CHAMADELLE LOUCHATS SALAUNES CISSAC-MEDOC LUCMAU SALLES COIMERES LUGOS SAUCATS COURS-LES-BAINS MACAU SAUGON CUDOS MARANSIN SAUMOS CUSSAC-FORT-MEDOC MARCHEPRIME SAUTERNES DONNEZAC MARCILLAC SAUVIAC ESCAUDES MARGAUX-CANTENAC SAVIGNAC ETAULIERS MARIMBAULT SENDETS FARGUES MARIONS SILLAS FRANCS MARTIGNAS-SUR-JALLE SOULAC-SUR-MER GAILLAN-EN-MEDOC MARTILLAC TAYAC GENERAC MASSEILLES TIZAC-DE-LAPOUYADE GISCOS MAZERES UZESTE GOUALADE MERIGNAC VENDAYS-MONTALIVET GRADIGNAN MIOS VENSAC GRAYAN-ET-L'HOPITAL MOULIS-EN-MEDOC VERTHEUIL GRIGNOLS NAUJAC-SUR-MER VILLANDRAUT GUILLOS NOAILLAN VIRELADE.