Resume Non Technique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Compétence Géographique Du Sista Sur Le Département
ORADOUR-FANAIS LA LONDIGNY FORÊT- PLEUVILLE ABZAC DE-TESSÉ LES ADJOTS MONTJEAN ST-MARTIN- DU-CLOCHER THEIL- EPENÈDE RABIER VILLIERS- TAIZÉ-AIZIE LESSAC LA LE-ROUX BRILLAC LA BERNAC PAIZAY- MAGDELEINE LE BOUCHAGE CHÈVRERIE HIESSE NAUDOUIN- EMBOURIE RUFFEC EMPURÉ VILLEFAGNAN BIOUSSAC BENEST LA FAYE CONDAC NANTEUIL- CONFOLENS ESSE VIEUX- ALLOUE EN-VALLÉE BRETTES RAIX RUFFEC LONGRÉ VILLEGATS BARRO LESTERPS COURCÔME VERTEUIL- ANSAC- S T- CHAMPAGNE- SUR-CHARENTE ST-COUTANT SUR-VIENNE CHRISTOPHE MOUTON SOUVIGNÉ TUZIE MONTROLLET LES ST-GEORGES GOURS SALLES-DE- LE AMBERNAC BESSÉ POURSAC ST-FRAIGNE VILLEFAGNAN VIEUX-CÉRIER ST-MAURICE-DES-LIONS CHARMÉ ST-GOURSON CHENON CHASSIECQ TURGON EBRÉON LE LUPSAULT COUTURE SAULGOND LONNES ST-SULPICE- GRAND- ST-LAURENT- BRIGUEUIL TUSSON MANOT JUILLÉ AUNAC-SUR- DE-RUFFEC MADIEU DE-CÉRIS BARBEZIÈRES CHARENTE BEAULIEU- PARZAC ORADOUR LIGNÉ SUR-SONNETTE MOUTONNEAU ROUMAZIÈRES- RANVILLE- VILLEJÉSUS FONTENILLE VENTOUSE CHABRAC LOUBERT BREUILLAUD LICHÈRES CHIRAC LUXÉ AIGRE ST-FRONT S T- FONTCLAIREAU VERDILLE FOUQUEURE GROUX CELLEFROUIN ST-CLAUD MOUTON MONS MANSLE VALENCE LA VILLOGNON NIEUIL ETAGNAC LA PÉRUSE ST-CIERS- TÂCHE AUGE- CELLETTES PUYRÉAUX MARCILLAC- AMBÉRAC SUR- EXIDEUIL ST-MÉDARD LANVILLE MAINE- BONNIEURE LUSSAC CHABANAIS BONNEVILLE COULONGES DE-BOIXE NANCLARS VAL-DE- GENOUILLAC ST-MARY ANVILLE LA VERVANT BONNIEURE SUAUX CHASSENON CHAPELLE SURIS GOURVILLE XAMBES ST-QUENTIN- AUSSAC- CHASSENEUIL- MAZIÈRES SUR-CHARENTE MONTIGNÉ VADALLE SUR-BONNIEURE VOUHARTE VILLEJOUBERT COULGENS GENAC-BIGNAC LES PINS PRESSIGNAC -
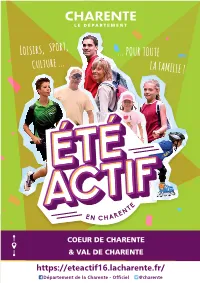
Dès Le 24 Juin 2019 !
COEUR DE CHARENTE & VAL DE CHARENTE https://eteactif16.lacharente.fr/ ÉDITOS En Charente, il y a tant d’occasions de Depuis de nombreuses années, l’été En Charente, l’« Été actif » porté par le Département, sortir de sa coquille ! Et l’Eté actif en est un actif est une période incontournable est devenu une opération incontournable pour vivre bon exemple ! Aux côtés du Département, de la saison estivale sur les deux sites pleinement des vacances dans un cadre naturel et la Communauté de Communes Cœur Ruffec et Villefagnan sur le territoire sécurisé ! de Charente accompagne le dispositif, de la Communauté de communes Val déployé, depuis la fusion des CDC, sur de Charente. Pendant 2 mois, plus de 200 activités sportives, l’ensemble de son territoire. De nombreuses activités sportives culturelles et de loisirs encadrées par des équipes Ainsi, curieux de tous âges, venez (canoë, tir à l’arc, équitation, grimp’arbres, compétentes et diplômées, sont proposées sur découvrir des activités diverses, tennis de table, badminton, escrime, 19 sites labellisés répartis sur l’ensemble du territoire. enrichies chaque année par de nouvelles roller...) et culturelles (théâtre, visites propositions : géocaching, canirando, patrimoine, paléontologie, fresque, Par le renouvellement de ce dispositif, le Département sports nature, mais aussi activités poterie, sculpture...) sont proposées, et les Communautés de communes sans oublier culturelles ou créatives (sérigraphie,…) à découvrir par notre jeunesse et le tissu associatif local permettent à chacun, seul, en famille ou entre vous attendent. à pratiquer en famille. amis, de partager de très bons moments autour d’animations de loisirs de qualité ou de sports de pleine nature, proposés aux meilleures Encadrées par des professionnels ou Et nous souhaitons que chacun, à travers conditions. -

Liste Communes Zone À Enjeu Eau.Xlsx
Liste des communes en zone à enjeux eaux pour l'appel à projet structure collective HVE dépt insee nom 16 16005 Aigre 16 16008 Ambérac 16 16010 Ambleville 16 16012 Angeac-Champagne 16 16013 Angeac-Charente 16 16014 Angeduc 16 16015 Angoulême 16 16018 Ars 16 16023 Aunac-sur-Charente 16 16024 Aussac-Vadalle 16 16025 Baignes-Sainte-Radegonde 16 16027 Barbezières 16 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 16 16031 Barro 16 16032 Bassac 16 16036 Bécheresse 16 16040 Berneuil 16 16041 Bessac 16 16042 Bessé 16 16046 Coteaux-du-Blanzacais 16 16056 Bourg-Charente 16 16058 Boutiers-Saint-Trojan 16 16059 Brettes 16 16060 Bréville 16 16072 Chadurie 16 16075 Champagne-Vigny 16 16077 Champmillon 16 16083 Charmé 16 16088 Chassors 16 16089 Châteaubernard 16 16090 Châteauneuf-sur-Charente 16 16095 Chenon 16 16097 Cherves-Richemont 16 16099 Chillac 16 16102 Cognac 16 16104 Condac 16 16105 Condéon 16 16109 Courbillac 16 16110 Courcôme 16 16113 La Couronne 16 16116 Criteuil-la-Magdeleine 16 16118 Deviat 16 16122 Ébréon 16 16123 Échallat 16 16127 Empuré 16 16136 La Faye 16 16139 Fleurac 16 16141 Fontenille 16 16142 La Forêt-de-Tessé 16 16144 Fouqueure 16 16145 Foussignac 16 16150 Gensac-la-Pallue 16 16151 Genté 16 16152 Gimeux 16 16153 Mainxe-Gondeville 16 16154 Gond-Pontouvre 16 16155 Les Gours 16 16165 Houlette 16 16166 L'Isle-d'Espagnac 16 16167 Jarnac 16 16169 Javrezac 16 16174 Julienne 16 16175 Val des Vignes 16 16176 Lachaise 16 16177 Ladiville 16 16178 Lagarde-sur-le-Né 16 16184 Lichères 16 16186 Lignières-Sonneville 16 16190 Longré 16 16191 Lonnes 16 16193 Louzac-Saint-André -

Arrêté Préfectoral Du 31 Mars 2021
Direction départementale des territoires ARRÊTÉ de restriction temporaire des prélèvements d'eau à usage d'irrigation effectués à partir des cours d'eau et de leur nappe d'accompagnement sur le bassin versant de la Charente du périmètre de gestion de l'OUGC Cogest'Eau dans le département de la Charente La préfète de la Charente Chevalier de l’ordre national du Mérite Chevalier de la légion d’honneur Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-3, L.212-4 et R.211-66 à R.211-74 concernant les mesures de limitations des usages de l’eau en cas de sécheresse ou à un risque de pénurie ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et L 2212-2 relatifs aux pouvoirs généraux des maires en matière de police et l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État dans le département en matière de police ; Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ; Vu le décret n° 62.1448 du 24 novembre 1962 relatif à l’exercice de la police des eaux ; Vu le décret n°94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition -

Chambres D'hôtes - Les Lilas - Ruffec - Charente
CHAMBRES D'HÔTES - LES LILAS - RUFFEC - CHARENTE LES LILAS - DENIS ET SIMONE, VOS HÔTES Chambres d'hôtes à Ruffec http://leslilas-ruffec.fr Simone Rougé +33 6 88 98 39 83 A Chambres d'hôtes - Les Lilas - Ruffec : 12 rue du hameau 16700 RUFFEC Chambres d'hôtes - Les Lilas - Ruffec Les Lilas - Chambre Azur Les Lilas - chambre écarlate Comprend 2 charmantes chambres pour 2 personnes chacune, situées dans une maison récente, de plain pieds, avec une grande salle d’eau indépendante avec 2 vasques, une douche munie d’un siège, d'une poignée et de WC. Elle est entourée d’un grand jardin arboré avec tables, fauteuils et parasols. Le petit déjeuner comprend des produits bio et faits maison pour la plupart et est servi, selon la saison dans le salon ou dans le jardin. Pique nique (non fourni) possible le soir, dans le salon ou le jardin. Parking privatif fermé avec télécommande. Prise de courant dans le parking, fournie pour le chargement d'un véhicule électrique, pendant la nuit, avec câble à disposition, contre une somme forfaitaire de 5 €. 1 chien ou 1 chat est admis avec supplément. Local à vélos sécurisé. Environnement très calme. Plusieurs commerces à 200 m dont un supermarché ouvert le dimanche et un kiosque à pizzas à emporter à proximité. Proche du centre ville, de la gare (5mn à pieds) et de la piscine. On peut utiliser le jardin pendant l'été pour se restaurer. Un barbecue est mis à votre disposition. L'hiver, on peut utiliser le salon muni d'une table pour manger un petit repas apporté, froid ou à réchauffer, Un réfrigérateur, un micro-ondes et un téléviseur de grand format sont à votre disposition dans le salon réservé aux visiteurs ainsi que des boissons chaudes (thé, café, tisane), sans supplément. -

Été Actif Val De Charente
ÉTÉ ACTIF VAL DE CHARENTE Inscriptions et paiement en ligne sur eteactif16.lacharente.fr eteactif16.lacharente.fr // www.lacharente.fr // Département de la Charente - Officiel // @charente // départementcharente ÉDITOS En Charente, été rime désormais avec activités ! En effet, l’opération « été actif », portée par le Département, est devenue un incontournable pour découvrir le territoire et s’initier à une multitude d’activités dans un cadre naturel et sécurisé. La nature est verdoyante, le soleil éclatant et l’envie de profiter du plein air à son apogée : c’est le moment idéal pour explorer l’écrin naturel unique et privilégié que nous offre la Charente, prendre le temps pour de nouvelles pratiques sportives et culturelles et même peut-être développer son goût pour les occupations manuelles ou culinaires ? Saviez-vous que 3 sites Charentais ont été désignés base-arrière pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Les athlètes viendront s’entraîner au basketball, au handball, à certaines disciplines de l’équitation ou même à l’athlétisme en Charente ; c’est l’occasion de connaître d’avantage ces sports exigeants et même d’initier les plus petits au baby basket ou au baby football ! Du 1er juillet au 31 août, ce sont ainsi plus de 200 activités encadrées par des équipes compétentes et diplômées qui seront proposées sur l’ensemble du territoire. Dans sa volonté de permettre à tous les Charentais de participer à cette opération, le Département a également prévu des animations accessibles aux personnes à mobilité réduite comme la Boccia, un jeu de balles s’apparentant à la pétanque, ainsi que la mise à disposition de casques de réalité virtuelle et l’organisation de tournois de e-sport. -

Inventaire Départemental Des Cavités Souterraines (Hors Mines) De La Charente (16) Phases 1 Et 2 : Valorisation Et Synthèse Des Données Collectées Rapport Final
Inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) de la Charente (16) Phases 1 et 2 : Valorisation et Synthèse des données collectées Rapport final BRGM/RP-62786-FR octobre 2013 Inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) de la Charente (16) Phases 1 et 2 : Valorisation et Synthèse des données collectées Rapport final BRGM/RP-62786-FR octobre 2013 Étude réalisée dans le cadre de la convention MEDDE n° 2200626840 D. Dugrillon Avec la collaboration de M. Colombel, M. Leroi, L. de Nantois et V. Peltier Approbateur : Vérificateur : Nom : F. Bichot Nom : E. Vanoudheusden Date : 16/12/2013 Date : 18/11/2013 Le système de management de la qualité et de l’environnement est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001. Mots-clés : cavité souterraine, base de données, inventaire, Charente, cavité naturelle, carrière souterraine, ouvrage civil, ouvrage militaire, cave, souterrain-refuge En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Dugrillon D. (2013) avec la collaboration de M. Colombel, M. Leroi, L. de Nantois et V. Peltier – Inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) de la Charente (16) – Phases 1 et 2 : Valorisation et Synthèse des données collectées. Rapport BRGM/RP-62786-FR, 96 p., 17 ill., 3 ann., 1 ann. ht © BRGM, 2013, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) de la Charente (16) Synthèse A la demande du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), le BRGM a réalisé un inventaire des cavités dans le département de la Charente. -

2019 05 05Annexe
PROJET MODIFICATIF DE STATUTS VU le Code général des Collectivités Locales, VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, VU la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République, VU la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Article 1 - COMPOSITION DU SYNDICAT En application de l’article L-5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé, entre les communes suivantes : Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Ambérac, Ambernac, Anais, Angoulême, Ansac-sur-Vienne, Anville, Aubeterre-sur-Dronne, Auge-St-Médard, Aunac-sur-Charente, Aussac-Vadalle, Barbezières, Bardenac, Barro, Bazac, Beaulieu-sur-Sonnette, Bellon, Benest, Bernac, Bessac, Bessé, Bioussac, Blanzaguet-St-Cybard, Boisné-la-Tude, Bonnes, Bors de Montmoreau, Le Bouchage, Bouex, Brettes, Brie-sous-Chalais, Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chadurie, Chalais, Champagne-Mouton, La Chapelle, Charmé, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon, Chassiecq, Châtignac, Chenon, Cherves-Châtelars, La Chèvrerie, Chirac, Claix, Combiers, Condac, Confolens, Coulonges, Courbillac, Courcôme, Courgeac, Courlac, La Couronne, Couture, Curac, Deviat, Dignac, Dirac, Douzat, Ebréon, Echallat, Edon, Empuré, Epenède, Les Essards, Esse, Etagnac, Exideuil-sur-Vienne, La Faye, Fléac, Fontclaireau, Fontenille, -

CRT Nouvelle-Aquitaine
NOUVELLE-AQUITAINE Sales Manual - 2018 www.visit-nouvelle-aquitaine.com Copyright : F. Roch ; S. Charbeau ; Camus ; Le Studio Photographique ; Charente Tourisme/C.Mariot ; S. Ouzounoff ; S. Laval ; St Gelais ; Villa Claude ; OT Rochefort Océan/M. Domenici ; F. Marzo ; Images et émotion ; Ile d'Oléron Marennes Tourisme ; Aquarium La Rochelle ; Mer et forêt ; CDCHS/V.Sabadel ; F. Giraudon ; J. Chauvet ; Montgolfière du Pinson ; Novotel ; J. Villégier ; T. Richard ; Laurent REIZ ; Pau Pyrénées Tourisme ; Cité du vin ; OTEM ; M. Turin ; Dominique Guillemain ; Romann RAMSHORN ; Eric Roger ; CRT Limousin/Bruno Chanet ; Guillaume Villégier; Ph. Labeguerie ; J.L. Kokel ; A. Dang ; J. Damase ; Mon nuage ; A. Pequin ; C. Marlier B. Bloch ; J.J. Brochard ; C. Fialeix ; G. De Laubier ; L. Aubergarde ; C. Boute ; Casson Mann; A. Pequin 2 Nouvelle-AquitaineTourist Board - Sales Manual 2018 Editorial Nouvelle-Aquitaine spirit L'esprit "Nouvelle vague" Nouvelle-Aquitaine is the largest region in France. It is as diverse as it is surprising, with nature, the great outdoors, vibrant cities and legendary beaches. So, no matter what type of holidays you’re looking for, there’s bound to be a destination for you. Nouvelle-Aquitaine conjures up famous places, like Bordeaux and the city of wine, Lascaux and the Dordogne Valley (which attracted more than 500,000 visitors in its very first year after ope- ning), Biarritz and the Basque Country, Poitiers and Futuroscope (where visitor numbers grew by 6%), Cognac, Pau and the Pyre- nees, or Limoges and its skilled craftsmanship. But there is also 750 km of fine sandy coastline, with ports from Michel DURRIEU Bayonne to La Rochelle, or the 110-metre-high Dune du Pilat and islands like the Ile de Ré and the Ile d’Oléron. -

Plan De Prevention Des Risques Naturels Vallee De La Charente Et De
PPR Vallées de la Charente et de l'Argent-Or Direction Départementale de l’Equipement Charente Service de l’Urbanisme et de l’Habitat PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS VALLEE DE LA CHARENTE ET DE L’ARGENTOR MANSLE CHENON PUYREAUX VERTEUIL FONTCLAIREAU BARRO MOUTON BIOUSSAC LICHERE RUFFEC AUNAC CONDAC MOUTONNEAU TAIZE-AIZIE BAYERS SAINT GEORGES CHENOMMET NANTEUIL EN VALLEE POURSAC CHAMPAGNE-MOUTON P.P.R. APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 09 DECEMBRE 2002 CRUAGGLO\MANSLE-ARGENTOR\PPR\ECRIT\RAPPORTapprobation.doc Approuvé le 09/12/2002 PPR Vallées de la Charente et de l'Argent-Or SOMMAIRE 1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE, INSERTION DU PPR DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ...........................................................................................................................1 1.1. Contexte législatif et réglementaire...........................................................................................1 1.2. Périmètre d’application .............................................................................................................2 1.3. La procédure .............................................................................................................................4 1.4. Les effets du PPR .....................................................................................................................4 2. PRESENTATION DES ETUDES .....................................................................................................5 2.1. Informations préalables.............................................................................................................5 -

La Démarche De ZSCE Captages Du Civraisien (86) Captages De La
20 février 2020 La démarche de ZSCE Captages du Civraisien (86) Captages de la Fosse Tidet (16) et de la source de Roche (16) Aurélie RENOUST Reponsable de l’unité Eau-Qualité DDT86 Stéphanie PANNETIER DDT 16 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE ET DE LA CHARENTE Sommaire Pourquoi une ZSCE ? 3 La ZSCE : qu’est-ce que c’est ? 6 Les principales étapes 10 La délimitation du périmètre 12 Proposition de planning 15 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE ET DE LA CHARENTE Pourquoi une ZSCE ? Un renouvellement des conditions de financement de l’Agence de l’eau Adour- Garonne (nouveau contrat Re-Sources) Demandé par Eaux de Vienne le 15 mars 2019, réponse favorable de la Préfète de la Vienne le 20 mai 2019. Financement des programme Re-sources 2019-2023 AAC de Charente sous réserve d’engagement de Mme la préfète sur un calendrier prévisionnel de lancement de la démarche ZSCE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE ET DE LA CHARENTE 3 La ZSCE : qu’est-ce que c’est ? Zone Soumise à Contrainte Environnementale Zones d’érosion Zones humides d’intérêt environnemental particulier Zones de Protection des Aires d’Alimentation des Captages (ZPAAC) Articles R.114-1 et s. du Code Rural DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE ET DE LA CHARENTE 4 La ZSCE : qu’est-ce que c’est ? (2) Un outil spécifique aux pollutions diffuses d’origine agricole Un périmètre d’application déterminé Une liste limitative d’actions : 1) Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; 2) Travail du sol, -
Parc Éolien Des Galacées Communes De Courcôme Et Villegats (16)
parc éolien des Galacées Communes de Courcôme et Villegats (16) CPENR LES GALACEES Dossier de demande d’autorisation environnementale PIECE 3bis. Résumé non technique de l’étude d’impact Décembre 2019. Version complétée suite à la demande de compléments de la Préfecture de Charente Résumé non technique de l’étude d’impact du parc éolien des Galacées - CPENR LES GALACEES 2 Pour le compte de : Centrale de Production d’Energies Renouvelables LES GALACEES (CPENR LES GALACEES) filiale à 99 % d’ABO Wind France et à 1 % d’ABO Wind Allemagne. Maître d’ouvrage : Fondée en Allemagne en 1996, ABO Wind Allemagne compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en Europe. En 2002, a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse (siège social), Orléans, Nantes et Lyon. Maîtrise d’ouvrage Référence du document : Enviroscop, Décembre 2019. PIECE 3bis. Résumé non technique de l’étude d’impact du déléguée / assistance à ABO Wind parc éolien des Galacées. Communes de Courcôme et Villegats (16). Version complétée suite à la demande de maîtrise d’ouvrage : 2 rue du Libre Echange CS 95893, 31506 Toulouse Cedex 5. compléments de la Préfecture de Charente. Dossier de demande d’autorisation environnementale. CPENR LES Suivi de projet : Alexis CHARRIER, Responsable de projets. GALACEES [email protected]. Tél : +33 (0)5.32.26.32.03 8 rue André Martin 76710 MONTVILLE Éoliennes 3 éoliennes de 4,5 MW | 149,1 m de diamètre | 179,6 m de hauteur en bout de pale Tél. +33 (0)952 081 201 / [email protected] Signataire de la Charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale Réalisation : Nathalie BILLER, ingénieure Environnement, SIG et paysage.