Bailleau-Armenonville Pour La Periode 2017-2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DS Mont Flube
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection du captage du Mont Flube *** Ymeray (Eure-et-Loir, 28) Dossier d’autorisation au titre du Code de la Santé Publique Dossier établi conformément : À l’Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R1321-12 et R. 1321-42 du Code de la Santé Publique REDACTION DIFFUSION Rédigé par Document Dossier Sanitaire Mont Flube C.MENARD Nombre de pages 98 Diffusion le 13/11/2018 Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France Ymeray (28) Dossier d’autorisation sanitaire Novembre 2018 Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France 6 place Aristide Briand 28 230 Épernon Interlocuteur : Mme (Présidente) M. (Vice-Président) Utilities Performance 26 rue du Pont Cotelle 45100 ORLEANS Interlocuteur : Mme Camille MENARD Mail : [email protected] Tél : 02 38 45 42 42 Fondateurs de Up 2/98 Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France Ymeray (28) Dossier d’autorisation sanitaire Novembre 2018 Sommaire 1. PREAMBULE .......................................................................................................................................... 8 2. DESIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION D’EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE ........................................................................................................................ 10 2.1. Désignation -

6 Du Code De L’Environnement
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection du captage du Mont Flube *** Ymeray (Eure-et-Loir, 28) Dossier d’Autorisation Environnementale Unique Dossier établi conformément : À l’Article R214-6 du Code de l’Environnement. REDACTION DIFFUSION Dossier Code de l’Environnement Mont Rédigé par Document Flube C.MENARD Nombre de pages 129 Diffusion le 30/09/2018 CCPEIDF – Dossier de DUP des périmètres de protection du forage du Mont Flube Ymeray (28) Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement Septembre 2018 Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France 6 place Aristide Briand 28 230 Épernon Interlocuteur : Mme RAMOND Françoise (Présidente) M. LEMOINE Stéphane (Vice-Président) Utilities Performance 26 rue du Pont Cotelle 45100 ORLEANS Interlocuteur : Mme Camille MENARD Mail : [email protected] Tél : 02 38 45 42 42 Fondateurs de Up 2/129 CCPEIDF – Dossier de DUP des périmètres de protection du forage du Mont Flube Ymeray (28) Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement Septembre 2018 Sommaire 1. RESUME NON TECHNIQUE ......................................................................................................................... 8 2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR .............................................................................................................. 11 2.1. Maître d’ouvrage ................................................................................................................................................... 11 2.2. Personnes -

Communauté De Communes Des Portes Euréliennes D’Ile-De-France
Département d’Eure-et-Loir Arrondissement de Chartres Canton de Maintenon COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D’ILE-DE-FRANCE _____ PROPOSITION DE DÉLIMITATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DU NOUVEAU FORAGE D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE SITUÉ AU LIEU-DIT « MONT FLUBE » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’YMERAY ______ Avis hydrogéologique de Gilbert ALCAYDÉ, Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département d’Eure-et-Loir ________ Paris, le 25 janvier 2018 2 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES EURÉLIENNES D’ILE-DE-FRANCE _____ PROPOSITION DE DÉLIMITATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DU NOUVEAU FORAGE D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE SITUÉ AU LIEU-DIT « MONT FLUBE » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’YMERAY ________ Par arrêté n° 2017-DD28-DESIGN-0027 en date du 24 novembre 2017, Madame la directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire , Délégation territoriale du département d’Eure-et- Loir, m’a désigné, sur proposition de l’hydrogéologue coordonnateur départemental, pour émettre un avis sur la détermination des périmètres de protection à instaurer et sur les mesures de protection à mettre en œuvre autour du captage réalisé au lieu-dit « Mont Flube » sur le territoire de la commune d’Ymeray en vue de la production d’eau destinée à l’alimentation des communes de Gallardon, de Champseru qui ne disposent pas de ressources propres ainsi que de la commune de Gas et de l’aérodrome de Bailleau-Armenonville dont les ressources propres doivent être abandonnées en raison de la mauvaise qualité des eaux produites. -

Ecrosnes Bulletin Municipal
ECROSNES BULLETIN MUNICIPAL 2013 Inscription sur la liste électorale Délivrée en mairie du domicile, Pièces à fournir : 1 pièce d’identité, INFOS SERVICES 1 justificatif de domicile. En cas de changement d’adresse dans la commune, en avertir la mairie. Le justificatif de domicile doit être un original à vos nom et Carte d’identité prénom, de moins de trois mois (quittance EDF, téléphone fixe mais pas de téléphone portable). Délivrée en mairie, Coût : gratuite (en cas de perte ou de vol, le coût est de 25 €), Le recensement et la Journée Défense et Pièces à fournir : Citoyenneté 1 copie intégrale d'acte de naissance ou l’ancienne Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous carte s’il s’agit d’une demande de renouvellement. les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire re- Le livret de famille, pour les enfants censer à la mairie de leur domicile. 2 photos d’identité, Cette démarche obligatoire s'insère dans le parcours de 1 justificatif de domicile, citoyenneté qui comprend outre le recensement, l'ensei- Pour les mineurs : il faut remplir une autorisation paren- gnement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté tale. (JDC). Attention : La présence du demandeur est indispensa- Cette journée donne lieu à la délivrance d'un certificat qui ble pour la prise d’empreinte digitale. est exigé pour présenter les concours et examens organi- sés par les autorités publiques (permis de conduire, bac- Passeport biométrique calauréat, inscription en faculté, etc…) Depuis le 26 mai 2009, les passeports sont délivrés Le recensement implique l'inscription automatique sur la par les mairies équipées du dispositif. -

Annexe Seule.Pdf
DEPARTEMENT EURE-ET-LOIR INVENTAIRES RELATIFS AUX FRAYERES ET AUX ZONES D’ALIMENTATION OU DE CROISSANCE DE LA FAUNE PISCICOLE AU SENS DU L.432-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT Liste des espèces fixée par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 en application du R.432-1 du Code de l’environnement Liste 1 - Chabot ; Lamproie de planer ; Ombre commun ; Truite Inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi « 1 » poissons fario ; Vandoise à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce Liste 2 - Brochet Inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont « 2p » poissons été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes Liste 2 - Ecrevisse à pieds blancs Inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été « 2e » écrevisses constatée au cours de la période des dix années précédentes la sarthe de sa source au loir (nc) Liste Espèces présentes Cours d'eau / Délimitation amont Délimitation aval Observation milieu aquatique Chabot ; Lamproie de la Berthe, ses affluents et De l'aval du pont de la à la confluence avec la planer ; Truite fario ; sous affluents RD368-3, Ronne, 1 Vandoise commune commune NOGENT-LE- ARGENVILLIERS ROTROU Chabot ; Lamproie de la Cloche, ses affluents et De sa source (étang de la à la confluence avec bras inclus 1 planer ; Ombre commun ; sous affluents Magnanne), -

Meta UH Bassin De L'eure
3.2 BASSIN DE L’EURE ET SES 8 UH 106 107 BASSIN DE L’EURE ET SES 8 UH 3ème PARTIE LES ACTIONS PRIORITAIRES PAR META UH 108 109 BASSIN DE L’EURE ET SES 8 UH 108 109 BASSIN DE L’EURE ET SES 8 UH 3ème PARTIE LES ACTIONS PRIORITAIRES PAR META UH Sav05 - AVRE 975 km2 Cette unité hydrographique est occupée aux trois liés à aux pertes karstiques et à la position perchée quarts par l’agriculture, principalement de type de la rivière. Toutes les masses d’eau souffrent 47 000 grandes cultures et élevage tout à l’amont. La surface d’une absence de gestion globale et coordonnée des habitants des prairies a diminué de moitié ces trente dernières milieux aquatiques, ainsi que de la disparition des années (partie Eure) et cette tendance se poursuit. zones humides. Eau de Paris effectue actuellement des mesures de gestion par rapport aux prélèvements km Sur l’aval de l’Avre (R254 et R256), la qualité éco- 641 logique est bonne et doit être préservée, les condi- effectués sur les captages de la Vigne (émergences de cours tions morphologiques pouvant toutefois encore être naturelles). Ces prélèvements ont une influence sur d’eau améliorées (nombreux ouvrages). L’état chimique les débits de l’Avre en aval des sources. Une optimi- est dégradé par les HAP sur l’Avre aval (R256). Sur sation de la gestion est en cours pour caler au mieux l’Avre amont (R252), des altérations morphologiques aux débits biologiques des cours d’eau. (vallée cultivée, plans d’eau) et des pollutions ponc- tuelles (matières organiques et oxydables) compro- La masse d’eau souterraine 3211 est contaminée par mettent l’atteinte du bon état écologique dès 2015. -
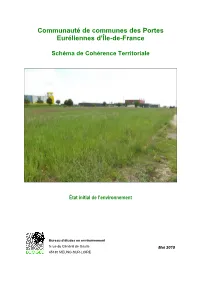
Etat Initial De L'environnement
Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France Schéma de Cohérence Territoriale État initial de l’environnement Bureau d’études en environnement 5 rue du Général de Gaulle Mai 2019 45130 MEUNG-SUR-LOIRE SCOT Portes euréliennes d’Île-de-France SOMMAIRE 1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE ...................................................................... 3 1.1. GÉOMORPHOLOGIE .................................................................................................................................. 3 1.1.1. Relief ............................................................................................................................................... 3 1.1.2. Géologie .......................................................................................................................................... 4 1.2. DONNÉES CLIMATIQUES ........................................................................................................................... 5 1.3. EAU SUPERFICIELLE ................................................................................................................................. 7 1.3.1. Bassin versant ................................................................................................................................. 7 1.3.2. Cours d’eau ..................................................................................................................................... 7 1.4. EAU SOUTERRAINE ................................................................................................................................ -
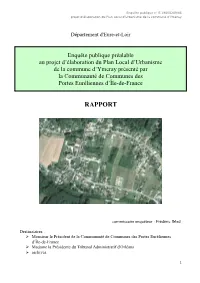
DUP Pièces Constitutives.Indd
Enquête publique n° E 18000209/45 projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ymeray Département d'Eure-et-Loir Enquête publique préalable au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ymeray présenté par la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France RAPPORT commissaire enquêteur : Frédéric Ibled Destinataires : Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France Madame la Présidente du Tribunal Administratif d'Orléans archives 1 Enquête publique n° E 18000209/45 projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ymeray Je soussigné, Frédéric Ibled, désigné en qualité de commissaire-enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal Administratif d'Orléans par la décision n° E18000209/45 en date du 7 janvier 2019 pour conduire l'enquête publique ayant pour objet la demande présentée par la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France (Eure-et-Loir) qui portera sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ymeray, déclare avoir procédé à la dite enquête. Selon les prescriptions de l'article 5 de l'arrêté en date du 15 février 2019 de Monsieur le Président de Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France (Eure-et- Loir), j'ai l'honneur de lui transmettre le dossier complet et les documents accompagnés : de mon rapport ; de mes conclusions motivées sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune d’Ymeray ; des annexes ; du registre d'enquête coté et paraphé, clos par mes soins à la fin de l'enquête ; des copies des documents paraphés attestant de la bonne exécution des mesures d'information et de publicité. -

Bilan Scientifique Eure-Et-Loir
CENTRE BILAN EURE-ET-LOIR SCIENTIFIQUE Tableau des opérations autorisées 2009-2013 Commune Responsable Type N° Année de Référence N° de site Programme Epoque Nom de site (Organisme) d’opération opération réalisation Carte Prospections aériennes 28 Alain Lelong (BEN) PRD 8181 2009 et terrestres sud de l'Eure-et-Loir Prospections aériennes 28 Alain Lelong (BEN) PRD 9021 2010 et terrestres sud de l'Eure-et-Loir Prospections aériennes 28 Alain Lelong (BEN) PRD 9163 2010 et terrestres sud de l'Eure-et-Loir Prospections aériennes 28 Alain Lelong (BEN) PRD 9394 2011 et terrestres sud de l'Eure-et-Loir Prospections aériennes 28 Alain Lelong (BEN) PRD 9813 2012 et terrestres sud de l'Eure-et-Loir Prospections aériennes 28 Alain Lelong (BEN) PRD 10087 2013 et terrestres sud de l'Eure-et-Loir Etude du peuplement 28 Alain Lelong (BEN) PRT 8214 2009 de la Beauce à l'époque antique Etude du peuplement 28 Alain Lelong (BEN) PRT 9428 2011 de la Beauce à l'époque antique 28 Prospection en Eure-et-Loir Daniel Jalmain (BEN) PRD 8233 2009 Prospections dans la vallée de 28 Gabriel Obringer (BEN) PRD 10136 2013 l'Eure, de Chartres à Maintenon Occupation du sol autour 28 du sanctuaire gallo-romain Ingrid Renault (BEN) PRD 8777 2009 de Hanches Occupation du sol autour 28 du sanctuaire gallo-romain Ingrid Renault (BEN) PRD 9913 2012 de Hanches Occupation du sol autour 28 du sanctuaire gallo-romain Ingrid Renault (BEN) PRD 8831 2010 de Hanches Prospections en Eure-et-Loir, les 28 Jean-Luc Renaud (BEN) PRD 10370 2013 mégalithes et leur environnement Prospection -

Inventaire De La Biodiversité Communale Commune De Gallardon
2017 - 2018 Inventaire de la Biodiversité Communale Commune de Gallardon Contact : Eure-et-Loir Nature Maison de la Nature Rue de Chavannes 28630 Morancez Tél : 02.37.30.96.96 E-mail : [email protected] Site internet : www.eln28.org RAPPORT FINAL Inventaire de la Biodiversité Communale Commune de Gallardon Rédaction : Amélie ROUX Bases de données : Eure-et-Loir Nature, SIRFF, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien Botanique – Mammifères - Chiroptères – Lépidoptères – Odonates : Eva CHERAMY, Giovanni SANDER, Bastien MAROQUIN, Julie PAVIE Orthoptères : Laurie GIRARD, Julie PAVIE Ornithologie - Amphibiens – Reptiles : Éric GUERET, Eva CHERAMY Crédits photos : Eure-et-Loir Nature, Oiseaux.net. 2 SOMMAIRE Introduction .................................................................................................................... 5 I) Méthodologie de travail .................................................................................................... 6 L'organisation au sein de l'association ................................................................................. 6 L'implication des élus et des habitants ................................................................................ 6 II) Présentation de la commune ............................................................................................. 7 Le contexte socio-économique .......................................................................................... 7 L'occupation du sol et le réseau hydrographique ................................................................... -

Registre De Suivi Des Dossiers Soumis À L'avis De La Commission Locale De L'eau - 2019
Registre de suivi des dossiers soumis à l'avis de la Commission Locale de l'Eau - 2019 TYPE DE DOSSIER (IOTA RUBRIQUE Numéro DATE DE soumis à autorisation, ORGANISME AYANT SAISI / LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DOSSIER PETITIONNAIRE DU PROJET NOMENCLATURE AVIS DE LA CLE de suivi RECEPTION EPTB, délimitation AAC, INFORME LA CLE DU PROJET EAU désignation OU,…) 1 Travaux de déconnexion de plans d'eau sur cours - bassin Puiseaux - 11/01/2019 IOTA et DIG Préfet du Loiret Syndicat Mixte de la Vallée du Loing Sur le périmètre du SAGE: Avis favorable Vernisson et aménagement ouvrages - bassin Aveyron Bassin Puiseaux-Vernisson, Commune de Nogent-sur- Vernisson 2 Demande d'augmentation de la consommation annuelle d'eau de la société 25/01/2019 IOTA Préfète d'Eure-et-Loir Société Hydro Aluminium Lucé (hors périmètre du SAGE) Pas d'avis (hors HYDRO ALUMINIUM à Lucé (28) périmètre du SAGE) 3 Création d'une Zone d'Aménagement Concerté "ZAC des antennes" - 01/03/2019 IOTA Préfète d'Eure-et-Loir Société d'Aménagement et d'Equipement du 2.1.5.0 Commune de Champhol (28) Avis favorable commune de Champhol Département d'Eure-et-Loir (SAEDEL) 4 Programme de travaux sur 5 ans sur le bassin de l'Œuf, de la Rimarde et de 06/03/2019 IOTA et DIG Préfet du Loiret Syndicat Mixte de l'Œuf, de la Rimarde et de 3.1.1.0 Bassins Œuf, Rimarde, Essonne Avis favorable l'Essonne l'Essonne (SMORE) 3.1.2.0 dans le Loiret 3.1.5.0 5 Questions importantes pour la révision du SDAGE et du PGRI Loire Bretagne 07/03/2019 Comité de bassin Loire Bretagne AELB Bassin Loire Bretagne Avis -

La Vallée De La Voise À Gallardon
A voir sur votre chemin - Montreuil Montreuil est une commune de peuplement ancien. Au lieu-dit de Cocherelle, un très beau dolmen est visible : il date du Néolithique, soit 20 siècles avant J.C. Un habitat de la Tène Finale (IIème – Ier siècles avant J.C.) a été mis au jour dans les années 60 près de Fermaincourt. Une villa gallo-romaine était située aux Prés de l’Eglise, au sud du village actuel, à proximité de la voie romaine de Dreux à Ivry-la-Bataille (sur l’itinéraire de Chartres à Evreux). Le village de Montreuil est mentionné pour la 1ère fois dans un acte de 1132. L’église Saint-Pierre, remaniée aux XVème et XVIème, est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : beau portail datant de 1527, statues de la Vierge et de Saint-Pierre du XVIème siècle. A proximité du village, on peut apercevoir les 79 arches de l’aqueduc de l’Avre. Il est l’un des ouvrages qui alimente la ville de Paris en eau potable. Inauguré en 1893, il achemine 80 millions de litres (sur un total de 680 millions de litres) par jour depuis la région de Dreux. Muzy est sur le passage de la voie romaine Evreux-Dreux (de Dreux à Ivry-la-Bataille). En 1128, le seigneur de Muzy fonda le prieuré Notre-Dame qu’il plaça sous la dépendance de l’abbaye de Coulombs. Aujourd’hui, ne subsiste que l’église Saint Jean-Baptiste datant de la fin du XIIème siècle : mise au tombeau d’époque renaissance, statues de la Vierge et de Saint-Jacques des XVème et XVIème siècle.