PDF Book 1998
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sport, Recreation & Open Space Issues Paper
Sport, Recreation & Open Space Issues Paper - January 2012 Contents 1 SPORT, RECREATION AND OPEN SPACE 1 1.1 Summary 1 1.2 Purpose 1 1.3 What is sport, recreation and open space? 2 1.4 Sport, recreation and open space ‘portrait’ of Cornwall 3 1.5 What is the role of the Core Strategy? 3 1.6 Relevant Policy Context and key evidence 4 1.7 Relevant Evidence and Research 5 1.8 Emerging Evidence 10 1.9 Gaps in Evidence 11 1.10 Key Messages from the Evidence Review 11 1.11 SWOT Analysis 13 1.12 Climate Change Considerations 13 1.13 Main Spatial Planning Issues 14 1.14 Appendix A 14 1.15 Appendix B 15 1.16 Appendix C 15 Sport, Recreation & Open Space Issues Paper - January 2012 Contents Sport, Recreation & Open Space Issues Paper - January 2012 1 Sport, Recreation & Open Space Issues Paper - January 2012 1 Sport, Recreation and Open Space 1.1 Summary Open spaces, sport and recreational facilities underpin people's quality of life in Cornwall. Taking into account the key messages from the current evidence available, the following spatial planning issue has been identified: Issue SROS1 – The Core Strategy should ensure the retention and provision of high quality accessible open spaces and recreational and sports facilities. 1.2 Purpose This is one in a series of papers dealing with a specific theme. Each can be read in isolation or together with other papers to gain a wider understanding of issues facing Cornwall. This paper sets out the evidence base and the policy context for sport, recreation and open space and describes how the issues that need to be addressed in relation to sport, recreation and open space could be taken forward in the Core Strategy. -

B U L L E T I N
B U L L E T I N Making sport and recreation a part of everyday life July 2010 . Issue 25 Coalition government announces sporting intentions I wrote last time about my optimism for the football World Cup and the Go to… potential of a British winner at Wimbledon. In the intervening time the coalition government has announced its austerity budget, including a number of cuts Coalition Government policies which will directly impact on sport and physical activity. On the face of it, Sports Awards optimism should be the farthest from our minds just now. However, there have also been a number of announcements beginning to set out the coalition 5 Hour Offer Survey stance on sport, which includes a desire to create a genuine and lasting Inspire Mark sporting legacy, with a focus on facilities and community level sport. An Playground to Podium additional £50 million is estimated to be directed to sport by 2012 as a result of lottery reform, and there will be an annual Olympic style school event with Club Support Programme increased competitive sport both within and between schools. Get Active Cornwall While we lament the lack of a national champion to cheer from either of the Connecting Cornwall: 2030 summer’s top sporting events, the potential for recent announcements to BCS Championships reinvigorate grass roots sport at a school / community level and the proximity St Austell Swim Fest of 2012, is reason to believe that sport and physical activity at a local level remains important. We should not forget that over the past three years Sports volunteering funding participation in sport has been steadily increasing in Cornwall. -

Origins of Canadian Olympic Weightlifting
1 Page # June 30, 2011. ORIGINS OF CANADIAN OLYMPIC WEIGHTLIFTING INTRODUCTION The author does not pretend to have written everything about the history of Olympic weightlifting in Canada since Canadian Weightlifting has only one weightlifting magazine to refer to and it is from the Province of Québec “Coup d’oeil sur l’Haltérophilie”, it is understandable that a great number of the articles are about the Quebecers. The researcher is ready to make any modification to this document when it is supported by facts of historical value to Canadian Weightlifting. (Ce document est aussi disponible en langue française) The early history of this sport is not well documented, but weightlifting is known to be of ancient origin. According to legend, Egyptian and Chinese athletes demonstrated their strength by lifting heavy objects nearly 5,000 years ago. During the era of the ancient Olympic Games a Greek athlete of the 6th century BC, Milo of Crotona, gained fame for feats of strength, including the act of lifting an ox onto his shoulders and carrying it the full length of the stadium at Olympia, a distance of more than 200 meters. For centuries, men have been interested in strength, while also seeking athletic perfection. Early strength competitions, where Greek athletes lifted bulls or where Swiss mountaineers shouldered and tossed huge boulders, gave little satisfaction to those individuals who wished to demonstrate their athletic ability. During the centuries that followed, the sport continued to be practiced in many parts of the world. Weightlifting in the early 1900s saw the development of odd-shaped dumbbells and kettle bells which required a great deal of skill to lift, but were not designed to enable the body’s muscles to be used efficiently. -

SOME THOUGHTS on the BODY: “HOW IT MEANS” and WHAT IT MEANS Our Friend, Al Thomas, Sent the Following Thoughts to Us Some Values That Weight Training Confers
VOLUME 2 NUMBER 5 January 1993 SOME THOUGHTS ON THE BODY: “HOW IT MEANS” AND WHAT IT MEANS Our friend, Al Thomas, sent the following thoughts to us some values that weight training confers. months back. He didn’t intend for us to publsih them; he only The film, it seems, had created the need for explanation to so many wanted to share with us what was on his mind. Even so, we have people that it became a sort of emotional watershed for me. Or, more decided to share his thoughts with you. As some of you know, Al accurately, it was the film, plus the fact that, having passed through has made seminal contributions to our game—particularly in a my fifties and the first year of my sixties, I was faced with retirement series of articles in Iron Man concerning women, strength and from my profession as a college teacher. With the ticking-down of physical development. He made these contributions simply by the machine that is symbolized by such life-changes, I began to focusing his long experience and his agile intelligence on the issue. wonder what truly had become my “value system”: Was the new What follows is a fascinating display of unexpurgated Thomas one that seemed to be a response to my film really as unworthy of a confronting certain ultimate questions. What follows is not for balding college professor with a Ph.D. as it seemed? the timid. What follows is a love song. As recently as a year ago, I would have claimed my family and (This has its origin in three questions posed at the recent Old-timers’ my profession (along with one or two other traditionally acceptable banquet. -
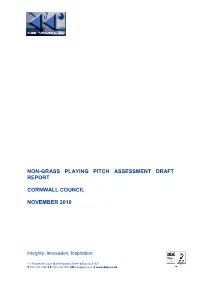
Add Client Organisation
NON-GRASS PLAYING PITCH ASSESSMENT DRAFT REPORT CORNWALL COUNCIL NOVEMBER 2010 Integrity, Innovation, Inspiration 1-2 Frecheville Court off Knowsley Street Bury BL9 0UF T 0161 764 7040 F 0161 764 7490 E [email protected] www.kkp.co.uk Quality assurance Name Date Report origination J. Woods, K. Freely August, September 2010 Quality control C. Fallon 25 October 2010 Client comments Final approval CORNWALL COUNCIL NON-GRASS PLAYING PITCH ASSESSMENT CONTENTS PART 1: INTRODUCTION ................................................................................................... 6 PART 2: CONTEXT .............................................................................................................. 7 2.1: National ...................................................................................................................... 7 2.2: Local......................................................................................................................... 10 PART 3: TOWARDS A LEVEL PLAYING FIELD .............................................................. 16 3.1 Report structure ........................................................................................................ 19 PART 4: GENERAL SPORTS ISSUES ............................................................................. 20 4.1: Introduction .............................................................................................................. 20 4.2: Clubmark ................................................................................................................. -

BOSCASTLE BLOWHOLE No 50 Summer 2005 £1
BOSCASTLE BLOWHOLE No 50 Summer 2005 £1 A Traditional Cornish Sport Returns To The Harbour see page 36 for full story Photo: Graham King Contents: Boscastle School p8 Church & Chapel p12 Posties Corner p14 Crossword p25 Pete's Peeps p26 Letters p32 Editorial The summer edition In many ways it seems a Last summer’s piece making their decision already - although with case of ‘plus ça change .. .’ seemed almost prescient; known, there will be a far such a chilly May it is hard it followed a well attended better likelihood of things In 2001 we were asking being done their way. to believe the calendar. meeting in the Village Hall for more help with the At present we do not have CONGRATULATIONS Blowhole - happily several concerning SWW plans a Village Plan. Whilst new writers are contributing for a sewage works in the the spirit prevails, let us to all the businesses who Valency Valley. prepare one, or better still have reopened since articles, some will become regular columns. Any offers Quote: ‘it was also good a Parish Plan. Let it be the Spring Blowhole - known what we want. We of help are still welcomed. because it brought together everywhere is ‘looking a cross section of our must publish our feelings good’ and let’s hope for 2002 spoke about the lack village. … People forgot about housing, roads and of Village celebrations their differences and joined traffic, the environment, a busy season so it can tourism and leisure, be ‘feeling fine’ as well for the Queen’s Jubilee forces with a common aim. -

Usa Wrestling Guide Contents
USA WRESTLING GUIDE CONTENTS USA Wrestling Media Information . .2 Olympic Team roster . .3 Olympic Games schedule . .4 President James Ravannack . .5 Excellence of USA Wrestling . .6 USA Wrestling Corporate Partners . .8 Executive Director Rich Bender . .9 USA Wrestling National Team Coaches . .10-12 USA Wrestling National Coaching Staffs . .13-14 2008 U.S. Freestyle Olympic Team Coaches . .15 2008 U.S. Greco-Roman Olympic Team Coaches . .16 2008 U.S. Women’s Olympic Team Coach . .17 Olympic Team Leaders . .18-19 International Rules and Scoring . .20-21 What is USA Wrestling? . .22 Olympic Games preview . .23-26 Olympic Games Story Ideas . .27 2008 Freestyle Olympic Team . National Team Rankings . .29 Freestyle Olympic Team Biographies (By Weight Class) . .30-41 2008 Greco-Roman Olympic Team . National Team Rankings . .43 Greco-Roman Olympic Team Biographies (By Weight Class) . .44-55 2008 Women’s Olympic Team . National Team Rankings . .57 Women’s Olympic Team Biographies (By Weight Class) . .58-65 Records & Results . Olympic Games . .67-71 USA Wrestling Records . .72 Editorial content for the 2008 USA Wrestling Team Guide was edited and designed by Craig Sesker. Content and editing assistance provided by Gary Abbott and Elizabeth Wiley. Cover design by Christina Copple. Photography by Larry Slater, John Sachs, Duncan Heath, Juan Garcia, Steve Brown, FILA-Sonka-Foto and Tom Kimmell. Cover Images: All photos were taken by Larry Slater USA WRESTLING MEDIA INFORMATION Gary Abbott either Gary Abbott or Craig Sesker. Communications Director Beijing Cell Phone: 1-391-072- Athletes may also be interviewed at the 0904 approved International Zone area at the Email: [email protected] Athlete Village, again by scheduling the interview with Gary Abbott or Craig Sesker. -

Celebrating Sporting History in Cornwall Cornwall's Sporting
1 July - 1 September 9 April - 27 October 1 March - 31 October Celebrating sporting 7 Fowey Sport 11 Duck Egg Record Home and Away Cricket Bat history in Cornwall Fowey Museum Lost Gardens of Heligan 1 Tel: 01726 852 458 Tel: 01726 845 100 Fowey Museum will Mrs Tremayne was celebrate, in a new presented with a curious exhibition, the variety of cricket bat in 1868 after sports that have taken place getting the duck egg (score 3 in Fowey, and the people of zero) record. Made by R who played them. Local hero, Palk and WLS Trelawney, Percy Seymour Varco, who who described themselves Pilchard Tails and played professional football as artisans of Heligan, the with Aston Villa and later bat includes a flattened tea 15 Other Sports in Constantine 21 became mayor of Fowey spoon, coins and tokens, Constantine Heritage Centre features, as well as ‘Charlie’ and the initials MT. The Tel: 01326 341 353 Rundle who played football small display will also for Tottenham Hotspur. feature photographs of the Constantine once had two football clubs, a bowling club, a rugby There will be photographs, Tremayne family at this date. club and tennis club. It also had the Constantine Pilchard Tails 5 trophies, medals and cycling club. One Constantine family provided a seven-a-side 32 36 memorabilia on display. 35 2 rugby team for Penryn, while local characters such as Dix (Harry Phillips) played darts. This exhibition will explore Constantine’s rich 17 and humorous sporting heritage. 14 18 29 2 August - 1 September See website for dates 2 April - 31 October 38 16 37 25 31 7 30 10 11 28 19 27 34 4 13 24 9 8 Events and exhibitions exhibitions and Events 2012 23 33 6 20 4 12 3 Kernow Kernow 22 Discover Cornwall’s Sporting Heritage 26 Cornish Studies Library 8 12 Istoriow Sport Sport Istoriow Tel: 01209 216 760 This exhibition of photographs, books, newspapers and original Hand Drilling Activity Bob Fitzsimmons and There will also be displays at sports centres manuscript sources will explore the history of sport in Cornwall. -
Cornwall Adventure Sports & Activities
BEST OF CORNWALL 2020 Cornwall Adventure Sports & Activities Cornwall is a Mecca for adrenalin-seekers and there are numerous ways to enjoy thrilling activities while getting to see the county’s beautiful countryside and coastline at the same time. 11 BEST OF CORNWALL 2020 Whether you love surfing the waves of the Atlantic Ocean, climbing the steep granite The Camel Trail is the most well-known recreational trail in Cornwall and is suitable for children and cliffs, zooming along the shores in a kite buggy, or descending a rocky winding trail adults, and cyclists of all abilities. Follow the trail as it runs alongside a disused railway line between Wenfordbridge, Bodmin, Wadebridge and Padstow. on a mountain bike, Cornwall offers plenty of adventure sports and activities for any The 18-mile trails offers views of the beautiful Camel Estuary and there are plenty of opportunities to age and any level. Plan a day out at one of our fun-packed adventure centres or try stop off at and visit local shops, pubs and attractions along the way. out a new sport with a qualified instructor and release the fear! On the following pages we have some of the best adventure sports and activities that Popular cycling trails in Cornwall include the Cornish Trail Multi-Way Trails, Mineral Tramway Heritage Project, First and Last Trail, Engine House Trail, Coast and Clay Trail, the North Cornwall Trail, St, Piran Cornwall has to offer: Trail, Saint’s Way, Wheal Peevor Mine Trail and the Goss Moor Trail. Land-Based Adventures GO KARTING / QUAD BIKING ABSEILING If you fancy yourself as a Formula One driver, and you need to get Abseiling originates from the German world abseilen which translates into “to rope down” and the some practice in, try out one activity involves the controlled descent down a cliff or rock face using a rope. -
Welcome to the Issue
Welcome to the Issue Volker Kluge Editor The focus of the last Journal was the first Olympic There is an intriguing story surrounding the Amsterdam Congress, which on 23 June 1894 decided to revive the poster. As the IOC were unable to agree on a rights deal Olympic Games. They set up an International Olympic with the descendants of the designer, they have used an Committee to organise them. Now, 125 years on, the new image from the cover of a Swiss book instead. This was Olympic House has opened and we offer an introduction based on the photograph of an Austrian wrestler, who of the new building in this issue. was recreating the pose of a statue by German sculptor On the occasion of this anniversary, it was natural to Max Kruse in 1879. These revelations come courtesy of consider other milestones of the Olympic Movement. Gherardo Bonini. Thomas Lippert and I have therefore written an article The contribution of Czech historian Martin Pelc about the IOC anniversaries from 1914 to 1969. on Hedwig Rosenbaum, who took part in the tennis However, the focus should not be on the festivities or tournament in Paris in 1900 and went on to become the the officials, but on the athletes. Among the outstanding first female Olympic medallist in Bohemia, proves that personalities of the past was the German gymnast and everything is still far from being researched. The author wrestler Carl Schuhmann, who also embodied the chose the title “Mistaken Identities” – a topic that is not prototype of the mature athlete, because despite a uncommon in the history of the Olympics. -

Open Rule Britannia-Submit.Pdf
The Pennsylvania State University The Graduate School College of Health and Human Development RULE BRITANNIA: NATIONALISM, IDENTITY, AND THE MODERN OLYMPIC GAMES A Dissertation in Kinesiology by Matthew P. Llewellyn ©2010 Matthew P. Llewellyn Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 2010 The dissertation of Matthew P. Llewellyn was reviewed and approved* by the following: Mark S. Dyreson Associate Professor of Kinesiology Dissertation Adviser Chair of Committee R. Scott Kretchmar Professor of Kinesiology James Thompson Professor Emeritus of Kinesiology Garry Chick Professor of Recreation, Park and Tourism Management Martin Polley Senior Lecturer of Sport History University of Southampton, UK Special Member Karl M. Newell Professor of Kinesiology Head of Department of Kinesiology *Signatures are on file in the Graduate School ii Abstract As the cradle of modern sport, Britain‘s rich sporting history contributed significantly to the nation‘s identity both at home and abroad. Through their governance and control of leading bureaucratic organizations and clubs, the British established and maintained a position of leadership both on and off the field. Britain‘s early sporting dominance, coupled with the use of sport as medium for shaping the abilities, values and character of a British governing class, cultivated a belief that sport played a crucial role in the acquisition and consolidation of British hegemonic power. After an initial period of unrivalled dominance, Britain‘s monopolistic position as leader of modern sport eventually came under serious assault. Britain‘s historical sporting supremacy—similar to her imperial and economic power in general—was relative, not absolute; a position predicated more on the weaknesses of her opponents rather than her own strengths. -

Calendar 2007.Qxd
06/07 COURSES AND WORKSHOPS www.cornwallsportspartnership.co.uk Cornwall Sports Partnership Contacts Executive Jonathan Harris 01872 324 327 Chairman [email protected] Strategic Mike Thomas 01872 324 654 / 07966 892 285 Director [email protected] Partnership Angela Barnett 01872 324 327 / 07968 892 756 Director [email protected] Professional Jacob Leat 01872 324 375 Assistant [email protected] Professional Vicki Gregory 01872 324 385 Assistant [email protected] Clerical Barbara Bardsley 01872 324 391 Assistant [email protected] Community Leadership Karen Edmond 01872 324 392 / 07831 391 796 Liaison Co-ordinator [email protected] Education Leadership Barbara Reynolds 01872 324 392 / 07968 892 945 Liaison Co-ordinator [email protected] Cornwall Club Natasha Sandoe 01872 324 392 / 07966 892 284 Development Officer [email protected] Community Sports Floyd Barnett 07968 516 799 Coach [email protected] Community Sports Marek Chucher 07966 892 283 Coach [email protected] Community Sports Rob Harrison 07973 813 551 Coach [email protected] Community Sports Steve Hillman 07837 311 539 Coach [email protected] Community Sports Chris Hunkin 07973 813 549 Coach [email protected] Community Sports Phil Morris 07973 813 548 Coach [email protected] www.cornwallsportspartnership.co.uk Cornwall NGB Officers Athletics Mo Pearson 01872 324 392 / 07973 813 550 Development Officer [email protected] & Community