Divan Indien
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
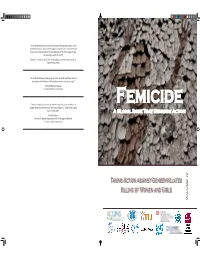
Femicide – a Global Issue That Demands Action, Volume IV
“In the nineteenth century, the central moral challenge was slavery. In the twenteth century, it was the batle against totalitarianism. We believe that in this century the paramount moral challenge will be the struggle for gen- der equality around the world.” Nicholas D. Kristof, Half the Sky: Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide “No child should have to fear going to school. No child should ever have to fear being a child. And no child should ever have to fear being a girl.” PhumzileMlambo-Ngcuka, Executve Director, UN Women “Women subjected to contnuous violence and living under conditons of gender-based discriminaton and threat are always on – death-row, always in fear of executon.” Rashida Manjoo Former UN Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences VOLUME IV ISBN:978- 3- 200- 03012-1 Published by the Academic Council on the United Natons System (ACUNS) Vienna Liaison Ofce Email: [email protected] Web: www.acuns.org / www.acunsvienna.org © 2015 Academic Council on the United Natons System (ACUNS) Vienna Liaison Ofce Fourth Editon Copyright: All rights reserved. The contents of this publicaton may be freely used and copied for educatonal and other non-commercial purposes, provided that any such reproducton is accompanied by an acknowledge- ment of the authors of the artcles. Compiled and Edited: Milica Dimitrijevic, Andrada Filip, Michael Platzer Edited and formated: Khushita Vasant, Vukasin Petrovic Proofread/*Panama protocol summarized by Julia Kienast, Agnes Steinberger Design: Milica Dimitrijevic, Andrada Filip, Vukasin Petrovic Photo: Karen Castllo Farfán This publicaton was made possible by the generous fnancial contributon of the Thailand Insttute of Justce, the Karen Burke Foundaton and the Organizaton of the Families of Asia and the Pacifc. -

HONOR KILLING and BYSTANDER INTERVENTION Garima Jain Dr
Stöckl, Heidi, et al. “The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review.” The Lancet 382.9895 (2013): 859-865. Stump, Doris. “Prenatal sex selection.” Report from the Committee on Equal Opportunities for Women and Men. Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2011). Tabukashvili, Marina. Georgia-A Century from Within. Tbilisi: Taso Foundation, 2011. Print. Tsuladze G,.Maglaperidze N.,Vadachkoria A. Demographic Yearbook of Georgia, Tbilisi, 2012. Barometer, Caucasus. 2010.”Dataset.” Caucasus Research Resource Center. Georgian Reproductive Health Survey (GEORHS10). IDFI.2014.Statistics of Murders in Georgia. https://idfi.ge/ge/statistic_of_murders_in_georgia NCDC/JSI.2012.Maternal Mortality Study: Georgia 2011. Georgian National Center for Disease Cntrol and Public Health, JSI Inc. Tbilisi. Vienna Declaration (2012). Vienna Symposium on Femicide, held on 26 November 2012 at the United Nations Office at Vienna recognized that femicide is the killing of women and girls because of their gender, see the declaration here:http://www.icwcif.com/phocadownload/newsletters/Vienna%20Declaration%20 on%20Femicide_%20Final.pdf. UNFPA Georgia.2014.Population Situation Analysis (PSA). Final Report. World Bank, 2014, Maria Davalos, Giorgia Demarchi, Nistha Sinha. Missing girls in the South Caucasus. Presentation. Conference organized by UNFPA. “Caucasus: Causes, consequences and policy options to address skewed sex ratios at birth. Presentation. Tbilisi International Conference on prenatal sex selection”. 4.7. HONOR RESTORED -

AATA 3325 (28 August 2015)
5KIPGFD[#WUV.++ 1501298 (Refugee) [2015] AATA 3325 (28 August 2015) DECISION RECORD DIVISION: Migration & Refugee Division CASE NUMBER: 1501298 COUNTRY OF REFERENCE: India MEMBER: Amanda Paxton David Corrigan DATE: 28 August 2015 PLACE OF DECISION: Melbourne DECISION: The Tribunal affirms the decision not to grant the applicants Protection visas. Statement made on 28 August 2015 at 4:02pm Any references appearing in square brackets indicate that information has been omitted from this decision pursuant to section 431 of the Migration Act 1958 and replaced with generic information which does not allow the identification of an applicant, or their relative or other dependant. 4GVTKGXGFHTQO#WUV.++QP,WN[CV 8GTKH[XGTUKQP 5KIPGFD[#WUV.++ STATEMENT OF DECISION AND REASONS APPLICATION FOR REVIEW 1. This is an application for review of a decision made by a delegate of the Minister for Immigration to refuse to grant the applicants Protection visas under s.65 of the Migration Act 1958 (the Act). 2. The applicants, who claim to be citizens of India, applied for the visas [in] July 2014 and the delegate refused to grant the visas [in] January 2015. 3. The applicants appeared before a Tribunal constituted by two Members on 14 August 2015 to give evidence and present arguments. 4. The applicants were represented in relation to the review by their registered migration agent. RELEVANT LAW 5. The criteria for a protection visa are set out in s.36 of the Act and Schedule 2 to the Migration Regulations 1994 (the Regulations). An applicant for the visa must meet one of the alternative criteria in s.36(2)(a), (aa), (b), or (c). -

Issues Paper Mixed Marriages in India
MRT-RRT Country Advice Mixed Marriage in India June 2012 Contents Section 1 – Overview ................................................................................................................. 2 Section 2 – Inter-religious marriages ......................................................................................... 5 Legislative Framework – Special Marriage Act 1954 ........................................................... 5 Legislative Framework – Religious Personal Laws ............................................................... 6 Registration ............................................................................................................................ 9 Social Attitudes .................................................................................................................... 10 Treatment by non-state actors .............................................................................................. 13 Khap Panchayats .................................................................................................................. 15 State Protection .................................................................................................................... 16 Relocation ............................................................................................................................ 19 Section 3 – Inter-caste marriages ............................................................................................. 22 Introduction to the Caste System ........................................................................................ -

The Case of the Love Commandos : Vish Puri, Most Private Investigator / Tarquin Hall
Also by Tarquin Hall From the Files of Vish Puri, India’s Most Private Investigator The Case of the Missing Servant The Case of the Man Who Died Laughing The Case of the Deadly Butter Chicken Nonfiction Mercenaries, Missionaries and Misfits: Adventures of an Under-age Journalist To the Elephant Graveyard: A True Story of the Hunt for a Man-Killing Elephant Salaam Brick Lane: A Year in the New East End Copyright © 2013 by Sacred Cow Media, Ltd. All rights reserved. The use of any part of this publication reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or stored in a retrieval system, without the prior written consent of the publisher – or, in case of photocopying or other reprographic copying, a licence from the Canadian Copyright Licensing Agency – is an infringement of the copyright law. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Hall, Tarquin The case of the love commandos : Vish Puri, most private investigator / Tarquin Hall. eISBN: 978-0-7710-3840-2 I. Title. PR6108.A544C374 2013 823’.92 C2013-900687-7 McClelland & Stewart, a division of Random House of Canada Limited a Penguin Random House Company One Toronto Street Suite 300 Toronto, Ontario M5C 2V6 www.randomhouse.ca v3.1 For Ta Contents Cover Other Books by This Author Title Page Copyright Dedication Prologue Chapter One Chapter Two Chapter Three Chapter Four Chapter Five Chapter Six Chapter Seven Chapter Eight Chapter Nine Chapter Ten Chapter Eleven Chapter Twelve Chapter Thirteen Chapter Fourteen Chapter Fifteen Chapter Sixteen Chapter Seventeen Chapter Eighteen Chapter Nineteen Chapter Twenty Chapter Twenty-one Chapter Twenty-two Chapter Twenty-three Chapter Twenty-four Chapter Twenty-five Epilogue Mouthwatering Dishes from the Vish Puri Family Kitchen Lucknow Mutton Biryani Chubby’s Peckish Pakoras Coriander Chutney Hungry Hungry Halva Glossary About the Author Prologue The Love Commando watched the black Range Rover pull in through the gates of the University of Agra. -

Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board Of
Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of... https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=4... India: Situation of inter-religious and inter-caste couples, including treatment by society and authorities; situation of children from such marriages (2017-May 2019) 1. Context According to data from India's 2011 census, India's main religious groups are Hindus (79.8 percent), Muslims (14.2 percent), Christians (2.3 percent) and Sikhs (1.7 percent) (US 25 Apr. 2018). Articles 25-28 of the Constitution of India provide for freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (India 1949). Article 25(1) provides the following: "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion" (India 1949). In India, the caste system is a form of hierarchical social stratification that divides Hindus into social categories and occupational groups, with the lowest group, who are outside the caste system, being the Dalits or "untouchables" (BBC 20 July 2017). Sources state that caste-based social structures remain a fundamental component of India's Hindu-dominant society and that caste-based discrimination persists (Anthropologist 5 Apr. 2019; Professor 6 Apr. 2019). Some other religious groups in India also have castes (US 29 May 2018, 7; Anthropologist 5 Apr. 2019; Professor 6 Apr. 2019). Article 15(1) of India's constitution provides the following: "The State shall not discriminate against any citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them" (India 1949). -

Palestinian Myths Debunked
$12 SUMMER 2012 VOLUME 19, NUMBER 3 Palestinian Myths Phyllis Chesler and Nathan Bloom Debunked Hindu vs. Muslim Honor Killings Alex Joffe Ofra Bengio Iraq and Turkey as The Rhetoric of Nonsense Models for Arab Democracy? David Bukay Ilan Berman Usurping Jewish History Iran’s Beachhead in Latin America Shaul Bartal Bruce Maddy-Weitzman Denying a Jewish Jerusalem The Arab League’s New Relevance Havatzelet Yahel, Hilal Khashan Ruth Kark, and Lebanon’s Shiite-Maronite Seth J. Frantzman Alliance The Negev Bedouin Reviews by Are Not Indigenous Abrahms, Dann, Güçlü, Himelfarb, Luft, Malik, Michael, Phelps, Rubin and Schanzer • Operationally: The Forum exerts an active in- fluence through its projects, including Campus Watch, Islamist Watch, the Legal Project, and the Forum Washington Project. www.MEForum.org • Philanthropically: The Forum distributes $2 million annually through its Education Fund, help- The Middle East Forum works to define and promote ing researchers, writers, investigators, and activists American interests in the Middle East and to protect the around the world. Constitutional order from Middle Eastern threats. The Forum holds that the United States has vital interests in the The MEF is a publicly supported, nonprofit organiza- region; in particular, it believes in strong ties with Israel and tion under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. other democracies as they emerge. Contributions are tax deductible. For information about • Intellectually: Through the Middle East membership, please contact the Middle East Forum, 1500 Quarterly, staff writings, lectures, and conference Walnut Street, Suite 1050, Philadelphia, PA 19102, calls, the Forum provides context, insights, and E-mail: [email protected]; Tel.: (215) 546-5406; Fax: policy recommendations. -

Recapitulation and Conclusion
RECAPITULATION AND CONCLUSION INTRODUCTION The research motif of this study began, and remains focused on, the question, Why would Indian parents kill young people who have fallen in love and make a public showing so their community can see what they have done? A parallel question followed: With the adoption of a Western-style democratic constitution and a police force available, why does the murder of newly married couples still happen in the present era? Added to these are the questions: What is progress? and, What are the steps forward? This study critically analyzes an extraordinary sequence of events that began in 1993 with global media reporting the illegal murder of young lovers in Northern India. It tells an ongoing saga involving local communities, the general public and the government. PAPER 1 Entitled ‘Towards a Study of Potentially Tragic Romantic Events of Romeo and Juliet Style (happening in the World Today and Mythological)’, Paper 1 is an ‘a priori’ research protocol for the study. As stated in the paper’s introduction, I, the author, noted violent outcomes involving young couples. This led to a desire to study and attempt to understand the couples’ social situation. The intent was to make a contribution to global perceptions regarding social progress related to romance tragedy in various cultures, in this instance involving race, religion, and social status, primarily in India. In Nepal in 2001, I was able to meet Hindu people locally and socially through professional voluntary working commitments. Paper 1 indicates five research avenues to be followed in investigating romance tragedy involving young lovers: mythological Recapitulation and conclusion 238 and legendary stories; in-depth interviews; community opinion; media reports; and theatre and the arts. -

Will They Sing Like Raindrops Or Leave Me Thirsty
understand i am 27 yrs old even my father beat me.We both traveled 9 years life togeth- er hope u can understand our situation if we separate. We would have 2 children if we get married, even we decided our children names. Day by day my parents are showing their cruel towards me. They are not allowing me to go out. My father is trying to con- tact my soul (my girl friend) to threaten her. They are saying if both get married they will kill us and they will also die. He is not allowing me to go office alone, they are following me where ever i go. Even he is asking my brother to follow me with out my knowing. The only problem is that my girl friend is another caste. Even he is saying that none of our relatives treat my father with respect because he married my mother on his interest (same caste). His intention is If i marry my girl friend no one will give respect to him. But all my relatives are comming to us now just bcoz of money. They are ready to kill us but not ready to accept us. Please help us. Subhas Prasad September 15th, 2011 7:58 pm I want to marry a brahmin girl, but our family are against it. There are chances of some legal & non legal action from both the family. Can you help us in getting married? We cant even get our friend envolved in this matter coz they are afraid. Urgent help required. -

Loving and Living in 21St Century India
ISSN (Online) - 2349-8846 Loving and Living in 21st Century India SUHASINI RAJ Vol. 47, Issue No. 25, 23 Jun, 2012 Suhasini Raj ([email protected]) is a freelance journalist based in New Delhi. Honour killings are rampant in many parts of India, particularly in its north and northwest states. An account of a young couple who managed to escape and marry but are still being hunted and thus, hiding. India sees more than 1000 honour killings every year say experts. The need for a law on honour killings / honour crimes to act as a deterrent is still to shape up in India, although Prime Minister Manmohan Singh had referred it to a group of ministers in 2010 and it should have been introduced as a bill a while ago. The National Crime Records bureau has no separate data on the number of honour killings but clubs them with murders. In 2010, Shaktivahini, an NGO working on honour killings, had filed a petition in the Supreme court, acting upon which the court had sought a response from the eight state governments, Haryana, Punjab, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Himachal Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where honour killings are rampant. Most recently, in a shocking revelation in Uttar Pradesh, a policeman, Satish Kumar Mathur was caught on hidden camera, advising the father of a girl who had married against his wishes, to kill her if she had indeed eloped. It is a matter of common knowledge that there remains strong resistance to inter caste and inter religious marriage in many families in India. -
![[2013] RRTA 207 (7 March 2013)](https://docslib.b-cdn.net/cover/0120/2013-rrta-207-7-march-2013-7130120.webp)
[2013] RRTA 207 (7 March 2013)
1200852 [2013] RRTA 207 (7 March 2013) DECISION RECORD RRT CASE NUMBER: 1200852 DIAC REFERENCE(S): CLF2011/198652 COUNTRY OF REFERENCE: India TRIBUNAL MEMBER: Sophia Panagiotidis DATE: 7 March 2013 PLACE OF DECISION: Melbourne DECISION: The Tribunal affirms the decision not to grant the applicant a Protection (Class XA) visa. STATEMENT OF DECISION AND REASONS APPLICATION FOR REVIEW 1. This is an application for review of a decision made by a delegate of the Minister for Immigration to refuse to grant the applicant a Protection (Class XA) visa under s.65 of the Migration Act 1958 (the Act). 2. The applicant who claims to be a citizen of India, applied to the Department of Immigration for the visa on [date deleted under s.431(2) of the Migration Act 1958 as this information may identify the applicant] November 2011. 3. The delegate refused to grant the visa [in] January 2012, and the applicant applied to the Tribunal for review of that decision. RELEVANT LAW 4. Under s.65(1) a visa may be granted only if the decision maker is satisfied that the prescribed criteria for the visa have been satisfied. The criteria for a protection visa are set out in s.36 of the Act and Part 866 of Schedule 2 to the Migration Regulations 1994 (the Regulations). An applicant for the visa must meet one of the alternative criteria in s.36(2)(a), (aa), (b), or (c). That is, the applicant is either a person in respect of whom Australia has protection obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees as amended by the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (together, the Refugees Convention, or the Convention), or on other ‘complementary protection’ grounds, or is a member of the same family unit as a person in respect of whom Australia has protection obligations under s.36(2) and that person holds a protection visa. -

Honour Killing
6/30/2020 Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada Home Country of Origin Information Responses to Information Requests Responses to Information Requests Responses to Information Requests (RIR) are research reports on country conditions. They are requested by IRB decision makers. The database contains a seven-year archive of English and French RIR. Earlier RIR may be found on the European Country of Origin Information Network website . Please note that some RIR have attachments which are not electronically accessible here. To obtain a copy of an attachment, please e-mail us. Related Links Advanced search help 4 June 2020 IND200256.E India: Honour-based violence, including prevalence in rural and urban areas; legislation; state protection and support services available (2016-May 2020) Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada 1. Overview In a 2012 report on honour-based violence related to the freedom of marriage, the Law Commission of India states that the terms "'honour killings'" and "'honour crimes'" are "expressions to describe the incidents of violence and harassment caused to [a] young couple intending to marry or having married against the wishes of the community or family members" (India Aug. 2012, 1). In an opinion piece published by Al Jazeera, Kavita Krishnan, the Secretary of the All India Progressive Women's Association (AIPWA) (Al Jazeera n.d.), indicates that honour-based violence can be defined as the "[v]iolence (against men and women both) to prevent a woman from exercising her choice in love and marriage," and adds that conceptions of honour-based violence must take into account a "very wide variety of https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458113&pls=1 1/14 6/30/2020 Responses to Information Requests - Immigration and Refugee Board of Canada forms, including violence against [a] daughter's partner" (Krishnan 14 Mar.