Préfet De La Région Nord - Pas-De-Calais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
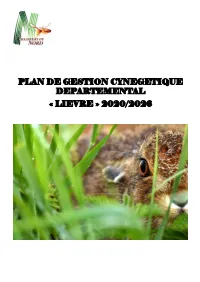
PGCA Lièvre 2020-2026
PLAN DE GESTION CYNEGETIQUE DEPARTEMENTAL « LIEVRE » 2020/2026 Un plan de gestion cynégétique lièvre existe sur l’ensemble du département du Nord depuis 2009. En 2015, et à partir des cartes d’attributions et de réalisations des 6 premières années d’exercice, la Fédération des Chasseurs du Nord a divisé le département en 20 unités de gestion cohérentes de l’espèce tout en respectant les limites des régions agricoles. Suite aux résultats positifs de ce dispositif de gestion au cours du PGCA 2015-2020 (cf graphique d’évolution des attributions départementales ci-dessous et indicateurs de suivi détaillés dans chacune des unités de gestion ci-après), nous proposons de maintenir ce découpage géographique pour les 6 prochaines années d’exercice. Evolution des attributions de bracelets de lièvres sur le département du Nord 70000 65200 65000 62423 60000 57638 55248 56399 53585 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Année Année Année Année Année Année 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 20 unités de gestion lièvres dans le département : - Flandre maritime : UGL1, - Flandre intérieure: UGL2, UGL3, UGL4 et UGL5, - Plaine de la Lys : UGL6, - Région de Lille : UGL7, - Pévèle : UGL8, - Plaine de la Scarpe et de l’Escaut : UGL9 et UGL10, - Cambrésis : UGL12, UGL13 et UGL14, - Hainaut : UGL11, UGL15, UGL16, UGL17 et UGL18, - Thiérache : UGL19 et UGL20. Éligibilité du plan de gestion lièvre Le plan de gestion départemental « Lièvre » décliné sur chaque unité de gestion est approuvé pour six années par un arrêté préfectoral après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS). -

Notice De Mise En Compatibilité Du Plui De L'hesdinois
Notice de mise en compatibilité du PLUi de l’Hesdinois Extension d’une zone économique sur Marconnelle Accusé de réception en préfecture 062-200044030-20190923-2019-093-DE Date de télétransmission : 27/09/2019 Date de réception préfecture : 27/09/2019 Sommaire I. Introduction ................................................................................................................ 3 II. Cadre législatif ............................................................................................................ 4 III. Modifications apportées aux pièces du Plan Local d’Urbanisme .............................. 7 1. Le plan de zonage ................................................................................................... 7 2. Compatibilité avec le règlement de la zone UE ..................................................... 8 IV. Conclusion .................................................................................................................. 9 Déclaration de projet- mise en compatibilité-PLUi de l’Hesdinois-Extension d’uneAccusé zone deéconomique réception en sur préfecture la commune de Marconnelle 062-200044030-20190923-2019-093-DE Date de télétransmission : 27/09/2019 Page 2 Date de réception préfecture : 27/09/2019 I. Introduction Le conseil communautaire de l’ex CCH ( Communauté de Communes de l’Hesdinois), a prescrit le 25 octobre 2012 l’élaboration d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal, dont le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a fait l’objet d’un débat le 18 décembre 2013. Au -

Prefecture Du Nord Republique Francaise
PREFECTURE DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE ---------------------------------- ------------------------------------- DIRECTION DES MOYENS ET DE LA COORDINATION Bureau de la coordination et des affaires immobilières de l'Etat Arrêté portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Communes de l'arrondissement de Valenciennes - Le Préfet de la Région Nord/Pas-de-Calais Préfet du Nord Commandeur de la Légion d’Honneur Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article R 111-4-1, Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R 123-13 et R 123-14, Vu le code de l’environnement, et notamment son article L 571-10, Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 14, Vu le décret n° 95.20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements, Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, Vu l’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, Vu la consultation des communes en date du 27 octobre 1999, A R R E T E : ARTICLE 1 - OBJET Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres des communes de l’arrondissement de Valenciennes mentionnées à l’article 2 du présent arrêté. -

Comité De Séquestre Pour La Gestion Des Biens Du Clergé Français Supprimé, Situé Aux Pays-Bas / P
BE-A0510_000433_002911_FRE Inventaire des archives du Comité de Séquestre pour la gestion des biens du clergé français supprimé, situé aux Pays-Bas / P. Lefèvre Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Comité de Séquestre pour la gestion des biens du clergé français DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:............................................................................5 Consultation et utilisation..............................................................................................6 Recommandations pour l'utilisation................................................................................6 Histoire du producteur et des archives..........................................................................7 Producteur d'archives.......................................................................................................7 Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille...........................................7 Compétences et activités.............................................................................................8 Contenu et structure......................................................................................................9 Contenu.............................................................................................................................9 Mode de classement.........................................................................................................9 -

Annexe CARTOGRAPHIQUE
S S R R R !" R $%&''()(* , R R - ! R - R - ". 0E -F 3R -, R (4- - '. 5 R R , , R 2 MM Le territoire du SAGE de l'Authie 1 Le Fliers L 'Au thie La Grouches ne en ili K L a La G é z a in c o u r to Entités géographiques Occupation du sol is e L'Authie et ses affluents Broussailles Limite du bassin hydrographique de l'Authie Bâti Pas-de-Calais Eau libre Somme Forêt Sable, gravier Zone d'activités 05 10 Km Masses d'eau et réseau hydrographique réseau et d'eau Masses Masse d'eau côtière et de transition CWSF5 transition de et côtière d'eau Masse Masse d'eau de surface continentale 05 continentale surface de d'eau Masse Masse d'eau souterraine 1009 : Craie de la vallée d vallée la de Craie : 1009 souterraine d'eau Masse L'Authie et ses affluents ses et L'Authie Le Fli ers e l'Authie e l Les masses d'eau concernant le territoire territoire le concernant d'eau masses Les ' A u t h i e du SAGE de l'Authie de SAGE du la Gézaincourtoise l a G r o u c h 0 10 l e a s K il ie n n 5 Km e 2 Les 156 communes du territoire du SAGE de l'Authie (arrêté préfectoral du 5 août 1999) et la répartition de la population 14 3 AIRON-NOTRE-DAME CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES AIRON-SAINT-VAAST RANG-DU-FLIERS BERCK BOISJEAN WAILLY-BEAUCAMP VERTON CAMPAGNE-LES-HESDIN BUIRE-LE-SEC GROFFLIERS WABEN LEPINE GOUY-SAINT-ANDRE ROUSSENT CONCHIL-LE-TEMPLE MAINTENAY SAINT-REMY-AU-BOIS NEMPONT-SAINT-FIRMIN TIGNY-NOYELLE SAULCHOY CAPELLE-LES-HESDIN -

Voirie Départementale Viabilité Hivernale
Voirie Départementale BAISIEUX Viabilité Hivernale Agence Routière de PEVELE-HAINAUT CAMPHIN-EN-PEVELE Barrières de Dégel HIVER COURANT GRUSON WANNEHAIN SAINGHIN-EN-MELANTOIS R D0 093 VENDEVILLE BOUVINES WAVRIN RD0094A HOUPLIN-ANCOISNE R D BOURGHELLES 0 CYSOING 0 6 2 TEMPLEMARS PERONNE-EN-MELANTOIS R D 0 LOUVIL 0 1 A FRETIN 0 9 3 9 SECLIN 9 0 4 0 5 0 0 0 0 D D D R HERRIN R R R GONDECOURT D 3B 0 D009 9 R RD0039 1 7 BACHY 4 R 9 D 0 0 0 R 9 D D AVELIN 1 0 R 06 7 ENNEVELIN RD 2 R 03 COBRIEUX D 45 0 R 1 D 2 0 8 9 ALLENNES-LES-MARAIS 5 RD 5 7 0 TEMPLEUVE-EN-PEVELE 4 CHEMY 54 1 9 0 R D D 0 GENECH R R 1 R R D 2 D0 D2 0 8 14 549 5 5 CARNIN 49 5 RD 92 R 009 0 D 3 D 0 R 0 6 PONT-A-MARCQ 2 B R R D D RD 0 0 C 0 549 0 D0054 A ATTICHES R 9 MOUCHIN R 6 D0 62 1 955 0 2 7 R 0 B D D 01 R PHALEMPIN 28 FLINES-LES-MORTAGNE 8 R 0 D 0 CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 8 0 0 0 3 R 6 D D 2A 9 R 0 R R 0 D 0 R 4 D MERIGNIES D 0 1 1 D 0 R 6 0 0 6 9 2 1 TOURMIGNIES 0 R 2 NOMAIN D 4 0 5 9 0 CAPPELLE-EN-PEVELE 5 MORTAGNE-DU-NORD 0 0 5 D 2 R 1 0 AIX D 6 2 LA NEUVILLE R 1 7 R 0 032 MAULDE D R D D 0 7 R RD R 2 D 2 127 012 6 01 RD0 7 A 8 0 D RUMEGIES 68 0 R 02 0 A D 8 7 012 R WAHAGNIES 8 D R 3 R D 9 CHATEAU-L'ABBAYE 0 5 0 A 5 D 3 5 4 R 9 9 THUN-SAINT-AMAND 7 0 0 R 0 D A D 6 R D R 4 2 0 95 0954 1 D 0 R D0 MONS-EN-PEVELE RD 0 RUMEGIES 0 HERGNIES 8 R R AUCHY-LEZ-ORCHIES D R 3 2 D 4 BERSEE R R R 6 5 D01 D 8 0 D 58 0 R 0 0 4 LECELLES 2 0 1 27 D 5 5 0 D 8D 0 4 8 6 R SAMEON 6 6 8 6 4 0 0 LECELLES 0 A VIEUX-CONDE D 2 0 D 0 R THUMERIES 2 R R R 1 1 LANDAS 0 D D 9 D R 0 NIVELLE 0 D0 0 008 6 R -

La Communauté Urbaine D'arras Crée Les Conditions Pour Que Le Vélo
Mardi 15 mai 2018 La Communauté Urbaine d’Arras crée les conditions pour que le vélo devienne facile dans le territoire La nouvelle piste cyclable dans le bois de la Citadelle d’Arras. Après avoir choisi de subventionner l’achat de vélo à assistance électrique, avoir mis en place un système de location longue durée de vélo à assistance électrique, la Communauté Urbaine d’Arras poursuit le développement des aménagements cyclables sur son territoire. Depuis le début de l’année 2018, des travaux ont été engagés pour créer des garages à vélos ainsi que des liaisons cyclables pour faciliter les trajets domicile-travail à l’aide de son vélo. Nouvelles pistes cyclables Dans le courant de l’année 2018, trois liaisons cyclables seront réalisées par le service voirie de la Communauté Urbaine d’Arras. Ces pistes sont situées sur les communes d’Achicourt, Arras, Saint-Laurent-Blangy, Fampoux et Roeux. • Liaison boulevard du Général de Gaulle – cité du Polygone à Achicourt : o La piste est terminée, avec un éclairage public à leds qui déclenche avec un détecteur de présence. o Montant des travaux : 187 645,70 € HT dont 87 000 euros de subventions. • Liaison Fampoux (rue des Moulins) – Roeux (rue du Pont) sur le chemin de halage et sur 2,7 km : o Démarrage des travaux le 28 mai pour une durée d’un mois. o Montant des travaux : 607 958,00 € HT dont 280 000 euros de subventions TEPCV • Liaison Darse Méaulens (rue de l’Abbé Pierre) – Saint Laurent Blangy (rue Laurent Gers) sur le chemin de halage et sur 2,5 km o Remplacement du revêtement en sable stabilisé par un revêtement comme celui utilisé à la Citadelle. -

Toutes Les Informations De Notre Village
SERQU’INFOS Toutes les informations de notre village Janvier 2019 Edition n° 29 Editorial EDITO Serquoises, Serquois, chers amis Serquoises, Serquois, C’est toujoursJe suis heureuse avec le même d’ouvrir plaisir la porte que deje vouscette retrouve nouvelle pour année vos avec présenter vous tous mes Serquoises, vœux et vous retracerSerquois. les C’est moments un moment forts de de 2016 rencontre et regarder qui fait vers chaud 2017. au cœurNous poursommes nous en, élus période, même difficile. si nous avons NotreJe suisde Pays nombreusesheu estreuse touché de occasionsvous par le retrouver chômage de nous en qui cerencontrer malheureusement début d’année tout au pour long n’est le de traditionnel pas l’année. en diminution Mais moment prenons et laisse un peu les airs d’échangebeaucoup depour vœux. desurvoler nos C’est concitoyens leaussi monde le moment etsur arriver le bord de dans dresser de lanotre route. un beaubref Nous bilanPays. avons des A l’ heureréalisationsvécu des où événementstout de va l’année vite, oùterribles les informations et écouléemalheureuseme et decirculent parler projets.presqunt l’histoiree L’année à la vitesse se répète.2017 de a laencoreNous lumière, sommes été oùriche l’on encore en peut travaux, en avoir deuil, maisbeaucoup et lesaujourd’hui baisses d’amis jesans souhaite les connaître, et importantesm’associer,ne de plus dotation nous con naîassocier, d’Etattre ses depuis tous voisins, à 2013la oùpeine noustout de seamenant ceux sait quiet où àont revoir on été peut touchésnotre rapidement plan dans d’investissement. leur désorganiser cœur. le cours de la vie Les projets serontenAprès envoyant pour ce préambule, certains une simple reportés je idée tiens surcar à remercierlesil nous réseaux est les impensable sociaux, employés notre d’augmenter communaux Monde, notre lesainsi impôts Pays, que lenotre afin conseil de entourage sont compensermunicipal. -

Liste Des Communes Situées Sur Une Zone À Enjeu Eau Potable
Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ABANCOURT 59001 Oui ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Oui ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Oui ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Oui ACHICOURT 62004 Oui ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Oui ADINFER 62009 Oui AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Oui AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Oui AIBES 59003 Oui AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Oui AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Oui AIRON-NOTRE-DAME 62015 Oui AIRON-SAINT-VAAST 62016 Oui AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Oui AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Oui ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Oui ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non Page 1/59 Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Oui ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Oui ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Oui AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Oui AMY 60011 Oui ANDAINVILLE 80022 Non ANDECHY 80023 Oui ANDRES 62031 Oui ANGRES 62032 Oui ANHIERS 59007 Non ANICHE 59008 Oui ANNAY 62033 -

ARC-EN-CIEL 2020 Schematique A2
vers vers Libercourt 203 206 vers Lille 201 vers Villeneuve d'Ascq vers Valenciennes BREBIERES CORBEHEM COURCHELETTES LAMBRES Lille LEZ DOUAI 207 vers Orchies RÉSEAU D’AUTOCARS DOUAI COROT DES HAUTS-DE-FRANCE 320 325 ABSCON Lycée SECTEUR NORD Polyvalent 6 MariannesEscaudainPlace StadeMarceauClg Félicien1/4 de CitéJoly6 heures HeurteauEgliseCambrésisMerrheimSalle (Forge) BaudinCheminCollège LatéralGare Bayard duErnestine NordDenain311 Hôpital Place Gare de Somain CAMBRÉSIS-SOLESMOIS Cité BonDéchetterie secoursLe ParcPlace Citédes hérosBrisseRésidenceSupermarché MolièreFaconSalle rue du desGrand pont SportsPlace CarréAxter StadeTennisMairieClémenceauSaint-AméLe Châtelier BoulevardRue Pasteur de ParisDe Gaulle Place Carnot Lycée Kästler CAUDRÉSIS-CATÉSIS Edmond Labbé Place ESCAUDAIN HORNAING DENAIN Pont de l'enclos septembre 2020 311 Les Baillons Saint-Pé Rue de Férin 4 Chemins Gare Place 4 Chemins Rond Point 1 Place Bocca Mairie FAMARS UNIVERSITÉ Gare de Douai Delforge Joliot Curie ANICHE 341 EMERCHICOURT SOMAIN Barbusse 303303E 303 333 420 RN vétérinaire Porte de Lycée Église 201 311 DENAIN Monsieur GayantRimbaud MONCHECOURT Collège E Litrée du Raquet FENAIN DOUCHY LES MINES ESPACE VILLARS FAMARS Marbrier VITRY Église BOUCHAIN PLACE ANICHE Mairie Annexe EN ARTOIS DECHY MARCQ EN 340 BOUCHAIN Parrain 311 334 Mineur Mairie COLLÈGE MONOD Maréchal Foch GOUY SOUS DOUAI OSTREVENT Centre Place 341 rue Pasteur NOYELLES SUR SELLE Rue de sailly BELLONNE SIN Église Wignolle LedieuPlace Moulin Cimetière Les 3 Bouleaux Rue Férin LE NOBLE Place Suzanne -

Segpa Douaisis
DOUAISIS - ASH Orchies Clg du Pévèle Roost Warendin MOUCHIN Clg Dr Schaffner NOMAIN Collèges avec SEGPA AIX Lallaing Collèges avec SEGPA AUCHY- et ULIS Auby Clg J.Curie LEZ-ORCHIES SAMEON Clg Victor Hugo LANDAS ORCHIES FAUMONT BEUVRY-LA-FORET COUTICHES RAIMBEAUCOURT Somain Clg Pasteur, V.Hugo BOUVIGNIES TILLOY-LEZ- ROOST- FLINES-LEZ- MARCHIENNES RACHES WARENDIN RACHES AUBY MARCHIENNES WARLAING FLERS-EN- ANHIERS ESCREBIEUX WANDIGNIES- HAMAGE VRED RIEULAY PLANQUE ESQUERCHIN WAZIERS LALLAING PECQUENCOURT ERRE DOUAI CUINCY MONTIGNY- FENAINHORNAING SIN-LE-NOBLE EN-OSTREVENT SOMAIN Douai LAMBRES- BRUILLE-LEZ- Clg Canivez, LEZ-DOUAI LOFFRE MARCHIENNES Gayant, ECAILLON Streinger, GUESNAIN COURCHELETTES Aniche DECHY LEWARDEMASNY Clg T.Monod FERIN ANICHE ROUCOURT AUBERCHICOURT GOEULZIN ERCHIN EMERCHICOURT MONCHECOURT CANTIN VILLERS-AU- TERTRE ESTREES BUGNICOURT MARCQ-EN- FRESSAINOSTREVENT Sin Le Noble HAMEL ARLEUX Clg A. France LECLUSE BRUNEMONT Arleux AUBIGNY- FECHAIN Clg Val de Sensée AU-BAC DOUAISIS - ASH Orchies Flines les Râches Clg du Pévèle Ecole Cassin Roost Warendin Waziers MOUCHIN Ecole Jules Ferry ULIS écoles Clg Dr Schaffner LP Croizat Clg Victor Hugo NOMAIN Marchiennes Ecole L.Gambetta, Collèges avec SEGPA AIX Clg M. Yourcenar Guironnet Lallaing AUCHY- Collèges avec ULIS Auby Clg J.Curie LEZ-ORCHIES SAMEON LP Croizat Ecole H.Dunant M LP LP avec ULIS Clg Victor Hugo LANDAS ORCHIES Ecole M.Pagnol IME Pecquencourt FAUMONT ERPD COUTICHES BEUVRY-LA-FORET Clg Schumann Ecole Langevin Flers en Escrebieux Wallon IEM Ecole Pt de la Deûle RAIMBEAUCOURT -

RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution De La Vème République Préfecture
RÉFÉRENDUMS - 1 RÉFÉRENDUM DE 1958 Constitution de la V ème République Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/2 Prévisions des résultats : rapports des sous-préfets et du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/3 Propagande communiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/4 Propagande socialiste : rapports des Renseignements généraux. 1W45524/7 Note sur la présence de ressortissants marocains sur certaines listes électorales. • Résultats 1W45524/6 Déroulement du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45524/5 Suivi des résultats. Sous-préfecture de Lens 1724W41/1 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux antérieurs et postérieurs à la consultation. Coupures de presse. RÉFÉRENDUMS - 2 RÉFÉRENDUM DE 1961 Autodétermination de l’Algérie Préfecture. Cabinet du préfet • Déroulement de la campagne électorale 1W45524/8 Organisation matérielle du scrutin : circulaire ministérielle. Allocution prononcée le 20 décembre 1960 par le général de Gaulle. 1W45524/8 Prévisions : rapport du 23 décembre 1960. 1W45524/8 Position des organisations politiques : rapport des Renseignements généraux. • Résultats 1W45524/8 Rapport post-électoral du préfet au ministre de l’Intérieur. Sous-préfecture de Lens 1724W41/2 Affiche de l’allocution du général de Gaulle. Affiche reproduisant l’arrêté de convocation des électeurs. 1724W41/3 Activité politique et presse : rapports des Renseignements généraux. Coupures de presse et tracts de propagande. RÉFÉRENDUMS - 3 RÉFÉRENDUM DU 8 AVRIL 1962 Accords d’Évian Préfecture. Cabinet du préfet • Instructions 1W45528/1 Instructions ministérielles et préfectorales. • Résultats 1W45528/3 Prévisions sur les résultats, exposé et appréciations sur les résultats du référendum : rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. 1W45528/2 Résultats par circonscription, par canton et par commune.