Mise En Place D'un Programme D'actions De Prevention
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SMDRA – Mairie De Soulom Juillet 2010
DOSSIER D’INFORMATION sur l’instabilité des terrains du secteur de la Galène et les risques d’éboulements liés à l’ancien site minier de Penarroya SMDRA – Mairie de Soulom Juillet 2010 PREAMBULE Suite aux actions menées dans le cadre de l’Action test Toxiques Gave de Pau (2005-2008), une réunion informelle s’est tenue en avril 2010 en mairie de Soulom à l’initiative du SMDRA afin de faire le point sur la situation des anciennes mines de Penarroya. Pour rappel, la procédure administrative de fermeture de ce site est engagée depuis 2001 avec le dépôt du dossier de déclaration d’arrêt définitif des travaux par la société Métaleurop auprès de la Police des Mines (ex-DRIRE, aujourd’hui DREAL). Lors de cette réunion, Monsieur le Maire de Soulom a exprimé sa volonté de constituer un dossier d’information sur le risque minier concernant sa commune (secteur de la Galène) afin de le joindre au Plan de Prévention des Risques Naturels, dont la phase d’enquête publique doit être lancée courant de l’été 2010. Le SMDRA a donc proposé de travailler en partenariat avec la mairie de Soulom afin d’élaborer une compilation des différents documents produits mettant en avant la question de l’instabilité des terrains (risques d’éboulements) sur le secteur de la Galène en lien avec le passé minier de ce site. 2 SOMMAIRE 1. La concession de Pierrefitte : rappel de l’historique ....................................................... 4 2. Etat d’avancement de la procédure de fermeture (Code minier) .................................... 5 2.1 Les étapes administratives de la procédure de fermeture selon le Code minier ............................ -

Catalogueargelès Gazost,Gavarnie, Cauterets, Val D'azun
Les Gîtes Ruraux 2014 ARGELÈS GAZOST,GAVARNIE, CAUTERETS, VAL D'AZUN HAUTES PYRÉNÉES 19/11/2013 Les Gîtes Ruraux et extraits de descriptifs La location au week-end ou en séjours en appartement ou maison. Cette formule s’appuie sur un accueil chaleureux et privilégié. Les gîtes confortablement équipés vous donneront la sensation d’un « chez vous ». Gîtes de France vous garantie des normes de confort suivies et réactualisées, se traduisant parfois pour certains gîtes par des mentions particulières relatives à la protection de l’environnement, l’aménagement d’équipement de loisirs (piscine, sauna, spa) ou encore l’adaptation aux handicaps (tourisme et Handicap). 2 Comment lire les mini-fiches ? Pictogrammes Loisirs Pictogrammes Commodités thermes piscine V.T.T lave-linge piscine lave-vaiselle pêche télévision golf cheminée équitation kit bébé randonnée wifi ski de fond spa ski de piste parking gare salon de jardin commerces Pictogrammes Thèmes Bienvenue à la Ferme 3 GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous... N° 65G017711 ADAST CM 342-L4 6 pers. 3 ch. A 4km d'Argeles-Gazost, au cœur d'une vallée riche en activités bénéficiant d'un emplacement idéal pour rayonner sur l'ensemble des plus grands sites pyrénéens, ce gîte situé à l'extrémité d'un ensemble de locations vous propose une prestation de qualité avec un jardinet aménagé à Sur 2 niv. : 3 Chambres (2 lits 2 pl., 2 lits 1 pl.), séjour/coin cuisine, salle de bains, 2 WC, salon de jardin, aire de stationnement. Randonnées sur place. Chauffage électrique et bois.Charges en sus. Courts séjours possibles (min 3 nuits). -

01/01/2014 Revue De Janvier 2014
Le monde RetRouvez dans ce numé Ro toute l'info Rmation de votRe cma deS rtisans édition Hautes-Pyrénées Thomas Garcia, officier de la Légion d’honneur Une cérémonie € en présence de Sylvia Pinel P. 5 Bimestriel n°98 • janvier-février 2014 1 le réPertoire des métiers P.36 LeS arTiSanS appRentissage d’arT miS à remiSe deS diPLômeS L’honneUr P. 4 P. 9 Hautes-Pyrénées Le monde RetRouvez dans ce numé Ro toute l'info Rmation de votRe cma deS rtisans édition Hautes-Pyrénées La Société d’encouragement aux métiers d’art s’expose P. 4 € Bimestriel n°98 • janvier-février 2014 1 le réPertoire des métiers P.36 Remise d’insigne appRentissage La ViSiTe de remiSe deS diPLômeS Sylvia PineL P. 5 P. 9 Hautes-Pyrénées P AnorAmA d ossier é dito diFFiCultés éConomiques : Daniel Puges, ne restez pas seuls Président de la CMA il suffit parfois d’un grain de sable des Hautes-Pyrénées pour que la machine s’enraye. la solution : rompre l’isolement et réagir dès les premiers signaux d’alerte, en parlant de ses difficultés à des experts qualifiés p. 29 La CMA a accueilli l’exposition Sema dans ses locaux. M. Robert Cadeac, délégué départe- mental, a mis un point d’honneur à encourager le savoir-faire et la volonté de ses ressortis- esdames et Messieurs, sants, mais aussi des artistes. P 4 MChers collègues, ■ éVénemenT 4 vernissAGe semA une exposition de qualité ! ProCédures extrA- Permettez-moi de démarrer 5 remise de l’insiGne d’oFFiCier judiCiAires et judiCiAires : ces quelques lignes par la de lA léGion d’Honneur des réPonses GrAduées présentation de tous mes vœux à M. -

100 Dpi) L ^ ^ Eb Igon a Dé 0 1 2 4 R 4 O Km U T E
720000 725000 730000 735000 740000 745000 750000 0°14'30"W 0°9'0"W 0°3'30"W 0°2'0"E 0 0 GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR-048 0 0 0 0 0 0 Product N.: 03Lourdes, v1 9 9 7 7 4 4 Lourdes - FRANCE Flood - 18/06/2013 Reference Map - Overview Landes Production date: 19/06/2013 United GeKrinsgdom Belgium Germany English Paris Channel ^ France France Midi-Pyrenees Switzerland Bay of Leg Aquitaine Italy N a Biscay " ve 0 d 3 e ' 1 P 1 au ° , 3 4 L es G av Mediterranean e s Spain Sea R e u n i s Pontacq Hautes-Pyrenees N .! " 0 3 ' n 1 .! ro ne 1 a ° ^ 4 G 3 4 Asson .! 0 Pontacq 0 0 0 Lourdes 0 0 A 5 Labatmale 5 d 8 ^ 8 o 7 7 ur 4 ^ 4 Lamarque-Pontacq Pyrenees-Atlantiques Coarraze Cartographic Information K 1:50000 Full color ISO A1, low resolution (100 dpi) L ^ ^ eB Igon a dé 0 1 2 4 R 4 o km u t e d e ^ Map Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 30N L o Graticule: WGS 84 geographical coordinates u Barlest r ± d e s Legend General Information Hydrology Transportation 0 0 0 0 £ 0 0 0 0 Area of Interest River " Bridge 8 ^ 8 7 7 4 ^ 4 Administrative boundaries Stream (!u Helipad Region Canal X Station Montaut Municipality Lestelle-Bétharram ^ Lake Railway Montaut-Betharram ^ Bartrès Settlements Railway Station Julos River Primary Road ^ R om ^ ! Populated Place z Poueyferré o u u ^ Point of Interest Secondary Road t O e ' Built-Up Area 4 Educational L d e Industry / Utilities P au K Medical Extraction Mine Lab le de atma Lac de au Lac de la ^ Religious Ruisse ^ Quarry Lourdes ^ N " ferme Larrouy Bourréac 0 ^ ' 6 e ° d 3 R e 4 ou ^ u te ^ Saint-Pé-de-Bigorre -

Lien Avec Le Classement Du « Bassin Du Gave De Cauterets » De 1928 En Cours De Revision Actuellement
HISTORIQUE DE LA PROTECTION DES GAVES DE CAUTERETS : LIEN AVEC LE CLASSEMENT DU « BASSIN DU GAVE DE CAUTERETS » DE 1928 EN COURS DE REVISION ACTUELLEMENT. Extrait du document “Classement du site du bassin du Gave de Cauterets” Rapport de présentation : DREAL Occitanie 2021 « Le site classé du « bassin du gave de Cauterets comprenant les vallées des gaves de Lutour, de Gaube, de Jerret, du Marcadau et du Cambasque », se situe en région Occitanie, au sud du département des Hautes Pyrénées en limite transfrontalière avec l’Aragon, dans la commune de Cauterets au sein de la communauté de communes Pyrénées-vallées des Gaves. C’est l’un des joyaux du Parc National des Pyrénées. Depuis des temps immémorables, le bassin de Cauterets, avec ses eaux aux vertus curatrices attire gens du pays et voyageurs, anonymes comme illustres. Les bienfaits de la cure sont prolongés par l’expérience des paysages. Bucoliques comme tourmentés, ces derniers l’Homme à la Nature. Aujourd’hui encore, le spectacle des gorges de Pierrefitte et de Soulom, le charme des promenades thermales, inspirent de nombreuses représentations artistiques révélatrices de rapports culturels de l’exaltation des sens par les cascades du Pont d’Espagne et du val de Jéret, la majesté envoûtante des lacs miroirs comme le lac de Gaube dominé au loin par le grandiose Vignemale, l’identité ancestrale des hauts pâturages de transhumance transfrontalière, attirent, enchantent et émerveillent les visiteurs. Ce sont ces paysages d’exception dont il est question ci-après de reconnaître et valoriser le caractère remarquable. La redéfinition du classement vise à parfaire la protection paysagère et patrimoniale pour transmettre aux visiteurs comme aux générations futures l’enchantement qui assure l’attractivité territoriale d’aujourd’hui comme celle de demain.” Ce site est classé par arrêté du ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts (Édouard Herriot) en date du 28/07/1928. -

Lettre D'information Aux Socioprofessionnels
AGENCE TOURISTIQUE DES VALLEES DE GAVARNIE LETTRE D’INFORMATION gavarnie - Argelès gazost - val d’azun - barèges - pierrefitte nestalas Madame, Monsieur, Sur le territoire de la nouvelle Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, 5 offices de Tourisme ont décidé de fusionner pour don- ner naissance à l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie afin d’assurer la promotion de cette destination à compter du 1er juillet 2017. Les Offices de Tourisme de Barèges, Gavarnie-Gèdre, de la Vallée d’Argelès-Gazost, de Pierrefitte-Nestalas/Soulom/Adast et du Val d’Azun travaillent depuis le 1er janvier à la constitution de la stratégie commune de développement touristique. Les OT de Cauterets et de Luz-Saint-Sau- veur ont fait le choix de conserver leur compétence à l’échelle communale. Toutefois, ils s’associent à la réflexion sur la stratégie de destination. L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie est constituée sous la forme d’un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commer- cial). Il est dirigé par un comité de direction constitué de 9 élus de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves (Mesdames DULOUT GLEIZE, MAURICE, PARROU, SAGNES, SARTHOU, Messieurs ARRIBET, MOLINER, SOLOME, ROUX) et de 6 socioprofessionnels nommés par le Président de la CC (Madame GERBEAU, Messieurs CAUSSIEU, DUBIE, LAGUERRE, MAUHOURAT, SEMPER) . M Pascal ARRI- BET (Maire de Barèges) en est le Président, Mme Christine MAURICE la Vice-Présidente et Mme Nathalie MARCOU, la directrice. Le siège social de l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie est domicilié à Argelès Gazost ; l’ensemble des six bureaux d’information tou- ristique fonctionneront dans les mêmes conditions que les années passées et le personnel reste en place. -
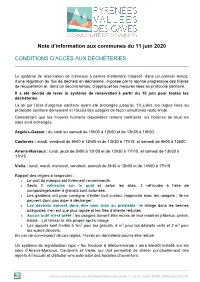
Note D'information Aux Communes Du 11 Juin 2020 CONDITIONS D
Note d’information aux communes du 11 juin 2020 CONDITIONS D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES Le système de réservation de créneaux a permis d’atteindre l’objectif, dans un premier temps, d’une régulation du flux de déchets en déchèterie, imposée par la reprise progressive des filières de récupération et, dans un second temps, d’appliquer les mesures liées au protocole sanitaire. Il a été décidé de lever le système de réservation à partir du 15 juin pour toutes les déchèteries. La loi sur l’état d’urgence sanitaire ayant été prolongée jusqu’au 10 juillet, les règles liées au protocole sanitaire demeurent et l’accès des usagers de façon simultanée reste limité. Considérant que les moyens humains disponibles restent contraints, les horaires de tous les sites sont inchangés. Argelès-Gazost : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 Cauterets : mardi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15, et samedi de 9h00 à 12h00 Arrens-Marsous : lundi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15, et samedi de 13h30 à 17h15 Viella : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15 Rappel des règles à respecter : • Le port du masque est fortement recommandé. • Seuls 2 véhicules sur le quai et, selon les sites, 3 véhicules à l’aire de compostage/casier à gravats sont autorisés. • Les gardiens ont pour consigne d’éviter tout contact rapproché avec les usagers ; ils ne peuvent donc pas aider à décharger. • Les déchets doivent donc être bien triés au préalable : le vidage dans les bennes adéquates n’en est que plus rapide et les files d’attente réduites. -

Carte Planning Déploiement FTTH 2018-2024
Déploiements FTTH ORANGE Période 2018 2024 ± Saint-lanne Castelnau-Riviere-Basse Madiran Heres Soublecause Labatut-riviere Légende Hagedet Caussade-riviere Lascazeres 2018 Villefranque Estirac Auriebat 2019 Sombrun Sauveterre 2020 Maubourguet Lahitte-toupiere 2021 Monfaucon Vidouze Larreule Lafitol e Buzon Gensac 2022 Nouilhan Ansost Barbachen Liac 2023 Caixon Segalas Artagnan 2024 Sarriac-bigorre Vic-En-Bigorre Rabastens-De-Bigorre Sanous Estampures Villenave-pres-bearn Mingot Saint-lezer Frechede Camales Moumoulous Bazillac Lacassagne Senac Mazerolles Pujo Saint-sever Escaunets Ugnouas Bernadets Villenave -de-rustan Escondeaux Mansa -debat Talazac -pres-marsac n Bouilh Lameac Fontrailles Seron Marsac Lescurry Peyrun -devant Antin Siarrouy Tostat Tarasteix Castera-lou Lapeyre Andrest Sarniguet Jacque Trouley Trie-Sur-Baise Guizerix Peyret Soreac Bouilh -labarthe Lubret-saint-luc Aurensan -saint-andre Oroix Gayan -pereu Lalanne-trie Sadournin Lagarde Dours ilh Osmets Sariac Casterets Chis Louit Marseillan Larroque -magnoac Oursbelille Luby Vidou Puntous Garderes Pintac Bazet Chelle-debat -betmont Thermes Collongues Puydarrieux Castelnau Sabalos Castelvieilh Tournous -magnoac Villembits Hachan -Magnoac Bours Oleac Mun -darre Barthe Betbeze Orleix Pouyastruc Cabanac Lamarque Luquet Borderes-Sur-L-Echez -debat Campuzan -rustaing Organ Aries-espenan Lizo Aubarede Lustar Lalanne s Sere Betpouy Deveze Marquerie Sentous Thuy -rustaing Aureilhan Boulin Cizos Pouy Hourc Peyriguere Bugard Vieuzos Coussan Tournous Villemur Goudon Ibos Souyeaux Bonnefont -

TARBES TARBES<>LOURDES<>GAVARNIE
TARBES TARBES<>LOURDES<>GAVARNIE JOURS DE FONCTIONNEMENT Été : circule tous les jours excepté les jours fériés du 15 juin 2019 au 1er septembre 2019 COMMUNES POINT D'ARRÊT COMMUNES POINT D'ARRÊT Tarbes Gare SNCF 08:10 Gavarnie Office du tourisme 11:15 17:30 Tarbes Gare Routière 08:20 Gèdre Office du tourisme 11:25 17:40 Tarbes Brauhauban 08:21 Gèdre Pragnères 11:35 17:50 Tarbes Assedic 08:23 Luz Saint Sauveur Place du 8 mai 1945 12:00 18:15 Tarbes Hôpital 08:25 Esquièze Sère Le pré de jonquille 12:01 18:16 Odos La Pène 08:27 Saligos Passerelle 12:03 18:18 Juillan Route de Lourdes Nord 08:30 Viscos Larise 12:04 18:19 Juillan Route de Lourdes Centre 08:32 Villelongue Rond point 12:17 18:32 Louey Route de Tarbes 08:36 Soulom Place 12:19 18:34 Juillan Aéroport 08:44 Pierrefitte Nestalas Mairie 12:20 18:35 Juillan Pyrène Pôle tertiaire 08:46 Pierrefitte Nestalas Gare SNCF 12:21 18:36 Louey Pyrène Pôle industrie 08:49 Pierrefitte Nestalas Stade 18:40 Adé La Chapelle 08:53 Pierrefitte Nestalas Gendarmerie 18:41 Adé Place Saint Hippolyte 08:55 Adast Route des vallées 18:42 Lourdes Saux 08:57 Saint Savin La Plaine 18:43 Lourdes ZC du monge 08:59 Lau Balagnas Balagnas 18:44 Lourdes Gare SNCF 09:01 Lau Balagnas Eglise 18:45 Lourdes Gare Routière 09:10 Argelès Gazost Sud 18:46 Lourdes Soum 09:12 Argelès Gazost Le Parc 18:47 Agos Vidalos Mairie 09:17 Ayzac Ost Colline aux marmottes 18:48 Agos Vidalos Eglise 09:18 Ayzac Ost Mairie 18:49 Ayzac Ost Eglise d'Ost 09:19 Ayzac Ost Eglise d'Ost 18:51 Ayzac Ost Mairie 09:21 Agos Vidalos Eglise 18:52 Ayzac -

LIGNE 965 TARBES - LOURDES - CAUTERETS / BAREGES / GAVARNIE 06.07.2020 Au 30.08.2020
LIGNE 965 TARBES - LOURDES - CAUTERETS / BAREGES / GAVARNIE 06.07.2020 au 30.08.2020 JOURS LMMeJVS Vendredi DIMANCHE & FETES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gare SNCF 06:55 08:00 08:10 09:55 11:30 12:15 13:15 14:30 16:25 17:25 18:15 08:10 Victor Hugo 06:57 08:02 08:12 09:57 11:32 12:17 13:17 14:32 16:27 17:27 18:17 08:12 Tarbes Allée Leclerc 07:00 08:05 08:15 10:00 11:35 12:20 13:20 14:35 16:30 17:30 18:20 08:15 Assedic 07:02 08:07 08:17 10:02 11:37 12:22 13:22 14:37 16:32 17:32 18:22 08:17 Hôpital 07:04 08:09 08:19 10:04 11:39 12:24 13:24 14:39 16:34 17:34 18:24 08:19 Odos La Pene 07:09 08:14 08:24 10:09 11:44 12:29 13:29 14:44 16:39 17:39 18:29 08:24 Route de Lourdes Nord 07:10 08:15 08:25 10:10 11:45 12:30 13:30 14:45 16:40 17:40 18:30 08:25 Route de Lourdes Centre 07:12 08:17 08:27 10:12 11:47 12:32 13:32 14:47 16:42 17:42 18:32 08:27 Stade Banive - - - - - 12:34 - - - - 18:34 - Juillan Mairie - - - - - 12:36 - - - - 18:36 - Rue Victor Hugo - - - - - 12:39 - - - - 18:39 - Juillan/Louey - - - - - 12:41 - - - - 18:41 - Louey Route de Tarbes 07:16 08:21 08:31 10:16 11:51 - 13:36 14:51 16:46 17:46 - 08:31 Aéroport 07:20 08:25 08:35 10:20 11:55 12:45 13:40 14:55 16:50 17:50 18:45 08:35 Juillan Pyrène pôle tertiaire 07:23 08:28 08:38 10:23 11:58 12:48 13:43 14:58 16:53 17:53 18:48 08:38 Louey Pyrène pôle industrie 07:24 08:29 08:39 10:24 11:59 12:49 13:44 14:59 16:54 17:54 18:49 08:39 La chapelle 07:27 08:32 08:42 10:27 12:02 12:52 13:47 15:02 16:57 17:57 18:52 08:42 Adé Place -
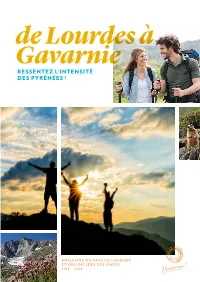
Argelès-Gazost
de Lourdes à Gavarnie RESSENTEZ L'INTENSITÉ DES PYRÉNÉES ! MAGAZINE DU PAYS DE LOURDES ET DES VALLÉES DES GAVES 2015 – 2016 Gavarnie — Mont Perdu, patrimoine mondial de l’Unesco Ce paysage de montagne exceptionnel, qui Ce site est également un paysage pastoral qui La zone Gavarnie - Mont Perdu vous offre un rayonne des deux côtés des frontières de France reflète un mode de vie agricole autrefois répandu paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté et d’Espagne, est centré sur le pic du Mont-Perdu, dans les régions montagneuses d’Europe. Il panoramique à une structure socio-économique massif calcaire qui culmine à 3 352 m. Le site présente des témoignages inestimables sur la qui a ses racines dans le passé et illustre un mode comprend deux des canyons les plus grands et société européenne d’autrefois à travers son de vie montagnard devenu rare en Europe. profonds d’Europe, du côté espagnol, et trois paysage de villages, de fermes, de champs, de cirques spectaculaires sur le versant français. hauts pâturages et de routes de montagne. Entrées du Parc national des Pyrénées Grands sites Midi-Pyrénées Tarbes Pau Barlest Toulouse Bordeaux Stations de ski alpin Loubajac Adé Stations de ski nordique Pau Bordeaux Bartrès Julos Thermes et centres thermoludiques Poueyferré Bagnères-de-Bigorre Paréac Lac de St-Pé-de-Bigorre Lourdes Bourréac Points info Peyrouse Escoubès-Pouts Grottes Lourdes Gav Lourdes de Bétharram e de Pau Arcizac- Lézignan ez-Angles Arrayou-Lahitte Gez-ez-Angles Sites touristiques Artigues Jarret RÉSERVE NATURELLE Aspin-en- -

Séance Du 24 Janvier 2019
Séance Publique du Conseil Municipal d’AYZAC-OST du 24 janvier 2019 SÉANCE DU 24 JANVIER 2019 Convocation a été adressée le 21 janvier 2019 par écrit à chacun des Conseillers Municipaux pour la réunion qui se tiendra le 24 janvier 2019 à 20 h 30 dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie à l’effet de délibérer sur les questions suivantes : ORDRE DU JOUR • Demande de FAR 2019 • Décisions d’urbanisme • Informations et questions diverses L’an deux mille dix-neuf, le 24 du mois de janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué le 21 janvier 2019, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Serge CABAR, Maire. PRESENTS : M. Serge CABAR Maire Mme Valérie MINIER 1ère Adjointe M. Jacques FALLIERO 2ième Adjoint M. Jean SERRUS 3ième Adjoint Mme Françoise LALLART-GROC M. Michel BERGON - M. André LATAPIE M. Didier LACABANNE- M. Guillaume NOGRABAT Absents : M. Bruno PARADE Secrétaire de Séance : M. Jacques FALLIERO 2019_01 : DEMANDE DE FAR 2019 Monsieur le Maire présente les estimations des divers projets concerné pas les demandes de subventions au titre du FAR (Fonds d’Aménagement Rural) auprès du Conseil Départemental : Programme de voirie 2019 pour un montant global de 47 799,82 € HT soit 57 359,78 € TTC • Chemin Soupeyre • Chemin Saint-Michel • Aménagement aire de stationnement lié à la maison médicale (2nde tranche), Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : - Accepte le montant des différentes estimations ci-dessus, - Mandate Monsieur le Maire pour solliciter la subvention au titre du FAR 2019 auprès du Conseil Départemental, - Décide d’inscrire cette dépense au budget communal 2019.