Réseau Natura 2000 Document D'objectifs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

GUIDE Écotourisme
haute-garonne 1 GUIDE Écotourisme VIVE l’écotourisme ! Le retour à la nature, sa préservation, sa mise en valeur, voilà qui parle aux habitants de la Haute-Garonne ! Leurs environnements de vie et de travail jouent dans la catégorie durable et éco- SOMMAIRE responsable, comme vous le percevrez bien grâce à ce guide dédié à l’écotourisme. Au fil des pages vous prendrez conscience de leurs engagements pris pour le respect des 2 Un territoire départemental préservé : préceptes de l’écologie, de la biodiversité, les sites Natura 2000 ................................................................................................ P.04 des sites merveilleux qui composent un des Espaces naturels sensibles ................................ P.06 patchwork incomparable de paysages et de sensations. Dix « Stations vertes » Les labels écotouristiques qui découlent de et deux « Pavillon Bleu » ........................................................................... P.08 cette action et de cette attention de tous Les hébergements les instants attestent de leur volonté et de celle de tout un territoire. De nombreux « écotouristiques » ..................................................................................................................... P.10 labels et distinctions participent de cet élan Des professionnels vert si nécessaire et si important aujourd’hui. à votre service ..................................................................................................................................................... P.14 Qu’ils s’appliquent -
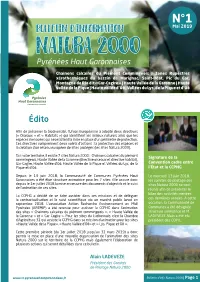
Bulletin D'information
N°1 Bulletin d’information Mai 2019 natura 2000 Pyrénées Haut Garonnaises Chainons calcaires du Piémont Commingeois | Zones Rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, Pic du Gar, Montagne de Rie dit «Gar-Cagire» | Haute Vallée de la Garonne | Haute vallée de la Pique | Haute vallée d’Oô | Vallées du Lys, de la Pique et d’Oô Édito Afin de préserver la biodiversité, l’Union Européenne a adopté deux directives (« Oiseaux » et « Habitats ») qui identifient les milieux naturels ainsi que les espèces menacées qui nécessitent la mise en place d’un périmètre de protection. Ces directives comprennent deux volets d’actions : la protection des espèces et la création d’un réseau européen de sites protégés (les sites Natura 2000). Sur notre territoire, il existe 7 sites Natura 2000 : Chainons calcaires du piémont Signature de la commingeois, Haute Vallée de la Garonne (directive oiseaux et directive habitat), Gar-Cagire, Haute Vallée d’Oô, Haute Vallée de la Pique et Vallées du Lys, de la Convention cadre entre Pique et d’Oô. l’État et la CCPHG Depuis le 13 juin 2018, la Communauté de Communes Pyrénées Haut Le mercredi 13 juin 2018, Garonnaises a été élue structure animatrice pour les 7 sites. Elle assure donc les comités de pilotage des depuis le 1er juillet 2018 la mise en œuvre des documents d’objectifs et le suivi sites Natura 2000 se sont de l’animation de ces sites. réunis afin de présenter le bilan des activités menées La CCPHG a décidé de se faire assister dans ses missions et de déléguer la contractualisation et le suivi scientifique via un marché public lancé en ces dernières années. -

Bagneres- De-Luchon
CARTE GÉOLOGIOUE DE LA FRANCE A 1/50000 , BAGNERES- • DE-LUCHON BAGNÈRES-DE-LUCHON la carte géologique à 1/50000 BAGNtRES-DE-LUCHON est recouverte par les coupures suivantes de la carte géologique de la France à 1/80000 : à l'ouest: LUZ (N° 251) à l'est: BAGNtRE5 (N" 252) • tamp"" ...., " .. ...' MINISTËRE DE L'INDUSTRIE ET DE L"AMËNAGEMENT DU TERRITOIRE BAGNtflES- l'Icdt-- V;e;lI.·Aur. IIUREAU DE RECHEACHES G~OlOGlaUES El MINIÈRES Df..l.IC>lC*' W~"btr'" ,--~, -~-~- SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL BoilO p<>Sl.11 6009 • 4~ Orléans c_. Z - f ••"". NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE BAGNÈRES-DE-LUCHON A 1/50 000 par M. CLIN, F. TAILLEFER, P. POUCHAN, A. MULLER 1989 Éditions du BRGM - BP 6009 - 45060 ORLÉANS Cedex 2 - FRANCE SOMMAIRE Pages PRÉSENTATION DE LA CARTE 5 HISTOIRE GÉOLOGIQUE SOMMAIRE 7 DESCRIPTION DES TERRAINS Il FORMATION SÉDIMENTAIRES, Il FORMATIONS MÉTAMORPHIQUES 29 FORMATIONS MAGMATIQUES 44 FORMATIONS SUPERFICIELLES 57 TECTONIQUE 62 ORGANISATION STRUCTURALE 62 CHRONOLOGIE DES DÉFORMATIONS 67 MOUVEMENTS COULISSANTS VARISQUES 68 PRÉHISTOIRE 68 RESSOURCES DU SOUS-SOL ET EXPLOITATIONS 68 HYDROGÉOLOGIE 68 HYDROTHERMAIJISME 69 RESSOURCES MINÉRAIJES, MINES ET CARRIÈRES 70 DOCUMENTATION COl\'lPLÉl\'IENTAIRE 74 SITES CLASSIQUES ET ITINÉRAIRES 74 BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 75 DOCUMENTS ET COLLECTIONS CONSULTABLES 79 AUTEURS DE LA NOTICE 80 - 5- PRÉSENTATION DE LA CARTE Le territoire couvert par la feuille Bagnères-de-Luchon à 1/50000, entre 42°39'36" et 42°50'24" de latitude N et entre 0°21 '26" et 0°43'2" de longitude E, s'étend essentiellement d'une part sur de hauts massifs fron taliers et au Nord de ceux-ci, dans les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne (France), et d'autre part, au Sud de ces mêmes massifs, dans la Province de Huesca (Espagne), et à l'Est de ceux-ci, sur le Val d'Aran, dans la Province de Lerida (Espagne). -

Les Sites Natura 2000 En Haute-Garonne
En outre, une évaluation d’une liste de projets d’aménage‑ ment ou activités fixée par arrêté préfectoral est réalisée afin de vérifier leur compatibilité avec la préservation de l’envi‑ Vallées du Tarn, de l’Aveyron, ronnement. du Viaur, de l’Agout et du Gijou Communes Natura 2000 : Bessières, Bondigoux, Buzet‑sur‑Tarn, Layrac‑sur‑Tarn, De l’Europe à la Haute‑Garonne La Magdelaine‑sur‑Tarn, Mirepoix‑sur‑Tarn, Villematier, Villemur‑sur‑Tarn. Au sein de l’Europe à 27, près de 25 000 sites ont été intégrés en Natura 2000 ; en France, 1 753 sites terrestres couvrent, avec 6,9 millions d’hectares, 12,5 % de la superficie du terri‑ toire auxquels il faut ajouter 4,1 millions d’hectares d’espaces marins (soit 207 sites marins). En Haute‑Garonne, le réseau européen de sites Natura 2000 couvre 7,5 % de la superficie du département et concerne 157 communes. Il se compose de 12 sites. Huit sites se concentrent dans le sud du département (pié‑ mont et massif pyrénéen). Les autres couvrent les cours d’eau tels que la Garonne, ses principaux affluents, ainsi que le Tarn. Environ 80 types d’habitats naturels ont ainsi été inventoriés. Les principaux habitats concernés sont les corridors fluviaux, les zones humides, les pelouses et les prairies, les forêts et les habitats rocheux. La faune et la flore s’illustrent par 12 espèces de mammi‑ fères (avec une dominante de chauves‑souris), 13 invertébrés 1 (principalement insectes du bois et papillons), 9 poissons sé‑ 2a espèces représentées : Grand Capricorne et Saumon atlantique. -
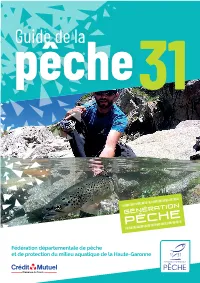
Guide-Peche-2021.Pdf
Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Garonne Plaisance du Touch SOMMAIRE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 4 Quelle carte pour 2021 6 Périodes d’ouverture et tailles légales 8 Comment mesurer un poisson 8 Limitation du nombre de captures 9 Nombre de cannes autorisées 9 Appâts 9 Classement piscicole 10 Heures légales de pêche 11 Modes de pêche prohibés 11 Procès verbaux 12 Réserves et pêches interdites 16 Les écrevisses PARCOURS SPÉCIAUX 18 Parcours spécifiques Μ22 Parcours animations pêche pour enfants 23 Parcours touristique et initiation 24 Parcours détente et initiation AGIR POUR LA PÊCHE 26 Calendriers des lâchers de truites 2021 28 Pêche en barque et float tube 28 Mises à l’eau 29 Pêche en embarcation en Haute-Garonne 30 Les associations de pêche 32 Les Ateliers Pêche Nature (APN) 33 Le pôle animation 31 34 Les dépositaires 38 Les pontons 40 Au service de la pêche 42 La garderie fédérale 44 Guide de pêche 44 Pêches spécialisées 46 Les hébergements pêche A L’INTÉRIEUR CARTE DÉTACHABLE > Réseau départemental > Lacs et plans d’eau > Lacs de montagne > Poster poissons LE MOT DU PRÉSIDENT L’année 2020 avait bien commencé et laissait présager une bonne année halieutique. La crise sanitaire et son train de mesures restrictives, est hélas venue perturber la pratique de notre loisir. Pour faire face à cette situation inédite, nous avons dû nous organiser pour assurer la continuité de gestion de la Fédération tout en respectant les consignes du confinement. Nous avons eu recours au télétravail pour le service administratif et à l’arrêt provisoire du service développement. -

La Crue De Juin 2013 Dans Les Pyrénées Garonnaises: De La Crise Hydrologique Au Territoire En Crise
La crue de juin 2013 dans les Pyrénées garonnaises : de la crise hydrologique au territoire en crise Aude Sturma, Jean-Marc Antoine, Sylvia Becerra, Anne Peltier To cite this version: Aude Sturma, Jean-Marc Antoine, Sylvia Becerra, Anne Peltier. La crue de juin 2013 dans les Pyrénées garonnaises : de la crise hydrologique au territoire en crise. Sud-Ouest Européen, Presses Universitaires du Mirail - CNRS, 2017, Regards croisés sur les fleuves Èbre et Garonne, pp.117-135. 10.4000/soe.3521. hal-02545924 HAL Id: hal-02545924 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02545924 Submitted on 17 Apr 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Sud-Ouest européen Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest 44 | 2017 Regards croisés sur les fleuves Èbre et Garonne La crue de juin 2013 dans les Pyrénées garonnaises : de la crise hydrologique au territoire en crise The Flood of June 2013 in the Garonne Pyrenees: From the Hydrological Crisis to the Territory in Crisis La riada de junio de 2013 en los Pirineos del Garona : desde la crisis hidrológica hasta -

Bulletin Municipal 2018
Bulletin Municipal de Bulletin N° 47 - Janvier 2019 CIERP-GAUD MAIRIE DE CIERP-GAUD Informations Utiles 1 Rue du Château - Centre Anti-Poison ..............................05 61 49 33 33 Horaires d’ouverture au public : - Pompiers ............................................................... 18 - Gendarmerie .......................................................... 17 Les Mardi, Mercredi, Vendredi de 10h00 à - - SOS Médecin .......................................0 805 85 31 31 12h00 et de 14h00 à 17h30 - SAMU de St-Gaudens ............................................. 15 - et le Samedi de 09h00 à 12h00 - Ambulances Taxi Berra .......................05 61 79 52 94 - Médecins - Téléphone : .............................05 61 79 50 73 - Docteur HERZI ................................05 61 79 53 23 - Télécopie ................................05 61 79 71 64 - Docteur LARRIEU ...........................05 61 79 70 43 - Site Internet : www.cierp-gaud.fr - Centre Médico-Social ..........................05 62 00 92 20 - E-Mail : [email protected] - Masseur-Kinésithérapeute - VAN MALDEREN Sarah ...................06 86 56 56 08 - Facebook : https://www.facebook.com/ Mairie-de-Cierp-Gaud/ - BIENIEK GOANNA ...........................06 41 43 10 89 - Pharmacie POMIES ..............................05 61 79 50 80 - Chirurgien – Dentiste, - Dr HERITIER ....................................05 61 79 70 65 - Dr Emilie JULIEN .............................05 61 79 71 01 - Dr Baptiste DESOBEAU ...................05 61 79 71 01 - Sages-femmes Libérales -

France, May 2007
Library of Congress – Federal Research Division Country Profile: France, May 2007 COUNTRY PROFILE: FRANCE May 2007 COUNTRY Formal Name: French Republic (République Française). Short Form: France. Term for Citizen(s): Frenchman/Frenchwoman. Adjective: French. Capital: Paris. Major Cities: The country’s capital Paris, the only French city Click to Enlarge Image with more than 1 million inhabitants, has a population of 2,142,800 in the city proper (as of 2004) and 11,330,700 in the metropolitan area (2003 estimate). Greater metropolitan Paris encompasses more than 15 percent of the country’s total population. The second largest city is Marseille, a major Mediterranean seaport, with about 795,600 inhabitants. Other major cities include Lyon, an industrial center in east-central France, with 468,300 inhabitants, and the second largest metropolitan area in France, with 1,665,700 people. Further important cities include: Toulouse, 426,700, a manufacturing and European aviation center in southwestern France; Nice, 339,000, a resort city on the French Riviera; Nantes, 276,200, a seaport and shipbuilding center on the Atlantic coast; Strasbourg, 273,100, the principal French port on the Rhine River and a seat of the European parliament (in addition to Brussels); Montpellier, 244,700, a commercial and manufacturing city in southern France; and Bordeaux, 229,500, a major seaport in southwestern France and the principal exporting center for key French vineyard regions. According to the 1999 decadal census, more than 25 additional French cities had populations surpassing 100,000. Independence: July 14, Bastille Day, is France’s national holiday. Public Holidays: New Year’s Day (January 1); Easter Monday (variable date in March or April); Labor Day (May 1); Ascension Day (Thursday, 40 days after Easter); World War II Victory Day (May 8); Bastille Day (July 14); Assumption (August 15); All Saints’ Day (November 1); Armistice Day (November 11); and Christmas Day (December 25). -

Rivière De La Pique, Entre Luchon Et La Garonne. (Identifiant National : 730030542)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030542 Rivière de la Pique, entre Luchon et la Garonne. (Identifiant national : 730030542) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : Z2PZ0303) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Parde Jean-Michel (Action Recherche Environnement en Midi-Pyrénées), .- 730030542, Rivière de la Pique, entre Luchon et la Garonne.. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030542.pdf Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées Rédacteur(s) :Parde Jean-Michel (Action Recherche Environnement en Midi-Pyrénées) Centroïde calculé : 462171°-1770679° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 28/01/2010 Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2010 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 02/06/2015 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS .....................................................................................................................................