Scot De La Provence Verte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PAPI Complet De L'argens Et Des Côtiers De L'estérel
PAPI Complet de l'Argens et des côtiers de l'Estérel Cartographie Syndicat mixte de l'argens| [email protected]| www.syndicatargens.fr| 09.72.45.24.91 PAPI de l'Argens et des côtiers de l'Esterel Programme d'Actions de Prévention des Inondations Carte 2 2016 - 2022 Relief et principaux sous-bassins versants de l'Argens µ Régusse Moissac- Bellevue Montferrat Bargemon La Verdière Ampus Châteaudouble Aups La B La Nartuby r Claviers L es 'E qu a e Varages u Tavernes Tourtour S a Fox-Amphoux La Bresque lé L'Endre e L'Endre Saint-Paul- L'Eau Salée Figanières Callas en-Forêt Villecroze LeR Saint-Martin Sillans-la-Cascade ey Salernes ran et Barjols av Bl Bagnols-en Pontevès Flayosc e La Cassole Draguignan L -Forêt La Florieye Le Reyran L'Argens Source L L Saint-Antonin e a Cotignac La Le Le Blavet C F N La Motte Brue-Auriac -du-Var lo R a a ri é r Entrecasteaux è t G s y a u Seillons-Source e l Trans-en b s y r a -d'Argens o -Provence n Ollières l e Châteauvert Puget-sur d Le Real e La L'Argens Amont Lorgues -Argens La Meyronne GGrande Montfort- Le Muy a Correns Garoronne sur-Argens L'Argens Moyenne n Carcès n Côtiers Taradeau L'Argens Aval e Bras L'A Le Thoronet rg Les Arcs Saint- en s Raphaël Saint-Maximin Roquebrune- -la-Sainte-Baume La Ribeirotte sur-Argens Fréjus Le Val Vins-sur-Caramy Cabasse Le C o u n l l o Le o e r u n Le Cauron u r a Tourves Vidauban Couloubrier b u C r Le Fournel Brignoles i o e e F r Le L Le Caramy Le Cannet- lle Le Luc des-Maures Ai La Celle Le Caramy Flassans L' Nans- Camps- Rougiers -sur-Issole les-Pins -

BULLETIN MUNICIPAL Décembren °13 2017
BULLETIN MUNICIPAL DécembreN °13 2017 Joyeuses fêtes! © Patrick CHAUDIER - Barjols Bulletin d’informations municipal de la Mairie de Barjols - Décembre 2017. Tirage : 1500 exemplaires. Directeur de publication : Benjamin DEMIRDJIAN , maire - Rédaction et conception : service communication Impression : IAP Manosque. Photos: service communication. Disponible à l’accueil de la mairie. Retour en images Edito Barjolaises, Barjolais, Je viens signer mon premier édito dans un contexte difcile où nous voyons disparaitre, les uns après les autres, les services publics de proximité et sommes révoltés devant la perte programmée de certaines compétences communales. Ma première crainte concerne la disparition de la Gendarmerie de Barjols. C’est en mars 2017 que nous avons ofciellement appris que notre agrément pour la construction d’une nouvelle brigade était caduque, et ce alors que notre projet était déjà bien engagé. En efet nous avions mis un emplacement réservé au PLU et la communauté de communes s’était portée acquéreuse du terrain. Les services départementaux de la gendarmerie souhaitent regrouper les deux casernes actuelles de Barjols et Carcès dans la zone économique de Cotignac, près de Carcès et à environ 20 km de Barjols, et ce « afn de garantir à court terme la capacité opéra- tionnelle des services et les conditions d’accueil du public et des victimes ». C’est aberrant et ce pour plusieurs raisons : - notre commune, contrairement à Cotignac, est depuis plusieurs années un bassin de vie reconnu et identifé, c’est un bourg-centre qui compte -

Annexes Projet Éolien D'artigues Et D'ollières (Var
Annexes Projet éolien d’Artigues et d’Ollières (Var - 83) Défrichement aux lieux-dits « Carraire Ouest » et « Carraire Est » Annexes Liste des annexes : ANNEXE N° 1 : ANNEXE PAYSAGERE ......................................................................................................................................... 434 ANNEXE N° 2 : FICHE ZNIEFF ..................................................................................................................................................... 438 ANNEXE N° 3 : LISTE DE TOUTES LES ESPECES DE FLORE OBSERVEES SUR LE TERRITOIRE LOCAL ............................................. 517 ANNEXE N° 4 : ESPECES PRESENTES SUR LES COMMUNES D’ARTIGUES ET OLLIERES D’APRES FAUNE PACA ........................... 520 ANNEXE N° 5 : ENSEMBLE DES ESPECES D’OISEAUX CONTACTEES SUR L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE ................................... 520 ANNEXE N° 6 : LISTE DE TOUTES LES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES SUR LE TERRITOIRE LOCAL (A GENCE VISU 2015) ........... 521 ANNEXE N° 7 : DE L’IMPACT GENERIQUE DES EOLIENNES SUR LES OISEAUX : APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE DU RISQUE DE COLLISION ........................................................................................................................................................................ 523 ANNEXE N° 8: ANALYSE DES SENSIBILITES DES OISEAUX AU RISQUE DE COLLISION ................................................................. 525 ANNEXE N° 9 : EXEMPLE D’UN SYSTEME DE DETECTION – SAFEWIND .................................................................................... -

Une Provence Inattendue
Provence Verte & Verdon PROVENCEVERTE.FR • 1 Une Provence Inattendue Découvrez Carcès, un village d’eau et de lumière Le village insolite de La Roquebrussanne Testez Le Rallye découverte des Coteaux Varois La glace au lait de chèvre Mais aussi Le château de Saint Martin de Pallières, Correns, La Verdière, le Verdon… Amusez- 80 activitésvous originales ! Prolongez vos vacances et familiales Vignobles & Découvertes Les santons et la crèche - Le Val Ce que vous ne devez pas manquer ! Jazz à Brignoles, Les parties de pétanque N°7 / 2019 Ce magazine vous est offert par l’Office de Tourisme PROVENCEVERTE.FR • 3 Bienvenue en Provence Verte & Verdon Territoire aux nombreux visages, Provence Verte & Verdon offre des paysages où alternent plaines plantées de vignes, vallons parsemés d’oliviers et collines verdoyantes. Provence Verte & Verdon s’étend des Gorges du Verdon au nord, aux Barres de Cuers au sud, des contreforts de la Sainte Victoire à l’ouest jusqu’à l’Abbaye du Thoronet à l’est. Lieu de vacances idéal, loin du bruit, des routes surchargées, où il fait bon vivre au chant des cigales. Même si cette Provence est inattendue par les couleurs qu’elle porte, le bleu de l’eau et le vert de ses forêts omniprésentes on y retrouve les cigales, les parties de pétanques entre amis, les assiettes colorées par les productions locales ... Sommaire Le château de La glace au lait de chèvre, Le magazine n°7 : Saint Martin de Pallières, . p .4-5 ça vous dit ? . p .28-29 “Une Provence Inattendue” est édité par Provence Verte Le château de Vins Le rosé sur Caramy . -

Barjols Provence Verdon
La Provence Verte appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire Le pays de la Provence Verte Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville et Pays d’art et d’histoire aux collectivités territoriales qui valorisent leur patrimoine. Il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture et du patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France. À proximité Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, Hyères, Martigues, le Pays du LAC D’ESPARRON Comtat Venaissin et le Pays s.U.D. bénéfi cient de l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire. D35 LAC DE QUINSON SAINT-JULIEN MONTMEYAN LE MONTAGNIER D554 RENSEIGNEMENTS GORGES Maison du Tourisme OffiDU VERDONce de Tourisme Communauté de communes D36 D35 D69 GINASSERVIS de la Provence Verte D13 de la Provence Verte à Barjols Provence Verdon D114 D36 D554 Carrefour de l’Europe Boulevard Grisolle Avenue de la Foux 83170 Brignoles 83670 BarjolsD30 83670 Varages D3 D70 LA VERDIERE Tél : 04 94 72D30 04 21 MONTMEYTél. : 04AN 94 77 20 01 Tél. : 04 94 77 18 53 D30 www.provenceverte.fr ot-barjols.provenceverte.fr www.provenceverdon.fr D70 En savoir plus sur le Pays d’art et d’histoire et découvrir son patrimoine : SAINT-MARTIN VARAGES RIANS DE PALLIÈRES www.patrimoineprovenceverte.fr FOX AMPHOUX ESPARRON TAVERNES laissez-vous ARTIGUES DE PALLIÈRES LAC D’ESPARRON SILLANS LA CASCADE conter Gateway to Haute Provence and the hillsides of the Var, near the SALERNES D35 LAC DE QUINSON SAINT-JULIEN MONTMEYAN BARJOLS LE MONTAGNIER D554 GORGES DU Gorges du Verdon and Sainte-Croix Lake, the peaceful village VERDON s.) et le village. -

L'écho De Baudinard-Sur-Verdon – Édition D'août 2013 – 3 Vos Élus Travaillent Également Sur Dossiers Et En Réunions
L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon – Édition d’août 2013 – 1 BAUDINARD-SUR-VERDON Monsieur le Maire, le Conseil municipal et les commerçants du marché d'été vous souhaitent une bonne lecture de ce numéro ! L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon. Magazine municipal d’information – Hôtel de ville, 36 Grand’Rue, 83630 Baudinard-sur-Verdon. Tél. 04 94 70 18 61 – Fax. 04 94 70 19 24 - Site internet : www.baudinard.fr - Courriel : [email protected] Directeur de la publication : Georges Pons - Crédits photos et rédaction : municipalité - Tirage : 90 exemplaires. Edition – Impression : mairie de Baudinard-sur-Verdon – Distribué gratuitement et/ou disponible à la mairie. L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon – Édition d’août 2013 – 2 ÉDITORIAL Cet éditorial est l'avant-dernier de la présente mandature. En 2014, cela fera six ans que vous avez élus des femmes et des hommes sur la liste que je présentais dont le but était - et reste toujours - d'œuvrer pour une meilleure qualité de vie au sein de notre petit village provençal, au profit de tous les habitants. Mais, rappelez-vous : que s'est-il passé durant les cinq dernières années de ce mandat de "ouf" ? Avant les dernières élections municipales, les opposants à la municipalité en place élaboraient un programme, se présentaient devant les électeurs, critiquaient parfois les actions passées, "bataillaient" fermement pour être élus. Puis, les élections passées, battus aux élections, ils retournaient à leurs occupations et laissaient les nouveaux conseillers travailler sereinement pour le bien de tous, y compris d'eux-mêmes. En 2008, changement de cap. Sur l'instigation de quatre nouvelles familles nouvellement installées dans le village, certains candidats opposés aux élus en place ou nouvellement mandatés par les habitants, aidés par des amis bien intentionnés, ont inauguré une nouvelle méthode de harcèlement : ils ont commencé par écrire anonymement sur Internet avant les élections. -
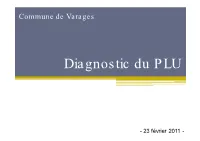
Diagnostic Du PLU
Commune de Varages Diagnostic du PLU - 23 février 2011 - Ière partie Données de cadrage Localisation Varages se situe dans le Nord- est du Var Elle s’inscrit dans le « Pays de la Provence Verte » (130 400ha) recouvrant : - 4 communautés de communes - 39 communes Elle appartient à la Communauté de communes « Provence Argens en Verdon » qui compte : - 11 communes - sur un territoire de 37 180 ha Structure de la commune 3521 ha 1085 habitants La Verdière Le centre villageois se situe sur une falaise de tufs dominant le « Ruisseau de Varages » Tavernes L’espace agricole est diffus St Martin L’ambiance dominante est collinaire et boisée Barjols Paysage* La commune de Varages appartient aux entités paysagères « Centre Var » et « Haut-Var » 5 unités remarquables identifiées: - la ripisylve - les grands domaines des secteurs orientaux - le plateau karstique au Nord-est -les coteaux agricoles de la dépression triasique - les secteurs urbanisés en périphérie du village * Source : Description des grandesunités remarquablessurlacommune deVarages – juin 2002 – BEGEAT et MJ Conseils Paysage* La structure villageoise correspond à celles des villages perchés du « Centre Var » Le paysage est modelé par les écoulements d’eaux issus du plateau de la Blaque et de la Verdière L’eau, omniprésente, est maîtrisée (canaux et industrie des faïences) Vue sur le village (Source : Frédéric D.) Vue sur le village (Source : BEGEAT) *Source : Atlas paysagerdela DIREN Bref historique Le quartier « Baou » témoigne de l’occupation médiévale par un bâti dense et compact. -

TERRITOIRES Et CENTRES DE SOLIDARITE
TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE et CENTRES DE SOLIDARITÉ Liste des centres de solidarité du conseil départemental Il est tout à fait conseillé aux chefs d’établissement de se mettre en lien avec les travailleurs sociaux de leur secteur dans le cadre de la prévention des situations d'enfants en risque de danger. En effet, les Assistantes sociales de secteur sont à même de coopérer dans la mesure où elles suivent un grand nombre de familles. TERRITOIRES D’ACTION CENTRES DE SOLIDARITE COMMUNES CONCERNEES SOCIALE LA SEYNE Centre Hermès 04 83 95 37 90 LA SEYNE SUR MER LA SEYNE – ST MANDRIER ST MANDRIER Mairie 04 94 11 51 60 ST MANDRIER les lundis et vendredis Cantons 1, 2, 3 Lazare Carnot 04 83 95 00 00 Canton 4, 5, 6 et 7 04 83 05 23 67 TOULON TOULON Canton 8 04 83 95 61 00 Canton 9 Ste Musse 04 83 16 67 15 HYERES 04 83 95 55 80 HYERES BORMES LES MIMOSAS 04 83 95 41 90 BORMES, LE LAVANDOU, LA LONDE CUERS 04 83 95 53 90 CUERS, COLLOBRIERES, PIERREFEU LA CRAU 04 83 95 56 20 LA CRAU, CARQUEIRANNE, LE PRADET VAL GAPEAU ILES D’OR LA GARDE 04 83 95 56 50 LA GARDE LA VALETTE 04 83 95 56 90 LA VALETTE, LE REVEST LES EAUX LA FARLEDE, BELGENTIER, SOLLIES-PONT SOLLIES-SOLLIES-PONT 04 83 95 46 00 SOLLIES-TOUCAS, SOLLIES-VILLE SIX-FOURS 04 83 95 41 00 SIX-FOURS Matin 04 94 10 25 75 SANARY SANARY Après-Midi 04 83 95 27 50 LITTORAL SUD STE BAUME OLLIOULES 04 83 95 58 50 OLLIOULES EVENOS, LA CADIERE, SIGNES, LE BEAUSSET, LE BEAUSSET 04 83 95 57 30 LE CASTELLET, RIBOUX BANDOL 04.83.95.52.70 BANDOL, ST CYR SUR MER BESSE, CABASSE, CARNOULES, FLASSANS, CŒUR DU -

Centre Social Et Culturel
' L'ECHO VINON-SUR-VERDON Magazine municipal n°169 - Décembre 2020 - Janvier-Février 2021 LA CHASSE AUX OEUFS organisée par l'Amicale des Donneurs de Sang Vinonnais RENDEZ-VOUS dimanche 4 avril au bord du Verdon Sous réserve des directives gouvernementales L'écho n°169 - 1 • Sommaire • Édito ............................................................ P. 3 • Actions municipales ....................................... P. 4 • Travaux et environnement ............................... P. 8 Talent vinonnais P. 16 • Au service des Vinonnais ............................... P. 13 • Talent vinonnais ............................................ P. 16 • Enfance et jeunesse ....................................... P. 17 • Sortir à Vinon ............................................... P. 21 Enfance et Jeunesse P. 17 • Côté Associations .......................................... P. 22 • Infos mairie .................................................. P. 30 • État civil ....................................................... P. 36 Focus Associations P. 22 L’écho de vinon-sur-Verdon n° 169 - Tirage : 2 450 exemplaires - Dépôt légal : Mars 2021 - Directeur de Publication : Claude CHEILAN Équipe logistique : Comité Communication Conception et réalisation : Mairie de Vinon-sur-Verdon - Service Accueil et Communication : 66, avenue de la Libération BP 19 - 83560 Vinon-sur-Verdon - 04 92 78 80 31 et Imprimerie Despretz : 90, rue St-André - 83560 Vinon-sur-Verdon - 04 92 78 82 07 Photos et textes : Associations, mairie et Jo Boudier NOUVEAU COMMERÇANT ROUMA NICOLAS -

DISCOVERY BOOKLET VERDON NATURAL REGIONAL PARK BOOKLET DISCOVERY BOOKLET DISCOVERY 30 50 40 34 25 48 45 49 10 47 13 16 21 12 14 6 8 4 Carbon Footprint
VERDON NATURAL REGIONAL PARK DISCOVERY BOOKLET DISCOVERY BOOKLET DISCOVERY Welcome to the Verdon Natural Regional Park The story of the Verdon starts with a river which rises in the southern Alps at an altitude of around 3,000 m to where it meets the Durance, covering SOMMAIRE the 165 km which will take it from being an Alpine torrent to a powerful river. Half-way along its course, as it goes through the Gorges, the Verdon carves its way through its meanders, using 4 Life-sized nature the slightest faults of the Pre-Alpine limestone mountains. Major development projects have 6 The Verdon's precious water used the river's energy to regulate its flow by building dams. Water then becomes precious as 8 Meeting the Verdon and living there it is a source of energy and a reservoir of drinking 10 On the Verdon's trails water for the whole region. It is also the basis of leisure and relaxation activities. The alternating 12 The Verdon for all white waters, big lakes and Gorges are perfect for a number of different sports. 13 The Valeurs Parc brand Since 1997, the Verdon Natural Regional Park 14 Coming to the Verdon and getting around has joined up with the river's fate by uniting 46 municipalities of its catchment area and the Alpes- 16 THE VALENSOLE PLATEAU de-Haute-Provence and Var departments. The Park is first and foremost founded on a territorial 21 THE HILLS OF THE HAUT VAR project which has made it possible to enhance the exceptional character of its landscapes and offer its 25 THE BASSES GORGES inhabitants opportunities for a good life. -

Autour De La Saint-Marcel À Barjols, Var
Maintenance et Mainteneurs de tradition autour de la Saint-Marcel à Barjols, Var Danièle Dossetto Paris, Mission du patrimoine ethnologique ; programme Tradition Aix-en-Provence, Centre d'ethnologie méditerranéenne et institut d'ethnologie méditerranéenne et comparative Mai 2000 SOMMAIRE 1 1ère partie Rapport terminal 4 2èine partie De la "Saint-Marcel" à la "Fête des Tripettes" 8 Une rétrospective. Des cas de figure 8 Restaurer la fête. De l'échec de 1768 au succès de 1867 11 Une revivification avec invention : 1893 13 Une action systématique : 1930-1954 13 .La tentation de la "Fête du boeuf" 18 . Dans le cadre d'un redressement symbolique 19 Des suites inattendues de la revivification 23 Elements d'analyse 23 Dire la fête "traditionnelle" 25 Le poids de l'écrit 29 Le facteur humain 30 Des ajustements du scénario festif... 34 ... à une redéfinition de l'espace 39 Références bibliographiques 42 Légendes des illustrations Ce tirage, destiné à la diffusion, ne reproduit pas le compte-rendu d'activité qui constitue la première partie du rapport original. La pagination en est toutefois conservée, de même que le report des légendes des illustrations en fin de texte. Celui-ci reprend mon intervention lors du colloque Relances de traditions en Europe auiourd'hui, MPE, CEM et IDEMEC, Aix-en-Provence, 17 et 18 septembre 1999 De la "Saint-Marcel" à la "Fête des Tripettes". Réactivations festives à Barjols (Var) de 1768 à 1954. Danièle Dossetto Paris, Mission du patrimoine ethnologique : programme Tradition Aix-en-Provence, Centre d'ethnologie méditerranéenne et Institut d'ethnologie méditerranéenne et comparative Mai 2000 A Marius Fabre (1909-1999), qui a favorisé cette recherche en me donnant accès à ses archives. -
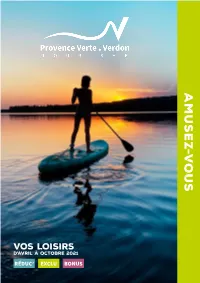
Guide Amusez-Vous En Provence
AMUSEZ-VOUs VOS LOISIRS d’Avril à octobre 2021 Réduc’ EXCLU BONUS AMUSEZ-VOUS, une offre à ne pas manquer ! - 80 activités pour vos vacances et vos loisirs, en famille ou entre amis, pour petits et grands - Des avantages comme s’il en pleuvait : des réductions, des animations exclusives ou des cadeaux - 1 destination : Provence Verte & Verdon, et tous les grands sites de loisirs alentours - Une réservation facile et pratique : votre office de tourisme vous conseille sur les activités et fait toutes vos réservations. Un seul interlocuteur et un seul paiement (CB, chèque, chèques vacances, espèces) Sommaire Canoë & bateau ....................................................... p. 4 Découverte de la nature ..................................... p. 10 Cheval & calèche ................................................... p. 15 Instants gourmands ............................................. p. 18 Musées & Monuments ......................................... p. 21 Activités en famille .............................................. p. 24 Parcs & jeux ............................................................ p. 30 Sur 2 roues .............................................................. p. 34 Visites guidées ...................................................... p. 37 B AVRIL-SEPTEMBRE 2019 - www.provenceverte.fr www.provenceverteverdon.fr - AVRIL-OCTOBRE 2021 1 LAC D’ESPARRON Où réserver ? D35 Tous les horaires sur LAC DE QUINSON MONTMEYAN D554 www.horaires.provenceverteverdon.fr SAINT-JULIEN GORGES LE MONTAGNIER DU VERDON D36 D35 D69 GINASSERVIS