Demande D'autorisation GENET RASORI Fontaine La Guyon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CC Entre Beauce Et Perche (Siren : 200058360)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC entre Beauce et Perche (Siren : 200058360) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Illiers-Combray Arrondissement Chartres Département Eure-et-Loir Interdépartemental non Date de création Date de création 10/12/2015 Date d'effet 01/01/2016 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Philippe SCHMIDT Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 2 rue du Pavillon Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 28120 ILLIERS-COMBRAY Téléphone Fax Courriel Site internet www.entrebeauceetperche.fr Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 21 944 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 48,13 Périmètre Nombre total de communes membres : 33 Dept Commune (N° SIREN) Population 28 Bailleau-le-Pin (212800213) 1 587 28 Billancelles (212800403) 333 28 Blandainville (212800411) 278 28 Cernay (212800676) 92 28 Charonville (212800817) 316 28 Chuisnes (212800999) 1 139 28 Courville-sur-Eure (212801161) 2 913 28 Épeautrolles (212801393) 190 28 Ermenonville-la-Petite (212801427) 189 28 Fontaine-la-Guyon (212801542) 1 717 28 Friaize (212801666) 251 28 Fruncé (212801674) 401 28 -

Compte Rendu De La Séance Du 24 Juin 2019
République Française Département EURE-ET-LOIR COMMUNE DE BAILLEAU LE PIN Compte rendu de séance Séance du 24 juin 2019 L’an 2019, le 24 Juin à 20:00, le Conseil Municipal de la Commune de BAILLEAU LE PIN s’est réuni à la Salle de réunion de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur LOCHON Martial, Maire, en session ordinaire. Présents : M. LOCHON Martial, Maire, Mmes : CHAUVEAU Estelle, DELPEUX Maryvonne, MURY Danièle, MM : BENOIST Laurent, DESVEAUX Luc, GOIRAND Jean-Luc, HENRIETTE Rodolphe, LAGOUTTE Christian, MAILLOT Yoland. Absents : Mesdames et Monsieur AUGROS Marie-Claude, CORDONNIER Virginie, AUTIN Jean Michel. Mme ZDEBSKI Patricia donne pouvoir à Mme CHAUVEAU M. MASSOT Eric donne pouvoir à M. GOIRAND M. SABATHIER Jérome donne pourvoir à M.HENRIETTE A été nommé(e) secrétaire : CHAUVEAU Estelle Le compte rendu du dernier conseil en date du 2 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. Monsieur le Maire demande au conseil de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour. Les membres présents acceptent à l’unanimité. L'ordre du jour sera le suivant : - Point Travaux - Convention avec le Département pour la rue de la Tuilerie - Recrutement - Rapport annuel Médiathèque - Aides exceptionnelles Associations - Accord local relatif à la composition du prochain conseil communautaire - Communauté de communes - Durées Amortissement Points travaux : Rues d’Hauville et de la Beaussière : Le Maire annonce qu’il y a eu des incidents quant aux sous-traitants de Synelva et a engendré le retard de fin de travaux. Rue de la Tuilerie : Les travaux sont bien avancés, et se termineront, normalement à la fin du mois d’août. -
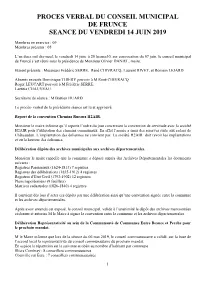
Compte – Rendu Du Conseil Municipal
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE FRUNCE SEANCE DU VENDREDI 14 JUIN 2019 Membres en exercice : 09 Membres présents : 05 L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 14 juin à 20 heures30, sur convocation du 07 juin, le conseil municipal de Fruncé s’est réuni sous la présidence de Monsieur Olivier DANIEL, maire. Etaient présents : Messieurs Frédéric SERRE, René CHIVRACQ, Laurent RIVET, et Romain LEJARD Absents excusés Dominique THIERY pouvoir à M René CHIVRACQ Roger LEUCART pouvoir à M Frédéric SERRE, Laetitia CHAUVEAU. Secrétaire de séance : M Bastien HUARD Le procès- verbal de la précédente séance est lu et approuvé. Report de la convention Chemins Ruraux H2AIR. Monsieur le maire informe qu’il reporte l’ordre du jour concernant la convention de servitude avec la société H2AIR pour l’utilisation des chemins communaux. En effet l’armée a émis des réserves suite aux radars de Châteaudun. L’implantation des éoliennes ne convient pas. La société H2AIR doit revoir les implantations et ou la hauteur des éoliennes. Délibération dépôts des archives municipales aux archives départementales. Monsieur le maire rappelle que la commune a déposé auprès des Archives Départementales les documents suivants : Registres Paroissiaux (1624-1813) 7 registres Registres des délibérations (1835-1912) 4 registres Registres d’Etat Civil (1793-1902) 12 registres Plans napoléoniens (9 feuillets) Matrices cadastrales (1826-1840) 4 registres Il convient dès lors d’acter ces dépôts par une délibération ainsi qu’une convention signée entre la commune et les archives départementales. Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, valide à l’unanimité le dépôt des archives mentionnées ci-dessus et autorise M le Maire à signer la convention entre la commune et les archives départementales. -

Télécharger Le Programme 2020
Fonds Européen de Développement Régional EXPOSITION - DÉMONSTRATION FILS ET FANTAISIE CRÉATION DE BIJOUX EN ÉMAIL BRODERIE D’ART SUR CUIVRE ET FUSION DE VERRE GEGON ATELIER BIJOUX Nadège ANTHOINE 06 09 67 13 66 1 rue des sables 28130 HANCHES Géraldine GONTIER 06 64 16 60 83 MATIÈRES À L’ŒUVRE 24, bis avenue Manoury 28600 Luisant [email protected] [email protected] www.gegon.fr E Démonstration du travail de la soie et de l’or - Broderie japonaise Illustration par vidéo et photos de mon travail. Exposition de bijoux en verre Murano et Bullseye avec la technique du à la Collégiale Saint-André Chartres CÉRAMISTE fusing, bijoux en émail sur plaque de cuivre (pièces uniques). L’ATELIER DE JOSIANE CRÉATRICE DE BIJOUX Josiane PIZETTE 06 73 50 57 01 PRUNAYLOTTE 8, rue d’Illiers 28120 Bailleau-lePin [email protected] E ISABELLE VALLIN 06 40 42 43 18 4 et 5 avril 10h> 19h 10 rue de la poste 28360 Prunay le Gillon Fabrication d’objets en céramique. Démonstration de modelage de figurine en grés [email protected] Création de bijoux - tissages perles en verre et résine CIRIER création d’un tissage - démonstration d’un tissage à l’aiguille avec et sans métier à tisser. LA MAISON LUCIEN 23 ARTISANS & 1 ORGANISME DE FORMATION Sébastien CHAMBENOIST 06 72 00 52 12 ÉBÉNISTE 8 rue de Langey 28290 commune nouvelle d’Arrou V & P AGENCEMENT vous plongent dans l’univers des métiers d’art. [email protected] www.lamaisonlucien.fr E David VOISIN 06 73 16 61 21 Explication de la création de bougie traditionnelle 18, rue Jean Rostand 28300 Mainvilliers Expositions, démonstrations, ateliers, etc.. -

La Synthèse De Llétat Initial De Llenvironnement
La synthèse de L’état initiaL de L’environnement ANALYSE DES SENSIBILITÉS DE L’ENVIRONNEMENT CHAVIGNY-BAILLEUL TILLY TILLY MULCENT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS GOUPILLIERES MONTAINVILLE CHAVIGNY-BAILLEUL EZY-SUR-EURE DAMVILLE BOIS-LE-ROI OULINS BOISSETS COUDRES CHAMPIGNY-LA-FUTELAYE SAINT-OUEN-MARCHEFROY OSMOY THOIRY CIVRY-LA-FORET MARCQ PRUNAY-LE-TEMPLE MOISVILLE Secteur NONANCOURT - CROTHDREUX SAUSSAY ORVILLIERS FLEXANVILLE VILLIERS-LE-MAHIEU ANET BEYNES LIGNEROLLES SAINT-LAURENT-DES-BOIS BONCOURT ROMAN BUIS - SUR - DAMVILLE Contournement de Dreux BERCHERES-SUR-VESGRE AUTOUILLET SAULX-MARCHAIS ORGERUS AUTEUIL MARCILLY - LA - CAMPAGNE ROUVRES SOREL-MOUSSEL GRESSEY TACOIGNIERES BEHOUST ILLIERS - L'EVEQUE HELLENVILLIERS N MARCILLY - SUR - EURE RICHEBOURG GARANCIERES Nonancourt SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE BOISSY-SANS-AVOIR VICQ NEAUPHLE-LE-VIEUX RD928 COURDEMANCHE BAZAINVILLE MILLEMONT DROISY BU LOUYE ABONDANT LA QUEUE-LES-YVELINES HOUDAN LA MADELEINE - DE - NONANCOURT GALLUIS SAINT - GEORGES - MOTEL MERE HAVELU MAREIL-LE-GUYON GOUSSAINVILLE MAULETTE MUZY NONANCOURT GAMBAIS GROSROUVRE SAINT - GERMAIN - SUR - AVRE ACON MARCHEZAIS MESNIL - SUR - L'ESTREE MONTREUIL SERVILLE MONTFORT-L'AMAURY BREUX - SUR - AVRE DAMPIERRE - SUR - AVRE CHAMPAGNE DANNEMARIE SAINT - LUBIN - DES - JONCHERETS CHERISY RN12 VERT - EN - DROUAIS GAMBAISEUIL SAINT - REMY - SUR - AVRE BROUE BOURDONNE DREUX LES MESNULS GERMAINVILLE BEROU - LA - MULOTIERE RN12 Dreux SAINT-REMY-L'HONORE LOUVILLIERS - EN - DROUAIS BOUTIGNY-PROUAIS BOISSY - EN - DROUAIS REVERCOURT SAINTE - GEMME - MORONVAL -

La Bonne Nouvelle En Val De L'eure
Paroisse « La Bonne Nouvelle en Val de l’Eure » Bailleau l'Evêque, Billancelles, Chauffours, Chuisnes, Courville sur Eure, Dangers, Fontaine la Guyon, Fontenay sur Eure, Friaize, Fruncé, Landelles, Le Favril, Le Thieulin, Mittainvilliers, Nogent sur Eure, Orrouer, Pontgouin, Saint Arnoult des Bois, Saint Aubin des Bois, Saint Denis des Puits, Saint Georges sur Eure, Saint Germain le Gaillard, Saint Luperce, Vérigny, Villebon NFORMATIONS POUR LES MOIS DE JUILLET / AOUT 2017 Ce feuillet est destiné à vous informer régulièrement de la vie de notre paroisse. N'hésitez pas à nous donner vos informations pour les partager ensemble. : 02.37.23.21.27 E-mail : [email protected] Les vacances sont là. Nous pouvons profiter de ce moment de repos bien mérité. « Dieu, lui-même, après avoir vu que tout ce qu’il a créé était bon, s’est reposé » (Gn 2,2). C’est un moment de repos, de découverte, de partage et de réflexion. Même si tous n’ont pas la possibilité de partir, nous pouvons partager ensemble de bons moments, en toute simplicité, en ouvrant notre porte aux autres. Sans vouloir gâcher notre joie, nous ne pouvons pas oublier que des hommes, des femmes et des enfants marchent sur les routes, à travers champs, traversent la mer au péril de leur vie, sans être des touristes, car ils ne cherchent que leur « terre promise ». Même si nous ne croisons pas leur route, soyons attentifs à leur détresse, dans nos paroles, nos prières et nos actes. Les détresses sont partout et nous n’aurons pas de mal, malheureusement, à retrouver proche de chez nous des personnes qui ont besoin de notre regard, notre écoute et notre cœur. -

Communautés De Communes Et D'agglomérations
Communautés de communes et d'agglomérations Gu ainville Gilles La Ch aussée-d 'Ivry Le Mesnil-Simo n ¯ Ou lin s Saint-Ouen-March efroy Anet Sau ssay Bonco urt Berchères-sur-Vesgre So rel-M oussel Rouvres Saint-Lub in -d e-la-Haye EURE Pays Houdanais Bû Abon dant (partie E&L) Havelu Serville Marchezais Go ussainville Montreuil Damp ierre-su r-Avre Saint-Lub in -d es-Jo ncherets Cherisy Saint-Rémy-su r-Avre Vert-en-Drouais Bro ué Dreux Pays de Bérou -la-Mulotière Germainville Lou villiers-en-Drou ais Sainte-Gemme-Moronval Boutigny-Pro uais Boissy-en-Drou ais VerneuMionltigny-sur-Avre Revercourt Prudemanche La Ch apelle-F orainvilliers Mézières-en-D rou ais Escorpain Allainville Verno uillet (partie E&L) Luray Ou erre Rueil-la-Gadelière Fessan villiers-Mattanvilliers Saint-Lub in -d e-Cravant Écluzelles Laons Garan cières-en-Drouais Garnay Les Pin th ières Charp ont Brezo lles Saint-Laurent-la-Gâtine Cro isilles Boissy-lès-Perche Châtain co urt Beauche Crécy-Cou vé Faverolles Rohaire Dreux Tréon Marville-Mo utiers-B rûlé Cru cey-Villages Villemeux-sur-Eu re Bréchamps Sau lnières Les Ch âtelets agglomération Saint-Ang e-et-Torçay Aunay-sou s-C récy La Ch apelle-F ortin Morvilliers Fon taine-les-Ribou ts Chaud on Coulombs Sen an tes Le Bo ullay-Mivoye La Man celière Lamb lo re Pu iseux Lormaye Saint-Lucien La Saucelle Maillebois Le Bo ullay-Thierry Le Bo ullay-les-Deux-Églises Orée du Nogen t-le-Roi Saint-Jean -de-Rebervilliers Lou villiers-lès-Perche Ormo y Perche La Puisaye Villiers-le-Mo rhier La Ferté-Vid ame Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Sau -

101 Du 4 Octobre 2018 LISTE DES COMMUNES SITUÉES DANS LA
ANNEXE 1 à la délibération n° 18 - 101 du 4 octobre 2018 LISTE DES COMMUNES SITUÉES DANS LA ZONE DE REDEVANCE POLLUTION MAJORÉE 17360 SAINTE-MARIE-DE-RE 17 - CHARENTE-MARITIME 17369 SAINT-MARTIN-DE-RE 17373 SAINT-MEDARD-D'AUNIS 17003 AIGREFEUILLE-D'AUNIS 17007 ANAIS 17376 SAINT-OUEN-D'AUNIS 17008 ANDILLY 17382 SAINT-PIERRE-D'AMILLY 17009 ANGLIERS 17391 SAINT-ROGATIEN 17010 ANGOULINS 17394 SAINT-SATURNIN-DU-BOIS 17019 ARS-EN-RE 17396 SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS 17028 AYTRE 17407 SAINTE-SOULLE 17041 BENON 17413 SAINT-VIVIEN 17051 LE BOIS-PLAGE-EN-RE 17414 SAINT-XANDRE 17057 BOUHET 17420 SALLES-SUR-MER 17059 BOURGNEUF 17439 TAUGON 17080 CHAMBON 17447 LE THOU 17091 CHARRON 17466 VERINES 17094 CHATELAILLON-PLAGE 17472 VILLEDOUX 17109 CLAVETTE 17474 VILLENEUVE-LA-COMTESSE 17121 LA COUARDE-SUR-MER 17480 VIRSON 17127 COURCON 17482 VOUHE 17132 CRAMCHABAN 17136 CROIX-CHAPEAU 22 - COTES D'ARMOR 17139 DOEUIL-SUR-LE-MIGNON Toutes les communes du département 17142 DOMPIERRE-SUR-MER 17153 ESNANDES 28 - EURE-ET-LOIR 17158 FERRIERES 28002 ALLAINES-MERVILLIERS 17161 LA FLOTTE 28004 ALLONNES 17166 FORGES 28005 ALLUYES 17182 LA GREVE-SUR-MIGNON 28010 ARGENVILLIERS 17186 LE GUE-D'ALLERE 28012 COMMUNE NOUVELLE D'ARROU 17190 L'HOUMEAU 28016 LES AUTELS-VILLEVILLON 17193 LA JARNE 28018 AUTHON-DU-PERCHE 17194 LA JARRIE 28019 BAIGNEAUX 17200 LAGORD 28021 BAILLEAU-LE-PIN 17201 LA LAIGNE 28026 BAUDREVILLE 17207 LOIX 28027 LA BAZOCHE-GOUET 17208 LONGEVES 28028 BAZOCHES-EN-DUNOIS 17218 MARANS 28029 BAZOCHES-LES-HAUTES 17221 MARSAIS 28031 BEAUMONT-LES-AUTELS 17222 MARSILLY -

Definition Des Bassins Hydrographiques – Liste Des Communes Concernées
Annexe 2 - Definition des bassins hydrographiques – Liste des communes concernées Bassin versant de « l'Aigre » CHARRAY LA FERTE-VILLENEUIL LE MEE Bassin versant de « l'Avre Aval » THIVILLE AUTHEUIL de sa source jusqu'àBérou la Mulotière RUEIL-LA-GADELIERE LA CHAPELLE-DU-NOYER BEROU-LA-MULOTIERE ROMILLY-SUR-AIGRE LA FERTE-VIDAME LAMBLORE LES RESSUINTES BEAUCHE BOISSY-LES-PERCHE LA CHAPELLE-FORTIN Bassin versant de « l'Avre Amont » MONTIGNY-SUR-AVRE de Bérou la Mulotière jusqu'à l'Eure MORVILLIERS MONTREUIL ROHAIRE DAMPIERRE-SUR-AVRE ESCORPAIN PRUDEMANCHE Bassin versant de « la Blaise » SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS VERNOUILLET SAINT-REMY-SUR-AVRE MONTREUIL VERT-EN-DROUAIS TREMBLAY-LES-VILLAGES DREUX GARNAY REVERCOURT LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES BREZOLLES AUNAY-SOUS-CRECY CRUCEY-VILLAGES CHERISY LAONS DREUX SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT CRECY-COUVE BEROU-LA-MULOTIERE SAULNIERES SENONCHES TREON LA FERTE-VIDAME SAINT-SAUVEUR-MARVILLE LA FRAMBOISIERE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS LOUVILLIERS-LES-PERCHE MAILLEBOIS LA MANCELIERE LE MESNIL-THOMAS LA PUISAYE SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS LES RESSUINTES SAINT-MAIXME-HAUTERIVE LA SAUCELLE PONTGOUIN LES CHATELETS SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN MORVILLIERS CRUCEY-VILLAGES FONTAINE-LES-RIBOUTS SAINT-ANGE-ET-TORCAY MANOU ARDELLES DIGNY FAVIERES JAUDRAIS SENONCHES THIMERT-GATELLES LOUVILLIERS-LES-PERCHE Bassin versant de « la Cloche» Bassin versant de « la Conie » LA GAUDAINE FONTENAY-SUR-CONIE MARGON ORGERES-EN-BEAUCE COUDRECEAU GUILLONVILLE FRETIGNY NOTTONVILLE SAINT-DENIS-D'AUTHOU PERONVILLE MONTLANDON VARIZE SAINT-VICTOR-DE-BUTHON -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 EURE-ET-LOIR INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 - EURE-ET-LOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 28-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 28-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 28-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 28-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

28-Eure-Et-Loir
28110 Lucé 28120 Bailleau-le-Pin 28120 Blandainville 28120 Cernay 28120 Charonville 28120 Châtelliers-Notre-Dame 28120 Épeautrolles 28120 Ermenonville-la-Grande 28120 Ermenonville-la-Petite 28120 Illiers-Combray 28120 Magny 28120 Marchéville 28120 Méréglise 28120 Meslay-le-Grenet 28120 Montigny-le-Chartif 28120 Nogent-sur-Eure 28120 Nonvilliers-Grandhoux 28120 Ollé 28120 Saint-Éman 28120 Sandarville 28120 Vieuvicq 28130 Bouglainval 28130 Mévoisins 28130 Pierres 28130 Saint-Martin-de-Nigelles 28130 Soulaires 28130 Villiers-le-Morhier 28130 Yermenonville 28140 Baigneaux 28140 Bazoches-les-Hautes 28140 Cormainville 28140 Courbehaye 28140 Dambron 28140 Germignonville 28140 Guillonville 28140 Loigny-la-Bataille 28140 Lumeau 28140 Nottonville 28140 Poupry 28140 Tillay-le-Péneux 28140 Varize 28150 Allonnes 28150 Baignolet 28150 Boisville-la-Saint-Père 28150 Boncé 28150 Fains-la-Folie 28150 Louville-la-Chenard 28150 Montainville 28150 Moutiers 28150 Pézy 28150 Prasville 28150 Réclainville 28150 Rouvray-Saint-Florentin 28150 Villars 28150 Villeau 28150 Villeneuve-Saint-Nicolas 28150 Ymonville 28160 Dampierre-sous-Brou 28160 Gohory 28160 Mézières-au-Perche 28160 Mottereau 28160 Moulhard 28160 Yèvres 28170 Ardelles 28170 Boullay-les-Deux-Églises 28170 Châteauneuf-en-Thymerais 28170 Favières 28170 Fontaine-les-Ribouts 28170 Puiseux 28170 Saint-Ange-et-Torçay 28170 Saint-Jean-de-Rebervilliers 28170 Saint-Maixme-Hauterive 28170 Saint-Sauveur-Marville 28170 Serazereux 28170 Thimert-Gâtelles 28170 Tremblay-les-Villages 28190 Billancelles 28190 Chuisnes -

Préfecture D'eure-Et-Loir Avis De Mise a Disposition Du Public
PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC OBJET : Projet de directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues proches et lointaines sur la cathédrale de Chartres PROJET CONDUIT PAR : La Préfète d’Eure-et-Loir- Place de la République- CS 80537 - 28019 CHARTRES cedex COMMUNES CONCERNEES : Allonnes, Amilly, Bailleau-le-Pin, Bailleau-l’Evéque, Bailleau-Armenonville, Barjouville, Berchères-Saint-Germain, Berchères-les-Pierres, Béville-le-Comte, Billancelles, Boisville-la-Saint-Père, La Bourdinière-Saint-Loup, Boncé, Bouglainval, Briconville, Cernay, Challet, Champhol, Champseru, Chartainvilliers, Chartres, Les Chatellers-Notre-Dame, Chauffours, Chuisnes, Cintray, Clévillers, Coltainville, Corancez, Le Coudray, Courville-sur-Eure, Dammarie, Dangers, Digny, Escrones, Epeautrolles, Epernon, Ermenonville-la-Grande, Fontaine-la-Guyon, Fontenay-sur-Eure, Francourville, Fresnay-le-Comte, Fresnay-le-Gilmert, Friaize, Fruncé, Gallardon, Gas, Gasville-Oisème, Gellainville, Le Gué-de Longroi, Hanches, Houville-la- Branche, Houx, Jouy, Landelles, Lèves, Lucé, Luisant, Luplanté, Magny, Maintenon, Mainvilliers, Marchéville, Meslay-le-Grenet, Meslay-le-Vidame, Mévoisins, Mignières, Mittainvilliers-Vérigny, Moinville-la Jeulin, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur- Eure, Oinville-sous-Auneau, Ollé, Orrouer, Poisvilliers, Pontgouin, Prunay-le-Gillon, Réclainville, Saint-Arnoult-des-Bois, Saint- Aubin-des-Bois, Saint-Denis-des-Puits, Saint-Georges-sur Eure, Saint-Germain-le-Gaillard, Saint-Luperce,