I. Thoracopterus Bronn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ribe Strelovške Formacije
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana Jahr/Year: 2010 Band/Volume: Suppl_5 Autor(en)/Author(s): Hitij Tomaz, Tintori Andrea Artikel/Article: Ribe Strelovske formacije. 108-130 SCOPOLIA Suppl. 5-2010 ©Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana, Slovenia; download www.biologiezentrum.at Ribe Strelovške formacije Tomaž Hitij in Andrea Tintori Fishes of the Strelovec Formation In addition to invertebrates, the Strelovec Formation also proved to be very rich in vertebrate fossils. Among fishes, the genusEosemionotus is the most abundant, followed by the genera Habroichthys, Placopleurus, Saurichthys, and the early neopterigians probably close to semionotiform (IFuro andISangiorgioichthys). Among them, a fish that probably belongs to the genus Ctenognathichthys was also found. Locally,Eosemionotus specimens can be found in large numbers on single bedding planes (possibly mass mortality events). Numerous very well preserved fish remains are certainly the most important and remarkable fossils from the Kamniško-Savinjske Alps. New fish specimens are being found regularly during each new visit to the outcrops of the Strelovec Formation, therefore new interesting finds are expected within the ongoing field research. 108 SCOPOLIA Suppl. 5-2010 ©Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana, Slovenia; download www.biologiezentrum.at Fosili rib iz Strelovške formacije spadajo med pripada rodu Ctenognathichthys (T-1025). najpomembnejše triasne najdbe v Kamniško- Večinoma prevladujejo rodovi majhnih rib. -Savinjskih Alpah. Najdenih jih je bilo že V današnjih ekosistemih je veliko število preko sto primerkov. Njihova največja poseb majhnih rib značilno predvsem za tropske nost in paleontološka vrednost pa je v tem, koralne grebene, ki so strukturno najkomple da so večinoma odlično ohranjene. -

The Early Triassic Jurong Fish Fauna, South China Age, Anatomy, Taphonomy, and Global Correlation
Global and Planetary Change 180 (2019) 33–50 Contents lists available at ScienceDirect Global and Planetary Change journal homepage: www.elsevier.com/locate/gloplacha Research article The Early Triassic Jurong fish fauna, South China: Age, anatomy, T taphonomy, and global correlation ⁎ Xincheng Qiua, Yaling Xua, Zhong-Qiang Chena, , Michael J. Bentonb, Wen Wenc, Yuangeng Huanga, Siqi Wua a State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan 430074, China b School of Earth Sciences, University of Bristol, BS8 1QU, UK c Chengdu Center of China Geological Survey, Chengdu 610081, China ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: As the higher trophic guilds in marine food chains, top predators such as larger fishes and reptiles are important Lower Triassic indicators that a marine ecosystem has recovered following a crisis. Early Triassic marine fishes and reptiles Fish nodule therefore are key proxies in reconstructing the ecosystem recovery process after the end-Permian mass extinc- Redox condition tion. In South China, the Early Triassic Jurong fish fauna is the earliest marine vertebrate assemblage inthe Ecosystem recovery period. It is constrained as mid-late Smithian in age based on both conodont biostratigraphy and carbon Taphonomy isotopic correlations. The Jurong fishes are all preserved in calcareous nodules embedded in black shaleofthe Lower Triassic Lower Qinglong Formation, and the fauna comprises at least three genera of Paraseminotidae and Perleididae. The phosphatic fish bodies often show exceptionally preserved interior structures, including net- work structures of possible organ walls and cartilages. Microanalysis reveals the well-preserved micro-structures (i.e. collagen layers) of teleost scales and fish fins. -
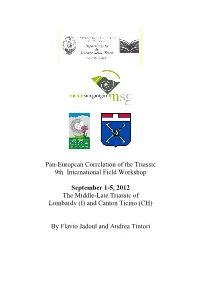
Lombardy 2012 Part A
Pan-European Correlation of the Triassic 9th International Field Workshop September 1-5, 2012 The Middle-Late Triassic of Lombardy (I) and Canton Ticino (CH) By Flavio Jadoul and Andrea Tintori 2 This Field Trip had support from: Convenzione dei Comuni italiani del Monte San Giorgio/UNESCO Fondazione UNESCO- Monte San Giorgio Svizzera Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera Parco Regionale della Grigna Settentrionale 3 September 2, first day by Andrea Tintori and Markus Felber MONTE SAN GIORGIO IS UNESCO WORLD HERITAGE SITE Monte San Giorgio is among the most important fossil-bearing sites in the world, in particular concerning the middle Triassic fauna (245-230 million years ago). Following the UNESCO inscription of the Swiss side of the mountain in 2003, the Italian side has been inscribed in 2010, stating that: “Monte San Giorgio is the only and best known evidence of the marine Triassic life but also preserves some important remains of terrestrial organisms. The numerous and diverse fossil finds are exceptionally preserved and complete. The long history of the research and the controlled management of the paleontological resources have allowed thorough studies and the classification of exceptional specimens which are the basis for a rich scientific paper production. For all these reasons Monte San Giorgio represents the main reference in the world concerning the Triassic faunas.” 4 THE GEOLOGICAL HISTORY OF MONTE SAN GIORGIO Monte San Giorgio belongs to the broad tectonic feature named Sudalpino , which encompasses all the rock formations lying South of the Insubric Line. The oldest rocks of Monte San Giorgio outcrop in spots along the shores of the Ceresio Lake, between the Brusino Arsizio custom house and the built-up area of Porto Ceresio. -

Osteichthyes, Actinopterygii) from the Early Triassic of Northwestern Madagascar
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (Research in Paleontology and Stratigraphy) vol. 123(2): 219-242. July 2017 REDESCRIPTION OF ‘PERLEIDUS’ (OSTEICHTHYES, ACTINOPTERYGII) FROM THE EARLY TRIASSIC OF NORTHWESTERN MADAGASCAR GIUSEPPE MARRAMÀ1*, CRISTINA LOMBARDO2, ANDREA TINTORI2 & GIORGIO CARNEVALE3 1*Corresponding author. Department of Paleontology, University of Vienna, Geozentrum, Althanstrasse 14, 1090 Vienna, Austria. E-mail: [email protected] 2Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, Via Mangiagalli 34, I-20133 Milano, Italy. E-mail: cristina.lombardo@ unimi.it; [email protected] 3Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, Via Valperga Caluso 35, I-10125 Torino, Italy. E-mail: giorgio.carnevale@ unito.it To cite this article: Marramà G., Lombardo C., Tintori A. & Carnevale G. (2017) - Redescription of ‘Perleidus’ (Osteichthyes, Actinopterygii) from the Early Triassic of northwestern Madagascar . Riv. It. Paleontol. Strat., 123(2): 219-242. Keywords: Teffichthys gen. n.; TEFF; Ankitokazo basin; geometric morphometrics; intraspecific variation; basal actinopterygians. Abstract. The revision of the material from the Lower Triassic fossil-bearing-nodule levels from northwe- stern Madagascar supports the assumption that the genus Perleidus De Alessandri, 1910 is not present in the Early Triassic. In the past, the presence of this genus has been reported in the Early Triassic of Angola, Canada, China, Greenland, Madagascar and Spitsbergen. More recently, it has been pointed out that these taxa may not be ascri- bed to Perleidus owing to several anatomical differences. The morphometric, meristic and morphological analyses revealed a remarkable ontogenetic and individual intraspecific variation among dozens of specimens from the lower Triassic of Ankitokazo basin, northwestern Madagascar and allowed to consider the two Malagasyan species P. -

Exceptional Vertebrate Biotas from the Triassic of China, and the Expansion of Marine Ecosystems After the Permo-Triassic Mass Extinction
Earth-Science Reviews 125 (2013) 199–243 Contents lists available at ScienceDirect Earth-Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/earscirev Exceptional vertebrate biotas from the Triassic of China, and the expansion of marine ecosystems after the Permo-Triassic mass extinction Michael J. Benton a,⁎, Qiyue Zhang b, Shixue Hu b, Zhong-Qiang Chen c, Wen Wen b, Jun Liu b, Jinyuan Huang b, Changyong Zhou b, Tao Xie b, Jinnan Tong c, Brian Choo d a School of Earth Sciences, University of Bristol, Bristol BS8 1RJ, UK b Chengdu Center of China Geological Survey, Chengdu 610081, China c State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan 430074, China d Key Laboratory of Evolutionary Systematics of Vertebrates, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100044, China article info abstract Article history: The Triassic was a time of turmoil, as life recovered from the most devastating of all mass extinctions, the Received 11 February 2013 Permo-Triassic event 252 million years ago. The Triassic marine rock succession of southwest China provides Accepted 31 May 2013 unique documentation of the recovery of marine life through a series of well dated, exceptionally preserved Available online 20 June 2013 fossil assemblages in the Daye, Guanling, Zhuganpo, and Xiaowa formations. New work shows the richness of the faunas of fishes and reptiles, and that recovery of vertebrate faunas was delayed by harsh environmental Keywords: conditions and then occurred rapidly in the Anisian. The key faunas of fishes and reptiles come from a limited Triassic Recovery area in eastern Yunnan and western Guizhou provinces, and these may be dated relative to shared strati- Reptile graphic units, and their palaeoenvironments reconstructed. -

From the Middle Triassic of Southern China
Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 50 (2), 2011, 75-83. Modena, 31 ottobre 201175 A new species of the genus Perleidus (Actinopterygii: Perleidiformes) from the Middle Triassic of Southern China Cristina LOMBARDO, Zuo-Yu SUN, Andrea TINTORI, Da-Yong JIANG & Wei-Cheng HAO C. Lombardo, Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, Università degli Studi di Milano, I-20113, Milano, Italy; [email protected] Z.-Y. Sun, Department of Geology and Geological Museum, Peking University, Beijing 100871, People’s Republic of China; [email protected] A. Tintori, Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, Università degli Studi di Milano, I-20113, Milano, Italy; [email protected] D.-Y. Jiang, Department of Geology and Geological Museum, Peking University, Beijing 100871, People’s Republic of China; [email protected] W.-C. Hao, Department of Geology and Geological Museum, Peking University, Beijing 100871, People’s Republic of China; [email protected] KEY WORDS - Actinopterygians, Perleidiformes, Perleidus sinensis n. sp., Middle Triassic, Southern China, Tethys. ABSTRACT - Perleidus sinensis n. sp., a new species of “Subholostean” fossil fish of the order Perleidiformes is described herein on the basis of a single, well-preserved specimen collected from the Upper Member of the Guanling Formation (Pelsonian, Middle Anisian, Middle Triassic) outcropping near Luoping (Yunnan Province) in South China. The vertebrate assemblage yielded by these levels is proving to be of importance with regard to the marine Triassic -

Copyrighted Material
06_250317 part1-3.qxd 12/13/05 7:32 PM Page 15 Phylum Chordata Chordates are placed in the superphylum Deuterostomia. The possible rela- tionships of the chordates and deuterostomes to other metazoans are dis- cussed in Halanych (2004). He restricts the taxon of deuterostomes to the chordates and their proposed immediate sister group, a taxon comprising the hemichordates, echinoderms, and the wormlike Xenoturbella. The phylum Chordata has been used by most recent workers to encompass members of the subphyla Urochordata (tunicates or sea-squirts), Cephalochordata (lancelets), and Craniata (fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals). The Cephalochordata and Craniata form a mono- phyletic group (e.g., Cameron et al., 2000; Halanych, 2004). Much disagree- ment exists concerning the interrelationships and classification of the Chordata, and the inclusion of the urochordates as sister to the cephalochor- dates and craniates is not as broadly held as the sister-group relationship of cephalochordates and craniates (Halanych, 2004). Many excitingCOPYRIGHTED fossil finds in recent years MATERIAL reveal what the first fishes may have looked like, and these finds push the fossil record of fishes back into the early Cambrian, far further back than previously known. There is still much difference of opinion on the phylogenetic position of these new Cambrian species, and many new discoveries and changes in early fish systematics may be expected over the next decade. As noted by Halanych (2004), D.-G. (D.) Shu and collaborators have discovered fossil ascidians (e.g., Cheungkongella), cephalochordate-like yunnanozoans (Haikouella and Yunnanozoon), and jaw- less craniates (Myllokunmingia, and its junior synonym Haikouichthys) over the 15 06_250317 part1-3.qxd 12/13/05 7:32 PM Page 16 16 Fishes of the World last few years that push the origins of these three major taxa at least into the Lower Cambrian (approximately 530–540 million years ago). -

Quaderns De Natura PEIXOS ACTINOPTERIGIS DEL
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Revistes Catalanes amb Accés Obert Quaderns de Vilaniu, 35: 55-87 (1999) ^^ Quaderns de Natura PEIXOS ACTINOPTERIGIS DEL TRIÀSIC MITJÀ DE LA PEDRA D'ALCOVER * per Joan Cartanyà Martí Paraules clau: actinopterigis, sistemàtica, Ladinià superior. Unitat d'Alcover. Resum: Els fòssils de les dolmicrites d'Alcover es coneixen des del 1963. La Unitat de les Dolomies Taulejades d'Alcover (pedra d'Alcover) té una potència de 70-80 m, i es troba en depressions interesculls. Estratigràficament es situa al Ladinià superior (Triàsic mitjà). Durant la deposició de la Unitat d'Alcover es van desenvolupar condicions anòxiques i hipersalines d'una forma periòdica. Les fàcies més abundants són constituïdes per capes de dolmicrites massives (d'entre 1 i 10 cm de gruix) i dolmicrites laminades molt fines. Localment apareixen capes ondulades amb plegaments i cabussaments. L'associació fòssil és al·lòctona i composta per grups florístics i faunístics com: plantes terrestres, celenterats, braquiòpodes, mol·luscs, artròpodes, equinoderms, peixos i rèptils, però la reputació d'aquests jaciments rau en el fet que els fòssils s'han conservat en dolmicrites i en la seva diversitat ictiològica. La fauna de peixos d'Alcover es caracteritza bàsicament per individus de talla mitjana. Els Saurichtiformes i els Perleidiformes són els ordres més comuns. Mitjançant aquest estudi els actinopterigis es classifiquen bàsicament a nivell genèric, i en alguns casos només a nivell de família. D'aquesta manera, i fins avui, han sigut prèviament indentificats 15 gèneres pertanyents a 11 famílies i nou ordres: Plycholepis, IBoreosomiis, Sauriclitliys, Colobodiis, Perleidus, IClenognaliclilltys, Peltoperleidiis, ICleithrolepididae indet., Pelíopleurus, Peripeltopleurus, IPlatysiagiim, Liiganoia, Eosemionotiis, Archaeosemionotus, Allolepidotiis, Eoeugnathiis, ICaturus, lOphiopsis, IPholidophoridae indet. -

Actinopterygian Fishes (Osteichthyes, Actinopterygii) from the Kalkschieferzone (Uppermost Ladinian) Near Meride (Canton Ticino, Southern Switzerland)
Actinopterygian fishes (Osteichthyes, Actinopterygii) from the Kalkschieferzone (Uppermost Ladinian) near Meride (Canton Ticino, Southern Switzerland) Autor(en): Bürgin, Toni Objekttyp: Article Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae Band (Jahr): 88 (1995) Heft 3 PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-167705 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Eclogae geol. Helv. 88/3: 803-826 (1995) 0012-9402/95/030803-24 $1.50 + 0.20/0 Birkhäuser Verlag. Basel Actinopterygian fishes (Osteichthyes; Actinopterygii) from the Kalkschieferzone (Uppermost Ladinian) near Meride (Canton Ticino, Southern Switzerland) Tom Bürgin Key words: Kalkschieferzone. Middle Triassic. Monte San Giorgio, fossil Actinopterygii. -
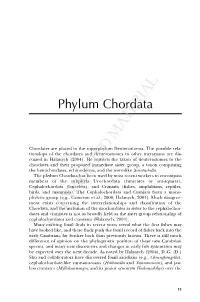
Copyrighted Material
06_250317 part1-3.qxd 12/13/05 7:32 PM Page 15 Phylum Chordata Chordates are placed in the superphylum Deuterostomia. The possible rela- tionships of the chordates and deuterostomes to other metazoans are dis- cussed in Halanych (2004). He restricts the taxon of deuterostomes to the chordates and their proposed immediate sister group, a taxon comprising the hemichordates, echinoderms, and the wormlike Xenoturbella. The phylum Chordata has been used by most recent workers to encompass members of the subphyla Urochordata (tunicates or sea-squirts), Cephalochordata (lancelets), and Craniata (fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals). The Cephalochordata and Craniata form a mono- phyletic group (e.g., Cameron et al., 2000; Halanych, 2004). Much disagree- ment exists concerning the interrelationships and classification of the Chordata, and the inclusion of the urochordates as sister to the cephalochor- dates and craniates is not as broadly held as the sister-group relationship of cephalochordates and craniates (Halanych, 2004). Many excitingCOPYRIGHTED fossil finds in recent years MATERIAL reveal what the first fishes may have looked like, and these finds push the fossil record of fishes back into the early Cambrian, far further back than previously known. There is still much difference of opinion on the phylogenetic position of these new Cambrian species, and many new discoveries and changes in early fish systematics may be expected over the next decade. As noted by Halanych (2004), D.-G. (D.) Shu and collaborators have discovered fossil ascidians (e.g., Cheungkongella), cephalochordate-like yunnanozoans (Haikouella and Yunnanozoon), and jaw- less craniates (Myllokunmingia, and its junior synonym Haikouichthys) over the 15 06_250317 part1-3.qxd 12/13/05 7:32 PM Page 16 16 Fishes of the World last few years that push the origins of these three major taxa at least into the Lower Cambrian (approximately 530–540 million years ago). -

A Hiatus Obscures the Early Evolution of Modern Lineages of Bony Fishes
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2021 A Hiatus Obscures the Early Evolution of Modern Lineages of Bony Fishes Romano, Carlo Abstract: About half of all vertebrate species today are ray-finned fishes (Actinopterygii), and nearly all of them belong to the Neopterygii (modern ray-fins). The oldest unequivocal neopterygian fossils are known from the Early Triassic. They appear during a time when global fish faunas consisted of mostly cosmopolitan taxa, and contemporary bony fishes belonged mainly to non-neopterygian (“pale- opterygian”) lineages. In the Middle Triassic (Pelsonian substage and later), less than 10 myrs (million years) after the Permian-Triassic boundary mass extinction event (PTBME), neopterygians were already species-rich and trophically diverse, and bony fish faunas were more regionally differentiated compared to the Early Triassic. Still little is known about the early evolution of neopterygians leading up to this first diversity peak. A major factor limiting our understanding of this “Triassic revolution” isaninter- val marked by a very poor fossil record, overlapping with the Spathian (late Olenekian, Early Triassic), Aegean (Early Anisian, Middle Triassic), and Bithynian (early Middle Anisian) substages. Here, I review the fossil record of Early and Middle Triassic marine bony fishes (Actinistia and Actinopterygii) at the substage-level in order to evaluate the impact of this hiatus–named herein the Spathian–Bithynian gap (SBG)–on our understanding of their diversification after the largest mass extinction event of the past. I propose three hypotheses: 1) the SSBE hypothesis, suggesting that most of the Middle Triassic diver- sity appeared in the aftermath of the Smithian-Spathian boundary extinction (SSBE; 2 myrs after the PTBME), 2) the Pelsonian explosion hypothesis, which states that most of the Middle Triassic ichthyo- diversity is the result of a radiation event in the Pelsonian, and 3) the gradual replacement hypothesis, i.e. -

A New Perleidid from the Spathian
ivist stlin di leontologi e trtigrfi volume IIW noF Q ppF PUSEPVS xovemer PHIQ e xi ivishsh pyw ri ersex @yvixiusexD iev sesgA yp greyr D exr s ysxgiD grsxe I P I Q y x D exhie sxys D heyxq tsexq 8 y ui wyexs eeivedX tuneD TD PHIQY eptedX ytoer PSD PHIQ uey wordsX xew txonD erleidiformesD irly rissiD pthinD dorsle ed nleF ghohuperleidus genF nF rppresent il piuÁ ntio outh ghinF perleidiforme onosiuto e prov l9origine dei perleidiformi giÁ verso l fine del rissio snferioreF estrtF e new tinopterygin genus nd speiesD ghohuperE leidus primus genF nF spF nFD is desried from the pper wemer of the xnlinghu pormtion @pthinD ylenekinD irly rissiA t wjiE sntrodution shn @wji rillAD ghohu gityD enhui rovineD outhest ghinF he new txon is ssigned to the order erleidiformes on the sis of he wellEknown rissi irly pish puns omintion of feturesX lrge wedgeElike preoperulum with expnded infroritl proess nd the sensory nl running lmost vertil long @ippD intori et lF PHIQA of wdgsrD qreenlndD the posterior mrgin of the preoperulum itselfY flnk sles somewht pitzergen nd est gnd @entunes et lF IWWHY vehE higher thn long in the trunk regionY presene of epxil rys in the mn IWSPY iveteu IWQRY heffer 8 wngus IWUTY udl finF emong erleidiformesD the new txon elongs to the erE tensio IWPID IWQPA re not younger thn the endE È leidideD eing very similr to erleidus in the generl ody shpeD mithinF hose ssemlges re omposed of primitive pttern of the skull onesD dentition mde of pegElike mrginl teethD nd numer of epxil rysF he new genus is hrterized y the neopterygins