Le Groupe De Bloomsbury
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AWAR of INDIVIDUALS: Bloomsbury Attitudes to the Great
2 Bloomsbury What were the anti-war feelings chiefly expressed outside ‘organised’ protest and not under political or religious banners – those attitudes which form the raison d’être for this study? As the Great War becomes more distant in time, certain actions and individuals become greyer and more obscure whilst others seem to become clearer and imbued with a dash of colour amid the sepia. One thinks particularly of the so-called Bloomsbury Group.1 Any overview of ‘alter- native’ attitudes to the war must consider the responses of Bloomsbury to the shadows of doubt and uncertainty thrown across page and canvas by the con- flict. Despite their notoriety, the reactions of the Bloomsbury individuals are important both in their own right and as a mirror to the similar reactions of obscurer individuals from differing circumstances and backgrounds. In the origins of Bloomsbury – well known as one of the foremost cultural groups of the late Victorian and Edwardian periods – is to be found the moral and aesthetic core for some of the most significant humanistic reactions to the war. The small circle of Cambridge undergraduates whose mutual appreciation of the thoughts and teachings of the academic and philosopher G.E. Moore led them to form lasting friendships, became the kernel of what would become labelled ‘the Bloomsbury Group’. It was, as one academic described, ‘a nucleus from which civilisation has spread outwards’.2 This rippling effect, though tem- porarily dammed by the keenly-felt constrictions of the war, would continue to flow outwards through the twentieth century, inspiring, as is well known, much analysis and interpretation along the way. -

Truly Miscellaneous Sssss
Provided by the author(s) and NUI Galway in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title Roger Fry and the art of the book: Celebrating the centenary of the Hogarth Press 1917-2017 Author(s) Byrne, Anne Publication Date 2018 Publication Byrne, Anne. (2018). Roger Fry and the Art of the Book: Information Celebrating the Centenary of the Hogarth Press 1917-2017. Virginia Woolf Miscellany, 92 (Winter/Fall), 25-29. Publisher International Virginia Woolf Society Link to https://virginiawoolfmiscellany.wordpress.com/virginia-woolf- publisher's miscellany-archive-issue-84-fall-2013-through-issue-92-fall- version 2017-winter-2018/ Item record http://hdl.handle.net/10379/15951 Downloaded 2021-09-25T22:35:05Z Some rights reserved. For more information, please see the item record link above. Space Consumes Me The hoop dancer dance...demonstrating how the people live in motion within the circling...spirals of time and space. They are no more limited than water and sky. Byrne, Anne. 2018. Roger Fry and the Paula Gunn Allen, The Sacred Hoop Truly Miscellaneous Art of the Book, Virginia Woolf Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged, life is a luminous halo sssss Miscellany, No 92, Winter/Spring a semi-transparent envelope surrounding us from the 2018, 25-29. beginning of consciousness to the end.” Virginia Woolf, “Modern Fiction” Roger Fry and the Art of the Book: Celebrating the Centenary of the Hogarth Press 1917-20171 The earliest SPACE WAS MOTHER Making an Impression I join the friendly, excited queue around the hand-operated press, Her womb a circle of all waiting in line for an opportunity to experience the act of inking the And entry as well, a circle haloed by freshly inked plate. -

Biographies and Autobiographies of Historians, Edited by Doug Munro and John G
7 Intersecting and Contrasting Lives: G.M. Trevelyan and Lytton Strachey Alastair MacLachlan This essay is about history and biography in two senses. First, it examines two parallel and intersecting, but contrasting lives: that of George Macaulay Trevelyan (b. 1876), probably the most popular historian and political biographer of early twentieth-century England – a Fellow and in old age the Master of Trinity College, Cambridge, an independent scholar for 25 years and, for 12 years, Regius Professor of Modern History – and that of his slightly younger Trinity protégé, Giles Lytton Strachey (b. 1880), a would-be academic rejected by the academy, who set himself up as a critical essayist and a historical gadfly – the writer credited with the transformation of a moribund genre of pious memorialisation into a ‘new’ style of biography. Second, the essay explores their approaches to writing nineteenth-century history and biography, and it assesses their works as products of similar but changing times and places: Cambridge and London from about 1900 to the 1930s.1 1 I shall therefore ignore Trevelyan’s later writings (he died in 1962), and concentrate on the biographies written by Strachey (S) and Trevelyan (T), with a focus on their nineteenth-century studies. 137 CLIO'S LIVES ‘Read no history’, advised Disraeli, ‘nothing but biography, for that is life without theory’. But ‘life without theory’ can be intellectually emaciated, and a comparative biography may have the advantage of kneading into the subject theoretical muscle sometimes absent in single lives, highlighting the points where the two lives intersected and what was common and what distinctive about them. -

Love Between the Lines: Paradigmatic Readings of the Relationship Between Dora Carrington and Lytton Strachey Janine Loedolff Th
Love Between The Lines: Paradigmatic Readings of the Relationship between Dora Carrington and Lytton Strachey Janine Loedolff Thesis presented in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts at the University of Stellenbosch Department of English Faculty of Arts and Social Sciences Supervisor: Dr S.C. Viljoen Co-supervisor: Prof. E.P.H. Hees November 2007 Declaration I, the undersigned, hereby declare that the work contained in this thesis is my own original work and has not previously in its entirety or in part been submitted at any university for a degree. Signature: Date: Copyright ©2008 Stellenbosch University All rights reserved ii Acknowledgements Dr Shaun Viljoen, for teaching me about uncommon lives; My co-supervisor, Prof. Edwin Hees; Mathilda Slabbert, for telling me the story for the first time, and for her inspirational enthusiasm; Roshan Cader, for her encouragement and willingness to debate the finer points of performativity with me; Sarah Duff, for continuously demanding clarity, and for allowing me to stay at Goodenough College; Dawid de Villers, for translations; Evelyn Wiehahn, Neil Micklewood, Daniela Marsicano, Simon Pequeno and Alexia Cox for their many years of love and friendship; Larry Ferguson, who always tells me I have something to say; My father, Johan, and his extended family, for their continual love and support and providing me with a comforting refuge; My family in England – Chicky for taking me to Charleston, and Melanie for making her home mine while I was researching at the British Library; and Joe Loedolff, for eternal optimism, words of wisdom, and most importantly, his kinship. -

A Clownfish Pastel on Buff Paper
Simon Bussy (Dole 1870 - London 1954) A Clownfish Pastel on buff paper. Signed with the artist’s monogram SB in black chalk. 211 x 290 mm. (8 1/4 x 11 3/8 in.) Simon Bussy’s pastels were widely admired by his contemporaries, and avidly collected by many. The poet Guillaume Apollinaire wrote of the artist that, ‘The pastels of Simon Bussy are delicate images, as precious as Persian miniatures. Precision and vitality are the characteristics of Simon Bussy’s talent, and his use of colour often reaches the heights of Matisse.’ For his drawings, Bussy invariably used a combination of French-made Roché pastels and buff paper produced by the firm of Cartridge in London. His animals are usually depicted against a toned background of one muted colour, with a reserve of white paper left untouched around the edges of the composition This study of a clownfish is a fine and typical example of Bussy’s refined, delicate pastel technique. As the contemporary scholar François Fosca noted, in one of the first monographs on the artist, ‘Simon Bussy developed a new style: with minute precision he applied a vaporous and blurred technique to drawing. In his work, there was never any hatching or vertical marks which would reduce the effect of the layer underneath, or make it stand out. Bussy developed a soft, velvety medium which always avoided becoming cloying or limp.’ Most of Simon Bussy’s pastel drawings of fish seem to have been made at the zoo at Vincennes, since he was unable to find adequate lighting at the London Zoo in order to make studies of fish there. -
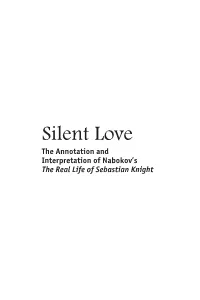
Silent Love the Annotation and Interpretation of Nabokov’S the Real Life of Sebastian Knight
Silent Love The Annotation and Interpretation of Nabokov’s The Real Life of Sebastian Knight Silent Love The Annotation and Interpretation of Nabokov’s The Real Life of Sebastian Knight GERARD DE VRIES Boston 2016 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: The bibliographic data for this title is available from the Library of Congress. © 2016 Academic Studies Press All rights reserved ISBN 978-1-61811-499-0 (cloth) ISBN 978-1-61811-500-3 (electronic) Book design by Kryon Publishing www.kryonpublishing.com On the cover: Portrait of R.S. Ernst, by Zinaida Serebriakova, 1921. Reproduced by permission of the Nizhnii Novgorod State Art Museum. Published by Academic Studies Press in 2016 28 Montfern Avenue Brighton, MA 02135, USA [email protected] www.academicstudiespress.com Effective December 12th, 2017, this book will be subject to a CC-BY-NC license. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Other than as provided by these licenses, no part of this book may be reproduced, transmitted, or displayed by any electronic or mechanical means without permission from the publisher or as permitted by law. The open access publication of this volume is made possible by: This open access publication is part of a project supported by The Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book initiative, which includes the open access release of several Academic Studies Press volumes. To view more titles available as free ebooks and to learn more about this project, please visit borderlinesfoundation.org/open. Published by Academic Studies Press 28 Montfern Avenue Brighton, MA 02135, USA [email protected] www.academicstudiespress.com For Wytske, Julian, Olivia, and Isabel. -

Abaa Virtual Boston Book Fair -- November 2020
Thomas A. Goldwasser Rare Books, Inc. 5 Third Street, Suite 530 San Francisco, CA 94103 t: (415) 292-4698 [email protected] ABAA VIRTUAL BOSTON BOOK FAIR -- NOVEMBER 2020 1. Ashbery, John. Not a First. Illustrated with three original drawings by $6,000 Jonathan Lasker. New York: Kaldeway Press, (1987). First edition. 18 pages, 17 inches x 11-1/2 inches, 30 x 45 cm. Printed in blue on "Poestenkill Leaves" paper made for this edition at the Kaldewey mill, bound by Christian Zwang, black paper over board, with relief impressions after Lasker's design on the sides. From a total edition of 55, this is one of 45 regular copies, signed on the colophon by Ashbery and Lasker, 10 "special" copies were made, and 10 "deluxe"are announced on the colophon but were never made (these were to have been bound by Jean de Gonet). Fine, in custom cloth case. The entire book evokes a sense of grayness, from the binding, to the drawings and lastly in the imagery produced by the poem itself. The stark imagery of Ashbery's poem is perfectly complemented by Lasker's original harsh black, white, and gray drawings. Volz 13 [32195] 2. Bibbs, Hart Leroy. Poly Rhythms to Freedom. Paris: Imprimerie Fact, [196-?]. Second $375 edition. 38 pp., 21 cm. Photo-mechanically reproduced sheets. Cover-title, stapled into printed plastic wrapper, crease in back cover, else fine. The first edition was published by Mac McNair, New York in 1964, the title was mis-spelled ("Rythms"); there was a second printing of this edition in 1967, with the title corrected. -

Mary Lago Collection Scope and Content Note
Special Collections 401 Ellis Library Columbia, MO 65201 (573) 882-0076 & Rare Books [email protected] University of Missouri Libraries http://library.missouri.edu/specialcollections/ Mary Lago Collection Scope and Content Note The massive correspondence of E. M. Forster, which Professor Lago gathered from archives all over the world, is one of the prominent features of the collection, with over 15,000 letters. It was assembled in preparation for an edition of selected letters that she edited in collaboration with P. N. Furbank, Forster’s authorized biographer. A similar archive of Forster letters has been deposited in King’s College. The collection also includes copies of the correspondence of William Rothenstein, Edward John Thompson, Max Beerbohm, Rabindranath Tagore, Edward Burne-Jones, D.S. MacColl, Christiana Herringham, and Arthur Henry Fox-Strangways. These materials were also gathered by her in preparation for subsequent books. In addition, the collection contains Lago’s extensive personal and professional correspondence, including correspondence with Buddhadeva Bose, Penelope Fitzgerald, P.N. Furbank, Dilys Hamlett, Krishna Kripalani, Celia Rooke, Stella Rhys, Satyajit Ray, Amitendranath Tagore, E.P. Thompson, Lance Thirkell, Pratima Tagore, John Rothenstein and his family, Eric and Nancy Crozier, Michael Holroyd, Margaret Drabble, Santha Rama Rau, Hsiao Ch’ien, Ted Uppmann, Edith Weiss-Mann, Arthur Mendel, Zia Moyheddin and numerous others. The collection is supplemented by extensive files related to each of her books, proof copies of these books, and files related to her academic career, honors, awards, and memorabilia. Personal material includes her journals and diaries that depict the tenuous position of a woman in the male-dominated profession of the early seventies. -

Mahmoud Mouktar.Pdf
Mahmoud Mouktar (1891-1934) Entre pharaonisme et Art déco Centre culturel du livre Édition / Distribution 6, rue du Tigre. Casablanca Tél : +212522810406 Fax : +212522810407 [email protected] Première édition 2020 Dépôt légal: 2020MO0000 ISBN: 978-9920-627-00-0 Mahmoud Mouktar (1891-1934) Entre pharaonisme et Art déco Mario CHOUEIRY Mario Choueiry 5 SOMMAIRE Introduction .............................................................................. 9 Avertissement ......................................................................... 11 Préface de Bruno Gaudichon .................................................. 12 Mahmoud Mouktar : les sources biographiques disponibles............. 17 L’enfance et la jeunesse de Mahmoud Mouktar en Égypte............. 19 L’ouverture en 1908 de l’École des beaux-arts du Caire ............ 22 Mahmoud Mouktar étudiant à l’École des beaux-arts du Caire ........................................................................... 31 L’attrait de Paris et de son École des beaux-arts sur fond de rupture des avant-gardes.................................................. 38 Les années d’études parisiennes de Mahmoud Mouktar.............. 45 Un artiste égyptien face à la tourmente de 14-18.................... 51 Mouktar directeur des ateliers du musée Grévin, le Paris des années folles et des amitiés françaises conservatrices...... 53 Une voie artistique médiane ................................................... 58 Le retour en Égypte et la fondation de la Chimère ................. 64 L’apparition inédite -

Olivia from Bloomsbury to The
OLIVIAFROM BLOOMSBURY TO THENRF Marie-Claire Hamard Unrversité de Franche-Comté Dorothy Bussy, the author of Olivia, an autobiographical novel published in 1949 when she was in her eighties, has had an interesting destiny which illustrates many of the subtle diíñculties encountered by an inteliigent woman born in the Mid-Victorian period. She can be defined briefly as the daughter of Sir Richard Strachey, a general and scientist with great responsibilities in Rritish India until 1871, as an elder sister of Lytton Strachey the writer, and James Strachey the translator of Freud, as the wife of Simon Bussy, a @ed but neglected French painter, and as the translator and close friend of the French novelist André Gide. Thus her career can be seen as subordinate to the careen of the men around her. By the same standards, she could be considered to have had a very full life, firsí in London at Lancaster Gate, as a member of a remakbly inte1lectua.I family, then after 1903 at Roquebmne on the French Riviera among artists. She had a daughter, Janie, born in 1905, who was a constant joy, and her fhendship with Gide, stwck in 1918, introduced her into the world of the Nouvelle Revue Fran~aise.She, for her part, introduced her French friends to the artistic and intellectuai coterie of Bloomsbury. She played the part of an intermediary, passing every year fiom Roquebrune to London via Paris; she played it in print as Gide's main translator and also in her many letteis. Her correspondence with Gide has been published in full by the NRF and a selection by Odord University Press Gambert 1979; Tedeschi 1983), it is interesting to see in those letters the European network of inteliectuai relations to whom this woman without a 'salon' effectively belonged. -

Silence Us Again. Nancy Manahan Napa College
Barbara Grier sets before us our entire literary heritage. Through her work we become visible to ourselves. This new expanded edition of The Lesbian in Literature is a must for the general reader as well as the serious collector. Here we meet all our ancestors and learn what they meant to their worlds and what they mean to our own. My own personal excitement about this book is beyond words. Jenny Feder Three Lives & Company, Ltd. Beginning with the first edition, The Lesbian in Literature has been a life line, helping me move from isolation and fear into a community of my Lesbian sisters and foremothers. It combats If the erasure of our past. It proclaims we have existed, we have struggled, we have loved, we have written. These affirmations are crucial at a time when patriarchal forces are mobilizing to silence us again. Nancy Manahan Napa College For ten years, The Lesbian in Literature bibliography has been my bible, almanac, and encyclopedia all rolled in one. Opening its pages is like opening a casket of jewels. May generations of Lesbians continue to be enriched and empowered by this wonderful work. Bonnie Zimmerman San Diego State University THE LESBIAN IN LITERATURE . , ,I, '." !' I ,r •• ."•• W< ',', ",,"po .", . THE LESBIANIN LITERATURE BARBARA GRIER the ~d -~lili / inc. 1981 THIS BOOK IS DEDICATED TO DONNA J. McBRIDE Copyright © 198 l by Barbara Grier All rights reserved. No part of Ibis book-may be reproduced or transmitted in ani'form or'by any"means,electronic or mechanical, including photocopying; without permission in writing from the publisher. -

Modern British, Irish and East Anglian
MODERN BRITISH, IRISH AND EAST ANGLIAN ART Tuesday 18 November 2014 Knightsbridge, London MODERN BRITISH, I RISH AND E AST A NGLIAN A RT | Knightsbridge, London | Tuesday 18 November 2014 18 November 2014 | Knightsbridge, London Tuesday 21719 MODERN BRITISH, IRISH AND EAST ANGLIAN ART Tuesday 18 November 2014 at 2pm Knightsbridge VIEWINGS BIDS ENQUIRIES Please see page 2 for bidder +44 (0) 20 7447 7448 Emma Corke information including after-sale EAST ANGLIAN PICTURES +44 (0) 20 7447 7401 fax +44 (0) 20 7393 3949 collection and shipment ONLY To bid via the internet please visit [email protected] www.bonhams.com Please see back of catalogue The Guildhall Shayn Speed for important notice to bidders Guildhall Street Please note that bids should be +44 (0) 20 7393 3909 Bury St Edmunds submitted no later than 24 hours [email protected] ILLUSTRATION Suffolk IP33 1PS before the sale. Front cover : Lot 29 East Anglian Art Back cover: Lot 176 Thursday 6 November New bidders must also provide Daniel Wright Inside front: Lot 18 9am to 7pm proof of identity when submitting +44 (0) 1284 716 195 Inside back: Lot 134 Friday 7 November bids. Failure to do this may result [email protected] 9am to 4pm in your bids not being processed. IMPORTANT INFORMATION CUSTOMER SERVICES The United States Government St Michael’s Hall; Bidding by telephone will only be Monday to Friday 8.30am to 6pm has banned the import of ivory Church Street accepted on a lot with a lower +44 (0) 20 7447 7447 into the USA.