En Déchiffrant Les Anciens Manuscrits, En Soulevant La Poussière Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Etude D'impact Sur L'environnement
4.5.1.4 Particularités du bruit des éoliennes 4.5.2.3 Données acoustiques Les éoliennes sont assimilées à des sources sonores ponctuelles localisées au niveau de la nacelle. On Les mesures de bruit sont réalisées conformément aux normes NFS 31-110 et NFS 31-114. Les appareils retient généralement les trois phases de fonctionnement suivantes pour définir les différentes sources utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de classe 1. de bruit issues d’une éolienne : Dans la mesure du possible, les microphones ont donc été positionnés à l’abri : - À des vitesses de vent inférieures à environ 4 m/s, la puissance acoustique de l'éolienne est très - du vent de façon à ce que la vitesse au micro ne dépasse pas 5 m/s conformément a la norme faible. Le bruit provient des équipements électriques et de ventilation. NFS 31-114. Pour cela un anémomètre a été place à côté d'un sonomètre sur un mât de 2 m - À partir d’une vitesse d'environ 4 m/s, l'éolienne se met en fonctionnement. La puissance (point R6- la Ville Morin à Plumieux). acoustique augmente avec la vitesse du vent. Le bruit est compose essentiellement du bruit - de la pluie ; les microphones ont été protégés par des boules anti-intempéries aérodynamique du frottement des pales dans l'air ainsi que des bruits mécaniques. - Au-delà de 7 à 8 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une puissance acoustique - de la végétation qui génère un bruit variable selon les saisons constante. - des routes dont le trafic peut engendrer un bruit irrégulier. -

Direction Des Services Départementaux De L'éducation
Ste-Brigitte St-Aignan Gourin Langonnet Plouray Roudouallec Silfiac Kergrist Cléguérec Croixanvec Le Saint Langoëlan St-Gonnery St-Tugdual Ploerdut Séglien Neuillac St-Gérand Ménéac Le Gueltas Brignac Faouët Le Croisty Guémené/Scorff Rohan Guiscriff Priziac Pontivy La Trinité Porhoët Locmalo Evriguet St-Brieuc St-Caradec Malguénac Noyal-Pontivy de Mauron St-Léry Trégomel Lignol Bréhan Guern Le Sourn Kerfourn Mohon Mauron Lanvénégen Kernascléden Persquen Crédin Guilliers Concoret Meslan St Thuriau Les Forges Bieuzy Berné St-Malo des Les Eaux Naizin Trois Fontaines Néant/Yvel Bubry Moustoir Pleugriffet La Grée Melrand Réguiny St-Laurent Inguiniel Remungol Lannoué Tréhorenteuc Pluméliau Loyat La Croix Hélléan Plouay Radenac Hélléan Lantillac Taupont St-Barthélèmy Josselin Campénéac Beignon Moréac St-Malo de Beignon Lanvaudan Quistinic Remungol Guégon Buléon Guillac Gourhel Calan Guénin St-Allouestre St-Servant Cléguer Baud Plumelin Guéhenno Ploërmel Augan Porcaro Pont- sur Oust Locminé Bignan Montertelot Guer Scorff Inzinzac Quily La Chapelle Neuve Billio Cruguel Monterrein Languidic Le Roc La Chapelle Lizio St-AndréCaro Monteneuf Caudan Camors Moustoir-Ac Caro Gestel Hennebont St-Jean Réminiac Guidel St-Abraham Brandérion Brévelay Quéven Colpo Plumelec Sérent St-Marcel Missiriac Ruffiac Tréal Quelneuc Lanester Brandivy Malestroit Carentoir Kervignac Pluvigner Lorient Nostang Landévant GrandchampLocqueltas St-Laurent Plaudren Trédion Bohal sur Oust St-Nicolas Ploëmeur Merlevenez St-Guyomard St-Congard du Tertre La Chapelle Locmiquélic Landaul -

Service Hydraulique an II-1953
Service archives Service hydraulique an II-1953 Répertoire numérique détaillé 7 S 1-1820 par Danielle Pellerin ; sous la direction de Florent Lenègre Vannes 2013 7 S Service hydraulique 2 Identification Référence de l'inventaire FRAD056_00000007S Référence service d'archives Archives départementales du Morbihan Intitulé Service hydraulique Cotes extrêmes 7 S 1-1820 Dates extrêmes an II-1953 Niveau de description Fonds Nombre d'éléments 1 820 articles Métrage 27,7 m.l. Resp. accès intellectuel Archives départementales du Morbihan Contexte Nom du producteur Préfecture du Morbihan Ponts et Chaussées Catégorie producteur administration Présentation du producteur La sous-série 7 S regroupe les dossiers concernant la gestion des eaux non navigables, non flottables. Les archives rassemblées dans cette sous-série sont issues pour partie des services de la préfecture et pour partie du service hydraulique créé en 1848, agissant pour le compte du ministère de l'Agriculture et placé sous l'autorité des services des Ponts et Chaussées. PRÉFECTURE Le rôle du service hydraulique est essentiellement administratif : suivi et contrôle des dossiers d'aménagements et de travaux, vérification des budgets, comptes administratifs et comptes de gestion des associations syndicales. Le rôle du préfet est en effet de vérifier et d'approuver les différents projets soumis par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ou par les différents directeurs des associations syndicales autorisées. Après la Révolution, des particuliers érigent de nouveaux moulins et réclament des droits sur l'eau. Le principe retenu est que l'eau n'appartient à personne mais est d'usage commun. Les lois de 1790 et 1791 donnent pouvoir à l'administration de régler les problèmes. -

Qj749a2vnjymi6.Pdf
couverture LOYAT_Mise en page 1 06/02/17 11:02 Page1 CALENDRIER des festivités JANVIER 8 Vœux du Maire FéVRIER 4 UNC/AFN Assemblée générale 18 GDY Repas MARS 4 Comité de Jumelage Théâtre 11 Ecole Ste Jeanne d'Arc Repas couscous 12 Société de chasse Repas 19 Club des Sorciers Repas AVRIL 2 VTT LOYAT Randonnée VTT et pédestre 23 Elections présidentielles (1er tour) MAI 7 Elections présidentielles (2è tour) 9 Commune Cérémonie commémorative suivie du verre de l'amitié JUIN 4 Ecole Ste Jeanne d'Arc Vide grenier 11 Elections législatives (1er tour) 18 Elections législatives (2è tour) 24 Les Amis de Théodore Botrel Fête de l'école JUILLET 1 Ecole Ste Jeanne d'Arc Fête de l'école 23 Chapelle et four de Trégadoret Pardon AOÛT 26 Associations sportives Journée sport et découverte 27 Association Chapelle de Crétudel Pardon de Crétudel OCTOBRE 7 Pastourelle Fest-noz 28 Comité de Jumelage Cabaret (animé par le célèbre sosie de Coluche) NOVEMBRE 11 Commune Cérémonie commémorative suivie du verre de l'amitié 18 Ecole Ste Jeanne d'Arc Raclette 26 Paroisse Repas DéCEMBRE 3 (à confirmer) CCAS Repas 16 Ecole Théodore Botrel Marché de Noël et Arbre de Noël 22 Ecole Ste Jeanne d'Arc Arbre de Noël couverture LOYAT_Mise en page 1 06/02/17 11:02 Page2 Annuaire des associations Vœux du Maire NOM ACTIVITé PRéSIDENT-ADRESSE AFN Association des anciens combattants CHEREL Marcel d'Afrique du Nord 3 rue du Stade - 56800 LOYAT Au nom de toute l’équipe municipale, permettez-moi Amis Théodore Botrel Asso école publique RICHARD PARPAILLON Hélène de présenter à chacune, à chacun d’entre vous, St Vily - 56800 LOYAT ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets APEL Suivi des activités de l'école BONNARD Jérôme tant personnels que professionnels. -

Accueils De Loisirs 3/17 Ans
Ploërmel Communauté ACCUEILS DE LOISIRS 3/17 ANS Campénéac, Gourhel, Josselin, La Trinité-Porhoët, Loyat, Mauron 3/11 ans et 9/15 ans, Ploërmel 3/5 ans, 6/9 ans et 9/15 ans Voici le second numéro de notre lettre d’information. Consacrée aux accueils de loisirs, elle consultable sur notre site internet : www.ploermelcommunaute.bzh, rubrique au quotidien / enfance-éducation / accueil de loisirs. Bonne lecture ! COÛT D’UNE JOURNEE A L’ACCUEIL DE LOISIRS Le coût d’une journée à l’accueil de loisirs en 2019 était de 38€ par enfant. DATES À RETENIR Répartition des dépenses Répartition des recettes Inscriptions séjours : Ouverture des inscriptions le mercredi 26 mai pour les enfants fréquentant l’accueil de loisirs depuis septembre et le lundi 31 mai pour « tous ». Inscriptions vacances d’été : Ouverture des inscriptions du lundi 7 juin jusqu’au jeudi 1er juillet 2021 Jours d’inscriptions : les lundis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, les mercredis de 14h à 18h30 VACANCES D’ETE : ACCUEIL MINIMUM La commission enfance/jeunesse a validé le principe de 2 jours de présence minimum par semaine (au lieu de 3) pendant les vacances d’été. REVISION DES TARIFS A COMPTER DU 7 JUILLET 2021 Suite à la révision du prix plancher journée en 2020 du fait de la suppression des bons CAF, les montants des prix plancher demi-journée avec repas, forfait semaine, Journée camp T1 et T2 ainsi que le coefficient journée camp T1 ont été modifiés. Prix plancher Prix plafond Coefficient Majoration hors CC Journée complète 6,50€ 15,50€ 1,10% 3,00€ ½ journée avec repas 6,00€ / 5,50€ 12,00€ 0,80% 3,00€ ½ journée sans repas 4,50€ 9,00€ 0,55% 2,00€ Forfait semaine 34,00€ / 29,00€ 70,00€ 1,00% 15,00€ Journée camp T1 23,00€ / 20,00€ 40,00€ 2,80% / 2,60% 7,00€ Journée camp T2 30,00€ / 27,00€ 52,00€ 3,60% 7,00€ Majoration sortie / spectacle 2,00€ L’ACTUALITÉ DE VOTRE ACCUEIL DE LOISIRS – LA TRINITE-PORHOËT 3/11 ANS Le sport autrement Dans le cadre des jeux olympiques organisés en France en 2024, Ploërmel Communauté a obtenu le Label « Terre de Jeux 2024 ». -

PREFECTURE DU MORBIHAN LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES HABILITES Mise À Jour Le 15 Février 2018
PREFECTURE DU MORBIHAN LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES HABILITES mise à jour le 15 février 2018 Code N° de Arrondis- COMMUNE NOM - PRENOM ADRESSE ACTIVITES * Postal TELEPHONE sement 56350 ALLAIRE Ambulances SARL Louis BLOYET Route de Vannes 02.99.71.94.55 VANNES 1-2-3-5-6-7-8 56350 ALLAIRE P.F. Christian LECLEVE Le Vau de Pierre 02.99.71.40.80 VANNES 2-3-5 Marbrerie Funéraire 56350 ALLAIRE Zone de Ste Anne 02.99.71.97.20 VANNES 8 DANO - ALLARD 56610 ARRADON Mme ou M. le Maire Mairie 02.97.44.01.56 VANNES 8 56640 ARZON Mme ou M. le Maire Mairie 02.97.53.44.60 VANNES 8 56640 ARZON Pompes Funèbres de Rhuys Chemin du Goh Velenec 02.97.41.36.14 VANNES 1-2-3-5-6-7-8 56800 AUGAN Mme ou M. le Maire Mairie 02.97.93.45.06 VANNES 8 56800 AUGAN P.F. Eugène COLIN La Ville Saloux 02.97.93.43.02 VANNES 5 Pompes Funèbres EVANNO 38-40 rue Abbé Philippe Le 56400 AURAY 02.97.56.40.77 LORIENT 1-2-3-5-6-7-8 (établissement secondaire OGF) Gall 56400 AURAY Mme ou M. le Maire 100 place de la République 02.97.24.01.23 LORIENT 8 56400 AURAY LE QUENTREC Franck 14 Rue du Drezen 06.14.24.85.61 LORIENT 4 - TH P.F.G Pompes Funèbres Générales 56400 AURAY 22, avenue Kerroux 02.97.56.29.24 LORIENT 1-2-3-5-6-7-8 (établissement secondaire OGF) SARL ASsistance Funéraire 6, rue Georges Guynemer 56400 AURAY 02.97.24.14.40 LORIENT 1-2-3-5-6-7-8 MARGELY Z.A.de Toul Garros SARL ASsistance Funéraire 56400 AURAY 38 avenue Foch 02.97.24.14.40 LORIENT 3 MARGELY Angle de l’avenue du Maréchal 56400 AURAY FUNECAP OUEST ROC ECLERC Foch 02.97.52.00.33 LORIENT 1-2-3-4-5-7-8 et de la rue Louis Billet 56550 BELZ SARL Pompes Funèbres de la R.I.A. -

Conseillers Communautaires
Nombre Commune Titre Prénom Nom Fonction commune de sièges BRIGNAC 1 Monsieur Martial LE BRETON Maire de Brignac Madame Hania RENAUDIE Maire de Campénéac CAMPÉNÉAC 2 Monsieur Bruno GABARD 1er adjoint CONCORET 1 Monsieur Ronan COIGNARD Maire de Concoret CRUGUEL 1 Monsieur Fabrice CARO 1er adjoint ÉVRIGUET 1 Madame Sophie COUTANT Maire de Évriguet Monsieur Jacques BIHOUÉE Maire de Forges de Lanouée FORGES DE LANOUÉE 3 Madame Edwige MESSAGER 3ème adjointe Monsieur André BRIEND Conseiller municipal GOURHEL 1 Monsieur Kévin ARGENTIN Maire de Gourhel Madame Marie-Noëlle AMIOT Maire de Guégon GUÉGON 3 Monsieur Jean-Paul CARAFRAY Conseiller municipal délégué Monsieur Jean-Marc DUBOT Conseiller municipal GUILLAC 1 Monsieur Stéphane ROUAULT Maire de Guillac GUILLIERS 1 Monsieur Joël LEMAZURIER Maire de Guilliers HELLÉAN 1 Madame Maryvonne GUILLEMAUD Maire de Helléan Monsieur Nicolas JAGOUDET Maire de Josselin JOSSELIN 3 Madame Fanny LARMET 1ère adjointe Monsieur Hervé LE COQ Conseiller municipal LA CROIX-HELLÉAN 1 Monsieur Jean-Yves JOSSE Maire de La Croix-Helléan LA GRÉE-SAINT-LAURENT 1 Monsieur André JOSSE Maire de La Grée-Saint-Laurent LA TRINITÉ-PORHOËT 1 Monsieur Michel PHILIPPE Maire de La Trinité-Porhoët LANTILLAC 1 Monsieur Michel BERTHO Maire de Lantillac Monsieur Denis TRÉHOREL Maire de Loyat LOYAT 2 Madame Danielle GUILLAUME 4ème adjointe Monsieur Yves CHASLES Maire de Mauron Madame Anne VACHON 1ère adjointe MAURON 4 MAURON 4 Monsieur Gérard REYNAUD 2ème adjoint Madame Fabienne BRIERO Conseillère municipale Monsieur Michel PICHARD Maire -

Bretagne - Morbihan • Saint-Aignan Gourin • • Saint-Gonnery Neulliac • • Ménéac Morbihan • Rohan Le Faouët • • Lignol Pontivy • • Noyal-Pontivy
Bretagne - Morbihan • Saint-Aignan Gourin • • Saint-Gonnery Neulliac • • Ménéac Morbihan • Rohan Le Faouët • • Lignol Pontivy • • Noyal-Pontivy • Pluméliau-Bieuzy Melrand • • Saint Thuriau • Josselin • Loyat • Campénéac • Baud • Bignan • Ploërmel • Inzinzac-Lochrist • Guer Guidel • • Hennebont • Plumelec • Monteneuf • Quéven • Sérent • Réminiac Lanester • Malestroit • • Ploemeur Lorient • Port-Louis • Landévant Brandivy • • • Grand-Champ • La Gacilly • Pluvigner • Locmaria-Grand-Champ Les Fougerêts • • Locoal-Mendon • Brech • Monterblanc Peillac • Sainte-Anne-d'Auray • Saint-Avé • • Saint-Nolff • Rochefort-en-Terre La Vraie-Croix Auray • • Ploeren• Vannes • • Séné • Sulniac • Questembert Carnac • • Baden• Île-d'Arz • Berric Locmariaquer • île- Ilur • Caden Saint-Pierre-Quiberon • Sarzeau • Le Guerno • • Péaule Ambon • • Saint-Dolay • Quiberon Arzal • La Roche- • Nivillac Bernard • JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 – BRETAGNE / MORBIHAN* Détails sur le site programme : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ AMBON LE FAOUËT PLUVIGNER ARZAL LE GUERNO PONTIVY AURAY LES FOUGERETS PORT-LOUIS BADEN LIGNOL QUESTEMBERT BAUD LOCMARIA-GRAND- QUEVEN BERRIC CHAMP QUIBERON BIGNAN LOCMARIAQUER REMINIAC BRANDIVY LOCOAL-MENDON ROCHEFORT-EN-TERRE BREC’H LORIENT ROHAN CADEN LOYAT ROHAN , SAINT-GOUVRY CAMPENEAC MALESTROIT SAINT THURIAU CARNAC MELRAND SAINT-AIGNAN GOURIN MENEAC SAINT-AVE GRAND-CHAMP MONTENEUF SAINT-DOLAY GUER MONTERBLANC SAINTE-ANNE-D'AURAY GUIDEL NEULLIAC SAINT-GONNERY HENNEBONT NIVILLAC SAINT-NOLFF ÎLE D'ILUR * ÎLE-D'ARZ NOYAL-PONTIVY -

Bassin Scolaire De Guer OBC201- Vers Guer TRANSPORTEUR: LINEVIA Du Lundi Au Vendredi GUER - MONTENEUF
Bassin scolaire de Guer OBC201- Vers Guer TRANSPORTEUR: LINEVIA Du lundi au Vendredi GUER - MONTENEUF Commune Arrêt Horaire GUER ST NICOLAS INTER LA CORNAIS 08:19 GUER LE CHOISEUL INTER LA CORNAIS 08:21 MONTENEUF SAINT MEEN 2 CARR CENTRE VILLAGE 08:23 GUER LARMELAIS 1 - VERS LA TELHAIE 08:28 GUER LA CROIX PAYEN 1 CARR D773 VERS GUE 08:31 GUER LA HUAIS DE BAS INTER D773 08:32 GUER LES MOUTIERS 1 INTER D773 VERS GUER 08:35 GUER COLLEGE ST MAURICE 08:37 Dépose des écoliers au collège sauf mecredi, prise en charge par les ATSEM Lundi - Mardi- Jeudi- Vendredi GUER Commune Arrêt Horaire GUER COLLEGE ST MAURICE 17:25 GUER LES MOUTIERS 2 INTER D773 VERS CARE 17:29 GUER ST NICOLAS INTER LA CORNAIS 17:30 GUER LE CHOISEUL INTER VERS ST MEEN 17:31 GUER LA TELHAIE EGLISE 17:33 GUER LARMELAIS 2 - VERS LA LANDRIAIS 17:34 GUER LA LANDRIAIS INTER TRELO 17:38 GUER LA CROIX PAYEN 1CARR D173 VERS GUE 17:42 GUER LA HUAIS DE BAS INTER D773 17:44 Correspondance OBS814 à COLLEGE ST MAURICE Mercredi GUER - MONTENEUF Commune Arrêt Horaire GUER COLLEGE ST MAURICE 12:30 GUER LES MOUTIERS 2 INTER D773 VERS CARE 12:36 GUER ST NICOLAS INTER LA CORNAIS 12:38 GUER LE CHOISEUL INTER VERS ST NICOLAS 12:40 MONTENEUF ST MEEN 2 CARR CENTRE VILLAGE 12:44 GUER LA CROIX PAYEN 3 INTER PAINGRAIN 12:49 GUER LA HUAIS DE BAS INTER D773 12:51 OBC202 - Vers Guer TRANSPORTEUR: LINEVIA Du lundi au Vendredi MONTENEUF - GUER Commune Arrêt Horaire MONTENEUF LE PETIT MOULIN 1 VERS MONTENEUF 08:22 MONTENEUF ETANG 1 RUE ST MICHEL VERS REMINIAC 08:24 MONTENEUF LA BOISSIERE BOQUIDEE 08:28 MONTENEUF -
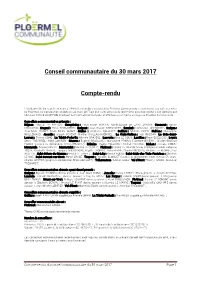
Conseil Communautaire Du 30 Mars 2017 Compte-Rendu
Conseil communautaire du 30 mars 2017 Compte-rendu L’an deux mille dix-sept, le 30 mars à 19H00, les membres du conseil de Ploërmel Communauté se sont réunis à la salle des fêtes de Ploërmel, sur convocation en date du 24 mars 2017 qui leur a été adressée le jour même par envoi postal à leur domicile par Monsieur Patrick LE DIFFON, Président de Ploërmel Communauté, et affichée le jour même au siège de Ploërmel Communauté. Conseillers communautaires présents : Brignac : Martial LE BRETON ; Campénéac : Louis-Marie MARTIN, Marie-Claude de SAINT-SERNIN ; Concoret : Ronan COIGNARD ; Cruguel : Henri RIBOUCHON ; Evriguet : Jean-Claude CORVAISIER ; Gourhel : Dominique DELOURME ; Guégon : Jean-Marc DUBOT, Marie-Noëlle AMIOT ; Guillac : Stéphane ROUAULT ; Guilliers : Michèle URIEN ; Helléan : Maryvonne GUILLEMAUD ; Josselin : Joseph SEVENO, Martine GUILLAS-GUÉRINEL ; La Croix-Helléan : Joël GUEGAN ; La Grée-Saint- Laurent : Thierry CONQ ; La Trinité-Porhoët : Michèle BRAJEUL ; Lanouée : Guy LE BOLU ; Lantillac : René QUELLEUC ; Loyat : Denis TREHOREL ; Odile SANTIER ; Mauron : Eugène GRASLAND ; Maryvonne PRIOUX, Fabienne BRIERO ; Charles-Edouard FICHET (jusqu’à la délibération N°CC-066/2017) : Ménéac : Yvette FOLLIARD ; Michel PICHARD ; Mohon : Josiane DENIS ; Monterrein : Marcel BENOIT ; Montertelot : Martine LE GUILLY ; Ploërmel : Patrick LE DIFFON, Marie-Thérèse FEVRIER, Fabienne JOSSE, Elisabeth DERVAL, Jacques MIKUSINSKI, Brigitte THOMAS, Alain HERVE, Chantal NICOLAS, Béatrice LE MARRE, Paul ANSELIN ; Saint-Brieuc-de-Mauron : Annick LE TARNEC -

CM+DU+22+FEVRIER+2019+.Pdf
COMMUNE DE MOHON- séance du 22.02. 2019 feuillet N° 1 COMMUNE DE MOHON EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2019 L’an deux mille dix-neuf, le 22 février à 20 heures 00, les membres du Conseil Municipal de MOHON se sont réunis à la salle de la mairie sur convocation en date du 13 février 2019 qui leur a été adressée par le Maire de la Commune de MOHON, Madame DENIS Josiane et affichée le 13 février 2019 à la Mairie de MOHON. PRENOM NOM FONCTION Présents Absents ayant donné Absents Secrétaire de pouvoir séance DENIS Josiane Maire X LE RAT Martine Adjointe X BLANDEL Alain Adjoint X CARO Jean-François Adjoint Pouvoir à Mme LE RAT Martine BOUTE Jean-Louis CM X X LE QUEUX Pascal CM X VANDEKERKOVE Marie-Véronique CM X LALYCAN Claudine CM Pouvoir à Mr GUILLEMAUD Marc GUILLEMAUD Marc CM X PRESSARD Hervé CM X CLERO Jean-Michel CM Pouvoir à Mr LE QUEUX Pascal MOREL Hervé CM X COLLAS Marc CM X HOUEIX Ludovic CM X TOTAL 14 09 03 02 Membres en exercice Membres présents Membres Suffrages exprimés donnant pouvoir 14 09 03 12 COMMUNE DE MOHON- séance du 22.02.2019 feuillet N° 2 Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal nomme Monsieur BOUTE Jean-Louis pour remplir les fonctions de secrétaire de séance et y adjoint Mme AUQUET Isabelle, Directrice Générale des Services en qualité de secrétaire assistante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2018 Mme le Maire demande s’il y a des remarques à formuler au procès-verbal de la séance du 30 novembre 2018. -

Obshab Fiche Loyers Ploermel Communaute 2018.Pdf
OBSERVATOIRE Agence Départementale d’Information sur le Logement DE L’HABITAT du Morbihan Grille de référence indicative des Loyers du Parc Privé 2018 PLOËRMEL COMMUNAUTÉ Niveaux de loyers hors charge au 1er janvier 2018 RÉALISATION Observatoire des loyers - ADIL 56 DATE DE PUBLICATION janvier 2019 CONTACT www.adil56.org - 02 97 47 68 91 Fiche loyers - ADIL 56 2018 PLOËRMEL APPARTEMENTS 1 pièce 2 pièces 3 pièces Indicateur de fiabilité Fourchette basse 242 € 335 € 400 € Loyer médian 255 € 360 € 420 € Fourchette haute 280 € 374 € 453 € Prix/m² médian 10,7 € 8,8 € 7,1 € Surface médiane 25 m² 41 m² 60 m² MAISONS 3 pièces 4 pièces 5 pièces Indicateur de fiabilité Fourchette basse 440 € 553 € 651 € Loyer médian 484 € 609 € 687 € Fourchette haute 520 € 650 € 700 € Prix/m² médian 7,4 € 6,6 € 6,3 € Surface médiane 65 m² 91 m² 105 m² PLOËRMEL COMMUNAUTÉ* (Hors Ploërmel) MAISONS 3 pièces 4 pièces 5 pièces Indicateur de fiabilité Fourchette basse 387 € 465 € 457 € Loyer médian 410 € 522 € 576 € Fourchette haute 466 € 563 € 620 € Prix/m² médian 5,7 € 5,2 € 5,9 € Surface médiane 73 m² 95 m² 105 m² * Brignac, Campénéac, Concoret, Cruguel, Évriguet, Gourhel, Guégon, Guillac, Guilliers, Helléan, Josselin, La Croix-Helléan, La Grée-Saint-Laurent, La Trinité-Porhoët, Lanouée, Lantillac, Les Forges, Loyat, Mauron, Ménéac, Mohon, Monterrein, Montertelot, Néant-sur-Yvel, Saint-Brieuc-des-Trois-Fontaines, Saint-Servant, Taupont, Tréhorenteuc, Val d’Oust Indicateur de fiabilité(nombre de références par typologie) 10 - 20 enquêtes 20 - 50 enquêtes > 50 enquêtes Fiche loyers - ADIL 56 2018 FICHE PRATIQUE : RÉVISION DE LOYER Comment établir ou réviser le Dans ce cas, le bailleur notifie au locataire, au montant d’un loyer du secteur moins six mois avant le terme du contrat, une proposition de renouvellement assortie d’un privé ? nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage Pour établir et réévaluer le loyer d’un logement pour des logements comparables.