Prefecture De L'oise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
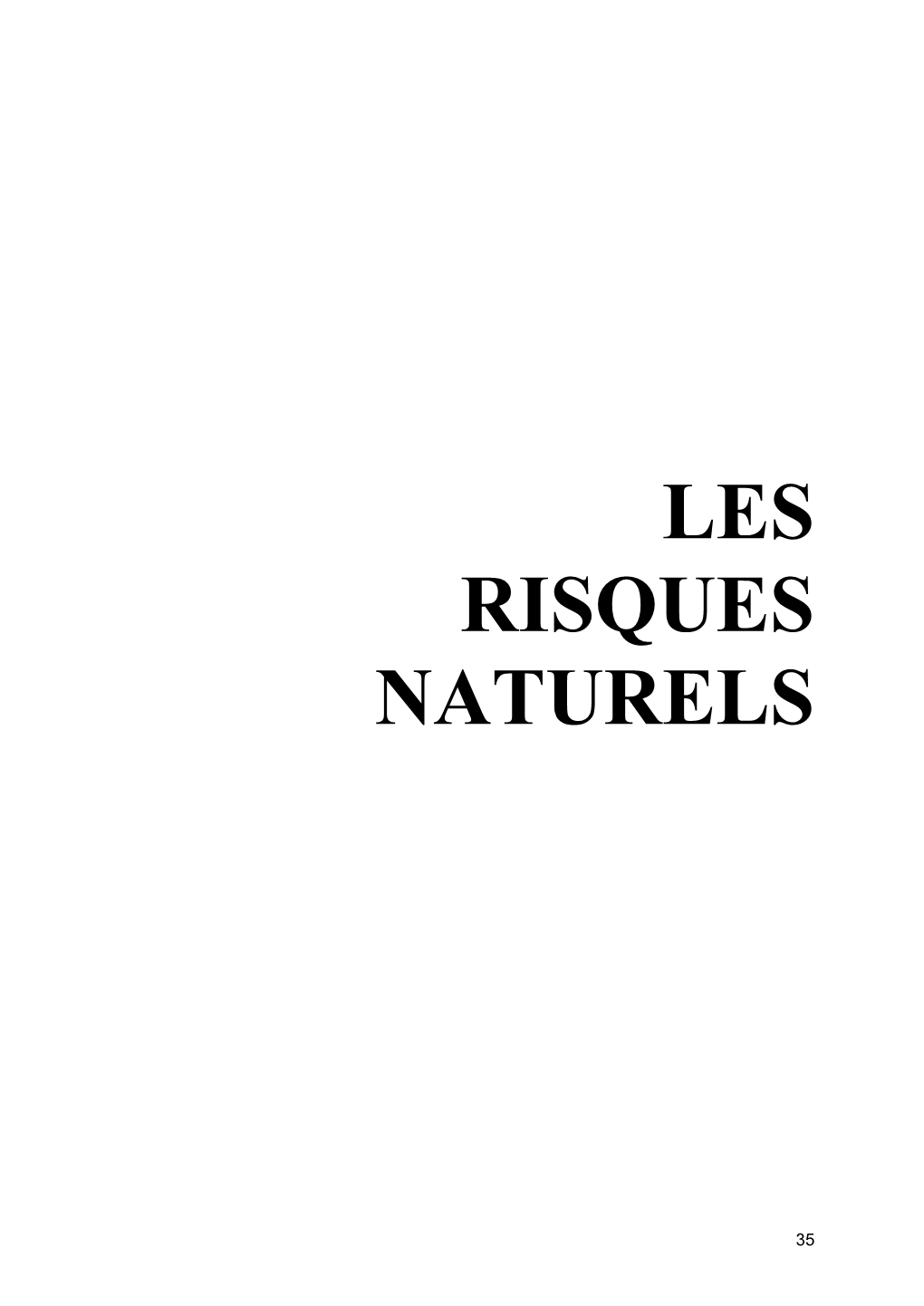
Load more
Recommended publications
-

16 Listecce-Beauvais.Pdf
COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT AÉRODROME DE BEAUVAIS-TILLÉ Mise à jour : 11 juin 2013 COLLÈGE DES PROFESSIONS AÉRONAUTIQUES PERSONNEL DE L'AÉRODROME Aéroport de Beauvais 1 M. Jean-Claude VIDAL Délégué CFE-CGC 60000 TILLÉ Titulaire Aéroport de Beauvais 2 Mme Shafika BOULARES Déléguée CGT 60000 TILLÉ Titulaire 73 rue Louis Barthou 60260 LAMORLAYE Aéroport de Beauvais 3 M. Olivier BOIS Délégué CFDT 60000 TILLÉ Titulaire Aéroport de Beauvais 4 M. Frédéric MARTENS Délégué SNCTA 60000 TILLÉ Titulaire Aéroport de Beauvais 5 M. Fabien GRAU Délégué CFE CGC 60000 TILLÉ Suppléant Aéroport de Beauvais 6 M. Rafik SENOUCI Délégué CGT 60000 TILLÉ Suppléant Aéroport de Beauvais 7 M. Jean-Pierre MAULER Délégué CFDT 60000 TILLÉ Suppléant Délégué SNCTA Aéroport de Beauvais 8 Mme Aude PRAUD 60000 TILLÉ Suppléant SAGEB 9 M. Emmanuel COMBAT Directeur Aéroport de Beauvais-Tillé Titulaire SAGEB 60000 TILLÉ Aéroport de Beauvais-Tillé 10 M. Florent MITELET Directeur de SAGEB Suppléant l'environnement - SAGEB 60000 TILLÉ COMPAGNIES AÉRIENNES 11 M. Dirk STREMES Ryanair Titulaire 12 M. Vincent LECOMPTE Wizzair Titulaire 13 M. Frédéric LEMERY Ryanair Suppléant 14 M. Denis LAFARGUE Wizzair Suppléant AÉROCLUB Délégué de l'aéroclub du Aéroclub du Beauvaisis 15 M. Alexis ZAGULAJEW Beauvaisis Aéroport de Beauvais-Tillé - BP Titulaire 30755 60007 BEAUVAIS Président de l'aéroclub du Aéroclub du Beauvaisis 16 M. André CRUCIFIX Beauvaisis Aéroport de Beauvais-Tillé - BP Suppléant 30755 60007 BEAUVAIS COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS N° Nom Fonction Adresse Coordonnées Qualité Présidente de la Communauté d'Agglomération 1 Mme Caroline CAYEUX Communauté du Beauvaisis Titulaire d'Agglomération du 48, rue Desgroux - BP 90508 Beauvaisis 60005 BEAUVAIS cedex Mairie de Tillé 2 M. -

Oise Très Haut Débit LE JOURNAL DES ADHÉRENTS DU SMOTHD
Oise Très Haut Débit LE JOURNAL DES ADHÉRENTS DU SMOTHD MAI 2019 #11 La société avance et se transforme ! Nous sommes en plein dans l’ère du numérique qui fait évoluer nos mœurs, nos façons de travailler et notre vision de l’avenir. L’EUROPE ACCOMPAGNE Les professionnels de demain sont les jeunes LES COMMUNES que nous accompagnons aujourd’hui, pour qui le numérique est un outil primordial de ans le prolongement du la commune de Noyon et recevront développement personnel mais également déploiement de la fibre un coupon d’une valeur de 15 000 professionnel. optique, le SMOTHD, euros permettant d’installer des équi- C’est avec cette vision que ce mois-ci le porteur du Schéma pements WI-FI dans des lieux publics journal des adhérents du Syndicat Mixte Directeur Territorial (parcs, places, bâtiments publics, Oise Très Haut Débit consacre ses articles Dd’Aménagement Numérique de l’Oise bibliothèques, centres de santé, mu- aux jeunes d’aujourd’hui et à leur avenir : accompagne les communes dans leur sées, etc) qui ne sont pas encore do- L’Espace Numérique de Travail, le métier démarche de développement des tés d’un point d’accès au WI-FI gratuit. de Technicien Fibre Optique ou encore usages et des services. Pour rappel, les communes sont l’opportunité d’améliorer pour tous et par tous La Commission européenne a lancé le sélectionnées selon le principe du la couverture mobile de notre département, jeudi 4 avril dernier le second appel à «premier arrivé, premier servi» en sont les sujets phares de notre 11ème édition. -

Les Cantons Et Communes De La 1Ère Circonscription De L'oise CANTON
Les cantons et communes de la 1ère circonscription de l'Oise CODE CANTON COMMUNE ARRONDISSEMENT POSTAL BEAUVAIS - NORD - EST 60000 BEAUVAIS Nord Est BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60000 BEAUVAIS Nord Ouest BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60000 FOUQUENIES BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60112 HERCHIES BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60112 PIERREFITTE EN BEAUVAISIS BEAUVAIS BEAUVAIS-NORD-OUEST 60650 SAVIGNIES BEAUVAIS BRETEUIL 60120 ANSAUVILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 BACOUEL CLERMONT BRETEUIL 60120 BEAUVOIR CLERMONT BRETEUIL 60120 BONNEUIL-LES-EAUX CLERMONT BRETEUIL 60120 BONVILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 BRETEUIL SUR NOYE CLERMONT BRETEUIL 60120 BROYES CLERMONT BRETEUIL 60120 CHEPOIX CLERMONT BRETEUIL 60120 ESQUENNOY CLERMONT BRETEUIL 60120 FLECHY CLERMONT BRETEUIL 60120 GOUY-LES-GROSEILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 HERELLE (la) CLERMONT BRETEUIL 60120 MESNIL-SAINT-FIRMIN (le) CLERMONT BRETEUIL 60120 MORY-MONTCRUX CLERMONT BRETEUIL 60120 PAILLART CLERMONT BRETEUIL 60120 PLAINVILLE CLERMONT BRETEUIL 60120 ROCQUENCOURT CLERMONT BRETEUIL 60120 ROUVROY-LES-MERLES CLERMONT BRETEUIL 60120 SEREVILLERS CLERMONT BRETEUIL 60120 TARTIGNY CLERMONT BRETEUIL 60120 TROUSSENCOURT CLERMONT BRETEUIL 60120 VENDEUIL CAPLY CLERMONT BRETEUIL 60120 VILLERS-VICOMTE CLERMONT CREVECOEUR LE GRAND 60360 AUCHY-LA-MONTAGNE BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60120 BLANCFOSSE BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60360 CATHEUX BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60360 CHOQUEUSE-LES-BENARDS BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60360 CONTEVILLE BEAUVAIS CREVECOEUR LE GRAND 60120 CORMEILLES BEAUVAIS CREVECOEUR -

Mars 2020 � Beauvaisis Notre Territoire � 3 #Agglo Vie Du Beauvaisis
LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS N° 62 | MARS | 2020 notre territoire FESTIVAL Le Blues Autour du Zinc 25 ans d'émotions AMÉNAGEMENT P.10 Rénovation urbaine LE MAGAZINE DU BEAUVAISIS N° 62 | MARS | 2020 notre territoire w Sommaire VIE DU 03 ÉDUCATION 18 BEAUVAISIS Un printemps sous le signe de la SOLIDARITÉ 19 ÉCONOMIE 05 culture, des loisirs et de la solidarité ! ENVIRONNEMENT 20 CADRE VIE C’est le printemps, ponctué de giboulées mais aussi de belles journées 06 ensoleillées. Les jours s’allongent et l’on reprend plaisir à sortir, en famille DÉCHETS SANTÉ 21 ou entre amis. Cela tombe bien, le calendrier des manifestations de mars et de début avril TRANSPORTS 07 SPORT 22 est particulièrement riche. Pour les amateurs de musique, le festival du Blues autour du Zinc et le festival LE BEAUVAISIS 08 CULTURE 23 de fanfares Taptoe ; pour les enfants et leurs parents, le festival Les petits EN IMAGES poissons dans l’O et la Chasse aux œufs ; pour les amateurs de marche à pied AGENDA 28 ou de course, la balade de Hez-Froidmont (le 8 mars), le trail des Lucioles (le RÉNOVATION 10 4 avril) et les Randonnées du Beauvaisis (le 13 avril). URBAINE LIBRE 32 Les passionnés d’art visiteront l’exposition consacrée à Santiago Borja au EXPRESSION Quadrilatère et iront assister à la conférence sur la restauration du Logis à la VIE MUNICIPALE 12 maladrerie Saint-Lazare. DE BEAUVAIS INFOS PRATIQUES Chacun, j’en suis sûre, trouvera une occasion de sortir de chez lui et de 33 partager de bons moments avec sa famille et ses amis. -

Relais Assistantes Maternelles Est Un Service D’Information Sur Les Différents Modes D’Accueil Pour Maison De L’Ensemble Du Territoire
Comment nous contacter ? Le Rdu BeauvaisisAM Maison de la petite enfance Le RAM du Beauvaisis RELAIS ASSISTANTES MAISON DE LA PETITE ENFANCE 20 avenue des écoles Lundi, mardi, jeudi et vendredi : MATERNELLES 8H45-12H & 13H30-16H30 (sur rendez-vous) Pas de rendez-vous le mercredi ✆ 03 44 79 39 09 de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis Autres Points Accueil RAM : AUNEUIL BRESLES Centre Social La Canopée 20 avenue de la Libération 318 rue des Aulnes Sur rendez vous au 06 61 41 23 29 Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 CRÈVECOEUR-LE-GRAND BEAUVAIS, QUARTIER ST JEAN Salle du Crépicordium MJA - 2 rue Berlioz rue du Presbytère Sur rendez vous au 07 62 17 95 24 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 GOINCOURT MILLY-SUR-THÉRAIN Où nous trouver ? Mairie - 12 rue Jean Jaurès Mairie - Rue de Dieppe 20 avenue des écoles 60000 Beauvais Sur rendez vous au 07 62 17 95 18 Sur rendez vous au 07 62 17 95 20 03 44 79 39 09 [email protected] Crévecoeur-le-Grand Crévecoeur-le-Grand 4 animatrices à votre disposition Le Relais Assistantes Maternelles est un service d’information sur les différents modes d’accueil pour Maison de l’ensemble du territoire. la Petite Enfance Lieu d’écoute et d’accompagnement à destination des Le Saulchoy parents employeurs, des professionnels de l’accueil Point d’accueil RAM individuel, ce service est ouvert à tous, gratuit, et Crèvecœur-le-Grand animé par 4 professionnelles petite enfance. Rotangy Secteur rose Francastel Emilie DUBOC Parents, Auchy-la-Montagne ✆ 07 62 17 95 20 le RAM vous propose : Lachaussée-du-Bois-d'Écu -

Reglement Interieur Des Dechetteries
REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETTERIES Le présent règlement intérieur a pour objet de garantir le bon fonctionnement des installations et la sécurité des usagers. Il définit les conditions dans lesquelles les usagers peuvent accéder au service des déchetteries du SMDO. Les usagers doivent respecter les prescriptions du présent règlement intérieur et ses annexes ainsi que les consignes de l’agent d’exploitation qui a autorité pour le faire appliquer. Les points clés de ce règlement intérieur sont les suivants : - Pour les particuliers : o Accès gratuit mais règlementé o Carte d’accès obligatoire o 4 m³ par jour maximum o 50 passages par an (courrier d’alerte à 40 passages) o Renouvellement de la carte (perte, vol, dégradation) à 5€ - Pour les professionnels : o Accès payant selon les déchets et réglementé (tous les déchets acceptés pour les particuliers ne sont pas acceptés pour les professionnels) o Carte d’accès en déchetterie obligatoire o Caution pour les cartes de 45€ pour un véhicule, 90€ pour deux véhicules et 10€ supplémentaires par véhicule o 4 m³ par semaine maximum o Dépôts autorisés uniquement du mardi au jeudi et du lundi au jeudi, sur les déchetteries implantées sur les Communautés de Communes du Pays de Bray, de Thelloise et de l’Oise Picarde o Limitation au véhicule de moins de 3,5t o Facturation semestrielle Les détails de ces dispositions se trouvent dans le présent règlement intérieur. Adopté par délibération du Comité Syndical lors de sa séance du 18 décembre 2019. SOMMAIRE Article 1 : Dispositions générales Article 1.1. Objet et champ d’application (p.4) Article 1.2. -

Bonne En Beauvaisis
N28 | SEPTEMBRE 2011 MAGINFOS LE MAGAZINE DES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS Bonne ////// DOSSIER PAGE L'enseignement 06 supérieur Rentrée en Beauvaisis en Beauvaisis ////// COMMUNE PAGE Découvrez 09 Maisoncelle- Saint-Pierre ////// ENTRETIENS DU BEAUVAISIS PAGE L'Agglomération, 11 trait d'union entre le rural et l'urbain #02 SOMMAIRE /// ÉDITO ACTUS #03 //////// ÉDITO //////// EMPLOI BONNE Suivi renforcé sur #09 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE RENTRÉE ! les chantiers d'insertion our remobiliser les publics exclus durable- ment du marché de l'emploi, les chantiers d'insertion sont des outils efficaces. Il en existe trois dans le Beauvaisis : deux chan- tiers "Bâtiment nature" et "Espaces natu- 01 ACTUS Prels" portés par l'Agglomération du Beauvaisis et un 03 I Chantiers d'insertion autre de rénovation de l'Ecospace porté par la Ville 04 I Transports : Les nouveautés de la rentrée Les premiers jours de septembre sonnent la fin des de Beauvais. 05 I Extension des réseaux d'assainissement vacances et annoncent la rentrée des classes pour Les deux collectivités et leurs trois partenaires opéra- tous les enfants du Beauvaisis. C'est l'occasion de tionnels – la Maison de l'Emploi et de la Formation leur souhaiter une bonne année scolaire. du Pays du Grand Beauvaisis, l'association "Réussir 05 ÉCONOMIE Demain, ces écoliers pourront poursuivre leurs avec le PLIE du Beauvaisis" et le Centre Communal études au cœur du territoire : l'enseignement d'Action Sociale de la Ville de Beauvais - ont signé 06 I L'Enseignement supérieur en Beauvaisis une convention pour renforcer l'accompagnement 07 I Pépinière : TCC reprend son envol supérieur propose une large palette de des salariés de ces chantiers le 5 juillet dernier. -
![884-7 Gal Beauvaisis [Converti] Copie](https://docslib.b-cdn.net/cover/8165/884-7-gal-beauvaisis-converti-copie-678165.webp)
884-7 Gal Beauvaisis [Converti] Copie
Conty GAL du Grand Beauvaisis Quincampoix- Fleuzy Escles- St-Pierre Fouilloy Saint- GAL du Grand Beauvaisis Valery Gourchelles Hescamps Romescamps Limite des EPCI Lannoy- Cuillère Daméraucourt Dargies Abancourt Saint-Thibault Gouy-les-Groseillers Ooy Élencourt Laverrière Croissy-sur-Celle Esclainvillers Lavacquerie Sarnois Beaudéduit Moliens Bonneuil-les-Eaux Blargies Sarcus Sommereux Fontaine- Grandvilliers Le Mesnil-Conteville Bonneleau Broquiers Paillart Cempuis Blancfossé Monceaux- Choqueuse- Fléchy Bouvresse l'Abbaye Halloy Conteville Esquennoy Rouvroy- Brombos les-Bénards les-Merles Feuquières Le Hamel Rocquencourt Formerie Briot Catheux Cormeilles Thieuloy- Breteuil St-Arnoult St-Antoine Grez Villers-Vicomte Sérévillers Hautbos Hétomesnil Le Saulchoy Tartigny Mureaumont Le Mesnil- Le Gallet Doméliers Omécourt Gaudechart Prévillers St-Firmin Broyes Campeaux Saint- Crèvecœur- CC de l'Oise Picarde Canny- Saint-Maur Le Crocq Hardivillers Bacouël sur-Thérain Deniscourt le-Grand Vendeuil- Plainville Viefvillers Caply CC de la Picardie Verte Lihus Oursel- Troussencourt Beauvoir Chepoix St-Samson- Rothois Maison la-Poterie Ernemont- Thérines Fontaine- La Hérelle Boutavent Loueuse Francastel Maisoncelle- Mory- Lavaganne Rotangy Tuilerie Montcrux Héricourt- Morvillers Haute-Épine Puits- St-André- Bonvillers Villers- sur-Thérain Roy- Marseille- Auchy-la- la-Vallée Farivillers Vermont Boissy en-Beauvaisis La Neuville- Montagne Sainte- Fontenay- Eusoye Torcy sur-Oudeuil Lachaussée- Froissy Ansauvillers Songeons Grémévillers Blicourt du-Bois-d'Écu -

Communes D'intervention
COMMUNES D'INTERVENTION ACTIVITE PERSONNES AGEES ACTIVITE PERSONNES EN SITUATION HANDICAP ACTIVITE ESA Attichy Moulin-sous-Touvent Armancourt Marest-sur-Matz Amy Couloisy Lassigny Rethondes Autreches Nampcel Attichy margny les compiègne Appilly Courtieux Le Plessis-Brion Ribécourt-Dreslincourt Bailly Noyon Autreches Mélicocq Attichy Crapeaumesnil Le Plessis-Patte-d'Oie Roye-Sur-Matz Berneuil sur Aisne Orrouy Bailly Montmacq Autreches Crisolles Libermont Saint-Crépin-aux-Bois Bethisy-Saint-Martin Passel Berneuil sur Aisne Moulin-sous-Touvent Avricourt Croutoy Longueil-Annel Saint-Etienne-Roilaye Béthisy-Saint-Pierre Pierrefonds Bienville Nampcel Baboeuf Cuise-La-Motte Machemont Saint-Jean-aux-Bois Bitry Pimprez Bitry Noyon Bailly Cuts Marest-sur-Matz Saint-Léger-aux-Bois Cambronne-les-Ribécourt Pont Leveque Cambronne-les-Ribécourt Pierrefonds Beaugies-sous-Bois Cuy Mareuil-la-Motte Saint-Pierre-Les-Bitry Carlepont Rethondes Carlepont Pimprez Beaulieu-les-Fontaines Dives Margny-aux-Cerises Saint-Sauveur Chelles Ribécourt-Dreslincourt Chelles Rethondes Beaurains-les-Noyon Ecuvilly Maucourt Salency Chevincourt Saint-Crépin-aux-Bois Chevincourt Ribécourt-Dreslincourt Béhéricourt Elincourt-Ste-Marguerite Mélicocq Sempigny Chiry-Ourscamps Saint-Etienne-Roilaye Chiry-Ourscamps Saint-Crépin-aux-Bois Berlancourt Evricourt Mondescourt Sermaize Couloisy Saintines Choisy au Bac Saint-Etienne-Roilaye Berneuil sur Aisne Flavy-le-Meldeux Montmacq Solente Courtieux Saint-Jean-aux-Bois Clairoix Saint-Jean-aux-Bois Bethisy-Saint-Martin Fréniches Morienval -

Voie Verte De Cuise-La-Motte À Courtieux 6,7 Km (05/03/2014)
Voie verte de Cuise-la-Motte à Courtieux 6,7 km (05/03/2014) N Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google Type de la voie : Voie Verte Villes traversées (ou très proches) : Cuise-la-Motte, Couloisy, Attichy, Jaulzy, Courtieux. Nature de la voie : ancienne voie ferrée Activités possibles : course à pied, fauteuil roulant, marche, roller-skating, vélo de course ou route, Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Canton d’Attichy vélo tout chemin VTC, Vélo tout terrain VTT Département, Région : Oise (Picardie) Revêtement : enrobé lisse Résumé / Descriptif : Cette Voie Verte, réalisée en 2011 sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée Compiègne-Soissons, constitue le premier tronçon de l'itinéraire cyclable reliant ces deux villes, le long de la Vallée de l'Aisne. Elle est réalisée en enrobé lisse, très roulant, et permet une balade agréable, qui longe notamment plusieurs étangs. Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=371 Section A : Cuise-la-Motte, rue du Flottage - Courtieux, Le Muid, limite départementale // PK 6,7 QUALITÉ Commentaires : Revêtement : lisse (compatible rollers) Entrée largeur = 1,60 m. Pente : moins de 2% Largeur de voie entre 2,10 et 2,20 m. Largeur en site propre : moins de 2,5 m Contrôles d'accès : potelets (au début 1,20 à 1,40 m dans l'axe, puis 70 à 90 cm). SÉCURITÉ 3 Traversées importantes : D335 (2000 véh/j, marquage pointillés blancs), D16 (2600 Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 7 / véh/j, marquage pointillés blancs), et gros point noir N31 (+ de 12000 véh/j, aucun moyenne (1 dangereuse -> point noir de sécurité) dispositifs de sécurisation, juste Stop vélo). -

Horaires Et Trajet De La Ligne T1 De Bus Sur Une Carte
Horaires et plan de la ligne T1 de bus T1 Auteuil Voir En Format Web La ligne T1 de bus (Auteuil) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Auteuil: 11:15 - 17:30 (2) Hôtel de Ville Beauvais: 08:15 - 14:30 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne T1 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne T1 de bus arrive. Direction: Auteuil Horaires de la ligne T1 de bus 12 arrêts Horaires de l'Itinéraire Auteuil: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi Pas opérationnel mardi Pas opérationnel Hôtel de Ville - Quai B Rue Malherbe, Beauvais mercredi Pas opérationnel Centre Commercial jeudi Pas opérationnel 47 Rue Juliette Névouet, Goincourt vendredi Pas opérationnel Place samedi 11:15 - 17:30 13 Rue Jean Jaurès, Goincourt dimanche Pas opérationnel Place 78 Grande Rue d'aux Marais, Aux Marais Mairie 19 Rue de la Poste, Rainvillers Informations de la ligne T1 de bus Direction: Auteuil St-Léger Rond-Point Arrêts: 12 Grande Rue, Saint-Leger-En-Bray Durée du Trajet: 60 min Récapitulatif de la ligne: Hôtel de Ville - Quai B, Saint-Léger Place Centre Commercial, Place, Place, Mairie, St-Léger 1 Rue du Placeau, Saint-Léger-en-Bray Rond-Point, Saint-Léger Place, Saint-Martin Le Nœud École, Frocourt École, Les Vivrots, Berneuil-En-Bray, Saint-Martin Le Nœud École Auteuil École Frocourt École 9 bis Rue de Beauvais, Frocourt Les Vivrots 2 Impasse des Croisettes les VIvrots, Berneuil-En-Bray Berneuil-En-Bray 2 Route de Beauvais, Berneuil-En-Bray Auteuil École 35 quater Rue de Gournay, Auteuil -

Couloisy Ordre
Compte-rendu du Conseil Communautaire Séance du 11 mars 2021 à 19h00 Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy Ordre du jour Appel des délégués : Signature du registre ; Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 21 janvier 2021 Désignation d’un secrétaire de séance : Anne Marie DEFRANCE Information sur les décisions de la Présidente : aucune Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune Madame la Présidente informe l’Assemblée Délibérante que la délibération portant sur la convention d’occupation temporaire en domaine privé entre la Mairie de Pierrefonds et la CCLO pour la voie verte Pierrefonds-Palesne est ajournée. Mme Demouy indique qu’il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir à la rédaction de la convention. Il faut donc reporter cette délibération ultérieurement en sachant que les travaux n’ont pas démarré. Etaient présents : Titulaires : M. FAVROLE, Mme BETRIX, M. DECULTOT, Mme RIGAULT, M. POTIER, M. FRERE, M. SUPERBI, M. DEBLOIS, M. CORMONT, Mme BEAUDEQUIN, M.BARGADA M. FLEURY, Mme CHAMPEAU, M. SARKÖZY, M. LOUBES, M. BOUCHEZ, Mme DEFRANCE, Mme DEMOUY, M. BEGUIN, , Mme VALENTE-LE HIR, M. GOURDON, M. GOUPIL, Mme BACHELART, M. DELCELIER, Mme PARMENTIER, M.LECAT, M. MAILLET ,Mme DECKER, M.BOURGEOIS, M. GOSSOT, M. LEBLANC, Mme BROCVIELLE (32) Suppléants : Mme CHEVOT (pour M. DEGAUCHY), M. MICHEL (pour M.LEMMENS), Mme SAUTEREAU-MOREL (pour M. DE FRANCE) (3) Absents ayant donné procuration à : Mme TUAL ayant donné pouvoir à M. FRERE , Mme BRASSEUR ayant donné pouvoir à