Rapport De Présentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Services De Soins Infirmiers À Domicile - ADMR Vendée
Services de soins infirmiers à domicile - ADMR Vendée Association locale ADMR du SSIAD Association locale ADMR du SSIAD des rives de la Boulogne Association locale ADMR du SSIAD de l’Ile de Noirmoutier 02 51 43 91 20 Association locale ADMR de Mortagne Sur Sèvre 02 51 39 07 88 du SSIAD Amaryllis 02 51 65 20 39 Noirmoutier 02 51 98 57 63 en Cugand l'Île La Bernardière L'Épine Saint Saint Hilaire La Bruffière La Guérinière Philbert de Treize Tiffauges Bouin de Loulay Septiers Bouaine Saint Mortagne Association locale Bois Saint Aubin sur de Montaigu Martin des Sèvre Barbâtre Ormeaux Saint Céné La Guyonnière des ADMR santé Gervais Boufféré Les Landes Tilleuls La Verrie Saint Saint Genusson Saint Beauvoir La Boissière Laurent sur Châteauneuf André Georges de Marillet Vouraie Treize de de sur Mer Rocheservière Montaigu Voies Montaigu La Gaubretière SaintSèvre La Garnache Malô 02 51 05 70 55 Bazoges du Treize La Barre Saint L'Herbergement Chambretaud Vents Mormaison Chavagnes en Bois de Urbain Beaurepaire Association locale ADMR Monts Froidfond Saint en Paillers Mallièvre Sallertaine Sulpice Les Brouzils Paillers le Notre Falleron aide et soins de l’Ile d’Yeu Les Lucs Verdon Les Epesses Dame Saint sur Saint de Étienne Saint La Rabatelière Monts Challans Boulogne La Copechagnière Fulgent Saint Les Châtelliers 02 51 58 38 67 Grand'Landes du Denis Mesnard Les Herbiers Saint Le Perrier Bois la la Mars Châteaumur Association locale ADMR Jean Saint Chevasse Saint Barotière la Saint Association locale ADMR Christophe Saint Saint Réorthe de Beaufou -

Communes Actionnaires Mise À Jour Janvier 2017
Communes actionnaires Mise à jour janvier 2017 Cugand Noirmoutier en l'Ile La Bernardière Bouin La Bruffière L'Epine St Hilaire de Loulay Tiffauges St Philbert de Bouaine La Guérinière Treize Septiers St Aubin des Ormeaux Barbâtre Montaigu St Martin des Tilleuls Mortagne sur Sèvre Boufféré La Guyonnière Bois de Cené Les Landes Genusson La Verrie St Gervais St Laurent sur Sèvre Beauvoir sur Mer La Boissière de Montaigu Châteauneuf Rocheservière St Georges La Gaubretière de Montaigu St Malo du Bois Mallièvre Treize Vents La Garnache L'Herbergement Bazoges en Paillers St Urbain Chambretaud Montréverd La Barre de Monts Les Brouzils Chavagnes en Paillers Beaurepaire Les Epesses Sallertaine Froidfond Falleron Grand'Landes Les Lucs sur Boulogne La Rabatelière Les Herbiers Notre Dame de Monts La Copechagnière Challans St Fulgent St Mars la Réorthe St Etienne du Bois St Denis la Chevasse Mesnard la Barotière Le Perrier St Christophe du Ligneron Chauché Soullans St André St Paul en Pareds Sèvremont St Paul Mont Penit Beaufou Goule d'Oie Vendrennes St Jean de Monts Palluau La Chapelle Palluau Ste Florence Mouchamps Le Boupère Bellevigny Boulogne St Mesmin Commequiers L'Oie Maché Essarts- Rochetrejoux Pouzauges Notre Dame de Riez en-Bocage Le Poiré sur Vie Apremont Dompierre sur Yon St Hilaire de Riez La Merlatière St Prouant Montournais L'Ile d'Yeu St Maixent sur Vie Aizenay St Maixent sur Vie St Vincent Sterlanges La Meilleraie Tillay La Genétouze Le Fenouiller St Martin des Noyers St Germain de Prinçay Monsireigne St Révérend Coëx Menomblet Mouilleron -

Guide Hébergements 2021 Pays Des Herbiers
LES HÉBERGEMENTS du Pays des Herbiers ACCOMODATIONS - LOS ALOJAMIENTOS 2021 Office de Tourisme du Pays des Herbiers 12 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS Tél. 33(0)2 44 40 20 20 • [email protected] Retrouvez nous sur facebook www.facebook.com/PaysDesHerbiers www.ot-lesherbiers.fr Les documents de l’Office de Tourisme sont non contractuels : les informations sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Pays des Herbiers. Crédit photo : David Fugère LES HÔTELS ET HÔTELS RESTAURANTS HOTELS AND HOTELS WITH RESTAURANT - LOS HOTELES Y LOS HOTELES RESTAURANTES HÔTEL COORDONNÉES INFOS PRATIQUES 1 rue des Rochettes - 85590 Saint-Mars-la-Réorthe OMNUBO *** Ouvert toute l’année Tél. 02 52 65 11 11 3 minutes du Puy du Fou 40 chambres - De 65 à 190 € / nuit / 2 pers. www.hotel-omnubo.com • [email protected] 6 rue de l’église - 85500 Les Herbiers LE CENTRE ** Tél. 02 52 65 00 65 Ouvert toute l’année 10 minutes du Puy du Fou www.hotellecentre-lesherbiers.com 9 chambres - 65 à 85 € / nuit / 2 pers. [email protected] LE RELAIS 18 rue de Saumur - 85500 Les Herbiers Ouvert à l’année Tél. 02 51 91 01 64 DE VENDÉE ** 27 chambres - À partir de 58 € / nuit / 2 pers. 10 minutes du Puy du Fou www.hotellerelais.com • [email protected] 99 avenue de Cholet - 85500 Les Herbiers ALOÉ *** Fermé pendant les vacances de Noël Tél. 02 51 66 80 30 10 minutes du Puy du Fou 68 chambres - 71 à 139 € / nuit / 2 pers. -

Guide Des Services Pour Les Seniors
PRÉSENTATION Guide des services pour les Seniors Mairie des Herbiers - Service des Affaires Sociales Tél. : 02 51 91 29 78 - www.cc-paysdesherbiers.fr Le CLIC du Haut-Bocage ,, Le CLIC du Haut-Bocage, antenne des Herbiers, est heureux de vous pré- senter son guide du soutien à domicile. L’étude gérontologique menée en 2000 avait mis en avant le besoin de coordination des services oeuvrant pour le soutien à domicile. En effet, partenaires bénévoles et professionnels travaillent tous dans une même direction : permettre aux retraités du Pays des Herbiers de passer les étapes de leur vie dans les meilleures conditions physiques et psycho- logiques. Retrouvez dans ce guide les clés du bien vieillir : coordonnées de profession- nels sociaux et médicaux, établissements, aides financières, animations, ... Les professionnelles du CLIC se tiennent à votre disposition. N’hésitez pas à les contacter. ,, Jeanine Bousseau Vice-présidente du CLIC du Haut-Bocage Le CLIC du Haut Bocage, Antenne des Herbiers, est destiné aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu’à leur entourage (famille, voisins, amis, …). Ce service gratuit permet de bénéficier d’un interlocuteur unique, qui évalue la situation de la personne dans sa globalité et propose des inter- ventions à domicile cohérentes et coordonnées. Pourquoi faire appel au CLIC ? - Lors d’un retour à domicile après une hospitalisation - Afin de soulager les aidants - Suite à l’altération de l’état de santé - Pour une aide aux démarches administratives - Pour adapter des services de soutien à domicile - Pour une recherche de structure d’hébergement (temporaire ou permanent) 2 Les missions du CLIC : - Accueil, écoute et soutien aux personnes âgées et à leur entourage. -

Capacite D'accueil Touristique EN Vendée
capacite d’accueil touristique EN VENDée données au 31 Décembre 2018 Le Département de la Vendée offre une capacité d’accueil de plus de 762 000 lits touristiques en 2018 dont 267 000 762.703 lits en hébergements marchands. L’hébergement non mar- EN vendée chand (résidences secondaires) représente quant à lui 65 % de l’offre d’hébergements touristiques. En comparaison à l’année dernière, le nombre de lits touristiques vendéens a progressé de 1,9 % tous types d’hébergements confondus. La Vendée reste le 1er département de France en nombre La vendée n°1 de campings et le 1er département touristique de la façade EN NOMBRE DE CAMPINGS atlantique ennombre de lits. Avec plus de 175 000 lits, l’hô- tellerie de plein air représente le premier mode d’héberge- ment marchand (66 % des lits marchands), devant les meu- blés/locations (14 %), la catégorie «Autres hébergements DES LITS TOURISTIQUES collectifs» (11 %) et l’hôtellerie (5 %). % SUR LE 79 littoral En terme de classement, 82 % des structures vendéennes en hôtellerie de plein air sont classées (dont 75 % de niveau 3, 4 et 5 étoiles) et 65 % des structures en hôtellerie sont classées (dont 63 % de niveau 3, 4 et 5 étoiles). La capa- cité d’hébergement touristique reflète également le poids +1,9 % de lits prépondérant du littoral puisque plus de 7 lits sur 10 sont ENTRE 2017 ET 2018 localisés sur les communes littorales du Département de la Vendée. Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : [email protected] Création, rédaction, édition : Vendée Expansion, Service d’Observation territoriale et touristique. -

Canton Des Herbiers
Canton des Herbiers Superficie : 472,01 km² Population totale en 2012 : 44 602 habitants Autoroutes Densité de population : 94,49 habitants / km² 2 X 2 voies Routes principales Routes secondaires Source : Insee, Recensement de la population 2012. COMMUNES APPARTENANT AU CANTON St Mars la Réorthe St Paul en Pareds 951 habitants Les Epesses 1.236 habitants 2.773 habitants Les Chatelliers Châteaumur Les Herbiers 725 habitants 16.188 habitants La Flocellière 2.616 habitants La Pommeraie sur Sèvre 1.082 habitants Mouchamps St Mesmin 1.786 habitants 2.868 habitants Pouzauges 5.722 habitants Montournais 1.754 habitants St Michel Mont Mercure 2.167 habitants Monsireigne 961 habitants Réaumur 857 habitants Chavagnes les Redoux Tallud Ste Gemme 823 habitants 479 habitants La Meilleraie Tillay 1.614 habitants Vendée Expansion ‐ 33 rue de l’Atlantique ‐ CS 80 206 ‐ 85005 LA ROCHE SUR YON Tél. : 02.51.44.90.00 ‐ Fax : 02.51.62.36.73 ‐ E‐mail : contact@vendee‐expansion.fr Création, rédaction, édition : Vendée Expansion, Service d’Observation et d’Information économiques. Contact : François RIOU Directeur de la publication : Eric GUILLOUX www.vendee‐expansion.fr Portrait de territoire 2015 Canton des Herbiers Fiches cantonales 2015 SERVICES PUBLICS -SANTÉ -ENSEIGNEMENT Services publics - Santé - Enseignement Commissariat / gendarmerie Centre de secours Point de contact La Poste Centre des finances publiques Etablissement d’enseignement primaire Etablissement d’enseignement secondaire Médecin généraliste Masseur kinésithérapeute Infirmier libéral Dentiste Principaux services publics Année 2013 Nombre d’établissements Commissariat 0 Gendarmerie 2 Enseignement Centre de secours 3 Point de contact de la Poste(1) 13 Année 2013/2014 Centre des Finances Publiques 2 Ecole primaire (1) Bureaux de poste, agences postales communales et points poste. -

Bulletin Municipal / 2017
Bulletin Municipal / 2017 SAINT MARS LA RÉORTHE SOMMAIRE Édito ..................................................................................................................................................... P. 1 Conseil municipal Les commissions Conseil municipal ................................................................................................................................. P. 2 Activités et travaux communaux Affaires sociales et scolaires (Maison seniors, CME) .............................................................................. P. 3 Urbanisme, environnement ................................................................................................................... P. 4 Voirie, patrimoine (Bâtiments communaux, voirie communale) .............................................................. P. 4 Communication (Tourisme et vie associative) ........................................................................................ P. 5 Finances ............................................................................................................................................... P. 5 Vie scolaire École Saint Médard .............................................................................................................................. P. 6 A.P.E.L - O.G.E.C ................................................................................................................................. P. 6-7 Paroisse Saint Jean-Baptiste des collines Communauté Chrétienne de St Mars ................................................................................................... -
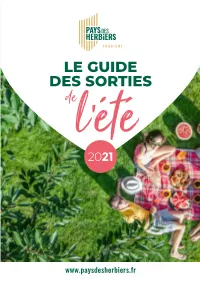
Des Sorties Le Guide
LE GUIDE DES SORTIES de l’été2021 www.paysdesherbiers.fr Édito Envie d’un été animé ? Posez vos valises au Pays des Herbiers ! Après une année bien difficile pour le monde du tourisme et de la culture, l’heure est à la détente et aux rencontres. Cet été au Pays des Herbiers, vous croiserez de nombreux artistes : comédiens, magiciens, musiciens, acrobates, sculpteurs… Le programme est riche et varié. Vous rencontrerez des passionnés d’Histoire qui vous conteront les secrets de notre riche patrimoine au détour d’une visite secrète à Vendrennes ou d’une balade commentée à Mouchamps, Petite cité de caractère. Vous goûterez aux saveurs du bocage lors d’un marché de producteurs aux Epesses, chez nos commerçants ou à la table d’un de nos nombreux restaurants. Vous découvrirez la beauté de nos paysages avec des amoureux de la nature et des grands espaces : Le Mont des Alouettes aux Herbiers, fraîchement rénové, le bois des Jarries à St-Mars-la-Réorthe ou encore toutes les activités sportives et de plein air proposées à la base de loisirs de la Tricherie à Mesnard-la-Barotière. Enfin aux Herbiers, vous vous émerveillerez devant d’inédits spectacles, vivants et gratuits des Palpitantes : notre nouveauté 2021 ! Dans ce programme des animations estivales, vous trouverez chaque jour une idée de sortie, en solo, en famille ou entre amis. Pour votre sécurité, toutes les dispositions seront prises pour vous permettre de profiter des animations en toute sérénité. Alors, laissez-vous transporter au Pays des Herbiers ! Véronique BESSE Bel été à tous ! Présidente du Pays des Herbiers Maire des Herbiers TOUT L’ÉTÉ LES MARCHÉS hebdomadaires LES HERBIERS VENDRENNES • Marché les mercredis et • Marché le mardi de 16h à 19h, samedis matins de 8h à 12h30 Parking du bar « le Padam au marché couvert St Pierre. -

DU PAYS DE POUZAUGES L OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020
DU PAYS DE POUZAUGES l OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020 LES PÔLES // EXPLIQUÉS PAR VOS ÉLUS / P.03 ALIMENTATION // DES ACTIONS CONCRÈTES POUR MANGER LOCAL / P.05 // LUi, QU'EST-CE QUI CHANGE ? / P.10-11 DOSSIER ᄳ TRANSITIONS // CODEV : QUI SONT LES MEMBRES ? / P.12-13 ACTION SOCIALE // CRÉATION D’UN CIAS / P.14-15 www.paysdepouzauges.fr CHAVAGNES-LES-REDOUX / LA MEILLERAIE-TILLAY / LE BOUPÈRE / MONSIREIGNE / MONTOURNAIS POUZAUGES / RÉAUMUR / SAINT-MESMIN / SÈVREMONT / TALLUD-SAINTE-GEMME UN ENVIRONNEMENT QUI NE CESSE DE BOUGER ET UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE MONDIAL “AGITÉ” FONT PLANER UN CLIMAT D’ANXIÉTÉ, VOIRE D’INCERTITUDE, ᄐCHEZ BEAUCOUPdito... D’ENTRE NOUS. Il est donc essentiel de croire en notre action chacun à notre niveau. Le développement ne se décrète pas. Il doit s’inscrire dans une ambition partagée. Il vient des forces vives de notre territoire : habitants, entreprises, élus locaux et associations... et ce sont eux qui lui insufflent leur énergie. Il ne peut se faire efficacement que lorsque les conditions y sont favorables. C’est là le rôle de la Communauté de Communes que d’encourager, d’organiser et coordonner les conditions de sa réussite. Continuons, ensemble, à faire vivre le Pays de Pouzauges et surtout gardons notre enthousiasme. La COVID 19 nous a invité à nous questionner sur des nouvelles formes d’initiatives, pour maintenir le lien social et impulser un nouveau souffle citoyen. Aussi, je profite de cet édito pour adresser un MERCI. • À toutes les associations du Pays de Pouzauges, qui depuis le mois de mars, ont été bousculées par la crise sanitaire, ont su faire preuve d’une remarquable capacité à réagir en mobilisant toutes leurs énergies : pour la réalisation de masques, la fabrication de blouses, pour assurer la protection du plus grand nombre ou en utilisant de nouveaux outils de communication pour conserver le lien avec leurs adhérents. -

Enfance Et Jeunesse
ENFANCE ET JEUNESSE www.mouchamps.com ENFANCE JEUNESSE ................................................................... P33 Enfance Jeunesse .........................................................................................P 34 Sommaire Conseil Municipal des Enfants Accueil périscolaire et accueil de loisirs ...............................................P 35 EDITO ........................................................................................................... P 1 Le relais des assistantes maternelles Association de parents d’élèves ..............................................................P 36 AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT ............................. P 2 Ecole René Guilbaud ...................................................................................P 37 Ouverture du contournement ....................................................................P 3 Ecole Notre Dame Aménagement au Colombier .................................................................P 4-5 OGEC - APEL ...................................................................................................P 38 La voirie ...............................................................................................................P 5 Restaurant scolaire - Eveil artistique et sportif ..................................P 39 La fibre optique, au service du développement économique .......P 6 La MAM des Babyloups – Le passeport du civisme .........................P 40 La fibre optique et l’ébranchage ...............................................................P -

ADLFI. Archéologie De La France - Informations Une Revue Gallia Pays De La Loire | 2008
ADLFI. Archéologie de la France - Informations une revue Gallia Pays de la Loire | 2008 Prospection aérienne Patrick Péridy Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/adlfi/1972 ISSN : 2114-0502 Éditeur Ministère de la culture Référence électronique Patrick Péridy, « Prospection aérienne », ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Pays de la Loire, mis en ligne le 01 mars 2008, consulté le 22 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/adlfi/1972 Ce document a été généré automatiquement le 22 avril 2019. © Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS Prospection aérienne 1 Prospection aérienne Patrick Péridy 1 Le programme de prospection aérienne 2008 se solde pour la seconde année consécutive par un bilan négatif, qu’il faut imputer une fois encore aux conditions climatiques. 2 Au total, 4h55 de survols ont été réalisées. Les renseignements recueillis tout au long de l’été auprès de plusieurs pilotes de la région sur la réponse de la végétation nous ont fait renoncer à reprendre les recherches en juillet et août sur la zone prévue en raison de l’extrême pauvreté des indices observés. 3 Trois missions ont été effectuées, couvrant les zones suivantes : 4 • 13/06/08 : Cholet, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Les Herbiers (est), La Chaize le Vicomte, Mareuil-sur-Lay, pourtour nord du Marais poitevin jusqu’à Longeville, Talmont-Saint- Hilaire, Les Sables-d’Olonne, La Mothe-Achard, La Genétouze, Les Essarts, Saint-Fulgent (2h00). 5 • 18/06/08 : Cholet, La Mothe-Achard, Saint-Mathurin, Vairé, vallée du Jaunay depuis l’embouchure jusqu’à Coëx, Challans, La Genétouze (1h20). -

Bulletin Annuel 2021 La Joséphine Mot Du Maire
Crédit photo : Podzee Les Hirondelles 3 Nouvelle équipe municipale RD 23 en travaux Les vestiaires de la salle de sports Bulletin Annuel 2021 La Joséphine Mot du maire .............................................................. 3 Commission services à la personne Service jus de pommes ......................................................... 18 Histoire de la commune .................................... 4 Atelier d’éveil : « Les P’tits lutins » ........................................ 18 MAM Les Pitchouns .............................................................. 18 Commission équipement Culture et patrimoine Mot de l’élu ............................................................................. 5 Travaux sur la RD 23 ................................................................ 5 Association du Patrimoine Saint Paulais ............................... 19 Zone Artisanale du Charfait .................................................... 5 Cabaret Saint Paul ................................................................. 20 Elagage des arbres pour la fibre optique ............................... 6 La Gorouée ............................................................................ 21 Assainissement de la Proutière ............................................... 7 Association des Jeunes Farfadets ......................................... 22 PLUIh ....................................................................................... 7 Lotissements Les Hirondelles 3 et Les Lavandières ................ 7 Sports et loisirs Plantations