Ô Canada: Un Hymne National, Deux Nations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
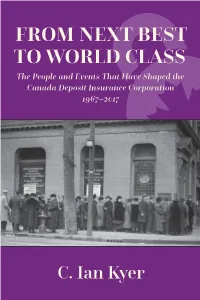
From Next Best to World Class: the People and Events That Have
FROM NEXT BEST TO WORLD CLASS The People and Events That Have Shaped the Canada Deposit Insurance Corporation 1967–2017 C. Ian Kyer FROM NEXT BEST TO WORLD CLASS CDIC—Next Best to World Class.indb 1 02/10/2017 3:08:10 PM Other Historical Books by This Author A Thirty Years’ War: The Failed Public Private Partnership that Spurred the Creation of the Toronto Transit Commission, 1891–1921 (Osgoode Society and Irwin Law, Toronto, 2015) Lawyers, Families, and Businesses: A Social History of a Bay Street Law Firm, Faskens 1863–1963 (Osgoode Society and Irwin Law, Toronto, 2013) Damaging Winds: Rumours That Salieri Murdered Mozart Swirl in the Vienna of Beethoven and Schubert (historical novel published as an ebook through the National Arts Centre and the Canadian Opera Company, 2013) The Fiercest Debate: Cecil Wright, the Benchers, and Legal Education in Ontario, 1923–1957 (Osgoode Society and University of Toronto Press, Toronto, 1987) with Jerome Bickenbach CDIC—Next Best to World Class.indb 2 02/10/2017 3:08:10 PM FROM NEXT BEST TO WORLD CLASS The People and Events That Have Shaped the Canada Deposit Insurance Corporation 1967–2017 C. Ian Kyer CDIC—Next Best to World Class.indb 3 02/10/2017 3:08:10 PM Next Best to World Class: The People and Events That Have Shaped the Canada Deposit Insurance Corporation, 1967–2017 © Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC), 2017 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. -

Orme) Wilberforce (Albert) Raymond Blackburn (Alexander Bell
Copyrights sought (Albert) Basil (Orme) Wilberforce (Albert) Raymond Blackburn (Alexander Bell) Filson Young (Alexander) Forbes Hendry (Alexander) Frederick Whyte (Alfred Hubert) Roy Fedden (Alfred) Alistair Cooke (Alfred) Guy Garrod (Alfred) James Hawkey (Archibald) Berkeley Milne (Archibald) David Stirling (Archibald) Havergal Downes-Shaw (Arthur) Berriedale Keith (Arthur) Beverley Baxter (Arthur) Cecil Tyrrell Beck (Arthur) Clive Morrison-Bell (Arthur) Hugh (Elsdale) Molson (Arthur) Mervyn Stockwood (Arthur) Paul Boissier, Harrow Heraldry Committee & Harrow School (Arthur) Trevor Dawson (Arwyn) Lynn Ungoed-Thomas (Basil Arthur) John Peto (Basil) Kingsley Martin (Basil) Kingsley Martin (Basil) Kingsley Martin & New Statesman (Borlasse Elward) Wyndham Childs (Cecil Frederick) Nevil Macready (Cecil George) Graham Hayman (Charles Edward) Howard Vincent (Charles Henry) Collins Baker (Charles) Alexander Harris (Charles) Cyril Clarke (Charles) Edgar Wood (Charles) Edward Troup (Charles) Frederick (Howard) Gough (Charles) Michael Duff (Charles) Philip Fothergill (Charles) Philip Fothergill, Liberal National Organisation, N-E Warwickshire Liberal Association & Rt Hon Charles Albert McCurdy (Charles) Vernon (Oldfield) Bartlett (Charles) Vernon (Oldfield) Bartlett & World Review of Reviews (Claude) Nigel (Byam) Davies (Claude) Nigel (Byam) Davies (Colin) Mark Patrick (Crwfurd) Wilfrid Griffin Eady (Cyril) Berkeley Ormerod (Cyril) Desmond Keeling (Cyril) George Toogood (Cyril) Kenneth Bird (David) Euan Wallace (Davies) Evan Bedford (Denis Duncan) -

CHRONICLES of CANADA Edited by George M
F 6 Universal Bindery Lid. BOOKBINDING - GOLD LETTERING Edmonton, Alberta Digitized by the Internet Archive in 2016 https://archive.org/details/chroniclesofcana30wron CHRONICLES OF CANADA Edited by George M. Wrong and H. H. Langton In thirty-two volumes 30 THE DAY OF SIR WILFRID LAURIER BY OSCAR D. SKELTON Part VIII The Growth of Nationality ii, V ” ' " "f /kttRvvKn taaow.c^i^ vc! us i'f# .H ..H bna. g.'i lyv .M-S-rmflO ' ' '^ HO VAC HKT LTi^JUAJ aiH'-lJlW 51 HOT iajia X' aweo va a? SIR WILFRID LAURIER ‘IN ACTION’ After an instantaneous photograpli taken during an address in the open air at Sorel, 1911 THE DAY OF SIR WILFRID LAURIER A Chronicle of Our Own Times BY OSCAR D. SKELTON Copyright in all Countries subscribing to the Berne Convention UNTVEBS!77 t r'KAS'' THE UNUfEBSiTX OE ALBEEXA I I PREFATORY NOTE i :n conformity with its title, this volume, lave for the earlier chapters, is history rather ihan biography, is of the day, more than of the nan. The aim has been to review the more ;ignificant events and tendencies in the recent )olitical life of Canada, In a later and larger lyork it is hoped to present a more personal ind intimate biography of Sir Wilfrid Laurier. O. D, SKELTON, Kingston, 1915. CONTENTS Page PREFATORY NOTE .... vii j I. THE MAKING OF A CANADIAN . I II. POLITICS IN THE SIXTIES . l8 I ! III. FIRST YEARS IN PARLIAMENT . 32 IV. IN OPPOSITION, 1878-1887 ; . 53 V. LEADER OF THE OPPOSITION, 1887-189S . 91 j VI. -

Crash Landing: Citizens, the State and Protest Against Federal Airport Development, 1968- 1976
Crash Landing: Citizens, The State and Protest Against Federal Airport Development, 1968- 1976 ii Crash Landing: Citizens, The State and Protest Against Federal Airport Development, 1968- 1976 By Michael Rowan, B.A., M.A. Supervisor: Dr. Ken Cruikshank Committee Members: Dr. Richard Harris, Dr. John Weaver, Dr. Penny Bryden A thesis submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy McMaster University © Copyright by Michael Rowan, January 2019. iii McMaster University DOCTOR OF PHILOSOPHY (2018) Hamilton, Ontario (History) TITLE: Crash Landing: Citizens, The State and Protest Against Federal Airport Development, 1968-1976 AUTHOR: Michael Rowan, B.A. (York University), M.A. (York University) PROFESSOR: Ken Cruikshank NUMBER OF PAGES 206 iv Abstract During the 1960s both the federal and provincial governments continued to take on new and larger responsibilities. During this same time period citizens began to mobilize and challenge the state on a number of social issues including race, gender, labour, urban sprawl and the environment. Citizens believed that not only did they have the right to challenge the authority of government in planning public policy, but they also had a right to participate in the decision- making process as much as any bureaucrat, expert, or elected official. In planning airports in Pickering, Ste. Scholastique and Sea Island, the federal government was opposed by citizen groups in each of these three cases. Citizens believed their voices were not being heard and that government officials did not respect them. As a result, they disrupted the meticulously laid out plans of elected officials and policy planners by drawing on evidence and expert advice. -

The Canadian Parliamentary Guide
NUNC COGNOSCO EX PARTE THOMAS J. BATA LI BRARY TRENT UNIVERSITY us*<•-« m*.•• ■Jt ,.v<4■■ L V ?' V t - ji: '^gj r ", •W* ~ %- A V- v v; _ •S I- - j*. v \jrfK'V' V ■' * ' ’ ' • ’ ,;i- % »v • > ». --■ : * *S~ ' iJM ' ' ~ : .*H V V* ,-l *» %■? BE ! Ji®». ' »- ■ •:?■, M •* ^ a* r • * «'•# ^ fc -: fs , I v ., V', ■ s> f ** - l' %% .- . **» f-•" . ^ t « , -v ' *$W ...*>v■; « '.3* , c - ■ : \, , ?>?>*)■#! ^ - ••• . ". y(.J, ■- : V.r 4i .» ^ -A*.5- m “ * a vv> w* W,3^. | -**■ , • * * v v'*- ■ ■ !\ . •* 4fr > ,S<P As 5 - _A 4M ,' € - ! „■:' V, ' ' ?**■- i.." ft 1 • X- \ A M .-V O' A ■v ; ■ P \k trf* > i iwr ^.. i - "M - . v •?*»-• -£-. , v 4’ >j- . *•. , V j,r i 'V - • v *? ■ •.,, ;<0 / ^ . ■'■ ■ ,;• v ,< */ ■" /1 ■* * *-+ ijf . ^--v- % 'v-a <&, A * , % -*£, - ^-S*.' J >* •> *' m' . -S' ?v * ... ‘ *•*. * V .■1 *-.«,»'• ■ 1**4. * r- * r J-' ; • * “ »- *' ;> • * arr ■ v * v- > A '* f ' & w, HSi.-V‘ - .'">4-., '4 -' */ ' -',4 - %;. '* JS- •-*. - -4, r ; •'ii - ■.> ¥?<* K V' V ;' v ••: # * r * \'. V-*, >. • s s •*•’ . “ i"*■% * % «. V-- v '*7. : '""•' V v *rs -*• * * 3«f ' <1k% ’fc. s' ^ * ' .W? ,>• ■ V- £ •- .' . $r. « • ,/ ••<*' . ; > -., r;- •■ •',S B. ' F *. ^ , »» v> ' ' •' ' a *' >, f'- \ r ■* * is #* ■ .. n 'K ^ XV 3TVX’ ■■i ■% t'' ■ T-. / .a- ■ '£■ a« .v * tB• f ; a' a :-w;' 1 M! : J • V ^ ’ •' ■ S ii 4 » 4^4•M v vnU :^3£'" ^ v .’'A It/-''-- V. - ;ii. : . - 4 '. ■ ti *%?'% fc ' i * ■ , fc ' THE CANADIAN PARLIAMENTARY GUIDE AND WORK OF GENERAL REFERENCE I9OI FOR CANADA, THE PROVINCES, AND NORTHWEST TERRITORIES (Published with the Patronage of The Parliament of Canada) Containing Election Returns, Eists and Sketches of Members, Cabinets of the U.K., U.S., and Canada, Governments and Eegisla- TURES OF ALL THE PROVINCES, Census Returns, Etc. -

W. S. Fielding and the Liberal Party in Nova Scotia, 1891 - 1896
K. M. McLaughlin W. S. Fielding and the Liberal Party in Nova Scotia, 1891 - 1896 Sir Richard Cartwright, Knight Commander of the Order of St. Michael and St. George, inveterate politician, ardent proponent of the policy of Unrestricted Reciprocity with the United States, was utterly despondent on learning the results of the election of 1891. Macdonald and the Conservatives remained on the benches of the Government side of the House. The National Policy so despised by Cartwright was still the law of the land. Victory had eluded the Liberals again. What so infuriated Cartwright was that Macdonald and the Conservatives had won their greatest support where Cartwright thought they ought to have been weakest — in the Maritime provinces. "The shreds and patches" of the nation, he fumed, had kept Sir John in power.1 Since Confederation Nova Scotians had been a puzzling enigma to the leaders of the Liberal party. Their special pleading in 1876 had moved Sir Richard Cartwright not to grant a significant increase in the tariff.2 Yet Nova Scotians voted overwhelmingly against the Liberal party in the elections of 1878, 1882 and 1887.3 Before the election in 1891, Nova Scotian Liberals assured their colleagues that the party would do well. Nova Scotia's Attorney- General, J. W. Longley, was quite confident of success. He believed that popular opinion supported the party's tariff policy and he had obtained money from the United States to finance the campaign, while the Conserv atives had less money than in previous elections. Even Sir Charles Tupper's return to Nova Scotia at the special behest of Sir John A. -

Geoffrey Bell Logbook 1909
T he Canadian POCKET DIARY 1909 PUBLISHED BY t h e B r o w n B r o s . LIMITED. MANUFACTURING STATIONERS . T O R O N T O . DOMINION OF CANADA Se a t o f Go v e r n m e n t —Ot t a w a . Ernest J. Lemaire, Chief Clerk and Private Secretary to Governor-General—His Excellency The Right Honourable Premier. Sir Arthur Henry George Earl Grey, Viscount Howick, High Commissioner for Canada in London—The Right Baron Grey of Howick, in the County of Northum Honourable Baron Strathcona and Mount Royal, G.C. berland, in the Peerage of the United Kingdom, and a M.G., LL.D. (Cantab.), 17 Victoria St., London, S.W. Baronet; Knight Grand Cross of the Most Distingui Sec’y., Can. Gov’t. Offices in London—W. J. Griffithe. shed Order of Saint Michael and Saint George, etc., etc. Asst. Secretary and Accountant—Arthur W. Reynolds. Staff.—Governor-General’s Secretary and Military Secre tary, Colonel J. Hanbury Williams, C.V.O., C.M.G.; DOMINION OF CANADA Aides-de-camp, Captain G. F. Trotter, D.S.O., Gren Formed of Ontario, Quebec, Nova Scotia and N.B. in 1867. adier Guards, Captain D. O. C. Newton, Duke of Manitoba and North-West Territories joined in 1870, Cambridge Own (Middlesex Regiment), Lieutenant British Columbia in 1871, Prince Edward Island in 1873. the Viscount Bury, Scots Guards; Comptroller of the The new Provinces of Alberta and Saskatchewan were Household, Major G. F. Paske, 3rd Oxfordshire Light created by special Act of Parliament, 1905. -

Fit for Purpose: Findings and Recommendations of the External Review of the Pan-Canadian Health Organizations
FIT FOR PURPOSE: FINDINGS AND RECOMMENDATIONS OF THE EXTERNAL REVIEW OF THE PAN-CANADIAN HEALTH ORGANIZATIONS Dr. Pierre-Gerlier Forest and Dr. Danielle Martin SUMMARY REPORT Fit for Purpose: Findings and Recommendations of the External Review of the Pan-Canadian Health Organizations Cat. No. H22-4/11-2018E-PDF Cat. No. H22-4/11-2018E (Print) ISBN 978-0-660-25782-2 (PDF) ISBN 978-0-660-25783-9 (Print) © 2018 by the External Review of the Pan-Canadian Health Organizations Disponible en français External Review of Pan-Canadian Health Organizations March 2018 The Honourable Ginette Petitpas Taylor Minister of Health Government of Canada Ottawa, ON Dear Minister, In fulfillment of our responsibilities as your expert advisors for the External Review of Pan-Canadian Health Organizations (PCHOs), please find attached our summary report. It reflects a thorough examination of the evidence and issues – and of our deliberations on them – as well as what we learned from submissions, commissioned research, and our consultation with health-care stakeholders from across the country. Thank you for choosing us for this work. We are honoured you put your trust in us, and hope that the resulting report helps guide your decisions around an intricate set of issues. This review comes at a propitious time in the history of health care in this country. From our consultations, it is clear that there is a consensus around the health system reforms required to bring 21st century health care to Canadians. The call to get on with this work came from all corners of the country and from all participants, regardless of their roles. -

Exploring the Trajectory of Housing Assistance Policies in Canada Jon
Exploring the Trajectory of Housing Assistance Policies in Canada | 135 Exploring the Trajectory of Housing Assistance Policies in Canada Jon Careless1 ABSTRACT, This article explores the degree to which changes in housing assistance policies (HAPs) reflect the structural shift from the welfare state era towards neoliberalism and financialization, as opposed to efforts concerning the right to shelter that have emerged in Canada between the mid-twentieth century and the housing surge of the 1990s and early-to-mid 2000s. My central argument is that the HAPs instituted by the Canadian state during the welfare state era were shown to garner limited legitimacy among policy-makers and served as an effective scapegoat for a state that came to shift the goals of HAPs towards purposes more explicitly associated with neoliberalism and financialization. To support this argument, I make the following claims that are informed by my empirical findings. Firstly, I show how Canada’s transition from the pre- 1980s welfare state era into the contemporary epoch of neoliberalism and financialization saw the state largely withdraw from providing HAPs in the form of public assistance. The twenty first century brought drastic cutbacks to social housing support through public resources. At the same time, I explain that HAP policies were diverted to ramp up the demand for homeownership and access to mortgages which primarily benefited lenders and investors involved in mortgage- backed securities. KEYWORDS: Housing Policy; Canada; CMHC; Neoliberalism; Financialization; Liberal-Welfare Regime 1 Jon Careless is currently a PhD candidate in the Department of Political Science at York University, with interests in Canadian housing policy, gentrification and theories of the state. -

Canada's Next Trade Battle
THIRTY-FIRST YEAR, NO. 1731 CANADA’S POLITICS AND GOVERNMENT NEWSPAPER WEDNESDAY, MAY 27, 2020 $5.00 News International trade Canada’s next trade battle: consensus building at the WTO A Global Affairs International Trade trade official told the Minister Mary House Committee on Ng says that reforming the International Trade in World Trade Organization March that Canada has cannot be done by the had little engagement Ottawa Group alone. The with the United States Hill Times on reforming the WTO photograph by Andrew Meade to date. BY NEIL MOSS s an embattled international Atrading system is further strained by some countries’ pro- tectionist instincts, the Canadian government continues to try to build consensus over needed Continued on page 12 Contending Tim with the Canada-U.S. Relations entertainment Powers economic hole p.10 policy briefing pp. 13-18 p.4 News Conservative leadership News COVID-19 & data News Economic recovery MacKay leadership camp Health agency reveals race- Unparalleled BoC bond purchasing touts strength in numbers based data guideline as calls grow for nation-wide collection welcomed to move country BY LAURA RYCKEWAERT Michael Diamond in a recent interview with The Hill Times. BY SAMANTHA WRIGHT ALLEN regardless of jurisdiction. That “We’re proud of the team, gap in information affects the from ‘defence ormer Progressive Conser- provincial, territorial, and federal vative leader Peter MacKay proud of the candidate for recruit- n response to calls for better de- Publications Mail Agreement #40068926 F ing a record-setting -

New Committee Likely to Cost More Than Any Other House Or Senate
TWENTY-EIGHTH YEAR, NO. 1401 CANADA’S POLITICS AND GOVERNMENT NEWSPAPER MONDAY, JANUARY 23, 2017 $5.00 It’s Hill No Who not my Climbers medals supports CTV’s David Taylor for now D. Comms to who party Justice Minister you! Wilson-Raybould Conservative Tom McMillan, p.10 Laura Ryckewaert, p. 20 Colin Kenny, p. 14 leadership p. 9 NEWS SECURITY OVERSIGHT COMMITTEE NEWS HARPER Harper fundraising role New committee likely appears unprecedented, expected to mobilize base BY LAURA RYCKEWAERT harper’s role as a board member for to cost more than any the Conservative Party’s fundraising Former prime ministers have arm appears unprecedented in helped out party fundraising other House or Senate efforts in the past, but Stephen Continued on page 18 NEWS ETHICS security committees Trudeau’s Aga Khan trip controversy ‘self-infl icted’ PR hit: MacKay The National Security Oversight Committee, which was promised BY RACHEL AIELLO who says he’s still scarred by his by the Liberals in the last election campaign, will be the fi rst of its own ordeal over the use of a Forc- Controversy over the use a es’ search-and-rescue helicopter private helicopter that has Prime on his way back from a personal kind in Canada. But opposition critics say it’s off to a rocky start. Minister Justin Trudeau in hot wa- stay at a fi shing lodge. ter with the ethics commissioner “your destination, your is a “self-infl icted” image hit, say purpose, who’s with you, and all critics such as Peter MacKay, the former Conservative minister Continued on page 16 NEWS OUELLETTE Rookie Liberal MP Ouellette walking, skiing 1,000 kilometres from Saskatchewan to Manitoba to send message of ‘greater unity’ BY ABBAS RANA order to send a message of hope, cooperation, and “greater unity” Rookie Manitoba indigenous for First Nations people. -

University Staff University Staff
www.ualberta.ca UNIVERSITY OF ALBERTA 1049 University Staff Staff University Adams, Kimberley D, BSEE MSc (Alberta), Assistant Professor of Rehabilitation Medicine (2005, 2005). University Staff Adeeb, Samer, BSc (Ain Shams), PhD (Calgary), Associate Professor of Civil and Environmental Engineering (2007, 2013). In Memoriam: Adesida, Adetola, BSc MSc (Essex), PhD (Manchester) Associate Professor of Surgery (2009, 2015). Adkin, Laurie E, BA (Saskatchewan), MA PhD (Queen’s), Associate Professor of Political Science Clark, Andrew K, BA BEd (Alberta), MEd (Manitoba), PhD (Alberta), Professor Emeritus of Industrial (1991, 1997). and Vocational Education (1967, 1986). Adolphson, Mikael S, BA (Lund), MA PhD (Stanford), Professor of East Asian Studies and Associate Chytracek, Mark, BA (Wisconsin), Director of Student and Residence Services in Augustana Faculty Dean of Teaching and Learning in the Faculty of Arts (2008, 2010). (2004, 2004). Afacan, Artin, BSc (Istanbul Technical), Faculty Service Officer of Chemical & Materials Engineering Donald, Elizabeth A, BSc (Alberta), MSc (Washington State), PhD (Cornell), Professor Emeritus of (2000, 2000). Foods and Nutrition (1969, 1988). Agrawal, Babita, BSc MSc (Allahabad), PhD (Alberta), Professor of Surgery (2001, 2013). Haddow, James Baird, BSc (St Andrews), MSc (Alberta), PhD (Manchester), Professor Emeritus of Agrawal, Sandeep K, BArch (India), MCP (Manitoba), PhD (Illinois), Professor and Director of the Mechanical Engineering (1955, 1988). Planning Program for Earth and Atmospheric Sciences (2013, 2013). Karpinski, Edward, BSc MEng PhD (Alberta), Professor Emeritus of Physiology (1967, 2004). Aguerrevere, Felipe L, BS (Simon Bolivar), MAdmin (IESA), PhD (California Los Angeles), Associate Lakey, William Hall, BSc MD (Alberta), FRCS(C), Professor Emeritus of Surgery (1960, 1993). Professor of Finance & Management Science (2000, 2008).