Form Janv 13CINEMAS EN AFRIQUE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
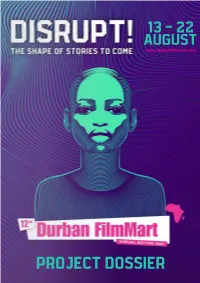
View the 2021 Project Dossier
www.durbanfilmmart.com Project Dossier Contents Message from the Chair 3 Combat de Nègre et de Chiens (Black Battle with Dogs) 50 introduction and Come Sunrise, We Shall Rule 52 welcome 4 Conversations with my Mother 54 Drummies 56 Partners and Sponsors 6 Forget Me Not 58 MENTORS 8 Frontier Mistress 60 Hamlet from the Slums 62 DFM Mentors 8 Professional Mourners 64 Talents Durban Mentors 10 Requiem of Ravel’s Boléro 66 Jumpstart Mentors 13 Sakan Lelmoghtrebat (A House For Expats) 68 OFFICAL DFM PROJECTS The Day and Night of Brahma 70 Documentaries 14 The Killing of A Beast 72 Defying Ashes 15 The Mailman, The Mantis, and The Moon 74 Doxandem, les chasseurs de rêves Pretty Hustle 76 (Dream Chasers) 17 Dusty & Stones 19 DFM Access 78 Eat Bitter 21 DFM Access Mentors 79 Ethel 23 PARTNER PROJECTS IN My Plastic Hair 25 FINANCE FORUM 80 Nzonzing 27 Hot Docs-Blue Ice Docs Part of the Pack 29 Fund Fellows 81 The Possessed Painter: In the Footsteps The Mother of All Lies 82 of Abbès Saladi 31 The Wall of Death 84 The Woman Who Poked The Leopard 33 What’s Eating My Mind 86 Time of Pandemics 35 Unfinished Journey 37 Talents Durban 88 Untitled: Miss Africa South 39 Feature Fiction: Bosryer (Bushrider) 89 Wataalat Loughatou él Kalami (Such a Silent Cry) 41 Rosa Baila! (Dance Rosa) 90 Windward 43 Kinafo 91 L’Aurore Boréale (The Northern Lights) 92 Fiction 45 The Path of Ruganzu Part 2 93 2065 46 Yvette 94 Akashinga 48 DURBAN FILMMART 1 PROJECT DOSSIER 2021 CONTENTS Short Fiction: Bedrock 129 Crisis 95 God’s Work 131 Mob Passion 96 Soweto on Fire 133 -

Banlieue Films Festival (BFF): Growing Cinephilia and Filmmaking in Senegal
Banlieue Films Festival (BFF): Growing cinephilia and filmmaking in Senegal Estrella Sendra SOAS, University of London and Winchester School of Art, University of Southampton [email protected] http://orcid.org/0000-0001-8344-2928 ABSTRACT This article examines small film festivals in the socio-cultural context of Senegal. Through the case study of the Banlieue Films Festival (BFF) in Dakar, founded in 2013 by Abdel Aziz Boye, I analyse the crucial role of festivals in strengthening the film industry, fostering cinephilia and encouraging the practical application of cultural policies. I suggest that contemporary film production, particularly, in the past five years (2015-2020) has been significantly shaped by grassroots initiatives that have eventually been transformed into structures. I also explore the role of “rooted cosmopolitans”, borrowing Kwame Appiah’s term in relation to the figure of Abdel Aziz Boye, who founded Cine UCAD at the Universite Cheikh Anta Diop, in Dakar, Cine Banlieue, and, upon returning to Senegal from France, the BFF. I discuss BFF’s various forms of legacy, concluding that it has been an active agent in forging a new cinephilia and inspiring a wave of young filmmakers in Senegal. KEYWORDS Banlieue Films Festival; Senegalese filmmaking; cinephilia; “rooted cosmopolitan”; film training; ethnography. Introduction Senegal enjoys an emblematic position in the history of African cinema. Following the increasing independence of African countries from French colonialism, Senegal became the home of pioneering filmmakers who would soon acquire international recognition, such as Ousmane Sembe ne (1923- 2007), Safi Faye (n. 1943), and Djibril Diop Mambe ty (1945-1998). These filmmakers sought to decolonise minds through the medium of film, and in doing so, to create a cinema from, by and for African people. -

Bronwen Pugsley
CHALLENGING PERSPECTIVES: DOCUMENTARY PRACTICES IN FILMS BY WOMEN FROM FRANCOPHONE AFRICA Bronwen Pugsley Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Nottingham, 2011 ABSTRACT This thesis is located at the intersection of three dynamic fields: African screen media, documentary studies, and women’s filmmaking. It analyses a corpus of fifteen films by Francophone sub-Saharan African women filmmakers, ranging from 1975 to 2009, within the framework of documentary theory. This study departs from the contextual approach to African women’s documentary, which has been predominant among scholarship and criticism thus far, in favour of a focus on the films as texts. The popular models developed for the study of documentary film by Western scholars are applied to African women’s documentaries in order to explore their innovative and stimulating practices; to determine the degree to which such models are fully adequate or, instead, are challenged, subverted, or exceeded by this new context of application; and to address the films’ wider implications regarding the documentary medium. Chapter One outlines the theoretical framework underpinning the thesis and engages with existing methodologies and conventions in documentary theory. Chapter Two considers women-centred committed documentary, analyses the ways in which these films uncover overlooked spaces and individuals, provide and promote new spaces for the enunciation of women’s subjectivity and ‘herstories’, and counter hegemonic stereotypical perceptions of African women. Chapter Three addresses recent works of autobiography, considers the filmmaking impulses and practices involved in filming the self, and points to the emergence of a filmmaking form situated on the boundary between ethnography and autobiography. -

Présentation D'africadoc
LE PROGRAMME AFRICADOC Des formations à la Cité documentaire de Saint-Louis, Sénégal Contacts : Dominique OLIER [email protected] - Aline ABT [email protected] www.docmonde.org LE PROJET POLITIQUE A travers ces actions, le "Village documentaire de Lussas" (France) porte des valeurs humanistes, fondées sur l’ouverture sur les autres cultures, la liberté d'expression et de création et des peuples. Dès son origine à la fin des années 70, Lussas s’est constitué comme un lieu de réflexion, de conception et de diffusion de ce qu’on nomme documentaire de création ou d’auteur. On ne peut aborder le documentaire sans l’inscrire dans ce que nous postulons être une véritable ligne anthropologique : celle qui relie les films de Chris Marker aux premières images de la Grotte Chauvet. Celle qui affirme que de tout temps, à travers les temps, les cultures, l’Histoire, les hommes ont eu recours au langage mais aussi à la représentation en « images » pour pouvoir se constituer comme sujets. Le film documentaire d’auteur en tant qu’œuvre de représentation du monde échappe aux images sensationnelles qui cultivent l’immédiateté et la sidération. Au contraire, il produit des images qui aident à penser, travaillent et nous travaillent sur le terrain de l’intelligence sensible. Il bouscule, questionne, intrigue, il donne à réfléchir sans livrer de conclusions préétablies en permettant d’accéder à d’autres représentations des réalités du monde. À notre époque où domine le « prêt à penser », il revendique sa posture radicale d’objet singulier, qui parle en son nom propre, invente sa forme pour tenter de déchiffrer quelque chose de la réalité en laissant le champ libre à l’interprétation. -

Mise En Page 1
ARTE PARTENAIRE DES 10E RENCONTRES TËNK DE SAINT-LOUIS Le Programme AFRICADOC, développé en France par l’association Ardèche Images, mène différents types d’actions visant à créer un réseau humain dans les domaines de la formation, de la réalisation, de la production et de la diffusion de films documentaires de création africains. AFRICADOC organise tous les ans au Sénégal depuis 2002, les Rencontres « Tënk » qui est l’un des rares rendez-vous professionnel de la coproduction documentaire en Afrique. Ce programme a permis en dix ans d’aider à l’écriture, puis à la production d’une centaine de films documentaires à travers une dizaine de pays. Les Rencontres « Tënk » de coproduction réunissent des professionnels africains et européens durant trois jours autour de la découverte de nouveaux projets de films documentaires africains. Ces projets ont préalablement été développés dans le cadre de résidences d’écriture coordonnées tout au long de l’année par AFRICADOC dans quatre à cinq pays d’Afrique. L’objectif est, qu’à l’issue de ces rencontres, la plupart des projets présentés aient trouvé des partenaires africains et européens qui les accompagnent dans leur processus de réalisation et de production. De ces rencontres de coproduction est né le désir de produire ensemble des documentaires qui sont par la suite réunis dans la collection LUMIÈRE D’AFRIQUE. Photo : Jean Latko, St-Louis 2010 [› L’Equipe Responsable du programme Africadoc : Jean-Marie Barbe Relations publiques : Maty Gueye Coordination des formations : Dominique -
Paris I Les Lilas Porto Novo Lomé Nov. 2015
FESTIVAL DES nouveaux Cinémas FNCD#5 documentaires#5 A 4 F 5 R 6 O 4 T 5 o 6 P 4 i 5 A 10 6 26 nov. 2015 Paris I les lilas porto novo lomé www.belleville-en-vues.org dans le cadre de du cinéma autrement 1 SOMMAIRE 4 ils nous soutiennent 4ils nous soutiennent p.3 4 Au cinéma, la représentation de la réalité des pays africains a longtemps été le fait édito p.4 exclusif des cinéastes occidentaux, le plus souvent français. Ousmane Sembène leur 4Programme artistique p.5 reprochait d’avoir enfermé le continent dans une vision essentialiste et de regarder les Africains « comme des insectes ». 4soirée évènement p.6 Depuis l’accession aux Indépendances, les cinéastes africains ont pu s’aventurer sur des chemins imaginaires inédits, et parfois créer leur propre réalité cinématographique. 4émergences p.7 4regards sur ishola akpo p.14 S’approprier les moyens techniques de faire, brouiller les frontières des genres pour mieux s’enchanter soi-même, déconstruire l’opposition fiction/documentaire, rechar- 4expanded cinema p.16 ger les capacités de l’oeil a être frappé par ce qui est étranger à l’habitude, pousser les personnages à se construire eux-mêmes pendant la réalisation d’un film... Les sentiers 4dérives écoutes radiophoniques p.19 d’un cinéma de liberté inauguré par Jean Rouch ne demandent qu’à fleurir. 4 talents en court rencontre pro - avec le cnc p.20 Le FNCD#5, en proposant un dialogue avec les villes et les cinémas du monde, nous 4table ronde p.21 propose de découvrir des oeuvres intimes et des regards sensibles portés sur les expé- riences d’un continent en mouvement que ni le champ des convoitises, ni les ravages 4tribute to kiripi katembo p.22 de la guerre ou l’étendue d’une prédation généralisée ne pourront réduire à néant. -
Nord-Pas-De-Calais Films Mdoc 2013 Couv Doc 2013 11/10/13 17:13 Pageii
films_Mdoc_2013_couv_doc_2013 11/10/13 17:13 PageI 14E édition www.moisdoc.com nord-pas-de-calais films_Mdoc_2013_couv_doc_2013 11/10/13 17:13 PageII _Le Mois du film documentaire est soutenu par : Centre National du Cinéma et de l’Image animée Ministère de la Culture et de la Communication (Service du Livre et de la Lecture ; Service de la Coordination des Politiques Culturelles et de l’Innovation ) Procirep SCAM - Action Culturelle Institut français _En région Nord-Pas de Calais, le Mois du film documentaire est soutenu par : Ministère de la Culture et de la Communication – direction régionale des affaires culturelles. _IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES 21, rue Curial – 75019 PARIS Marianne Palesse, déléguée générale Tél. 01.43.38.19.92 [email protected] _Coordination régionale HEURE EXQUISE ! Le Fort, rue de Normandie 59370 MONS-EN-BARŒUL Martine Dondeyne - Tél. 03.20.43.24.32 [email protected] _Programmation www.moisdudoc.com films_Mdoc_2013_Coorections_Films_docu_13 11/10/13 15:15 Page1 © D.R. > VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 Ouverture du Mois du Film Documentaire 2013 en région Nord-Pas de Calais STUDIO 43 Pôle Marine - Rue des Fusiliers Marins 59140 Dunkerque 03.28.66.47.89 - [email protected] Tarif 6 € / 4,80 € PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE RÉGIONALE > 20 H 30 LES JOURS HEUREUX « Quand l’utopie des résistants devint réalité » DE GILLES PERRET / FRANCE / 2013 / 1 H 37 Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis poli- tiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résis- tance vont changer durablement le visage de la France. -

Sous Le Parrainage De Marie-Noëlle HIMBERT
Association Africadoc Bénin 01BP360 Porto Novo +229 93805815/20215616 [email protected] www. africadocnetwork.com Sous le Parrainage de Marie-Noëlle HIMBERT LA FEMME À L’ÉPREUVE DES INÉGALITÉS…… AUTRES REGARDS Dossier de Presse de la 3ème Edition du Festival BeninDocs 2 La Marraine de BeninDocs 2015 Auteure de quatre essais, Marie-Noëlle HIMBERT est journaliste, réalisatrice de documentaire et scénariste. Elle a aussi publié quatre essais. Portée par une vision du monde où se conjuguent humanisme et réalisme, et convaincue que l’accès au savoir est un puissant outil égalitaire et démocratique, elle concentre son travail depuis quelques années sur de grands personnages de l’histoire des sciences : leurs découvertes ont permis de sauver des millions de vies, leur parcours personnel est porteur de valeurs. Après Pasteur, elle a coécrit pour France 2 le scénario de Marie Curie, une femme sur le front, et publié aux éditions Actes Sud Marie Curie, Portrait d’une femme engagée, 1914-1918. En parallèle de ses travaux personnels, elle intervient pour des sociétés de production en tant que script doctor sur des projets documentaires, afin d’aider des auteurs à faire émerger le film qu’ils portent en eux. « "Sois patiente et courageuse, et fais ce que tu peux là où tu te trouves maintenant". C’était il y a cent ans : la première guerre mondiale venait de commencer, Marie Curie écrivait à sa fille de 16 ans. Bientôt, ensemble, elles sillonneraient le front pour offrir aux blessés la radiologie qui allait sauver plus d’un million de vies. Aujourd’hui, dans notre monde troublé, ces mots d’une femme lumineuse ravivent notre espoir. -

AHONTO Kwami Etonam Jean Réalisateur Cinéastre Né Le 26 Octobre 1985 À Lome (Togo) Nationalité Togolaise S/C 08 BP : 80338
Appel à projets-Thrillers et Talents / Jean Etonam AHONTO AHONTO Kwami Etonam Jean Réalisateur Cinéastre Né le 26 Octobre 1985 à Lome (Togo) Nationalité Togolaise S/C 08 BP : 80338 Lomé-Togo/Djidjolé +228 90 84 93 63 / +228 97 91 99 33 [email protected] / [email protected] Etudes scolaires et Professionnelles Novembre 2017 : Formation en organisation d’un évènement culturel e dans les collectivités territoriales de l’Université Senghor d’Alexandrie en Egypte avec la collaboration de la Francophonie Octobre 2017 : Formation en production de films documentaires en prélude au FESDOB avec SAWADOGO Noraogo du Burkina Faso et Katell Paillard de la France Novembre-Décembre 2016 : Formation en production de film documentaire de création organisé par AFRICA DOC à Saint Louis au Sénégal Février 2015 : Formation en écriture et réalisation de films avec micro caméra (téléphone portable) à Ouagadougou organisé par Canal France International (CFI : coopération média) dans le cadre du festival FESPACO 2015 2012 – 2014 : CTMA (Certificat de Techniciens des Métiers de l’Audiovisuelles) : Formation en cinéma option réalisation à ECRAN : Ecole de Réalisations Audiovisuelles et des Nouvelles technologies Juin 2006- juin 2007 : Formation en infographiste Octobre 2005- juin 2007 : Faculté des sciences de gestion à l’université de Lomé Juillet 2005 : Baccalauréat en techniques commerciales et forces de vente Expériences Professionnelles Juillet 2017 : Equipe de réalisation pour le spot de sensibilisation du projet d’aménagement urbain du Togo (PAUT) Octobre 2017 : Membre du bureau exécutif du festival du film documentaire de Blitta (FESDOB) Depuis2015 à nos jours: Directeur de production des résidences de productions de KINO KABARET : rencontre internationale réunissant des jeunes venant de l’Afrique et de l’occident et s’achevant par la réalisation de courts métrages projetés à l’institut français de lomé. -

Francophonie & Cinéma Africain on Est Ensemble
FrancophonieFrancophonie && CinémaCinéma africainafricain OnOn estest ensembleensemble !! Sommaire Éditorial 5 Francophonie et Fespaco 6 Témoignages 11 Alain Gomis 12 Félicité Wouassi 13 Jean-Pierre Bekolo 14 JIhan El-Tahri 15 Les films soutenus par l’OIF au programme du Fespaco 17 Longs-métrages en compétition 18 Documentaires 21 Courts-métrages 30 Longs-métrages en section « Panorama » 32 Bilan du fonds d’aide de l’OIF 35 «Les rois de Ségou» sur un piédestal 39 «Invisibles», un succès historique 41 L’aventure de «L’œil du cyclone» 48 Maki’la, premier film et jeunes talents 49 ÉDITORIAL De la naissance à la maturité : fierté Le cinquantième anniversaire du Fespaco est un événement qui ne peut pas laisser la Francopho- nie indifférente. Tout d’abord parce que ce festival et l’organisation commune des pays francophones sont jumeaux. Ils ont beau avoir des dates de nais- sance différentes (comme beaucoup d’Africains de cette génération qui sont « nés vers »…), tous deux ont été conçus en février 1969. Avant de recevoir Le cinéma reflète la vie réelle des peuples mais son nom de baptême définitif, le Fespaco s’est aussi leurs espoirs et leurs rêves. Les cinémas afri- appelé « Semaine du cinéma africain de Ouaga- cains, dans leur diversité, ont su exprimer tout cela dougou ». Quant à la Francophonie, elle est née à naturellement et le Fespaco en a été le témoin, le Niamey d’une conférence des pays francophones, réceptacle, la caisse de résonance. Et c’est pour- avant d’être baptisée Agence de coopération cultu- quoi le sentiment qui domine aujourd’hui n’est pas relle et technique, puis Agence Intergouvernemen- la nostalgie ou l’attendrissement mais plutôt la fier- tale de la Francophonie et, enfin, Organisation in- té. -

Mise En Page 1
Le Programme AFRICADOC, développé en France par l’association Ardèche Images, mène différents types d’actions visant à créer un réseau humain dans les domaines de la formation, de la réalisation, de la production et de la diffusion de films documentaires de création africains. AFRICADOC organise tous les ans au Sénégal depuis 2002, les Rencontres « Tënk » qui est l’un des rares rendez-vous professionnel de la coproduction documentaire en Afrique. Ce programme a permis en plus de huit ans d’aider à l’écriture, puis à la production d’une cinquantaine de films documentaires à travers une dizaine de pays. Les Rencontres « Tënk » de coproduction réunissent des professionnels africains et européens durant trois jours autour de la découverte de nouveaux projets de films documentaires africains. Ces projets ont préalablement été développés dans le cadre de résidences d’écriture coordonnées tout au long de l’année par AFRICADOC dans quatre à cinq pays d’Afrique. L’objectif est, qu’à l’issue de ces rencontres, la plupart des projets présentés aient trouvé des partenaires africains et européens qui les accompagnent dans leur processus de réalisation et de production. De ces rencontres de coproduction est né le désir de produire ensemble des documentaires qui sont par la suite réunis dans la collection LUMIÈRE D’AFRIQUE. Equipe et contacts [› L’Equipe Responsable du programme Africadoc: Jean-Marie Barbe Relations publiques: Maty Gueye Coordination des activitées: Sophie Marzec, Dominique Olier, et Marie-Louise Sarr Régie générale: Gora Seck Assistants Régie: Sega Ba, Massamba Diongue Relations de Presse: Mame Woury Thioubou Administration: Marie Tortosa, Brigitte Avot Photos: Anne-Jo Brigaud [› L’Hôtel Mermoz [› Ardèche Images | Africadoc Espace officiel des rencontres 2011 Le Village 07170 Lussas, France Langue de Barbarie | Hydrobase Tel. -

Catalog Stlouis2014 Mise En Page 1
3 SOMMAIRE Les Projections . 5 Sélection Officielle Longs Métrages . 7 Sélection officielle Moyens et Courts Métrages . 19 Focus Cinéastes . 29 Classics Docs . 33 Séances Spéciales . 37 Urban Docs . 41 Des formations aux Rencontres professionelles . 45 Les Résidences d'Ecriture . 47 Africadoc Production . 55 Les 12ème Rencontres Tënk de coproduction . 61 De la production à la diffusion . 77 Africadoc c’est aussi . 83 Le Master de Saint-Louis . 85 Le Réseau Africadoc . 89 © photo de couverture : Alain-Paul Mallard 4 DES RENCONTRES TËNK DE COPRODUCTION, AU « FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE DE SAINT-LOUIS » Après 12 ans d’existence, le programme dérouler les 12e rencontres Tënk de copro- Africadoc présente le Festival du film docu- ductions équitables qui devraient, une nou- mentaire de Saint-Louis, du 1er au 6 décembre velle fois, permettre la coproduction d'au 2014. moins une quinzaine de nouveaux films. Des Un événement qui est le développement di- projets développés dans le cadre de rési- rect des rencontres professionnelles qui de dences d’écriture organisées cette année par Gorée à Saint-Louis, ont permis la mise en pro- le réseau Africadoc en Côte d’Ivoire, au Tchad, duction de près d’une centaine de films doc- au Mali, au Maroc et au Burkina Faso. umentaires africains. Des rencontres qui au fil De la diffusion des œuvres en direction d'un du temps, ont permis d’accompagner et de public le plus large possible au renforcement renforcer l’émergence d’un tissu professionnel de la production, cet évènement artistique, de jeunes cinéastes et producteurs indépen- économique et intellectuel majeur autour du dants africains.