Chapitre C. Analyse De L'etat Initial Et Des Enjeux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'accompagnement De Vos Territoires
L’accompagnement de vos territoires RELATION ADHÉRENTS ARCHITECTURE/PAYSAGE/URBANISME SERVICES NUMÉRIQUES SERVICE JURIDIQUE/AMF86/FORMATION DES ÉLUS Architecte Julien Secheresse AJSA -Photographe : Maud Piderit, Focalpix adriers - amberre - anche - angles-sur-l’anglin - angliers - antigny - an- tran - arcay - archigny - aslonnes - asnieres-sur-blour - asnois - aulnay - availles limouzine - availles-en-chatellerault - avan- ton - ayron - basses - beaumont saint cyr - bellefonds - berrie - ber- the- gon - beruges - bethines - beuxes - biard - bignoux - blanzay - boivre-la-vallee - bonnes - bonneuil-matours - bouresse - bourg-archambault - bournand - brigueil-le-chantre - brion - brux - buxerolles - buxeuil - ceaux-en-loudun - celle-l’evescault - cenon- sur-vienne - cernay - chabournay - chalais - chalandray - champagne- le-sec - champagne-saint-hilaire - champigny en rochereau - champniers - charroux - chasseneuil-du-poitou - chatain - chateau-garnier - chateau-larcher - chatellerault - chaunay - chauvigny - chenevelles - cherves - chire-en-montreuil - chouppes - cisse - civaux - civray - cloue - colombiers - valence-en-poitou - cou- lombiers - coulonges - coussay - coussay-les-bois - craon - croutelle - cuhon - cur- cay-sur-dive - curzay sur vonne - dange-saint-romain - derce - dienne - dissay - doussay - fleix - fleure - fontaine-le-comte - frozes - gencay - genouille - gizay - glenouze - gouex - guesnes - haims - ingrandes - iteuil - jardres - jaunay-marigny - jazeneuil - jouhet - journet - jousse - la bussiere - la chapelle viviers -

Pj N°5 Capacités Techniques Et Financières Cdc Civraisien En Poitou
Capacités techniques et financières Capacités techniques Dans le cadre de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes des Pays Civraisien et Charlois a fusionne, la Communauté de Communes de la Région de Couhé et la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou ont fusionné, au 1 er janvier 2017, pour former la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (40 communes, environ 28 000 habitants). Sur ce nouveau territoire la gestion de la compétence "déchet" (collecte et traitement) est différente suivant les anciennes communautés de communes ainsi que le mode de financement : - la CC des Pays Civraisien et Charlois a transféré ses compétences collecte et traitement au SIMER, - la CC de la Région de Couhé a transféré sa compétence traitement au SIMER, la gestion de la collecte est confiée au SIMER via un marché de prestation (jusqu’au 1er février 2021) mais la compétence est restée communautaire, - la CC du Pays Gencéen a conservé ses compétences traitement et collecte et dans ce cadre elle a conventionné avec les différents organismes. Communes composant la Communauté de Anché, Asnois, Blanzay, Brion, Brux , Champagné le Sec, Communes du Civraisien en Poitou Champagné St-Hilaire, Champniers, Chapelle-Bâton, Charroux, (au 1 e janvier 2017) Châtain, Château-Garnier, Chaunay, Civray, Ferrère-Airoux, Gençay, Genouillé, Joussé, Linazay, Lizant, Magné, Payroux, Romagne,St-Gaudent, St-Macoux, St-Maurice la Clouère, St-Pierre d’Exideuil, St-Romain, St-Saviol, St-Secondin , Savigné, Sommières du Clain, Surin, Valence en Poitou ( Ceaux en Couhé, Chatillon, Couhé, Payré, Vaux en Couhé), Voulème, Voulon Infrastructures gérées par la Communauté − Territoire ex CC Région de Couhé de Communes du Civraisien en Poitou , − Déchèterie principale de Couhé (objet de la présente étude) et relatives à la gestion des déchets (nature, déchèterie de Chaunay . -

Vienne2 Liste Des Communes Rattachées À Chaque Centre De Mise
Centre de mise à disposition CIVRAY Centre d’intervention du SDIS Place du 8 mai 1945 86 400 CIVRAY - MAGNE - AVAILLES LIMOUSINE - MAUPREVOIR - BLANZAY - MOUTERRE SUR BLOURDE - CHAMPAGNE SAINT HILAIRE - PAYROUX - CHATEAU-GARNIER - PRESSAC - CHARROUX - ROMAGNE - CHAUNAY - SAINT GAUDENT - CIVRAY - SAINT MAURICE LA - COUHE CLOUERE - GENCAY - SAVIGNE - JOUSSE - SOMMIERE-DU-CLAIN - L’ISLE JOURDAIN - USSON -DU -POITOU - LIZANT Centre de mise à disposition MONTMORILLON Centre d’intervention du SDIS 58 rue des Clavières 86 500 MONTMORILLON - LUSSAC LES CHATEAUX - ADRIERS - MONTMORILLON - BETHINES - PERSAC - BONNES - SAINT GERMAIN - BRIGUEIL LE CHANTRE - SAINT SAVIN - CIVAUX - SILLARS - CHAUVIGNY - VALDIVIENNE - LATHUS - VERRIERES - LA TRIMOUILLE - LE VIGEANT Centre de mise à disposition LOUDUN Centre d’intervention du SDIS 3 Avenue de Ouagadougou 86 200 LOUDUN - COUSSAY LES BOIS - MONT SUR GUESNES - LES TROIS MOUTIERS - SAINT JEAN DE SAUVES - LOUDUN - SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS - MONCONTOUR 1 Centre de mise à disposition de CHÂTELLERAULT Centre d’intervention du SDIS 14 rue Raymond Pitet 86 100 CHÂTELLRAULT - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - LENCLOÎTRE - ARCHIGNY - LESIGNY - AVAILLES en CHÂTELLERAULT - LES ORMES - BEAUMONT - NAINTRE - BONNEUIL-MATOURS - PLEUMARTIN - BUXEUIL - SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS - CENON-SUR-VIENNE - SAINT PIERRE DE MAILLE - CHÂTELLERAULT - SCORBE-CLAIRVAUX - CHENECHE - SOSSAY - DANGE SAINT ROMAIN - TARGE - DISSAY - THURE - INGRANDES - USSEAU - LA ROCHE POSAY - VICQ SUR GARTEMPE - LA PUYE - VOUNEUIL SUR VIENNE Centre de mise -

Magazine D'informations De La Communauté De Communes Des
Territoires / Économie / Santé / Loisirs & Tourisme Charlaisienle N°01 Magazine d’informations de la Communauté JUIN 2014 de Communes des Pays Civraisien & Charlois Asnois • Blanzay • Champagné-le-Sec • Champniers • Charroux Chatain • Civray • Genouillé • Joussé • La Chapelle-Bâton Linazay • Lizant • Payroux • Savigné • St-Gaudent • St-Macoux St-Pierre-d’Exideuil • St-Romain • St-Saviol • Surin • Voulême Edito Ensemble et solidaires Depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle collectivité a été créée en Sud Vienne, la Communauté de Communes des Pays Civraisien et Charlois, fruit du rapprochement de deux territoires complémentaires, le Civraisien et le Charlois, dans le cadre de la réforme de l’intercommunalité votée à l’Assemblée Nationale en décembre 2010. Votre bulletin d’information porte donc un nouveau nom, « le Charlaisien », et ce premier numéro comporte plus d’informations que de reportages, afin de vous présenter les acteurs, les compétences et les orientations de votre collectivité. La fusion des deux communautés s’est faite de manière réfléchie et concertée sur plusieurs années, et je tiens à remercier tous les élus qui ont contribué à sa réussite. Votre nouvelle Communauté de Communes est désormais en ordre de marche. Ses 11 commissions sont au travail, malgré un contexte national difficile et de nombreuses interrogations sur le périmètre des territoires et les moyens qu’ils auront à leur dispo- sition dans l’avenir. Nous sommes tous très attachés à la démocratie de proximité et plus que jamais nous souhaitons rester à l’écoute et solidaires, dans le respect de la population et du terri- toire. Aussi, la Communauté de Communes continuera de travailler à un développement harmonieux et équilibré au service des communes et de leurs habitants, l’amélioration de notre cadre de vie étant une priorité absolue. -

Commune De SAINT BARBANT
E-mail : [email protected] DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE Commune de SAINT BARBANT Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de SAINT BARBANT. Autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Parc éolien de SAINT BARBANT. Maîtrise d’ouvrage : S.A.S. ENERGIE SAINT BARBANT RAPPORT D’ENQUETE ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE Messieurs Clarisse ROUGIER (Président) Michel GUILLEN Frédéric GISCLARD Septembre 2018 – Octobre 2018 – Novembre 2018 A Rapport d’enquête B Conclusions et avis C Documents constituant le dossier D Pièces jointes Parc éolien de SAINT BARBANT – Novembre 2018 Vendredi 16 novembre 2018 1 SOMMAIRE A. RAPPORT D’ENQUETE ....................................................................................................................6 I. Généralités .................................................................................................................................6 1.1. Objet de l’enquête ...............................................................................................................6 1.2. Cadre juridique ....................................................................................................................6 II. Description du projet ..................................................................................................................8 2.1. Le projet lui-même ...............................................................................................................8 -

Chateau-Garnier, Infos
Décembre 2014 Les enfants de Château- Le Comité d’Echanges Garnier nous racontent leurs Culturels et de Jumelage a activités périscolaires fêté ses 35 ans... A lire en page 9 A lire en page 56 CHATEAU-GARNIER, INFOS. Château-Garnier et ses belles fontaines... Le Petit Chabanne Le Grand Brizard Couture Le Grand Brizard 1 Décembre 2014 LE MOT DU MAIRE C‘est toujours avec beaucoup de plaisir évocateur de cet état d’esprit, tout comme vous pourrez le constater dans ce «que je viens vous présenter notre bulletin comme la scission en deux de notre an- bulletin, 2014 est une année où notre municipal qui retrace la vie de notre com- cien canton (et par là même de notre commune a encore su faire preuve de mune au cours de l’année écoulée. Communauté de Communes). Où est le dynamisme, tant au niveau de ses réali- bon sens, la pertinence de ces mesures, la sations (Salle Semailles au Vent, Salle des 2014 a été tout d’abord marquée par les concertation avec les élus ? Cela ne Fêtes, mise en place des rythmes sco- élections municipales et je vous remercie laisse présager rien de bon pour l’avenir, laires...) qu’au niveau de ses animations à nouveau pour la confiance que vous notamment en ce qui concerne le pro- (Foire de Château-Garnier, rencontres du nous avez témoignée. chain regroupement de nos Communau- Jumelage…) et de ses associations. 2014, c’est aussi la mise en place pro- tés de Communes et tout simplement Je vous laisse le soin de découvrir tout gressive de la réforme territoriale dans pour nos communes rurales. -

Répar on Des Agences Territoriales Et Des Centres D'exploita
Répar��on des Agences Territoriales et des Centres d'Exploita�on Agence de Neuville-de-Poitou Centre de Loudun Viennopôle 29 rue des Aubuies 86200 Loudun Saix Centre de Vaux-sur-Vienne Pouançay Roiffé [email protected] Raslay 37 Godet Morton Tel. 05 49 22 96 84 Vézières Beuxes Saint-Léger 86220 Vaux-sur-Vienne de Mbr. Marçay Les Trois Bournand (37) [email protected] Berrie Mou�ers Agence de Châtellerault Basses Tel. 05 49 93 04 48 Ternay Sammarçolles Ceaux-en Loudun Curçay Glénouze Pouant Loudun Messemé Ranton Mouterre Silly Port-de-Piles Centre de Châtellerault Nueil Saint Chalais Maulay Laon La Roche sous-Faye Rigault 8 rue Marcel Dassault Arçay Buxeuil 86100 Châtellerault Angliers Les Ormes Dercé Mondion Vellèches Martaizé Prinçay Saint-Rémy Sérigny Saint [email protected] Monts-sur Christophe Dangé sur-Creuse Leigné Guesnes Guesnes Saint-Romain Aulnay sur-Usseau Tel. 05 49 93 31 16 Berthegon Saint-Gervais Vaux Moncontour les-Trois-Clochers Saint-Clair La Chaussée Saires Leugny Orches Ingrandes Usseau Verrue Savigny Antran Marnes sous-Faye 79 (79) Sossay Oyré Doussay Mairé Centre de Saint-Savin Saint Saint-Jean-de-Sauves Coussay Chartres Cernay Saint-Genest Thuré Lésigny d'Ambière Châtellerault Route de Béthines La Grimaudière Chouppes Scorbé Coussay-les-Bois 86310 Saint-Germain Mazeuil Lencloître Clairvaux Mirebeau Senillé [email protected] Craon Thurageau Centre de Amberre Ouzilly Colombiers Saint-Sauveur Cuhon Naintré La Roche Tel. 05 49 48 16 48 Posay Massognes Availles Leigné Neuville-de-Poitou Cenon en-Ch. les-Bois Maisonneuve Saint-Mar�n-La-Pallu Beaumont Monthoiron Pleumar�n 11 rue de l'Outarde canepe�ère Champigny Saint-Cyr en-Rochereau Chenevelles Vicq-sur-Gartempe Vouzailles Vouneuil-sur-Vienne 86170 Neuville-de-Poitou Chabournay Cherves Neuville-de-P. -

Répar on Des Agences Territoriales Et Des Centres D'exploita
Répar��on des Agences Territoriales et des Centres d'Exploita�on Agence de Neuville-de-Poitou Centre de Loudun Viennopôle 29 rue des Aubuies 86200 Loudun Saix Centre de Vaux-sur-Vienne Pouançay Roiffé [email protected] Raslay 37 Godet Morton Tel. 05 49 22 96 84 Vézières Beuxes Saint-Léger 86220 Vaux-sur-Vienne de Mbr. Marçay Les Trois Bournand (37) [email protected] Berrie Mou�ers Agence de Châtellerault Basses Tel. 05 49 93 04 48 Ternay Sammarçolles Ceaux-en Loudun Curçay Glénouze Pouant Loudun Messemé Ranton Mouterre Silly Port-de-Piles Centre de Châtellerault Nueil Saint Chalais Maulay Laon La Roche sous-Faye Rigault 8 rue Marcel Dassault Arçay Buxeuil 86100 Châtellerault Angliers Les Ormes Dercé Mondion Vellèches Martaizé Prinçay Saint-Rémy Sérigny Saint [email protected] Monts-sur Christophe Dangé sur-Creuse Leigné Guesnes Guesnes Saint-Romain Aulnay sur-Usseau Tel. 05 49 93 31 16 Berthegon Saint-Gervais Vaux Moncontour les-Trois-Clochers Saint-Clair La Chaussée Saires Leugny Orches Ingrandes Usseau Verrue Savigny Antran Marnes sous-Faye 79 (79) Sossay Oyré Doussay Mairé Centre de Saint-Savin Saint Saint-Jean-de-Sauves Coussay Chartres Cernay Saint-Genest Thuré Lésigny d'Ambière Châtellerault Route de Béthines La Grimaudière Chouppes Scorbé Coussay-les-Bois 86310 Saint-Germain Mazeuil Lencloître Clairvaux Mirebeau Senillé [email protected] Craon Thurageau Centre de Amberre Ouzilly Colombiers Saint-Sauveur Naintré Cuhon Varennes La Roche Tel. 05 49 48 16 48 Posay Massognes Availles Leigné Neuville-de-Poitou Cenon en-Ch. les-Bois Maisonneuve Saint-Mar�n-La-Pallu Beaumont Monthoiron Pleumar�n 11 rue de l'Outarde canepe�ère Champigny Saint-Cyr en-Rochereau Chenevelles Vicq-sur-Gartempe 86170 Neuville-de-Poitou Vouzailles Chabournay Vouneuil-sur-Vienne Cherves Neuville-de-P. -
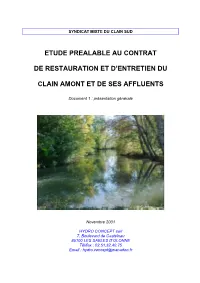
Presentation Generale Etude H
SYNDICAT MIXTE DU CLAIN SUD ETUDE PREALABLE AU CONTRAT DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DU CLAIN AMONT ET DE SES AFFLUENTS Document 1 : présentation générale Novembre 2001 HYDRO CONCEPT sarl 7, Boulevard de Castelnau 85100 LES SABLES D’OLONNE Tél/fax : 02.51.32.40.75 Email : [email protected] HYDRO CONCEPT 2001 SOMMAIRE PRESENTATION GENERALE DU BASSIN VERSANT DU SYNDICAT MIXTE DU CLAIN SUD .................................................................................................................................................... 3 1- La situation géographique et le périmètre de l’étude ................................................................ 4 2- Les données climatiques ........................................................................................................ 5 3- Géologie – Hydrogéologie - Tectonique ................................................................................. 5 4- Unités topographiques et réseau hydrographique du bassin versant ........................................... 7 5- Hydraulique des cours d’eau du bassin versant........................................................................ 8 6- La qualité des eaux des cours d’eau du bassin versant ............................................................ 10 7- La population du bassin versant ........................................................................................... 12 8- Le traitement des eaux usées et les autres types de pollutions ................................................. 13 9- Les activités humaines -

Circonscription De Montmorillon Sud Vienne
Circonscription de Montmorillon Sud Vienne IEN : Turi Laure Référents DDEN : Jacques ROLIN - Françoise BARC - Mireille COIRIER-SENAMAUD COMMUNE NOM DE L'ECOLE TYPE NOM - PRENOM ADRIERS "François Albert" PRIM SARRASIN Bernard AVAILLES-LIMOUZINE PRIM DEBIAIS Jean - Jacques BETHINES Béthines / Haims RPI ROLIN Jacques BLANZAY Blanzay / Champniers RPI PRICART Pascale BONNES PRIM BOURESSE PRIM BARC Françoise CHAMPNIERS Champniers / Blanzay RPI PRICART Pascale CHAPELLE-VIVIERS (LA) La Chapelle - Viviers / Leignes - sur - Fontaine RPI CHARROUX Pôle Educatif PRIM SOUBIROUS Colette CHÂTEAU - GARNIER PRIM HEBRAS Françoise CHAUVIGNY "Les Guiraudières" PRIM DUPUY Danielle CHAUVIGNY "Varenne" MAT PUISAIS Marie-Danielle CHAUVIGNY "Jean Arnault " ELEM PUISAIS Marie-Danielle CHAUVIGNY "Villeneuve" ELEM CIVAUX "Paul Cézanne" PRIM CIVRAY Pôle Educatif PRIM COIRIER - SENAMAUD Mireille DIENNÉ "Louise et Albert Violette" PRIM JEAN Bernard FLEIX Fleix / Paizay - le - Sec RPI FESSARD Nicolas GOUEX Gouex / Persac / Queaux RPI HAIMS Haims / Bethines RPI ROLIN Jacques ISLE-JOURDAIN (L') PRIM JEAMET Pierre JARDRES Jardres / Pouillé / Tercé RPI JOUHET PRIM MINIER Christine LATHUS-SAINT-REMY "Abel Thévenet" PRIM BAUDOIN Bénédicte LEIGNES-SUR-FONTAINE Leignes - sur - Fontaine / La Chapelle - Viviers RPI LHOMMAIZE PRIM FLOQUET Elsa - Esperanza LIZANT Lizant / Voulême RPI DUQUERROIR Eliane LUSSAC-LES-CHATEAUX ELEM RULLIER Pierre LUSSAC-LES-CHATEAUX "Jean Rostand" MAT DECHELLE Didier MAUPRÉVOIR Mauprévoir / Pressac RPI FRADET Françoise MAZEROLLES PRIM COMBEAUD Roland -

Cahiers Du Patrimoine Naturel
Les Cahiers du patrimoine naturel Le Pays civraisien BOCAGE et PLAINES PRAIRIES HUMIDES RIVIÈRES et FORÊTS ALLUVIALES MARES BOIS et LANDES Sommaire Présentation du Pays.......................... 3 Depuis plus de 40 ans, les naturalistes parcourent le Bocage et plaines................................ 4 département dans ses moindres recoins pour en dresser l'inventaire du patrimoine naturel. Prairies humides................................. 5 Afin de valoriser l’importante collection de données Rivières et forêts alluviales................. 6 récoltées au fil de leurs différentes missions, Vienne Mares.................................................. 8 Nature, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne, a décidé de publier un bilan Bois et landes..................................... 9 des connaissances pour chaque pays du département sous la forme de Cahiers du patrimoine naturel. Zones d'intérêt majeur...................... 1 0 Enjeux sur le territoire.......................1 2 Cette synthèse se veut un outil pour l’élaboration de la trame verte et bleue dans la gestion durable du Espèces patrimoniales....................... 1 4 territoire et a aussi pour but de sensibiliser élus et grand public qui sont responsables de la conservation Conclusion générale.......................... 1 5 d’espaces et d'espèces phares du département. Le CR-Rom joint contient (au format PDF), le cahier, la liste complète et détaillée des espèces patrimoniales, l'ensemble des textes réglementaires ainsi que les fiches descriptives des différents sites qui présentent un intérêt patrimonial sur le Pays. 2 Cahiers du patrimoine naturel • Pays civraisien Présentation du Pays Caractérisé par ses célèbres terres rouges à châtaigniers, le Pays civraisien occupe l'extrême sud-ouest du département de la Vienne. C’est le seul secteur du département qui Pays d'élevage il y a encore quelques décennies, s’étende sur deux bassins versants différents, le Civraisien a été progressivement converti en celui de la Vienne et celui de la Charente. -

Mouvement Départemental 2020
Mouvement départemental 2020 ANNEXE 8 - Les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (R.P.I) et les Pôles Educatifs Territoriaux du département de la Vienne Liste sous réserve de l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale 2020 DPE 5 - Bureau du premier degré Circonscription R.P.I BLANZAY – CHAMPNIERS PAYROUX - SAINT ROMAIN - CHAPELLE BATON* – JOUSSE* ST MACOUX - ST SAVIOL – ST PIERRE D’EXIDEUIL - LINAZAY* LIZANT – VOULEME Montmorillon, Sud MAUPREVOIR - PRESSAC Vienne ANGLES SUR L'ANGLIN (circonscription de Châtellerault) - ST PIERRE DE MAILLE BETHINES - HAIMS – VILLEMORT* CHAPELLE VIVIERS - LEIGNES SUR FONTAINE FLEIX - PAIZAY LE SEC - STE RADEGONDE* - LAUTHIERS* GOUEX - PERSAC - QUEAUX JARDRES - POUILLE – TERCE AYRON - CHALANDRAY – MAILLÉ LEIGNE SUR USSEAU - USSEAU - VELLECHES - MONDION* MOUTERRE-SILLY - RANTON* – ST LAON - GLENOUZE* BEUXES – MESSEME* - SAMMARCOLLES Lencloître, Nord Vienne BOURNAND - VEZIERES CHERVES - CUHON - VOUZAILLES - MAISONNEUVE* - MASSOGNES* DOUSSAY - ORCHES - SAVIGNY-SOUS-FAYE MAZEUIL - LA GRIMAUDIERE (VERGER SUR DIVE) – CRAON* MORTON - ROIFFE - SAIX COUSSAY LES BOIS - LEIGNE LES BOIS Châtellerault LESIGNY - BARROU (37) - MAIRE* LEUGNY - ST REMY SUR CREUSE CHENEVELLES (Châtellerault) – MONTHOIRON (Châtellerault) Poitiers Nord LA CHAPELLE MOULIERE - LAVOUX (Poitiers Est) – LINIERS (Poitiers Est) CHATEAU-LARCHER - MARNAY CURZAY-SUR-VONNE - SANXAY - JAZENEUIL Poitiers Sud GIZAY - VERNON CLOUE – CELLE L’EVESCAULT En rouge, RPI sur plusieurs circonscriptions. * commune sans école Circonscription R.P.I concentrés CEAUX EN LOUDUN - MAULAY – POUANT - NUEIL-SOUS-FAYE - LA ROCHE-RIGAULT MONTS-SUR-GUESNES - BERTHEGON - DERCE - GUESNES - PRINCAY - SAIRES - Lencloître, Nord VERRUE Vienne ST LEGER DE MONTBRILLAIS - BERRIE - POUANCAY - TERNAY LES TROIS MOUTIERS - CURCAY-SUR-DIVE RASLAY CHAUNAY - CHAMPAGNE LE SEC ( 2 ECOLES A CHAUNAY, MATERNELLE ET Poitiers Sud ELEMENTAIRE) En gras, les communes d'implantation de l'école Circonscriptions Pôle Educatif Territoriaux L'ISLE JOURDAIN : exercice dans les locaux du collège.